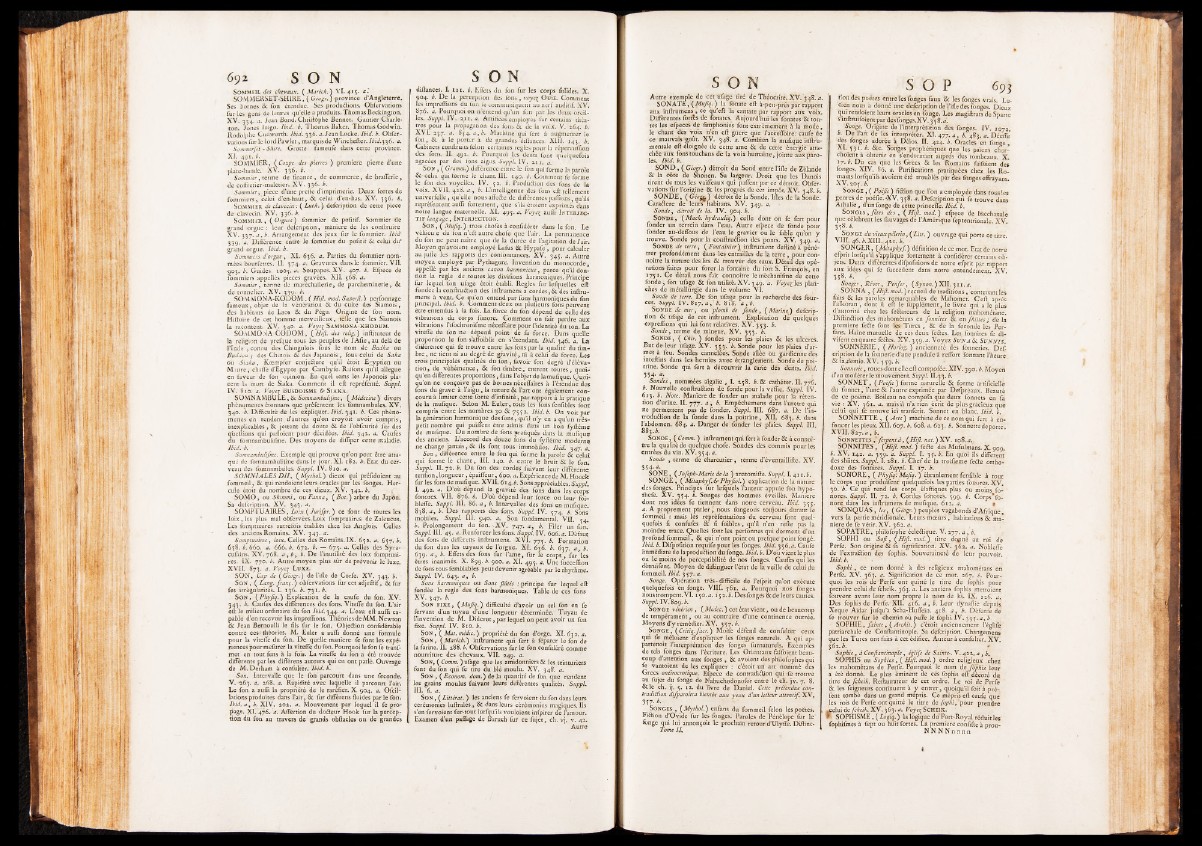
, s I : -i' i: h
, ; . ! i
692 S O N SON
Sommeil du chevaux. ( Mtrich.) V I. 41 ç. a.
SÜUMERSET-SHiRii;, ) province d’Angleterre.
Ses bornes ôc Ion étendue. Ses produdions. üblervations
furies geii3 de lettres tju'elk a produits. Thom.nsBockington.
X V . 334. a. Jean Bond. Cluidophe Bennct. Gautier Cbarle-
ton. Jones Inigo. Ihid. b. Thomas Baker. Thomas Godwin.
Rodolj)he Ctulwonh. Ibid. 336. u. Jean Locke. Ibid. b. Oblcr-
vations fur le lord Pawlet, marquis de V ’ incheAer. Ibid.'^■ ^6. a.
Som’n:rfec - dhin. Grotte lameufe dans cette province.
XI. 491. b.
SOM MIER, (^Coupe de.< pierres ) premiere pierre d’une
plate-bande. X V . 336. b.
Sommier, terme de finance, de commerce, de braflcric,
de cürtVetier-maletier. X V . 336. b.
Sommier, piece d'une prelle d'imprimerie. Deux fortes de
foniiniers, celui d'en-haut, & celui d'en-bas. X V . 336. b.
So.M.MiEU de clavecin : Luth.) defeription de cctic piece
de clavecin. X V . 336. b.
SûM.MitR, (^Orgues) fommicr de pofitif. Sommier de
grand oi'guo : leur defeription, manic-re de les conllriiire
X V . 337. a , b. Ariangemcm des jeux fur le fommier. Ibid'
339. a. Différence entre le fommier du pofuit Ck celui du*
grand orgue. Ibid. b.
Scmm'.crs d'orgue , XI. 636. a. Parties du fommier nommées
bourfettes. II. 374. a. Gravures dans le lommicr. V i l.
903. b. Guides. 1003. u. Soupapes. X V . 407. b. Efpece de
fommiers appelles pieces gravées. XII. 568. a.
Sommier, terme de maréchailerie, de parcheminerie, &
de tonnelier. X V . 339. b.
SO.M:ViÜNA-KOüOM , ( Hiß. mod. Superß. ) perfonnage
fameux, objet de la vénération ik du culte des Siamois,
des habitans de Laos ik du Pégu. Origine de fon nom.
Hiltoire de cet homme merveilleux, telle que les Siamois
la racontent. X V . 34O a. SamMONA-KHODUM.
SO.UM O.vA C O D O M , {H iß . dts reiig.) inflituteur de
la religion de pref.|ue tous les peuples de l'A fie , au delà de
rinde , connu des Chmgulois fous le nom de Budha ou
Bud.iou ; des Cltiiioi» 6c des Japonois , fous celui de Saka
ou Siaka, Kcempter conjeélure qu’il étoit Égyptien ou
M .u r e , chnffé d’Egypte par Cainbyfe. R.iil'ons qu’il allégué
en faveur de fon opinion. En quel rems les Japonois placent
la mort de Siaka. Comment il eft repréfenté. Suppl.
IV. 810. J. Voye^ Busdoisme 6* SiAKASOMN
A.MBULE, 6c Somnambuüjme, ( Médecine ) divers
phénomènes étonnans que préfentein les fomnambules. X V .
340. b. Diftîcuicé de les expliquer. Ibid. 341. b. Ces phénomènes
en rendent d’antres qu’on croyoit avoir compris,
inexplicables 3, 6c jettent du doute 6c de l’obEtiirité fur des üeltions qui p.iffoient pour décidées. Ibid. 342. a. Caufes
n fomnambulifme. Des moyens de difliper cette maladie.
Ibid. b.
Somnambulifinc. Exemple qui prouve qu’on peut être attaqué
de fomnambulifme dans le jour. XI. 182. b. Etat du cerveau
des fomnambules. Suppl. IV. 810. a.
SOM N Iâ LES D U , {Myehol.) dieux qui préfidoient au
fommeil, 8c qui rendoient leurs oracles par les fonges. Hercule
éioit du nombre de ces dieux. X V . 342. b.
SOM O , ou Sktmmi, oaFanna, {B o t.) zrhxe du Japon.
Sa defeription. X V . 343. <1.
SOM PTU A IR E S , Loix {Jurifpr.) ce font de routes les
loiXjles plus mal obfervées.Loix fomptuaires de Zaleucus.
Les fomptuaires autrefois établies chez les Anglois. Celles
des anciens Romains. X V . 343. a.
Somptuaires , /oi*. Celles des Romains. IX. 652. a. 657. b.
638. b. 660. a. 666. b. 672. b. — 673. a. Celles des Syra-
eufains. X V . 768. a , b , b. De l’inutilité des loix fomptuaires.
IX. 770. b. Autre moyen plus sûr de prévenir le luxe.
XVII . 873. a. Voyei LUX£.
S O N , C.ip de {Géogr.) de l’ifle de Corfe. XV. 343. b.
S on , ( Lang. fr.trtç. ) obfervations fur cet adjeftif, 6c fur
fes irrégularités. I. 136. b. 731 .^.
So n , {P hy ßq .) Explication de la caiife du fon. X V .
343. b, Caufes des différences des fons. Vîtefle du fon. L’air
eii le milieu ordinaire du fon Ibid. 344. a. L’eau eff aufli capable
d’en recevoir les imprefiions. Théories deMM. Newton
6c Jean Bernoulli le fils fur le fon. Objeôion confidérable
contre ces diéories. M. Euler a aufft donné une formule
pour la vîtelTe du fon. D e quelle maniéré fe font les expériences
pour mefurer la viteffe du fon. Pourquoi le fon fe tranf-
met en tout fens à la fois. La viceffe du fon a été trouvée
différente par les différens auteurs qui en ont parlé. Ouvrage
de M. Derham à confulcer. Ibid. b.
Son. Intervalle que le fon parcourt dans une fécondé.
V . 263. a. 268. a. Rapidité avec laquelle il parcourt l’air.
Le fon a aufli la propriété de le raréfier. X. 904. a, Ofcil-
lacions produites dans l’air, 8c fur différens fluides par le fon.
Ibid, a , b. X IV . 202. a. Mouvement par lequel il fe propage.
XI. 476. a. Affertion du doéleur Hook fur la perception
du fon au travers de grands obftacles ou de grandes
dillanccs. I. n i . b. Erlcts du fon fur les corps Iblides. X.
904. b. D e la percepuon dc> ions , O uïe. Comment
les impreflions du ion le >.omiminiqucnt ;ui nerf auditif. X V ,
876. a. Pourquoi on ii'cmend qu'un Ion p.ar les iluix oreilles.
Suppl. IV . 2^11. a. Amiices employes iur certains théâtres
pour la proi}.igation des fon^ de de la voix. V. 264. b.
X V I . 237. a. 854. d ,b. Macliiiie qui fort à augmenter le
fo n , 6c à le porter à de grandes diffances. X I ll. 143. b.
Cabinets conllruiis ielon certaines regies pour I.1 réperciiluon
des fous. IL 492. b. Pourquoi les dents font quelquefois
agacées par des Ions aigus. 6'.ïpp/. IV. 211. a.
Son , ( Gr.imm.) différence encre le fen qui forme la parole
8c celui qui forme le citant, l i l . 140. b. Comment fc forme
le fon des voyelles. IV. 32. b. Produélion des fons de la
voix. X VU . 428. a , b. L’intelligence duS fons off tellement
iiniverfeüe, quelle nousaffeéle de d.ff'érentes pallions, qu’ils
repréfcntenc aulfi fortement, que s’ils étoient exprimés dans
notre langue maternelle. XL 495. m Fuye^ aulit iNTr^RjEC-
TW lang.tjge, INTERJECTION.
S o n , { Mujiq.) trois choies à confidérer dans le fon. Le
véhicu e du ion n’d l autre chofe que l’air, La jrermanenca
du fon no peut naître que de la durée de l’agitation de l’air.
Moyen qu'avoienc employé Lafus 6c Hypafe , pour calculer
au julle les rapports des conlonnances. X V . 345. d. Autre
moyen employé par Pyiliagore. Invention du monocorde,
appelle par les anciens canon hannonicus, parce qu’il don-
noit la regie de toutes les divifions harmoniques. Principe
fur lequel fon ufage étoit établi. Regies fur lefqiielles eff
fondée la conilruition des inffriimens a cordes,6c des inftrit-
mens à vent. C e qu’on entend par fons harmoniques du fon
principal. Ibid. b. Comment deux ou plufieurs fons peuvent
être entendus à la fois. La force du fon dépend de celle des
vibrations du corps fonore. Comment on fait perdre aux
vibrations rifochronifme néceffaire pour l ’identité du ton. La
vitefl'e du Ion ne dépend point de fa force. Dans quelle
proportion le fon s’affbiblit en s’étendant. Ibid. 346. a. La
différence qui fe trouve entre les Ions par la qualité du timbre
, ne tient ni au degré de gravité, ni à celui de force. Les
trois principales qualités du fo n , favoir fon degré d’élévation,
de véhémence, 6c fon timbre, entrent toutes, quoi-
qu’en différentes proportions, dans l’objet de lamufique. Quoiqu’on
ne conçoive pas de bornes néceffaires à l’étendue des
fons du grave à l’aigu , la nature 8c l’art ont également concouru
à limiter cette forte d’infinité , par rapport à la pratique
d e là mufique. Selon M. Eu le r , tous les fons fenfibles font
compris entre les nombres 30 8c 7352. Ibid. b. On voit par
la génération harmonique des fons, qu’il n’y en a qu’im très-
petit nombre qui puiffent être admis dans un bon fyffêrac
de mufique. Du nombre de fons j*ratiqucs dans la mufique
des anciens. L ’accord des douze fons du fyffême moderne
ne change jamais, 6c Us font tous immobiles. Ibid. 347.
Son , différence entre le fon qui forme la parole 8c celui
qui forme le chant, iU. 140. b. entre le bruit & le fon.
Suppl. II. 72. b. Du fon des cordes fuivant leur différente
tenfion, longueur, épaifiéur, 600. <1. Expérience de M.Hoocfc
fur les fons de mufique. X V i l, 614. b. Sons appréciables. Suppl.
I. 492. a. D ’où dépend la gravité des fons dans les corps
fonores. VII. 876. b. D ’où dépend leur force ou leur fol-
blelTe. Suppl. 111. 86. a , b. Intervalles des fons en mufique.
838. a, b. Des rapports des fons. Suppl. IV . 374. h. Sons
mobiles. Suppl. 111. 940. a. Son fondamental. VII. 34,
b. Prolongement dii fbn. sX V . 747. n , b. Filer un fon,
Suppl. l i l . 45. Renforcer les fons. Suppl. IV . 606. a. Défaut
des fons de différens inftrumens. X V I . 773. b. Formation
du fon dans les tuyaux de l’orgue. XI. 636. b. 637. a , b.
639. a , b. Effets des fons fur l’ame, fur le corps, fur^les
êtres inanimés. X. 899. b. 900. a. XI. 493. a. Une fncceffion
de fons tous femblables peut devenir agréable par le rhythrae.
Suppl. IV. 643. a , b.
Sons harmoniques ou Sons fliités : principe fur lequel eff
fondée la regie des fons harmoniques. Table de ces fons
X V . 347. b.
Son FIXE, {Mufiq.) difficulté d’avoir un tel fon en fe
fervant d’un tuyau d’une longueur déterminée. Tu yau de
l’invention de M. Diderot, par lequel on peut avoir un fon
fixe. Suppl. IV. 810. é.
Son , ( Mat. médic. ) propriété du fon d’orge. XI. 63 2. a.
Son, {Maréch.) inffrument qui fert à féparer le fon de
la farine. II. 288. b. Obfervations fur le fon confidéré comme
nourriture des chevaux. V II . 249. a.
Son, ( Comm. ) ufage que les amidonniers 8c les teinturiers
font du fon qui fe tire du blé moulu. XV. 348. a.
Son , ( Econom. dom. ) de la quantité de fon que rendent
les grains moulus fuiyant leurs différentes qualités. Suppl.
III. 6. a.
Son , ( Littéral. ) les anciens fe fervoient du fon dans leurs
ceremonies hiftrales, 8c dans leurs cérémonies magiques. Ils
s’en fervoient fur-tout lorfqii’ils vouioienc infpircr de l’amour.
Examen d’un paffage de Baruch fur ce fujec, ch. vj. t-. 42.
Autre
SON
Antre exemple de cet ufage tiré de TJtéocrirc. X V . 348. a.
SO N A T E , ( AJ«/?-/.) la fonatc eff à-pen-près par r.apporc
aux inffnimens, ce qu’eff la cantate par rapport aux voix.
Différentes fortbs de fonates. Aiijourd'Jiui les fonates 8c toutes
les efpeces de ftmphonies font extrêmement à la mode ,
le chant des voix n’en cft gucre que l’acceflbire; caufe de
ce mauvais goût. X V . 348. a. Combien la mufique inftrii-
mcmale eff éloignée de cette ame 8c de cette énergie attachée
aux fonstouchans de la voix humaine, jointe aux paroles.
Ibid. h.
SO N D , ( Géogr.) détroit du Sond entre l’iffe de Zélande
Sc la côte de Shonen. Sa largeur. Droit que les Danois
tirent de tous les vaifleaux qui paffent par ce détroit. Obfer-
vaiions fur l’origine 8c les progrès de cct impôt. X V . 348. b.
S O N D E , ( Géoÿ^ ) détroit de la Sonde. Ifles de la Sonde.
Caraélere de leurs habitans. X V . 349. a.
Sonde, détroit de la. IV . 904. b.
Sonde, {Macb. hydrauliq.) celle dont on fe fert pour
fonder un terrein dans l’eau. Autre efpece de fonde pour
fonder au-deflbns de l’eau le gravier ou le fable qu’on y
trouve. Sonde pour la conftruélion des ponts. X V . 349. a.
Sonde de terre, {Fontainier) in finiment deffiné à pénétrer
profondément dans les entrailles de la terre , pour con-
noître la nature des lits Sc trouver des eaux. Détail des opérations
faites pour forer la fontaine du fort S. François, en
17 51. C e détail nous fait connoître le méchanifmc de cette
fonde , fon ufage 8c fon utilité. X V . 349. a. Voye^ les plan-
clies de métallurgie dans le volume VI.
Sonde de terre. D e fon ufage pour la recherche des foiir-
ces. Suppl. IV . 8 17. 8 i8. a , b.
Sonde de mer, on plomb de fonde, {Marine^) defeription
& ufage de cet inffrument. Explication de quelques
CxprefTions qui lui font relatives. X V . 333. b.
Sonde, terme de mineur. X V . 333. b.
Sonde, ( Chir. ) fondes pour les plaies 8c les ulcérés.
But de leur ufage. X V . 333. é. Sonde pour les plaies d’armes
à feu. Sondes cannelées. Sonde ailée ou gardienne des
inteftins dans les hernies avec étranglement. Sonde de poitrine.
Sonde qui fert à découvrir la carie des dents, Ibid.
334-
Sondes, nommées algalie , I. 238. b. 8c cathéter. II. 776.
h. Nouvelle conffruélion de fonde pour la veflie. Suppl. IV.
613. b. Note. Maniéré de fonder un malade pour la rétention
d’urine. II. 777 . a , b. Empêchemens dans l’uretre qui
ne permettent pas de fonder. Suppl. III. 687. a. D e l’in-
troduflion de la fonde dans la poitrine, XII. 683. b. dans
l ’abdomen. 684. a. Danger de fonder les plaies. Suppl. III
883.^.
Sonde , ( Comm. ) inffrument qui fert à fonder 8c à connoître
la qualité de quelque chofe. Sondes des commis pour les
entrées du ’ r à .X V . , , , , . . .
Sonde , terme de charcutier, terme d’éventailllffe. XV.
3 3 4 .-Z.
S O N E , {Jofeph-Marie de la ) anatomiffe. I .4 i i .é .
S O N G E , {Méiapliyf.ô- P kyfol.) explication de la nature
des fonges. Principes fur lefquels l’auteur appuie fon hypo-
ihefe. X V . 334. b. Songes des hommes éveillés. Maniéré
dont nos idées fe tiennent dans notre cerveau. Ibid. 333.
a. A proprement parler, nous fongeoiis toujours durant le
fommeil : mais les repréfentations du cerveau fon: quelquefois
fi confufes 8c fi foibles, qu’il n’en reffe pas la
moindre trace. Quelles font les perfonnes qui dorment d’un
profond fommeil, & qui n’ont point ou prefque point fongé.
Ibid. b. Difpofition requife pour les fonges. Ibid. 336.<j. Caufe
immédiate de la produaion du fonge. Ibid. b. D ’où vient le plus
Ou le moins de perceptibilité de nos fonges. Caufes qui les
détruifent. Moyen de diffinguer l’état de la veille de celui dn
fommeil. Jéit/. 337. a.
Songe. Opération très-difficile de l’efprit qu’on exécute
quelquefois en fonge. V I lI . 361. a. Pourquoi nos fonges
nous trompent. V I . 130. *j. 152.^. Des fonges 8c de leurs caules.
Suppl. IV. 809. h.
Songe vénérien, (jVfêt/ffc. ) cet é ta tv ient, ou de beaucoup
de tempérameilt, ou au contraire d’une continence outrée.
Moyens d’y remédier. X V . 337. é.
Songe, {Critiq.facr.) Moile défend de confulter ceux
qui fe mêloient d’expliquer les fonges naturels. A qui ap-
partenoit l’interprétation des fonges furnaturels. Exemples
de tels fonges dans l’écriture. Les Orientaux faifoient beaucoup
d’attention aux fonges , 6c avoient des philofophes qui
fe v.antoient de les expliquer ; c’étoit un art nommé des
Grecs onéirocrotique. Efpece de contradifUon qui fe trouve
au fujet du fonge de Nabiichodonofor entre le ch. jv . 7. 8.
8c le ch. ij. 3. 12. du livre de Daniel. Cette prétendue eûn-
tradi6lion difparoîtra bientôt aux yeux d'un kÜcur attentif. X V .
337. b.
Songes , {Mythol.) enftms du fommeil félon les poètes.
Fiftion d’Ovide fur les fonges. Paroles de Pénélope fur le
fcnge qui lui annonçoit le prochain retour d’Ulyffe. Diffinc-
Tome II,
S O P 693
tion des poètes entre les fonges faux 6c les fonges vrais. Lucien
nous a donné une defeription de l’ifle des fonges. Dieux
qui rendoient leurs oracles en fonge. Les magiffrats de Sparte
s’inffruifoient par des Ibnges.XV. 3 38.J.
■ ^nge. Origine de l’interprétation des fonges. IV . 1072.
b. D e l’art de les interpréter. XI. 477. ^ , b. 483. DéeiTe
des fonges adorée à Délos. II. 424. b. Oracles en fonge ,
XI. 331. b. 8cc. Songes prophétiques que les païens cher-
clioient à obtenir en s’endormant auprès des tombeaux. X.
17. é. Du cas que les Grecs 8c les Romains faifoient'des
fonges. XIV. 86. a. Purifications pratiquées chez les Romains
lorfqu'ils avoient été troublés par des fonges effrayans.
XV, 203. b.
Songe , ( Poe/?r) fiffionque l’on a employée dans tousies
genres de poéfie. -XV. 3 38. a. Defeription qui fe trouve dans
Aihalie , d’un fonge de cette princeffe. Ibid. b.
Songes J des , {H iß . mod.) efpece de bacchanale
que célèbrent les fauvages de l’Amérique feptentrionalc. X V .
3 38. b.
Songe du vieux pèlerin, {L in , ) ouvrage qui porte ce titre
VIII. 46. é. XIII. 421. b.
SO N G ER , {Mitaphyf) définition de ce mot. Etat de notre
efprit lorfqu’il s’applique fortement à confidérer certains objets.
Deux differentes difpofitions de notre efprit par rapport
aux idées qui fe fucccdenc dans notre entendement. XV.
338. b.
Songer , Rêver, Penfer, {Synon. ) XII. 3 1 1.
SO N N A , ( Hiß. mod. ) recueil de traditions, contenant les
faits 8c les paroles remarquables de Mahomet. C e ff après
l’aikoran , dont il eff le lupplément, le livre qui a le plus
d’aiitoritè chez les fcélateurs de la religion inahomérane.
Diftinélion des mahométans en fonnites & en fhUtes ; d e là
première fefte font les Turcs , 8c. de la fécondé les Per-
fans. Haine mutuelle de ces deux feéles. Les fonnites fe di-
vifenten quatre fefles. X V . 3 39. V o y e z S u n a 8c S u n n i s .
SONNERIE , ( Horlog. ) ancienneté des fonneries. Def-
cripiion de la fonnerie d'une pendule à rcflbrt fonnanc l’heure
& laxleniie. X V . 3 59. é.
Sonnerie, roues dont elle eff compofée. X IV . 390. b. Moyen
d’en modérer le mouvement. Suppl. II. 3 3. é.
SO N N E T , {P û é fe ) forme naturelle Sc forme artificielle
du fonhet, l’une Sc l’autre exprimée par Defpréaux. Beauté
de ce poème. Boileau ne compoîa que deux fonnets en fa
vie : X V . 361. a. mais il n’a rien écrit de plus gracieux que
celui qui le trouve ici tranferit. Sonnet en blanc. Ibid. b.
SO N N E T T E , ( Arts ) machine de ce nom qui Eri à enfoncer
les pieux. X II. 607. b. 608. <2. 623. b. Sonnette déporté
X V I I . 827.<2, é.
Sonnettes , ferpentà, {Hiß. nat.) X V . loS.a.
SONNITES , {Hiß. mod. ) feéle des Mufiilmans. X. 909.
b. XV. 142. a. 339. a. Suppl. I. 33. b. En quoi ils different
des shiites. Suppl. 1. 281. b. C h e f de la troifieme feiffe orthodoxe
des fonnites. Suppl. 1. 17. b.
SO N O R E , {Phyßq: Mufiq.) ébranlement fenCble à tout
le corps que produifent quelquefois les parties foiîures. X V .
30. b. Ce qui rend les corps èlaftiques plus ou moins fonores.
Suppl. II. 72. b. Cordes fonores. 599. b. Co rps'fo-
nore dans les inffrumens de mufique. 612. .1. t
S O N Q U A S , tes, {Géogr.) peuples vagabonds d’Afriqu e,
vers la partie méridionale. Leurs moeurs , habitations Sc maniéré
de fe vêtir. X V . 362. a.
SO P A T R E , philofophe ccleélique. V . 277. a , b.
SOPHI ou S o fi, {H iß . mod.) titre dc^né au roî de
Perfe. Son origine 8c fa fignification. X V . 36a. a. NobleiTe
de i’extraélion des fophis. Souveraineté de leur pouvoir
Ibid. b. ■
Soplti , ce nom donné à des religieux ntahométans en
Perfe. X V . 363. a. Signification de ce mot. 267. b. Pourquoi
les rois de Perfe ont quitté le titre de fophis pour
prendre celui etc feheik. 36}. a. Les anciens fophis mectoient
loiivent avant leur nom propre le nom de ki. IX. 126. a.
Des fophis de Perfe. X ll. 416. a , b. Leur dynaffie depuis
Xeqtie Aidar jufqu'à Sclia-Hufl'ein. 4:8. a , b. Défentê de
fe trouver fur le chemin où palTe le fophi. IV. 393. <2, b
SOPHIE , fainte, {Archit.) c’étoit anciennement l’églùe
patriarchale de Conftantinople. Sa defeription. Changemens
que les Turcs ont faits à cet édifice. Auteur à confulter, X V .
362. é.
Sophie , à Conßantinople, églife de Sainte-. V. 422. a ,b .
SOPHIS ou Sophées, { Hiß. mod.) ordre religieux chez
les mahométans de Perfe. Pourquoi le nom de fophis leur
a été donné. Le plus éminent de ces fophis eff décoré du
titre de feheik. Reffanrateur de cet ordre. Le roi de Perfe
8c les feigneurs continuent à y entrer, quoiqu’il foit à pié-
fent tombé dans un grand mépris. C e mépris eff caufe que
les rois de Perfe ont quitté le titre de fophi, pour prendre
jCelui de feheik. X V . 363. J. Voye^ SCHEIK.
* SOPHISME , ( Logiq.) la logique du Port-Royal réduit les
fophifines à fept ou huit forces. La première confiffe à prou-
N N N N n n n n