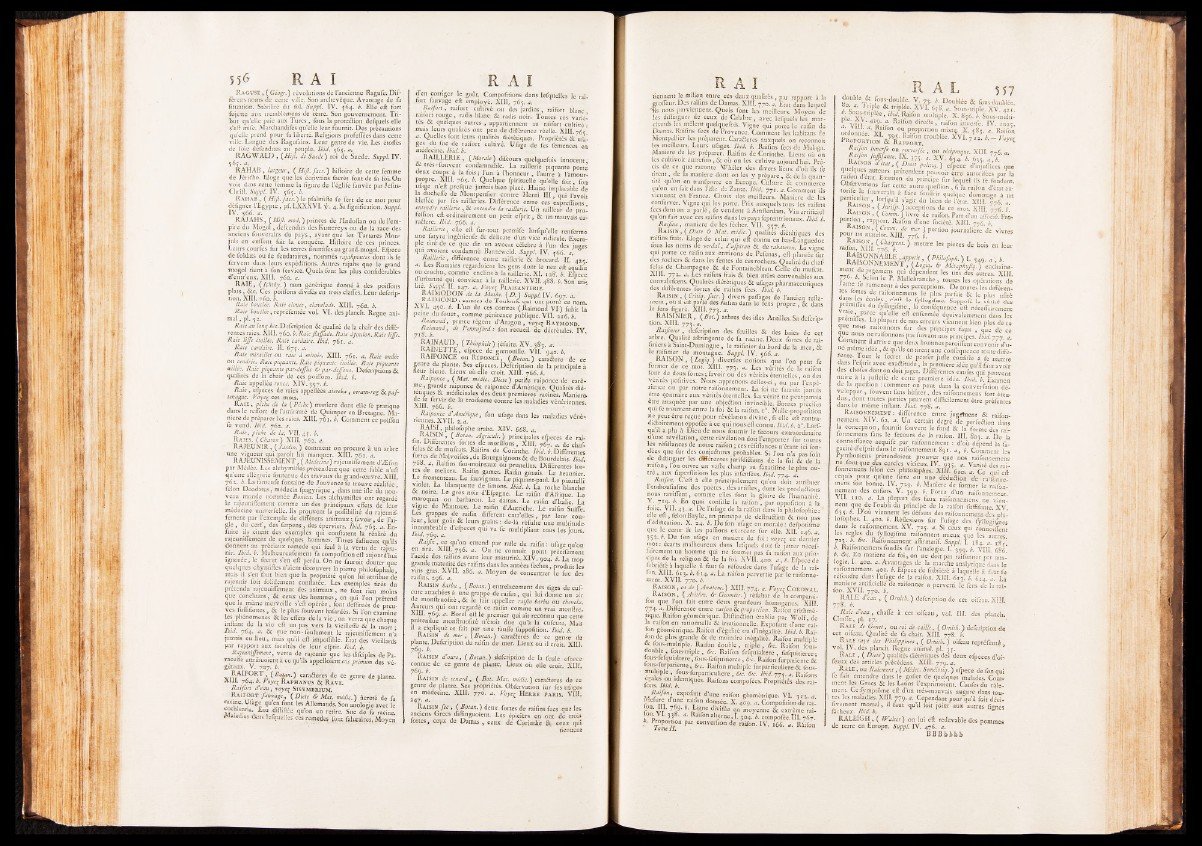
5 5 6 R A î R A I
! I
li 1
;iii
. ♦
R a g USE , (Gca^r, ) Involutions de l'ancienne Ragufc. DiT-
fèrens noms de ccae vilie. Son archevêque. Avantage de fa
fituanon. Stérilité du fol. Suppl. IV . 564. b. Elle ell fort
fujcttc aux tremblenicns de terre. Son gouvernement. T ribut
qu’elle paie aux T u r c s , fous laproceclion defquels elle
s’cR inife. Marchandilcs qu'elle leur tournir. Des précautions
q iitlic prend pour la liberté. Religions profelTécs dans cette
ville. Langue des Ragufiins. Leur genre de vie. Les ctofl'es
de foie déiendues au peuple. IhiJ. 565. n.
K A GW A LD , {Hiß. de Sucd-i) roi de Suede. Suppl.lW.
565. U.
RAHAR , Lirgeur, {Hiß.j'acr.') hiftoire de cette femme
de Jéridio. Eloge que les écrivains facrés font de lit foi. On
voit d.ms cette femme la figure de l’églife fauvée par Jefus-
C.'hrifl, Suppl. IV. ^65. b.
R a i î a b , {H ijl.Jjcr.') le pfalmiAe fe fert de ce mot pour
défigner l’E g yp te, p f.L X X X V I . f . 4 .Safignificarion. Suppl.
IV . 566. a.
RAJ.M-IS, {Hiß. mod.) |)rinces de l’Indofi an ou de l’empire
du M o gu l, defeendus des Kuttereys ou de la race des
anciens fouverains du p a y s , avant que les Tartares Mon-
juls en eulTeiu tait la conquête. HiHoire de ces princes.
Lettrs courfes fur les terres foumifesau grand-mogol. Efpece
de foldais ou de feudataircs, nommés r.ij.ilipoutcs dont ils fe
lervciu dans leurs expéditions. Autres rajahs que le grand
iiiogol tient à fon fervice. Quels font les plus confidérables
d’entr'eux. XIII. 760. u.
R A IE , {Ichthy.) nom générique donné à des poiflbns
plats, & c. Ces poilfons divifés en trois claiTes.Leur deferio-
rion. XIII. 760. é. ^
li.ue bouclée. R.iie clouée, cljvelude. XIII. 760. b.
/ i j ’c fo.vcA^,repréfemée vol. VI. des planch. Regne anim
a l, pi. 52.
K.ue ,m lon^ bec. Defeription & qualité de la chair des diffé-
rentes raies. XÜI. 760. b. Raie ß.iß'aJe. Raie à foulon. Raie lUTc.
Raie liße étoilé:. R.iie cardait e. ibiJ. 761. a.
Raie cardaire. IL 675. a.
Raie mir.iillet ou r.ùe à miroir, XIII. 761. a. Raie ondée
ou cendrée. Raie pupi.inte. R.üe pi.juante étoilée. Raie piquante
eeillce. R.iie piquante par-deß'us & par-dcjfous. Deferiptions &
qualités de la chair de ces poilTons. Ibid. b.
Rate appellee ronce. X IV . 35-. b.
Rate, efpeces de raies appellees lenagiie. Voye:^ aiereba , ceram-rog & paf- ces mots.
R a i e , pèche de la {Pèche) maniéré dont elle fe pratique
dans le rclfort de l’amirauté de Quimper en Bretagne. Manière
de préparer les raies. XIII. 761 . b. Comment ce poilfon
fe vend. !bid. 762. a.
R.tie, pêche de la. VIL 45. b.
R a ie s . {Charon) XIII. 762. a.
R A JEU NIR, ( Jardin. ) comment on procure à un arbre
une vigueur qui paroît lui manquer. XIII. 762. a.
RAJEUNISSE.viENT, ( Médecine) rajeunilfemcnt d’Æfon
par .Médée. Les alchymifies prétendent que cette fable n’efi
tyu’une allégorie foutemie des travaux du grand-oeuvre. X III.
7Ö2. b. La fameufe fontaine de Jouvence fe trouve réaliféc ,
felon Dcodatus, medecm fpagyrique , dans une ille du nouveau
monde nommée Bonica. Les alchymilles ont regardé
le rajeunKfement comme un des principaux effets de leur
médecine unlverfelle. Ils ]>rouvent la poflibilité du rajeunif-
fement par l’exemple de différens animaux 5 favo ir, de l’aigle
, du c e r f, des ferpens, des éperviers. Ibid. 7Ö3. a. En-
fuite ils citent des exemples qui conftatent la réalité du
rajeunilTement de quelques hommes. Titres faffueux qu’ils
donnent au précieux remede qui feul à la vertu de rajeunir.
Ibid. h. Malheureufement fa compofition eft aujourd’hui
Ignorée, le fecret s’en eff perdu. On ne fauroit douter que
quelques^ chy^milles n aient découvert la pierre philofophale,
mais il s’en faut bien que la propriété qu’on lui attribue de
r.i]eiimr foit fohdement conffatéc. Les exemples tirés du
pretendu rajcuniffement des animaux , ne font rien moins
que concluans, & ceux des hommes, en qui l’on prétend
que la même merveille s’eff opérée, font dellitués de preuves
iuffilantes, & le plus fouvent hafardés. Si l’on examine
les phenomenes & les effets de la v ie , on verra que cliaque
inltanr oe la vie eft un pas vers la vieillcffe & la mort •
Jhid. ^64. a. & que non-feulement le rajcuniffement n’a
jamais eu h eu, mais qu'il eff impoffible. Etat des vieillards
par rapport aux facultés de leur cfprit. Ibid. b.
Rajyumjfement, vertu de rajeunir que les difciples de Pa-
racelfc attribuoieut à ce qu’ils appelloiem ens prïmum des v é gétaux.
V . 707. b.
cafiifteres cio ce genre de plante.
A l lL 764. b. Voyei R a ph aNUS & R a v E.
R .„ fin J-cu , voye:(_ SlSYMBRIUM.
R a ifo r t fauvage, {Dicte O Mac. médic.) âcreté de fa
MCine. ^lage qu’en font les Allemands. Son anologie avec le
^chl.ana . Eau dillillée qu’on en retire. Suc de fa racine.
dans lefqiiedes ces remèdes font falutaires, Moyen
den corriger le goût. Conmofitions dans lefqucllcs le rai
fort fauvage cfl employé. XIII, 763.,;.
Raifort, raifort culiivé ou des jardin.s , raifort bl.nnc
railorc rouge , radis bhme & radis noir. Toutes ces variétés
ik quelques autres , appartiennent au raifort cultivé -
mais leurs qualités ont peu de différence réelle. XIII. yC<.
a. Quelles loin leurs qualités diététiques. Propriétés & ufa-
ges du flic de raifort cultivé. Ufage de fes femences en
medecme. Ibid. b.
RAILLERIE , (A/erj/e ) difeours quelquefois innocent
^ très-fouvent condamnable. La raillerie piquante porte
deux coups à la lois; l’iin à l’honneur , l’autre à i’amour-
propre. XIII. 763. b. Quelque fpirituclle qu’elle fo it, fou
ufage n’eff pref<|ue jamais bien placé. Haine implacable de
la clucheffe de Monipenfier contre Henri I I I , qui i’avoic
bldîce par fes railleries. Différence entre ces expreffions,
entendre raillerie , & entendre la raillerie. Un railleur de pro-
felfiüii eff ordinairement un petit efprit, & un mauvais ca-
raélere. Ibid. 766. a.
Raillerie , c\\c fur-tout permife lürfqu’clle renferme
une latyre ingénieufe & délicate d’un vice ridicule. E.xem-
ple tiré de ce que dit un avocat célébré à l’im des juges
qm avoicnt condamné Barneweld. Suppl. IV. 36Û. a.
Raillerie, différence entre raillerie bc brocard. I[.*4a3.
a. Les Romains regardoieiu les gens dont le nez eff aquilin
ou crochu, comme encliiis à la raillerie. XI. 128. b. Eljiecc
d urbanité qui convient à h raillerie. XVII. 48S. b. Son uti-
hic. Mtppl. II. 147. J/oyei PLAiSANTERIf.
R.AIMODON de U Mothe. ( D. ) Suppl. IV. 697. a.
^^'••'^^MOND: comtes de Touloufc qui ont porté ce nom.
A V I . 430. b. L ’un de ces comtes (Raimond V I ) fubit la
peine (lu louée, comme pénitence publique.VIl. 2 16 .E
Raimond, prince régent d’Aragon , voyrç Raymond.
Raimond, de Pennaford : fon recueil de décrétales. IV .
R-AîN A U D , {Théophile) jé fu ite .X V . 383. .r.
R /vINET TE, efpece de grenouille. V IL 942. b.
RAIPON CE ou Ré p o n c e , {Botan.) carailere de ce
genre de plante. Ses efpeces. Defeription de la principale à
fleur bleue. Lieux où elle croît. XIII. 766. b.
Raiponce, {M at. médic. Dicte) petife raiponce de caré-
iHC, grande raiponce & raiponce d’Amérique. Qualités dié-
tetiques & médicinales des deux premières racines. Manière
troifieme contre les maladies vénériennes
A i i l. 766. b.
■ ^■ ‘T ‘^'!f‘ £^'nérique, fon ufage dans les maladies véné*
tiennes. X V II . 2. a.
R A IS I , philofophe arabe. X IV . 668. a.
c {Botan. Agriculc.) principales efpeces de railin.
Lrifferentes fortes de morillons, XIII. 767. .r. de chaf.
lelas & de mufeats. Raifins de Corinthe, /il./, i. Différentes
lortcs deMalvoifies.de Bourguignons & de Bourdelais. Ibid,
70». Kailins fau-moireaux ou prunelles. Différentes fortes
de mehers. Raihn gamet. Raifin gouais. Le beaunier.
i-e Iromenteau. Le fauvignon. Le piquanc-paul. Le pizutelU
violet. La blanquette de limons. Ibid. b. La roche bknclie
& noire. Le gros noir d’Efpagne. Le raifin d’Afrique. Le
maroquin ou barbarou. Le damas. Le rai.fin d’Italie La
vigne de Mantoue. Le raifin d’Autriche. Le raifin Siiiffe.
Les grappes ^de raifin different entr’elles , par leur cou-
_cur, leur goût & leurs grains : de-là réfulte une nuikimde-
innombrable d efpeces qui va fe multipliant tous les jours. Ibid. 769. a. ‘
entend par rafle du raifin: ufage qu’on
en tire. X III 756. a. On ne connoît point précifément
lucide des raifins avant leur maturité.XIV. 904. b. La trop
grande maturité des raifins dans les années feches, produit les
Vins gras. XVII . 286. a. Moyen de concentrer le fuc des
railins. 296.
R aisin barbu , ( Bot.in. ) entrelacement des tiges de euf-
cute attachées à une grappe de raifin , qui lui donne un air
de monffruofité , & le fait appeller raifm barbu ou chevelu.
Auteurs qui ont regarde ce raifin comme un vrai monflre.
A llI . 769. a. Borel efl le premier qui ait reconnu que cette
prétendue monfiruofité n’étoit due qu’à la cufcuce. Mais
il a expliqué ce fait par une fauffe fuppofition. Ibid. b.
R ais in de mer, {Botan.) caraéleres de ce .»enre de
plante. Defeription du raifin de mer. Lieux où il croît XIII
769. b.
R ais in d’ours, {Botan.) .defeription de la feule efpece
connue de ce genre de plaiKC. Lieux ou elle croit. XIII.
769. b.
R ais in de renard, { Bot. Mat. médic.) caraéleres de ce
genre de plante. Ses propriétés. Obfervation fur les ufages
en médecine. XIII. 770. a. roye:^ EIerbe Ja iu s . VIIL
247. a.
Ra i s in /ec , { Botan.) deux fortes de raifins fecs que les
anciens Grecs diftinguoieiit. Les épiciers en ont de trois
forces, cepx de Damas , ceux de Corimlie 6c ceux qui
tlenueiu
R A I
tiennent le milieu entre ces deux oualités, par rapport à la
grolfeur. D es raifins de Damas. XIII. 770, a. Etat dans lequel
•ils nous jiarvicnücnt. Quels font les meilleurs. Moyen' de
les difiingucr de ceux de Calabre, avec lofquels les marchands
les mêlent quelquefois. Vigne qui porte le raifin de
Damas. Raifins lecs de Provence, Comment les habitans de
Montpellier les préparent. Caraélcres auxquels on reconnoit
les meilleurs, Leurs ufages. Ibjd. b. Raifins fees de Malaga.
Manière de les préparer. Raifins de Corinthe. Lieux où on
les cultivoit aurrefois, & où on les cultive aujourd’hui. Précis
de ce que raconte V^ielcr des divers lieux d’oii ils le
m-ent, de la maniéré dont on les y prépare , & d e la quantité
qu’on en tranfporte en Europe. Cûhure & commerce
(juon eu fait dans lille de Zantc. Ibid. 771. a. Comment ils
viennent en France. Choix des meilleurs. Maniéré de les
conferver. Vigne qui le.s porte. Prix auxquels tous les raifins
fees dont on a parlé, l’c vendent àAmflerdam. Vin artificiel
qu’on fuit avec ces raifins dans lespaysfeptentrionaux. Ibid. b.
Raijîns, m.inicre de les féchcr. VU . 33T. b.
R aisin , ( /Xc7c & Mat. médic.) qualités diététiques des
raifins frais. Eloge de celui qui eft connu en bas-Languedoc
lous les noms de verdal, d'afpiran & de rabaieren. La vigne
qui porte ce raifin aux environs de Pefenas, efl plantée fur
des rochers Sc dans les fentes de ces rochers. Qualité du chaf-
felas de Champagne & de Fontainebleau. Celle du mufeat.
XIU. 772. a. Les raifins frais & bien mûrs convenables aux
convalefcens. Qualités diététiques Sc ufages pharmaceutiques
des diftéreines ibrtes de raifins fees. Ibid. b.
R aisin , {Criiiq. fie r.) divers paffages de l’ancien tefla-
ment, ou il cfl parlé des raifins dans le Icns propre , & dans
le fens figuré. XIU. 773.
_ RA IS IN IER , {B ot.) arbres des ifies Antilles. Sa defeription.
XIII. 773. a. '■
Raiftmer, defeription des feuilles Sc des baies de cet
arbre. Quahié aftringcnte de fa racine. Deux fortes de rai-
fimers a Saint-Domingue , le raifinier du bord de la mer, &
le raifinier de montagne. Suppl. IV. 566.
R A IS O N , {Logiq.) diverfes notions que l’on peut fe
former de ce mot. XIII. 773. Les vérités de la raifon
font de deux fortes; favoir ou des vérités éternelles, ou des
ventes poiitivcs. Nous apprenons celles-ci, ou par l’expé-
riencc ou par notre raifonnemenr. La foi ne fauroit jamais
etre contraire aux vérités éternelles. La vérité ne pcmjamais
être attaquée par une objeélion invincible. Bornes précTcs
qui fe trouvent entre la foi & la raifon. i", Nulle propofuion
ne peut être reçue pour révélation divine , fi elle efl contra-
diftoirement oppofée à ce qui nous efl connu. Ibid. b. 2°. Lorf-
qu’il a plu à Dieu de nous fournir le fecours extraordinaire
ü une revelation, cette révélation doit l’emporter fur toutes
les refinances de notre raifon ; ces réfiffances n’étant ici fondées
que fur des conjeaures probables. Si l'on n’a pas foin
oe diltmguer les différentes jurifdiaions de la foi & de la
nufoii, Ion ouvre un vafie champ au fanacifme le plus out
r e , aux fupcrflmons les plus infenfées. Ibid. 774, a.
Raifon. C ’efl à elle principalement qu’ou doit attribuer
leiuhoufiafme des poètes, des artlfles, dont les produaions
nous raviffent, comme elles font la gloire de l’humanité,
y . 719. b. En quoi confille la raifon , par oppofition à la
folie. V II . 43, ,7. De l’ufagc de la raifon dans la philofophie:
elle e f l , felon B a y le , un principe de dellruaion 6c non pas
d édification. X. 24. b. De fon ufage en morale: defpotifme
que le coeur 6c les pafiîons exercent fur elle. XII. 146. a.
332./. D e fon ufage en maticrc de foi; voye^ ce dernier
mot: écarts malheureux dans lefquels doit fe jetter nécef-
fairement un lioinme qui ne fouiner pas fa raifon aux principes
de la religion & de la foi. XVII . 400. a , b. Efpece de
yb ric té à laquelle il faut fe refondre dans l'ufage de la rai-
fan, XIII, 613. b. 614. a. La raifon pervertie par le raifonne-
incnt. XVII . 770. b. '
Ra i s o n , os de { Anatom. ) XIII. 774. a. Hoycÿ^ CoRONAt
R.AISON, ( Arilhm. & Gcuméir. ) véfuitat de la comparai-
fon que l’on fait entre deux grandeurs homogepes. XIII.
774. a. Différence entre r.iifon ik proportion. Raifon arithmé-
nqiie. Raifon géométrique. Diflinélion établie par W o lf , de
b raifon en raiionnelle & irrationnelle. Expofant d’une Vai-
ffm géométrique. Raifon d'égalitc ou d'inégalité. Ibid. b. Rai-
fon dc plus grande & de moindre inégalité. Raifon multiple
oc loiis-multiplc. Raifon double, triple , &c. Raifon fous-
(lo u b k , fous-triple, &c. Raifon fcfquialtere , fefquitierce;
yus-fefqui.-iltere, fous-fefquitievcc, &c. Raifon furpaiiente &
lous-lurpatiente, 6’c. Railbn multiple furparticuliere & fous-
mu iiple , fous-furparticulicre , 6-c. &c. Ibid. 7 7 3 . R^ifons
égalés ou identiques. Raifens compofées. Propriétés des râlions.
Ibid. b.
Raifon, expofant d’une raifon géométrique. V I. 41-' a
Mefure d une „ ifo n cl„ „ „ je . X. 409. Compof.tlon de ra,:
fro»n VV II. 338J. 4, RFa?d,o"n' a'‘lPte“r’n'-’ “e , ïI.’ 3"04'o, y ' "c"o'm &po fée.lll. 76'■7=1.- Sr/f" “"'■“■‘‘°" '*'= IV- -• RMfon
R. A 557 donblc Si f„ „ jd o u b le . V 73. l. Doublée & fm.s doublée.
y ,.. 1 r,| lc & iriplec. X V I , 6 , 3 . Sou,-triple. X V . 4a,
i. SouSylnplee, ,W . Ilaif„„ „„d.iple, X. 8,6 . b. Souw nùti-
f V i l l I?'-?' ™''o" Inverfe. IV. 102,.
oidomté," ■ >“ n 'iv s- X. 58,. 4. Raifon
PPirTo port ion &V /R5 a' pBpaoiforitl troublée. X VvIi,, ^7 Jj22 . hr. — Vt ooyyecz^
ICujon jum jante.lX. 375. X V , 634. b. 633. a , b
d’in unices que
a fou r ^ ; r ê t r e autorifees par la
Ohfi‘ J L fur lequel ils fe fondent,
torife Ir 'r d'ieflion , fi Ja raifon d’état auparticuiiu
, lorfquil .s’agit du bien de l’etat. X l i l , 776 .7
R X ^ccepiions de cc mot. XIII. 776. b.
K a i .on , ( Comm.) hvre de raifon. Part d’un affocN
portion , rapport. Raifon d’une fociété. XIII. 7-76 b pourTF:i£xî,f 7;ii‘’°™“" ""°
raiîbF Y v i P'“ “ <1= =" !=“ '■
R A B O N N A B L E , 4 p pr,;,, ( Mifo/i,,/, ) I ,4 9 4
A ONNEMEn A A » « . 6' i l f b y f f A à n . -
776 s B 1“ uns des autres. XIII.
Mallebranche , tomes les opérations de
ms Vn ‘ ° perceptions. De toutes les difi'érenrcs
loues de raifonncmens le plus parfait & le nlus ufité
dans k s écoles c’efl le fyllo^ifmc^ Suppofé ha l é l c S S
piymilfes du fyllogifme, la conféquence efl néceffiirement
orebn;fr'’ ' ' ’r enfermée équivalcmmenc dans les
P ^ iilîes. La jdupai-t do nos erreurs viennent bien olus de ce
q c. nous raifüimons fur des principes faux que de ce
que nous ne railonnons pas fuivant nos principes. Ibid 77 7 a
yomment il arrive que deux hommes paroiffent convenir d’u-
e meme idée , & qu’ils en tirent une confequencc toute cliffé-
coufiflc à fe mettre
t ans I efprit avec exaaitude, h premiere idée qu’il faut avoir
des chofes donton doit juger. Différentes cames qui peuvent
nuire a la jiifleife de cette premiere idée. Ibid. b. Examen
de la qudtion : comment on peut dans la converfation développer
, louvcnt lans héfiter, des raifonncmens fort étendus,
dont toutes parties peuvent difficilement être préfemes
dans le même inflam. Ibid. 778. a.
R a iso n n em en t : différence entre jugeaient & raifon-
nement. X IV . 62. a. Un certain degré de perfeaion dans
la conception, fournit fouvent le fond & la forme des r;ù-
fonnemens fans le fecours de la raifon. III 803 a Do ïa
connoiffance acquife par raifonnement ; d’où dépend la fa-
gacitedefprit dans le raifonnement.891. b. Comment les
Pyrriiomens prétendoient prouver que nos raifomiemcns
ne font que des cercles vicieux. IV. 935. Vanné des r?i-
fonnemens félon ces philofbphes. XIII. 610. Ce oui cfl
requis pour qu’une fuite ou une déduélion de ra'ionne-
mens foit bonne. IV. 729. é. Maniéré de former le raifon-
nemeiit des enfans. V . 399. b. Force d’un raifonnement
\ 1 1 . 110. a. La plupart des faux raifonnemens ne viennent
que de l’oubli du principe de la raifon fuffifante. X V ,
633. b. D ou viennent les déf.nus des raifonnemens des dIù-
lofophes. I. 402. b. Réflexions fur l'ufage des fyllogifines
dans le raifonnement. X V . 713. 4. Si ceux- qui comtoiffmt
les regies du fyllogifme raifonnent mieux que les autres
723. b. S’c. Raifonnement affirmatif. Suppl. I, 184. a. i8 r '
b. Raifonnemens fondés fur l’analogie. I. 399. b. VIT! 68^
b. f'c . En matière de fo i, 011 ne doit pas raifonner pri- analogie.
I. 400. U. Avantages de la marche analytique drms le
railonnemem. 401. b. Elpece de fobriccé à laquelle il fuit 1-
réioudre dans l'iifage de la raifon. XIII. 613. b. 614, ,3. La
manière artificielle de raifonner a perverti le fens de I.1 raifon.
XVII, 770. b.
d eau , ( Orniih.) defeription de cet oifeau. XIII.
R.ÜC d'eau, chaffe à cet oifeau, vol. III. des planch
Cliafle, pl. 17. \
R âle de Genet, ou roi de caille, ( Orniih. ) defcrmtlon de
cet oifeau. Qualité de fa chair. XIII. 778. b.
R.-.LE rayé des Philippines , ( Orniih. ) oifeau repréfenté
vol. I\'. des planch. Régné animal, pl. 33. ’
R ale , ( DUte ) qualités diététiques des deux efpeces d’oi-
feaux des articles précédens. XIII. 779. a.
R ale , ou Râlement, {Médec. Seméioiiq. ) efpece de fon qui
fe fiiit entendre dans le goficr de quelques malades. Coin-
ment les Grecs Sc les Latins l’exprimoient. Caufes du râle-
nicrt. Cefymptôme efl d'un très-mauvais augure dans toutes
les maladies. XIII. 779. a. Cependant pour qu’il foit déci-
fivement mo rtel, il faut qu’il foit joint aux autres fignes
fâcheux. Ibid. b. °
RALEIGH , ( IValrcr) on lui efl redevable des pommes
de terre en Europe. Suppl. IV. 476. a.
B B B b b b b