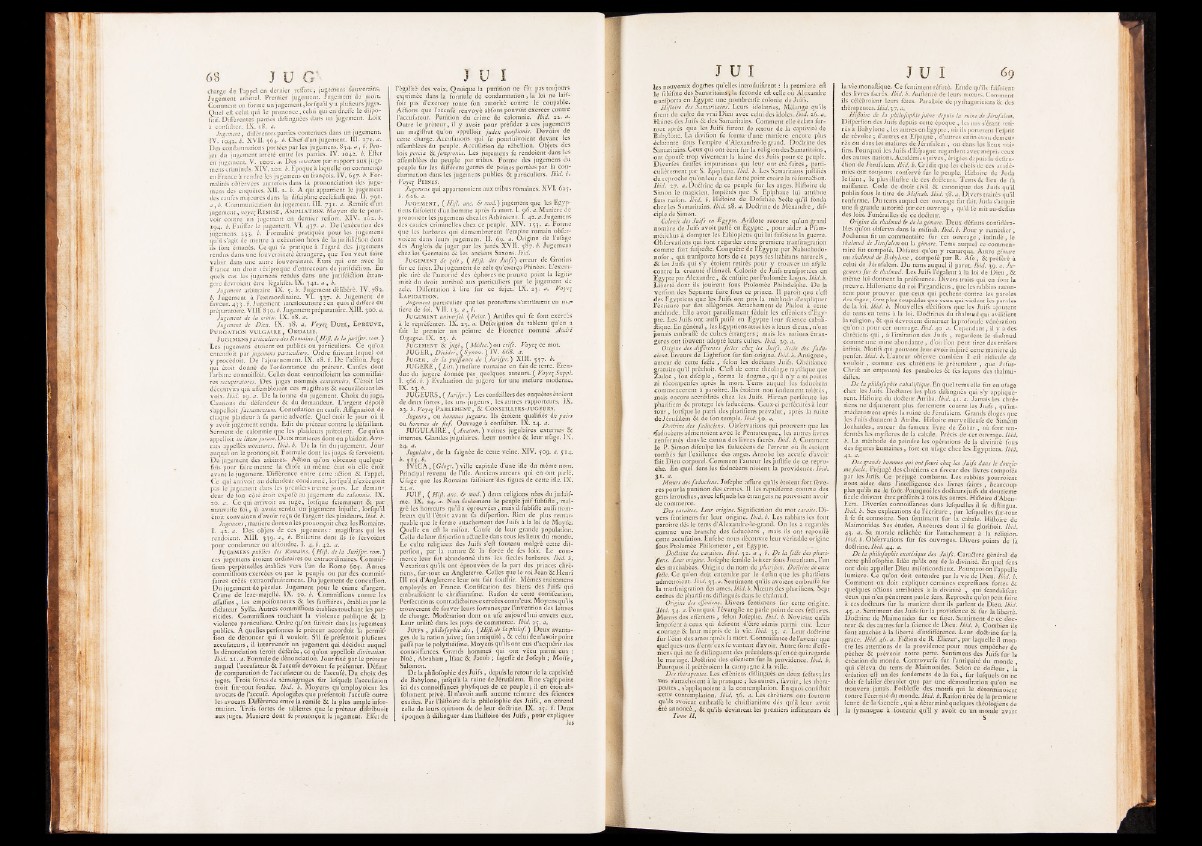
') !
if"
P 4 1
’’ i- ‘
J U G' clurgo clc l'appel cn dernier rclTort, jn^eniens fouvcralns.
' ' • ’ ■ ■ ■ .............. Jin’ emeiu arbiual. Pi jugement . ...... •nient de
Cuinmeiit on f'orme un jugement,loiliju il y a pluiieurs juges.
Quel efl celui qui le prononce, celui qui en dre lie le d'iipo-
fitif'. DitTérences parties diilinguées dans un jugement. Luix
à conlulier. IX. i8. u.
Ju!;cmau, diiVérenics parties contenues dans un jugement.
iV . 1042. b. XVII. 5Ö4. h. Ch e f d’un jugement. 111. 271. J.
Dos condamnations portées par les jugemens. 834. e , b. Projet
du jui;emcnt arrêté entre les jxnties. fV . 1042. b. Ellcr
en jin.-emcnt. V, ic o a . n. Des rcur.tum par rapport aux jugemens
u iminels. X IV. 202. k. Epoque à laquelle on commença
cn France à rendre les jugemens en Irançois. IV . 637' b- Eor-
m.iüiés ühl'ervées aiirrelois dans la prononciation des jiigc-
mens des enquêtes. XII. 2. b. A qui ujiparcient le jugement
des cailles majeures dans la dilciplinc eccléfi.illique. II. 791.
.i,b . Communication du jugement, i l l . 731. .1. Remiledun
jugement, vuycj; RtMlsE , ÀM^tI-^TlON. Moyen de le pour-
vtàir contre un jugement en derni<.;r relTort. X IV . lù i . b.
194. b. F.unrer le jugement. V I . 437. ,1. l.)e l’exécution des
jtigeinens. 235. b. Formalité praticjiiée pour les jugemens
qu'il s’agit de mettre à exécution hors de la juiifdiéfion dont
iis fom émanés. Ce qui le pratique à l’égard des jugemens
rendus dans une fouveraineté étrangère, que l’on veut taire
valoir dans une autre fouveraineté. Etats qui ont avec la
France un droit réciproque d’emrecours de jurifdic^ion. Eu
quels cas les jugemens rendus dans une jiivifdiction étrangère
dovroient être légalités. IX. 341. a , h.
Jiii^cmcru arbitraire IX. 3. b. Jugement délibéré. IV. 782.
b. Jugement à rexunordinaire. V I . 337. b. Jiigeinent de
faveur. 43} . b. Jugement interlocutoire ; en quoi il différé du
préjiaratoii e. V l lE 830. b. Jugement préparatoire. XIII. 300.
Jugc/miti de U croix. IX. î8. a.
ju-^ement de IX. 18. u. DUEL, ÉPREUVE,
P u r g a t io n v u l g a ir e , Ü r d .^l ie .
JuCLMENS pjrikuliers des Romains.{Hiß.de la jurifpr. rom. )
Les jugemens éioient ou publics ou particuliers. C e qu’on
cnteiuloit par ju^eme/is p.vncuUers. Ordre fitivant lequel on
y jirocédoit. De l'ajournement. IX. 18. b. D e l'aftion. Juge
qui étoit donné de l’ordonnance du préteur. Caufes dont
l’arbitre comioiffoit. Celles dont connoiffoient les comnitiTai-
res rccuperjtores. Des juges nommés cc/itumvirs. C ’étolt les
décemvirs qui alTcmbloicnt ces mugiftrats & recuellloiciit les
voix. Ibid. 19. J. D e lu forme du jugement. Choix du juge.
Cautions du défendeur & du demandeur. L’argent dépofé
s'appelloit faerameruum. Contellatioii en caufe. Alîîgnaiion de
cliaquc plaideur à fa partie adverfe. Q uel étoit le jour où il
V avoit jugement rendu. Edit du préteur contre le défaillant.
Serment de calomnie que les plaideurs pretoienr. C e qu’on
appelloit in liieni jurure. D..UX maniérés dont 011 plaidoit. A v o cats
appellés niorutores. Ibid. b. D e la fin du jugement. Jour
auquel on le piononçoit. Formule dont les juges fe fervoient.
Du jugement des arbitres. Aélion qu’on obtenoit {[uelquc-
fois pour faire mettre la chofe au même état où elle étoit
avant le jugement. Différence entre cette uéfion & l’appel,
(ie qui airivolt au défendeur condamné, lorfqti'il n’cxécutoit
pas le jugemetn dans les premiers trente jours. Le demandeur
de ibn coté étoit expolé au jugement de calomnie. IX.
20. a. C e qui arrivoit au ju g e , lorfque feiemment & par
mauvaife fo i , U avoit rendu un jugement injulle, lorfqu'il
étoit convaincu d’avoir reçu de l’argent des plaideurs. Ibid. b.
/ww/ic«i, maniéré dont on les proiionçoit chez les Romains.
I. 42. a. Des objets de ces jugemens : magiftrats qui les
rendoient. XIII. 539. <t, b. Bulletins dont ils fe fervoient
pour condamner oit abfoudre. I. 4. b. 42. u.
J u g em en s publies des Romams. {H iß . delà Jurifpr. rom.)
CCS jugemens éioient ordinaires ou extraordinaires. Comniif-
fions perpétuelles établies vers l’an de Rome 605. Autres
commiffions exercées ou par le peuple ou par des commif-
faires créés extraordinairement. Du jugement de concuffion.
Du jugement de péculat. Jugement pour le crime d’argent.
Crime de leze-majeRé. IX. 20. b. CommilTions contre les
aflaflins, les cmpoilbnncurs & les fauffaires, établies par le
ditlateur Sylla. Autres commiflions établies touchant les parricides.
CommilTions touchant la violence publique & la
violence particulière. Ordre qu'on fuivoit dans les jugemens
publics. A quelles perfonnes le préteur accordoit la permif-
fion de dénoncer qui il vouloir. S’il fe préfentoit plufieurs
acculatcurs, il tntervenoit un jugement qui décidoit auquel
la dénonciation leroit déférée, ce qu’on appelloit divination.
Ibid. 21. d. Fonnule de dénonciation. Jour fixé parle préteur
auquel l’acculateur Ôc l’aceufé dévoient fe préfenter. Défaut
de comparution de l’aceufateur ou de l’aceufé. D u choix des
juges. Trois fortes de témoignages fur Icfquels l’accufaiion
étoit fur-tout fondée. Ibid. b. Moyens qu’employoient les
avocats de l’accufé. Apologillcs que préfentoit l’accufé outre
les avocats. Différence entre la remife ßc la plus ample îiifor-
mation. Trois Ibrtes de tablettes que le préteur diftribuoit
au.x juges. Maniéré dont fe prononçoit le jugcinem. Effet de
J U I ^ îég al'té des voix. Quoique la punition ne fût pas toujours
cx|irimée dans la formule de condamnation, la loi ne laii-
foit pas d'exercer tome fon autorité contre le coupable.
ATioiis (|iie l’accafé renvoyé abfous pouvoir exercer contre
I’accufoteur, Punition du crime de calomnie. Ibid. 22. a.
Outre le préteur, il y avoit pour préfider à ces jugemens
un niagillrat qu'on appelloit judex tjiurßionis. Devoirs de
cette charge. Accufations qui fe pourfuivoient devant les
niremblées du peuple. Aeeufation de rébellion. Objets des
loix poreia 6c feinproiii.i. Les jugemens fe rendoient dans les
affemblées du peuple par tribus. Forme des jugemens du
peuple fur les difterens genres de peines portées par la con-
d.imnat.oii dans les jugeintns publics & particuliers. Ibid. b.
Voyc^ Peines.
Jugemens qui apparteiioicnt aux tribus romaines. X V I . 623.
b. 626. .r.
Jugement, {H iß . anc. 6 -/not/.) jugement que les Egyptiens
faifoient d'un homme après fa mort. I. ob. a. Maniéré de
prononcer les jugemens chez les Athéniens, l. 42. .2. Jugemens
des caufes criminelles chez ce peuple. XIV. 133. .2. Forme
que les barbares qui démembrèrent l’empire romain obfcr-
volent dans leurs jugemens. II. Ö9. a. Origine de riifage
des Anglois de juger par les jurés. X V ll. 387. é. Jugemens
chez les Germains ck. les anciens Saxons. Ibid.
Jugement de ^ele, { H ß . des Juifs) erreur de Grotius
fur ce fujet. Du jugement de zele qu’exerça Phinées. L’exemple
tiré de l’autorité des éphores ne prouve [loint la légitimité
du droit attribué aux particuliers par le jugement de
zele. E)iirertation à lire fur ce fujet. IX. 23. a. Voye^
LARID.A.TION.
Jugement particulier que les proteffans s’attribuent cn matière
de foi. VU . 13. a , b.
Jugement univerfel. {Peint.) Artilles qui fe font exercés
h le reprélentcr. IX. 23. a. Defeription du tableau qu’en a
fait le premier un peintre de Florence nommé André
Org.igna. IX. 23. b.
Jugement èk jugé, ( Mèdec.) ou crife. Voyc^ ce mot,
JU G ER, Décider, {Synon. ) IV. 668. u.
Juger, de U puif'ance de {Jurifpr.) XIII. 537. b.
JU GERE , {L itt.) mefure romaine cn fait de terre. Etendue
du jugere donnée par quelques auteurs. (
I. 366. i . ) Evaluation du jugere fur une mefure moderne.
IX. 23.*.
JUGEURS, ( Jurifpr.) Lesconfeillersdes enquêtesétoicnt
de deux fortes, les un-ju geu rs, les autres rapporteurs. iX.
23. b. Voyei PARLEMENTCoNSEÎLLERS-JUGEURS.
Jugeurs, on hommes jugeurs. Ils étotent qualifiés d'c pairs
ou hommes de fief Ouvrage à confulter. IX. 24. a.
JU G U L A IR E , {Anatom.) veines jugulaires externes 5c
internes. Glandes jugulaires. Leur nombre 5c leur ulage. IX.
24. a.
Jugulaire, de la faignée de cette veine. X IV . 309. a. 314.
6. 3I 3. i.
IV IC A , (Gc'ogr. ) ville capitale d’une iile du même nom.
Principal revenu de l’ifle. Anciens auteurs qui en ont parlé.
Ulage que les Romains faifoient des figues de cette ifle. IX.
24.-2.
JU IF , {H ß .a n c . 6* mod.) deux religions nées dujiidaïf-
me. IX. 24. a. Non feiilemein le peuple juif fubfifte, malgré
les horreurs qu’il a éprouvées , mais il fubfiRe aufli nombreux
qu’il rétoit avant fa dtfperfion. Rien de plus remarquable
que le ferme attachement des Juifs à la lot de -Moyfe.
Quelle en efl: la raifon. Caufe de leur grande population.
Celle de leur dil'pcrfion aéluellc dans tous les lieux du monde.
L e culte religieux des Juifs s’efl foutenu malgré cette dif-
perfion, par la nature 5c la force de fes loix. Le commerce
leur fut abandonné dans les ficelés barbares. Ibid. b.
Vexations qu’ils ont éprouvées de la part des princes chrétiens
, fur-tout cn Angleterre. Celles que le roi Jean 5c H enri 111 roi d’Angleterre leur ont fait fouffrir. Mêmes traitemens
employés en France. Confifeation des biens des Juifs qui
embraffoient le ciiriflianil'me. Raifon de cette confifeation.
Pcrféciicions comradiéloires exercées contr’eux. M oyens qu’ils
trouvèrent de faiiver leurs fortunes par l’invention des lettres
de change. Modération dont on ufc aujourd’hui envers eux.
Leur utilité dans les pays de commerce. Ibid. 23. a.
Juif s , phüofophie des, ( Hiß. de laphilof. ) Deux avantages
de la nation juive; fon antiquité , 5c celui de n’ayoir point
paffé par le polythéifme. Moyens qu’ils ont eus d’acquérir des
connoiffances. Grands hommes qui ont vécu parmi eux ;
N o é , Abraham , Ifaac 8c Jacob ; fitgeffe de Jofeph ; Moife,
Salomon.
De la philofophie des Juifs, depuis le retour de la captivité
de Babylone, jufqii’à la ruine de Jérufalem. Une s’agit point
ici des connoiffances phyfiques de ce peuple ; il en étoit ab-
folument privé. Il n’avoit aufli aucune teinture des fcicnces
exaétes. Par l’iiifloirc de la philofophie des Juifs, on entend
celle de leurs opinions 8c de leur doéirine. IX. 23. b. Deux
époques à diflingucr dans l’hifloire des Juifs, pour expliquer
’ les
J U I les nouveaux dogmes qu’elles introdiiifircnt : la premiere crt
le fehiflne des Samaritains, la fécondé efl celle où Alexandre
tranfporta en Egypte une nombreufe colonie deJiiüs.
IJiJhire des S.un.iritains. Leurs idolatries. Mélange qu'ils
firent (il! culte du vrai Dieu avec celui des idoles. Ibtd. 26. u.
Haines des Juifs 5c des Samaricains. Cominciu elle éclata fur-
tout après que les Juifs furent de retour de la captivité de
Babylone. La divifion fe forma d'une maiiicrc encore plus
éclatante fous l’empire d’AIexandre-le gnuid. Doéfrine des
Samaritains.Ceux qui ont écrit fur la religion desS.imaritains,
ont époufé trop vivement la haine des Juifs pour ce peuple.
Diverfes fauffes imputations qui leur ont été faites, parii-
cullérenicnt par S. Epiphane. Ibid. b. Les Samaritains juflifiés
du reproche qu’onlour a fait de nepoiiit croire la lélurreéllon.
Ibid. IJ . a. Doéiiiiic dp ce peuple fur les anges. Hifloire de
Simon le m.agicieii. Impiétés que S. Epiphane lui attribue
fans raifon. Ibid. b. Hifloire de Dofithéc. Scéte qu’il fonda
chez les Samaritains. Ibid. 28. a. Doflrine de Ménandre, dif-
ciple de Simon.
Colonie des Juifs en Egypte. Ariftote raconte qu’ un grand
nombre de Juifs avoit pafl'é en Egypte , pour alcler à Pfam-
mcticlius à dompter les Ethiopiens qui lui faifoient la guerre.
Obfervations qui font regarder cette premiere tratffmigration
comme fort fiifpcéle. Conquête de l’Egypte par Nabiichocio-
nofor , qui tranfporte hors de ce pays lés habitans naturels ,
& les Juifs qui s’y ctoienc retirés pour y trouver un afylc
contre la cruaiité d'Ifinaél. Colonie de Juifs tranfporcées en
Egypte par Alexandre , Sc enftiite par Pcolomée Lagus. Ibid. b.
Liberté dont ils jouirent fous Ptolomcc Piiiladelpiic. D e la
verfion des Septante faite fous ce prince. Il paroît que c ’efl
des Egyptiens que les Juifs ont pris la méthode cl’e.xpliquer
récriture par des allégories. Attachement de Philon à cette
inechode. Elle avoit pareillement féduit les efféniens d'Egypte.
Les Juifs ont aufli puifé en Egypte leur fcience cabali-
Jlique. En général, les Égyptiens attachés à leurs dieux , n'ont
jamais embralTé de cultes étrangers ; mais les nations étrangères
ont fouvent adopté leurs cultes. Ibid. 29. a.
Origine des différentes fecîcs che^ les Juifs. Seéce des fidu-
céens. Érreurs de Lightfoot fur fon origine. Ibid. b. Antigone,
auteur de cette feéfe , felon les doéfeiirs Juifs, übéilfancc
gratuite qu'il préchoit. C e ft de cette théologie myfliquc que
Zadûc , l'on difciple , forma le dogme , qu'il n’y a m peines
ni récompenfes après la mort. Tenis auquel les faducéens
commcnccrciii à paroitre. Ils étoient non leulemcnt tolérés,
mais encore accrédités chez les Juifs. Hircaii perfécute les
phariflens 5c protege le's faducéens. Ceux-ci perlécucésà leur
to u r , lorfque le parti despharlfiens prévalut, après la ruine
de JciTifalem & de fon teni|>le. Ibid. 30. a.
Dotirinc des faducéens. Obfervations qui prouvent que les
■ ffadiicéens adifiettoient avec le Pentateuque, les autres livres
renfermés dans le canon des livres facrés. Ibid. b. Comment
le P. Simon difculpe les faducéens de l’erreur où ils étoient
tombés fur rexiflencc des anges. Arnobe les acciife d'avoir
fait Dieu corporel. Comment rameur les jiiflifie de ce rejiro-
che. En quel fens les faducéens nioient la providence. Ibid.
31 . a.
Aleeurs des faducéens. Jofephe afftire qu’ils étoient fort féve-
res pour la punition des crimes. 11 les repréfenre comme des
gens farouches, avec lefquels les étrangers ne pouvoieiu avoir
de commerce.
Des caraïtes. Leur origine. Signification du mot caraï/e. D ivers
fentimens fur leur origine. Ibid, b. Les rabbins les font
paroitre dés le tems d’Alcxandre-le-grand. On les a regardés
comme une brandie des faducéens , mais ils ont repouffé
cette aeeufation. Eufebe nous découvre leur véritable origine
fous Ptolemée Philometor, en Egypte.
Doéîrine des caraites. ibtd. 3 2. 22 , b. De la fcéîe des phari-
fiens. Leur origine. Jofephe femble lafi.xer fous Jonatham, l’un
des macliabécs. Oiiginc du nom de phatifen. Doclrine de cette
feÜe. C e qu'on doit entendre par le deflin que les pharificiis
admettoient. Ibid. 33.12. Sentiment qu’ils avoient embiaffé fur
la tranfmigration des ames. Ibid. b. Moeurs des pharificiis. Sept
ordres de pharifiens diflingués dans le thalmucl.
Origine des ejj'enicns. Divers fentimens fur cette Origine.
Ibid. 34. a. Pourquoi l’évangile ne parle point de ces feétaires.
Moeurs des eiïéiiiens , felon Jofoplic. Ibid. b. Noviciat qu’ils
împofent à ceux qui défirent d’être admis parmi eux. Leur
courage 8c leur mépris de la vie. Ibid. 33. a. Leur dodriiie
fur l’état des ames après la mort, Connoilî'aiicc de l’avenir que
quelques-uns d’cmr'eux fe vantent d’avoir. Autre forte d’cil'é-
niens qui ne fe difliiigncnt des précédens qu’en ce qui regarde
le mariage. Doéfriiic des cfieniens fur la providence. Ibid. b.
Pourquoi il préféroiein la campagne à la ville.
Des thérapeutes. Les efféniens diflingués en deux feftes; les
Uns s’acrachoient à la pratique ; les autres, fa v o ir , les thérapeutes
, s’appliquoienc à la contemplation. En quoi confifloit
cccre contemplation. Ibid. 36. a. Les chrétiens ont foutenu
qu’ils avoient embraflé le chriflianifme dés qu'il leur avoit
été annoncé , & qu’ils devinrent les premiers inflituteurs de
Tome II.
U I 69
ia vie lùonaflique. Ce femiment réfuté. Etude qu’ils f.iifoient
des livres làcrcs. Ibtd. b. Auflérité de leurs moeiiis. Comment
ils célcbroicnr leurs fêtes. Parallèle de jiyihagoriciens & des
thérapeutes. Ibid.-.,!, a.
Hifloire de L philofophie juive depuis la mine de Jérufalem.
Difperfion des Juifs depuis cette époque , U s uns s’éi.mt retirés
à Babylone , les autres en Egypte, oii ils porteront l’elj^rit
de révolte ; d’autres en Efpagne , d’autres enfin étaiu dcniéii-
rés ou dans les niafures de Jérufalem , ou dans les lieux vr.i-
fins. Pourquoi les Juifs d’Erpagne regardent avecmépiis ceux
des autres nations. Académies juives, érigées depuis la dcflru-
élion de Jérufalem, Ibid. b. Crédit que les chefs tic ces académies
ont toujours confervé fur le peuple. Hifloire de Jucla
le faint, le plus illiiflie de ces doéleuis. Tems & lieu de fa
naiffance. Code de droit civil & canonicme des Juifs qu'il
publia fous le titre de M ifu h . Ibid. 38. a. IJivers traités qu’il
renferme. Du tems auquel cet ouvrage fut fait. Jucla s’acc[tiic
une fl grande autorité par cet ouvrage , qu'tl fe mit au-deirus
des loix. Funérailles de ce doifleur.
Origine du thalmud 6* de lagemate. Deux défauts conficlcra-
Mes qu’on obferva dans la mifnah. Ibid. b. Pour y remédier,
Jüclianan fit un commentaire fur cet o u v ra g e, iiu in ilé ,le
thalmud de Jérufalem on la gémare. Tems auquel ce commentaire
fut conipofé. Défauts qu’on y remarqua. Autre gémare
ou thalmud de B.ibyUme , compofé par R. A f c , & préféré à
celui de Jci ufalcin. Du tems auquel il parut. Ibid. 39. a. Jugemens
fur le thalmud. Les Juifs l’égalent à la loi de Dieu , 5c
même lui donnent la préférence. Divers traits qui en font ia
preuve. Hifloriette du roi Pirgandictis, que les rabbins racontent
pour prouver que ceux qui pèchent contre les paroles
des fages , font plus coupables qiie ceux qui violent les paroles
de la loi. Ibid. b. Nouvelles clécifions que les Juifs ajoutent
de teins en tems à la loi. Doélrines du ihalmKd qui aviliflciit
la religion, 5: qui devroient diminuer la prol'oiidc vénération
qu’on a pour cet ouvrage. Ibid. 40 a. Cependant, il y n des
clirécicns qui , à rimiration des Juifs , regardent le thalmud
comme une mine abondante , ci'oii l'on peut tirer des tréf'ors
infinis. Motifs qui peuvent leur avoir iiiljiiré cette maniéré de
penCer. Ibid. i . L’auteur obferve combien il ell ridicule de
vouloir , comme ces chrétiens le prétendent , que J.fus-
Clirifl ait emprunté fes paraboles 6c lés leçons des thalmu-
difles.
De la philofophie cabalifique. En quel tems elle fut cn ulage
chez les Juifs. Dodeurs les plus diflingués qui s’y appliquèrent.
Hifloire du dodleur Atriba. Ibui. 4 1. -2. Jamais les chrétiens
ne difpiuerent plus fortement contre les Juifs , qii’iin-
xnédintcnicnt après la ruine de Jérufaiem. Grands éloges que
les Juifs donnent à Atriba. Hifloire mervcilleufe de Siméon
lochaidcs. auteur du fameux livre de Zohar , où font renfermés
les myfleres de la cabale. Précis de cet ouvrage. Ibid,
b. La méihocie de peindre les operations de la divinité fous
des figures humaines , fort en ufage chez les Egyptiens. Ibid.
42, .2.
Des gr.vids hommes qui ont fleuri chei les Juifs dans le douzième
fecle. Préjugé des chrétiens en faveur des livres conipolés
par les Juifs. C e préjugé combattu. Les rabbins poiirroicnt
nous aider dans l’intelligence des livres faints , beaucoup
plus qu’ils ne Je font. Pourquoi les doélcurs juifs du douzième
fiecle doivent être préférés à fous les autres. Flifloire d’Aben-
Ezra. Diverfes connoiffances clans lefqiielles il fe diftingua.
Ibid. b. Ses explications de récriture , par lefqiielles fur-tout
il fe fit connoitre. Son fentiment fur la cabale. Hifloire de
Ma'imonides. Ses études. Ancêtres dont il fe glorifioit. Ibid.
43. a. Sa morale relâchée fur l’attachement à la religion.
Ibid. b. Obfervations fur fes ouvrages. Divers points Je fa
doftfine. Ibid. 44. a.
De la philofophie exotérique des /22/j/r. Caratflere général de
cette philofophie. Idée qu'ils ont de la divinité. En quel fens
ont doit appeller Dieu mifericorciiciix. Pourquoi on l’appelle
lumière. C e qu’on doit entendre par la vie de Dieu, Ibid. b.
Comment on doit expliquer certaines expreflions fortes 6c
quelques aélions attribuées à la divinité , qui fcandalifent
ceux qui n’en pénètrent pas le fens. Reproche qu’on peut faire
à ces cloâeurs fur la maniéré dont ils parlent de Dieu. Ibid.
43. a. Scntiincut des Juifs fur la providence 8c fur la liberté.
Doéîrine de Maimonides fur ce fujet. Sentiment de ce docteur
5c des autres fur la fcience de Dieu. Ibid. b. Combien ils
font attacliés à la liberté d'incliflérence. Leur doéîrine fur la
grace. Ibid. 46. a. Fiélion de R. Eliezer, par laquelle U montre
les attentions de la providence pour nous empêcher de
pécher Sc prévenir notre perte. Sentimens des Juifs fur la
création du monde. Coiitroverfe fur l’antiquité du monde ,
qui s’éleva du tems de Maimonides. Scion ce doéteur , la
création efl un des fondemens de la f o i , fur lefquels on ne
doit fe laiffer ébranler que par une démonflration qu’on ne
trouvera jamais. Foibleffe des motifs qui le déterminoient
contre I’cternitc du monde. Ibid. b. Raifon tirée de la premiere
lettre de la Genefc , qui a déterminé quelques théologiens de
la lynanogue à foutenir qu’il y avoit eu un monde avant