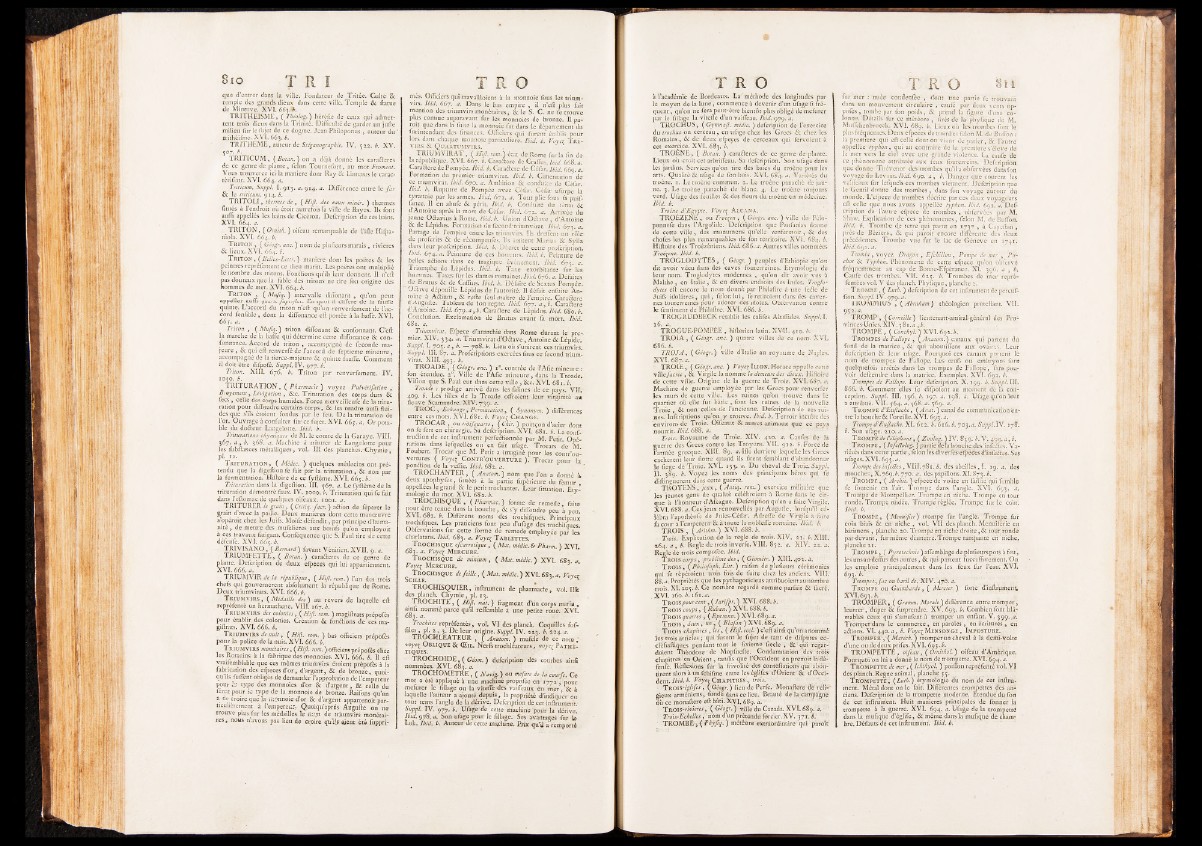
' ' i T i 1
i- ''1 -
f '1
8 x0 T R
que d'cnticr dans la ville. Fomlatcur de Trltée. Culte 8c
temple des grands dieux dans cette ville. Temple 8c ftatuc
de Minerve. X V I . 66-^.è.
T R lTH E lSM t - , ( Théolog.) Iiér<ifie de ceux qui admettent
trois dieux dans la Trinité. Diffinihé de garder un jiifle
milieu Cur ie fiijct do ce dogme. Jean Philopomis , auteur du
trithéifmc. X VI, 663. b.
TR ITH EM E , autour de IV. <j2i. b. X V .
ERITICUM , {B oum.) on a déjà donné les caraélcrcs
do cc genre de plante , lélon Tournetbrt, au mot Froment.
Vous trouverez ici la maniéré dont Ray & Linna:us le carac-
lérifenc. X V I . 664. a.
Tnùcum. Suppl. I. 913. J. 914. U. Différence entre le fur
Sc le tiiticiim. 914. b.
T R IT O L I , thermes de , {FUß. des e.vtx miner. ) thermes
ßtues à l’endroit où étoii autrefois la ville de B.iycs. Ils font
auHi appelles les bains de Cicéron. Dclcriptioii de ces bains.
XVI. 664. U. ‘
TR ITO N , ( Ornith. ) oifeau remarquable de l'ide Plifna-
niola. X VI, 664. b.
T riton , ( Géo»r. .me.) nom de phifieursmarais rivieres
8c lieux. X V I . 664. h.
T riton, {BelU s-Le tf.) manière dont les poètes 8c les
peintres rcprclentent ce dieu marin. Les poètes ont multiplié
le nombre des tritons. Fondions qu’ils leur donnent. Il n'cll
pas douteux que ia fable des tritons ne tire fon origine des
hommes de mer. XVI. 664. b.
T riton , ( Mufitj. ) intervalle dixTonant , qu’on peut
appeller auffi quarte fuperfluc. En quoi il différé de ia faiiffe
quinte. L'accord du triton n’ell qu'un renverfement de l'accord
fenüblc , donc la difl’onance cil portée à la baffe. X V I .
663. .X.
Triton , { M u fq .) triton diffonant 8c confotinanr. C'eff
la marche de la baffe qui détermine cette dilfonance 8c con-
lonnance. Accord de triton , accompagné de fécondé majeure
, Sc qui eil renverfé de l’accord de fejJtieme mineure ,
accompagné de la tierce-majeure Sc quinte faulfe. Comment
il doit être difpofé. Suppl. IV. 977. b.
Triton. X i l l . 676. b. Triton par renverfement. IV .
1030. b.
T R IT U R A T IO N , ( Pharmacie ) v o ye z Pulvcrifation ,
B:oyemcnt, Lévipation , 8cc. Trituration des corps durs 8c
fees , celle des corps humides. Force mervcillcufe de la trituration
pour dilToudve certains corps, & les rendre auffi fluides
que s’ils étoieiit fondus par le feu. D e la trituration de
l’or. Ouvrage à confulter fur ce fujet. X V I. 665. a. ü r potable
du dofteiir Langelotte. IbiJ. b.
Triturations ehymiques de M, le comte de la Garayc. VIII.
367. , b. 368. a. Aîaehine à triturer de Langelorte pour
les fubllances métalliques, vol. III des planches. C h yinie ,
pl. 12.
T rituration, ( Médec. ) quelques médecins ont prétendu
que la digeftion fe fait par la trituration, 8c non par
la fermentation. Hilloire de ce fyfféme. X V I . 663. b.
Trituration dans la digeftion. III. 367. a. Le fyftéme de la
trituration démontré faux. IV. 1000. b. Trituration qui fc fait
dans l’eftomac de quelques olfeaux. 1001. a.
TR ITU R ER le grain , ( Criiiq. fier. ) aélion de leparer le
grain d av cc la paille. Deux maniérés dont cette mariccuvrc
s opéroit chez les Juifs. xMoife défendit, par principe d’humanité
, de mettre des nuifeJieres aux boeufs qu’on employoit
à ces travaux fatigans. Conféquence que S. Paul tire de cette
défenfe. X V I. 66<^.b.
T R IV ISA N O , ( Bernard) favant Vénitien. X V II . g. a.
T R IUM F E T T E , ( Botan.) caraélercs de ce genre de
plante. Defeription de deux efpcces qui lui appartiennent.
X V I . 666. a.
TR IUM V IR la république, { Fîifl. rorn.) l’un des trois
chefs qui gouvernèrent abfolument la république de Rome.
D eu x triumvirats. X VI. 666. b.
T riumvirs, {Médaille des) au revers de laquelle eft
repréfentè un hermathene. VIII. 167. b.
T riu.mvirs des colonies, ( fiifl. torn. ) magiftrats prépofés
pour établir des colonies. Création 8c fonélions de ces magiftrats.
X V I . 666. b.
T riumvirs de n uit, {FUß. rom. ) bas officiers prépofés
pour la police de la nuit. X V I . 666. b.
T riu.mvirs monétaires, {Hiß. mm.)officier»prépofés chez
les Romains à la fabrique des monnoies. X VI. 666. b. Il eft
vrailemblablo que ces mêmes triumvirs étoient prépofés à la
fabrication des efpeccsd’o r , d’argent, 8c de bronze, quoi-
Gu’ils fulfent obligés de demander l’approbation de l’empereur
pour type des monnoies d’or 8c d’argent, 8c celle du
lénat pour k type de la monnoie de bronze. Raifons qu’on
a de croire que la n'.onnoie d’or 8c d’argent apparcenoic particulièrement
à l’empereur, Quoiqu’aprés Augufte on ne
trouve plus fur les médailles le iicm de triumvirs monétair
e s , nous n avons pas lieu de croire qu’ils aient été fuppri-
T R O
niés. Officiers qui travailloient à la monnoie fous les triumvirs.
Jbid. 667. a. Dans le bas empire , il n’ell plus ftiit
mention des triumvirs monétaires, 8c le S. C. ne fe trouve
plus comme auparavant fur les monnoies de bronze. Il pa-
roit que dans la luite lu monnoie fut tlatis le département du
furintendaiu des finances. Officiers qui furent crahlis pour
lors dans chaque monnoie particulière, Ibid. b. Foyer T ré-
vjR.s S: Q uartumvirs.
TR IUM V IR A T , ( IFift. rom.) état de R.ome fur la fin de
la république. XVI. 667. b. Caraftorc do Cr,iffii-.. lo,d. 668.
Caraèlercdo Pompée. Ibid. b. Caraflcrc de Ccl'ar. IhiJ. 669. a.
rormation du premier iriumvirat. Ibid. b. Cimcncaiion de
cc triumvirat. Ibid. 670. a. Ambition & conduite de Céfar.
Ibid. b. Rupture de Pompée avec Céfar. Cefar iiftirpe la
cyranuic par les armes. Ibid. 6~i. a. Tout plie fous l'a puif-
fmee. 11 en abufe 8c périt. Ibid. h. Conduite du lénac 8c
d’Antoine après la mort de Céfir. lbiJ.S-71. a. Arrivée du
jeune Oft-aviiis à Rome. Ibid. b. Union d O d.ive , d’Antoine
8c de Lépidus. Formation du fecond-trimnvirat. Ibid. 673. a.
P.irtage de l'cmpiie entre les triumvirs. Ils dreffenr nn rôle
de profcrics Sc de récompenfes. lis imitent M.iriu-, 8c Syila
dans leur profeription. Ibid. b. .Decree de cetie piofcription.
Ibtd. 674. U. Peiiunre de ces iioiTviirs. Ibid. b. Peinture de
belles aélions dans cc tragique événement. Ibid. 673. a.
Triomphe de Lepidus. ibid. b. Taxe exorbitante fur les
ho.nmes. Taxes fur les dames romaines. Ibid. 676. a. Défaites
de Brunis 8c de Caffuis. Ibid. b. Défaite de Sextus Pompée.
Oftave dépouille Lépidus de l'autorité. Il défait enfiiite Antoine
à Aclium , 8c refte leiil maître do l'empire. Caraélerc
d Augufte. Tableau de fon régné. Ibid. 677. a , b. Caraftere
d’Antoine. Ibid. 679. a , b. Caraélere de Lépidus. Ibid. 680. b.
Conclufion. Exclamation de Brutus avant fa mort. Ibid
681. 4.
Trtumvir.it. Efpece d’anarchie dans Rome durant le premier.
XIV. 334. U. Triumvirat d’O ftav e , Antoine 8c Lépide.
Suppl. I. 703. a , b. — 708. b. Lieu oii .s’unirent ces triumvirs.
Suppl. Ili. 87. a. Proferiptions exercées fous cc fécond triumvirat.
XIII. 493. b.
T R O A D E , ( Géogr. anc. ) 1°. contrée de l’Afie mineure :
fon étendue. 2". Ville de l’Afie mineure, dans la Troade*
Vifion que S. Paul eut dans cette ville , Sec. XVI. 681. b.
Troade : prodige arrivé dans les falincs de cc pays. V i f ,
409. b. Les filles de la Troade offroient leur virginité ait
fleuve Scamaiulre. X IV . 739, a.
T R O C , Échange, Permutation, { Synonym. ) différences
entre ces mots. X V I . 6S1. b. Voye^ Change.
T R O C A R , outroifquarrs, {Chir.) poinçon d’acier don»-
on fe lert en chirurgie. Sa defeription. X V I . 681. b. La conf-
truéHon de cet iriftrument pcrfeélionnée par M. Petit. Opérations
dans lefquclles on en fait ufage. Trocars de M
Foubert. Trocar que M. Petit a imaginé pour les contr’ou-
vertures ( Foye^ C ontr’ouverture ). Trocar pour ia
ponélion de la veffie. Ibid. 682. a.
T R O C H A N T E R , ( An.itom. j nom que l’on a donné i
deu.x apophyles, fiiuées à la partie fupérieure du fémur
appellees le grand 8c le petit trochanter. Leur fmiation. Etymologie
du mot, XVI. 682. b.
T R O CH ISQ U E , ( Pharmac. ) forme de remede , faite
]>our être tenue dans la bouche, 8c s’y diifoudre peu .à peu.
X V I . 682. h. Dift'érens noms des trochifqiies. Principaux
trochlfques. Les praticiens font peu d’ufage des trochifques.
Obfervations fur cette forme de remede employée par les
charlatans. Ibid. 683. a. Foyer^ T ablettes.
T rochisque efearrotique , ( Mat. médic. & Pharm. ) X V I .
6S3. a. Foyei MeRCURE. ^
T rochisque de minium, { Mat. médic.) XVI. 683 a
Foyei Mercure.
T rochisque de fc ilk , {M a t . m é d k .)X W l.6 îy a . Foyer
SCILLE. , ^
TR O C H ISQ U IE R , inftrument de pharmacie, vol. I lk
des planch. C h ym ie , pl. 13.
FRO CH IT E , ( Hifl. nat. ) fragment d’un corps mari« ,
ainfi nommé parce qu’il reffcmble à une petite roue. X V I.
683. a.
Trockites repréfentés, vol. V I des planch. Coquilles fuf-
lile s , pl. 2 . 3. D e leur origine. IV . 223. b. 224. a.
TR O CH L E A T E U R , ( Anatom. ) mufcle de ce nom
wyeç Oblique 8c OEil. Nerfs trochléateurs, voycr Pathétiques.
T R O C H O ID E , ( Géom.) defeription des courbes ainfi
nommées. X V I . 683. a.
TR O CH OM E TR E , ( Navig. ) ou mefurc de la courfe. Ce
mot a été appliqué à une machine propoféc en 1772 , pour
mefurer le fillage ou la viteffe des vaiffeaux en mer , 8c à
laquelle l’auteur a ajouté depuis, la propriété d’indiquer en
tout lems l’angle de la dérive. Defeription de cet inftrument,
Suppl. IV . 977. h. Ufage de cette machine pour la dérive.
Ibid. 978. a. Son ufage pour le fillage. Ses avantages fur le
Lok. Ibid. b. Auteur de cette ma.diine. Prix qu’il a remporté
T R O
à l’académie de Bordeau.x. La méthode des longitudes par
le moyen de la lune, commence à devenir d’un ufage ft fréquent
, qu’on ne fera peut-être bientôt plus obligé de mefurer
par le fxllage U viteffe d’un vaiffeau. Jbid. 979. a.
T R O C H U S , ( Gymnajl. médic. ) defeription de l’exercice
du trochus ou cerceau, en ufage chez les Grecs 8c chez les
Romains, 8c de deux efpeces de cerceaux qui fervoient a
cet exercice. X V I . 683. b.
T R O È N E , ( Boun. ) caraélcrcs de ce genre de plante.
Lieux où croit cet arbrilieau. Sa defeription. Son ufage dans
les jardins. Services qu’on tire des baies du troène pour les
ans. Qualité 8c ufage de fon bois. X V I . 684. a. Variciés du
troène. 1. Le noéiie commun. 2. Le troène panaché de jaune.
3. Le troène panaché de blanc. 4. Le iroènc toujours
verd. Ulhge des feuilles 8c des fleurs du troène en médecine.
Ibid. b.
Troène d'Egypte. Foyct^ A lC.'.na.
T llÛ É Z EN E , ou ftoét^cn , ( Géogr. anc. ) ville du Félo-
ponnefe dans l’Argolide. Dclcripiion que Paufanias donne
de cette v ille , des monumens qu’elle renfennoir, 8c des
chofes les plus reinarqu.nbles de fon territoire. X V I . 684. b.
Hiftoire des Troézéniens. Ibid. 6S6. a. Autres villes nommées
Troét^ene. Ibid. b.
T R O G L O D Y T E S , ( Géogr. ) peuples d’Ethiopie qu’on
dit avoir vécu dans des caves fouterreines. Etymologie de
leur nom. Troglodytes modernes , qu’on dit avoir vus à
Mahhe , en Italie , 8c en divers endroits des Indes. Troglodytes
eft encore le nom donné par Philaftre à tine fefle de
Juifs idolâtres, q u i, felon lu i, fc reiiroieiu dans des cavernes
fouterreines pour adorer des idoles. Obfervation contre
jpc femimenr de Philaftre. X V I . 686. b.
TR Û G R U D B E C K rétablit les califes Abalffides. Suppl. \.
16. a.
TROGU E-POMPÉE , hiftoricn latin. X V I I . 410. b.
T R O IA , {Geogr. anc. ) quatre villes de ce nom. XVI.
686. b. ,
T R O JA , {Géogr.) ville d'Italie au royatimc de Naples.
X V I . 687. J.
T R O IE , {Géogr.anc.) Fby«? Ilion. Horace appelle cette
vilie/ùcrec , 8c Virgile la nomme la demeure des dieux. Hiftoire
de cette ville. Origine de la guerre de Troie, X V I . 687. a.
Macliine de guerre employée par les Grecs pour renverfer
les murs de cette ville. Les ruines qu’on trouve dans le
quartier oil elle fut bâtie , font les ruines de la nouvelle
Troie , 8c non celles de l’ancienne. Defeription clc ces ruines.
inferiptions qu’on y trouve. Ibid. b. Terroir inculte des
environs de Troie. Oifeatix & autres animaux que ce p.ays
notirrit. Jbid. 688. a.
Troie. Royaume de Troie. X IV . 420. a. Cniifes de la
guerre des Grecs, contre les Troyens. V II . 912. Force de
farinée grecque. XIII. 89. a. Ifte derrière laquelle les Grecs
cachèrent leur flotte quand ils flrent femblant d’abandonr.cr
le ftege de Troie. X V I. 133. a. Du cheval de Troie. Suppl.
II. 389. b. V o y ez les noms des principaux héros qui fe
diftingucrent dans cette guerre.
T R O Y E N S , {Antiq. rom.) exercice militaire que
les jeunes gens de qualité célébrcieiit à Rome dans le cirque
à l’honneur d’Afcagnc. Defeription qu'eu a faite Virgile.
XVI. 688. U. Ces jeux renouvelles parAiiguftc, lorfqu’il célébra
l’apothéofe de Jiiles-Céfar. Adreffe de Virgile à faire
fa cour à l'empereur 8c à toute la nobleffe ro.mainc. Ibid. b.
TR O IS , ( A'ithm. ) X VI. 688. b.
Trois. Explication de la règle de trois. X IV . 21. é. XIIÎ.
1 6 4 .4 , b. Regle de trois inverfe. V III. 832. a. X IV . 22.4.
Regle de trois compofée. Ibid.
T rois conu, problème des, {Gèonièlr.) XIII. 4O2. 4.
• T rois, (philofoph. L itt.) ralfon deplüfieiirs cérémonies
qui fe répétoient trois fois de luite cliez les anciens. V llI .
88.4. Propriétés qiie les pythagoriciens artribuoientaii noinbrc
trois. XI. 203. E Ce nombre regardé comme parfait 8c faerc.
X V I . 160. b. 161.4.
T rois pour cent, ( Jurifpr. ) X V I. 6 8 8 , b.
T r o iscof/pj, {Ruban.) X V I .6 8 8 . é.
T rois öU4r/■ ^^ , (£/’cro«/2. ) XVI. 689.4,
T rois , iL'hx, un, {Blafon)X'J\.6%<). a.
T rois chapitres , Us, ( Hiß. cccl. ) c’eft ainfi qu’on a nomriié
les trois articles ; qui furent le fujet de tant de difpiites ec-
cléfiaftiques pendant tout le fixieme ficelé , 8c qVii regar-
doient Théodore de Mopfuefte. Condamnation des trois
chapitres en O rien t , tandis que l'Occident en prenoit la défenfe.
Réflexions fur la hivolité des conteftations qui a!)du-
tirent alorsà un fehiftne entre les églifes d'O rient Sc d’Occi-
Cttnt. Ibid. b. Foyer C hapitres, trois.
TKOis-églifs , (Ctog r.) lieu de Perfe. Monaftere de religieux
arméniens, fondé dans ce lieu. Beauté de la campagne
où ce monaftere eft bâti. XVI. 689. a.
TROIS-rivierej, {Géogr.) ville du Canada. X V I. 689. 4.
Trois-Echelles , nom d’un prétendu forcier. X V . 371. é.
TR OM B E , ( P hy f‘l- ) météore extraordinaire qui paroît
T R O Bt!
fin’ mer ; nuée condenféc , dont une partie ft- trouvant
oans un mouvement circulaire , canlé par deux vents op-
pofés , tombe par fon poids, iSc jirend la figure d’une co lonne.
Dét.iils Uir cc météore , tirés de la phylique de M.
MufTchenbrocck. X V I. 689, b. Lieux où les trombes ft>m le
plubfréqucmcs. Deux efpeccs de troml es félon M. de Bnfidn :
la premiere qui eft celle dont on vient de narler 8c l’autre
appellee typhon, qui au contmire de la premiere s’élève de
1.1 mer vers le ciel avec une grande violence. La caufe de
ce phénomène attribuée aux toux fouten’eins. Defeription
que donne Tliévcnor des trombes qu’il a obfervées clansfon
voyage du Ibid. 690. a , b. Danger (|ue courent les
'.’alffeaux fur Icfquels CCS trombes viennent. Defeription que
le Gentil donne des trombes, dans fon voy.-.ge autour du
monde. L’vfpecc de trombes décrite parues deux voyageurs
eft celle que nous avons appellee typhon. Ibid. 691. a. D e feription
de l'autre efpece de trombes , obfervées par M.
.Sliaw. Explication de ces phénomènes, félon M. deBulTon.
Ibtd. b. Trombe de terre qui parut en 1737 , à Capefinn ,
près de Béziers, Sc qui paioit encore différente des deux
précédentes. Irom be vue fur le lac de Géneve en 1741.
Ibid. 692. 4.
Trombe, v o ye z Dr.tgon , Efchillon , Pompe de mer , JUi-
chot fie Typhon. Phénomène de cette efpece qu’on obferve
fréquemment au cap de Bonnc-Efpèrance, XI. 396. a , b.
Caille des trombc.s. VII. 623. b. Trombes de mer repré-
lemèes vol. V des planch. Phylique, planclic 2.
T ho.mbe , ( Luth. ) defeription de cet inftrument de peicnf-
fion. Surpl. IV. 9 79 .4.
TRÜM M IUS , {Abraham) théologien proteflant. V II .
95^^- .
TR OM P , {Corneille) lictucnant-amiral-gcnéral des Pro-
ivinces-Unies. XIV. 3 8 1.4 , é.
TR OM P E , ( Conchyi. ) X V I . 692. b.
T rompes rft , (,^/7.imra.) canaux qui partent du
fond de la matrice , 6c qui aboutilTenr aux ovaires. Leur
defeription 8c leur ufage, Pourquoi ces canaux portent ie
nom de trompes de Fatlope. Les oeufs ou embryons (ont
quelquefois arrêtés dans les trompes de Fallope, fins pouvoir
defeendre dans la matrice. Exemples. X V I . 692. b.
Trompes de Fallope. Leur defeription. X. 199. b. Suppl.Wl.
866. b. Comment elles fe difpolènt an moment de la conception.
Suppl. III. 196. b. 197. 4. 198. 4. Ufage qu'on leur
a attribué. "VIL 364. a. 368. a. 369. a.
T rompe d'EuJlache, {A n at. ) canal de communication entre
la bouche 8c l’oreille.X V I. 693.4.
Trompe ef F.uJI.tche. XI. 612. b. 616. b. 703.4. Suppl.W. 178.
b. Son ufage. 210. a.
T rompe deTélépham , ( Zoôlog. ) IV, 839. h. V . 499. , b.
T rompe, {InfeHolog. ) partie delà b ondie des infeé'tes. V a riétés
dans cette partie , felon les diverfes effieces d’i’nfcéies. Ses
ufages. X V I. 693.4.
Trompedesinfeélis b. des abeilles , I. 19. a. des
mouches, X.y6e).b. 770. 4. des papillons. XI. 873.
T rompp , ( Archie. ) efpece de voûte en failiie qui ftinble
fe foutenir en l’air. Trompe dans l’ angle. X V I . 693. a,
Tro.Tipe de Montpellier. Trompe en niche. Trompe en tour
ronde. Trompe ondée. Trompe réglée. Trompe fur le coin.
Ibid. b.
T rompe, {Menuifter) trompe fur l’angle. Trompe fur
coin biais & en niche , vol. V I I des planch. McnnÜ'erie en
bâtimens, planche 20. Trompe en niche droite ,8c tour ronde
par-devant, furmème diamètre.Trompe rampante en niche,
planche 21.
T rompe , ( Pyrotechnie ) affemblage de phifieurs pots à feu,
les unsau-deffus des autres, 8c qui partent fuccc-ftivement. On
les emploie principalement dans les feux fur l’eau. XVI,
693. b.
Trompes, fa : ou baril de. X IV . 470. a.
T rompe ou Guimb.trde, ( Mercier ) forte d'iuftrumenc.
X V I . 693. b.
TR OM P E R , ( Gr4mm. Afuraft ) différence entre tromper,
leurrer , duper 6c furpreiulre. X V . 693. b. Combien font blâmables
ceux qui s’aimifent â tromper un enfant. V . 3 99. .4,
Tromper dans le commerce, en paroles, en écritures , en
aélions. VI. 440.4, b. Mensonge , I.viposture.
T romper ,■ ( M.iréch. ) tromperun cheval à la demi-volte
d’n ne ou dedeux prifes. X V I. 693. é.
T R OM P E T T E , oifeau, {Ornithol.) oifeau d’Amérique.
Pourquoi on lui a donné le nom de trompette. XVI. 694. a.
T rompette de mer, ( Ichtkyol. ) poiffon repréfenté vol. V I
des planch. Régné animal, planche 33.
T rompette, {Luth.) étymologie du nom de cet inftm-
ment. Métal dont on le fait. Différentes trompettes des anciens.
Defeription de la trompette moderne. Etendue du fon
de cet infiniment. Huit manières principales de fonner la
trompette à la guerre. X V I . 694. a. Ufage de la trompette
dans la muftque d’eglife, 8c même dans la mufique de chambre.
Défauts de cet inftrument. Ibid. b.