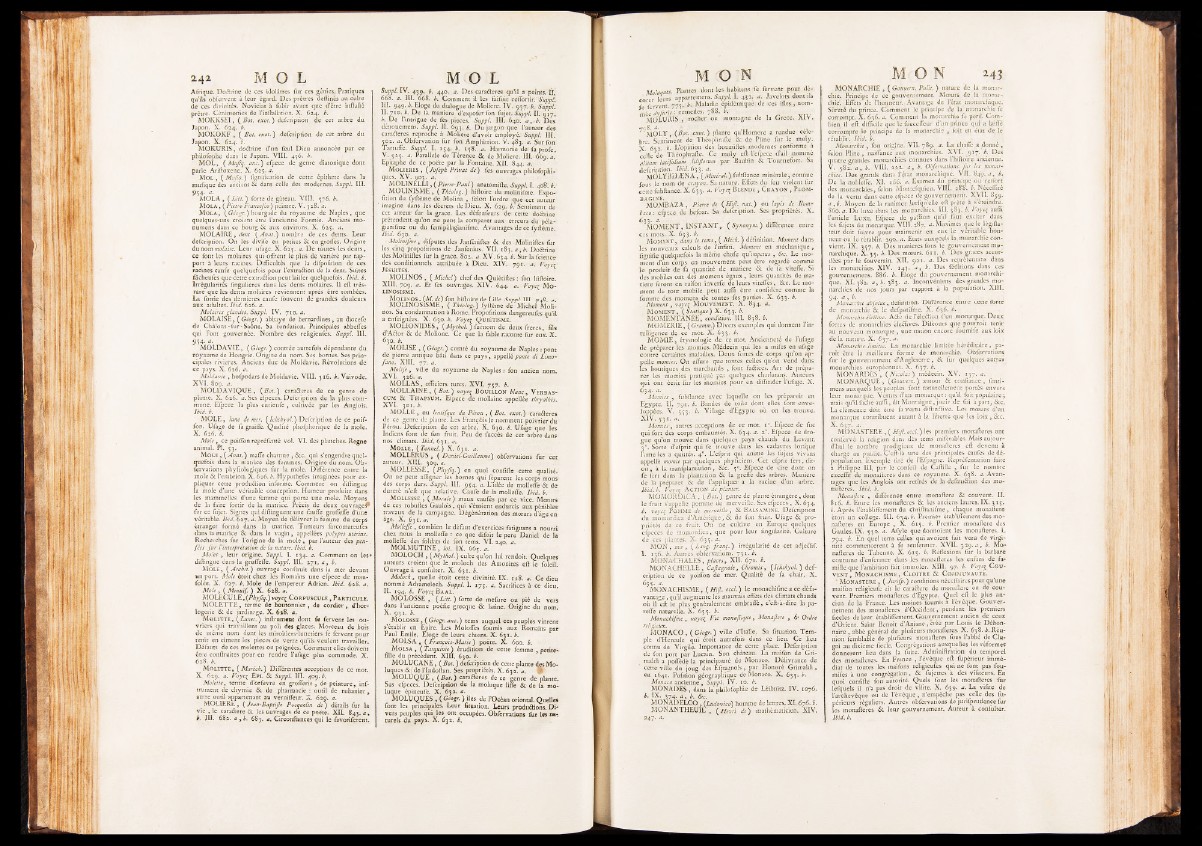
''■ Vt!'.
I f.iji
!" !
t i'
P't
: 1I'
M 111 'là
142- M O L
Afrique. Doffrine de CCS idolâtres fur ccs génies. Pratiques
qu'ils oblcrvcnc à leur égard. Des prêtres dellinés au culte
de CCS divinités. Noviciat à l'ubir avant que d’être inftallé
prêtre. Cérémonies de rinllall.ntion. X. 624. b.
M Ü K K S lil, (^Bot. (xo!.) defeription de cet atbre du
Japon. X. 624. b.
M O K Ü K F , ( Bot. fx o ï.) defeription de cet arbre du
Japon. X. 624. t.
M Ü K U R IS , doéiriiie d’im feul Dieu annoncée par ce
philofophe dans le Japon. VII I. 456. b.
M O L , {Mufiq. itm.) efpece de genre diatonique dont
parle Arillo.xene. X. 625..;.
Mo l , {^Mufîq.) fignjicntion de cette épithete dans la
mulique des ai:ci;.ns dans celle de.s modernes. III.
954. -7.
jMÜLA , ( Z/rr. ) forte de gâteau. M i l . 576. b.
Mola , ( Pkno rrjucefoo) peintre. V . 328. a.
Mo la, ( Gt.'gr,) bourgade du royaume de Naples, que
quelques-uns croient être l'anciinne Formle. Anciens mo-
numens dans ce bourg 6c aux environs. X. 623. n.
M Û L A IR lî, dent {Annt.') nombre de ces dents. Leur
defeription. On les divi(e en petites 6c en grolfes. Origine
du nom molaire. Leur ufage. X. 625. n. De toutes les dents,
ce font les molaires cmi oiTrenr le plus de variété par rapport
à leurs racines. Difficultés que la difpofition de ces
racines canfe quelquefois pour l’extraéllon de la dent. Suites
fâdicufes que cette extraflion peut laifiêr quelquefois. Ibid. b.
Irrégularités llngulicres dans les dents molaires. Il ell très-
rare que les dents mobiircs reviennent après être roinbécs.
La fortie des dernières caufe Ibuvent de grandes douleurs
aux adultes. lh:d. 626. a.
Molaires glandes. Suppl. IV. 710. a.
M O L AISE, (Geo^r.) abbaye de bernardines, au diocefe
de Cbâ!ons-liir-Saône. Sa tondation. Principales abbelTes
qui l’ont gouvernée. Nombre des religieufes. Suppl. 111.
‘2- , ,
iM OLD AVIE, (Gcdgr. ) contrée autrefois dépendante du
royaume de Hongrie. Origine du nom. Ses bornes. Ses principales
rivieres. Anciens duc de Moldavie. Révolutions de
ce pays. X. 626. a.
MoUavie , hofpodars de Moldavie. VIII. 3 16. b. Vaivode.
X V I . 809. <7.
M O L D A V IQ U E , (R o f.) caraiSeres de ce genre de
plante. X. 626. j .S e s elpeces. Deicription de la plus commune.
Efpc-cc la plus curieufe , cultivée par les Angiois.
Ibid. b.
M O L E , lune de mer. {^Icbthyol.') Defeription de ce polf-
fon. Ufage de fa graiife. Qualité pholphoriqiie de la mole.
X. 626. b.
MoU , ce poilTon repréfcitté vol. VI. des planciies. Régné
animal. Pl. 33.
Mole , malTo clurnue , 8cc. qui s’engendre quelquefois
d.ms la ivatiice des femmes. Origine du nom. Ob-
fervations phyfiologiqucs fur la mole. Dirterence entre la
mole 6c l’cmbrion. X. 6î6. i>. Hyporhefes imaginées pour expliquer
cctre prochiéfion inlorme. Comment on didingiie
la mole d’une véritable conception. Humeur produite dans
les mammelles d’une femme qui porte une mole. Moyens
de la faire fortir do la matrice. Précis de deux ouvrage^
fur ce fujet. Signes qui difttnguent une faulTe groffeile d’une
véritable. Ibid. 627. a. Moyen de délivrer la femme du corps
étranger formé dans la matrice. Tumeurs farcomateufes
dans la matrice 8c dans le vagin , appellées polypes utérins.
Rocheicbes fur l'origine de la m o le , par l’auteur des pen-
jées jur 1'interpretaùon de la nature. Ibid. b.
Moles , leur origine. Suppl. 1. 134. a. Comment on les*
dillingue dans la groffieffe. Suppl. III. 271. a , b.
Mole, {Archit.') ouvrage conflruit dans ia mer devant
Hiipori. étoit chez les Romains une efpece de mau-
folée. X. 627. b. Mole de l’empereur Adrien. Ibid. 628. <7.
Mole , ( Menuif. ) X . 628. a.
MOLF. CVLE,{PhyJ!q.)voyei CORPUSCULE , PARTICULE.
M O L E T T E , terme de boutonnier , de cordier , d’horlogerie
& de jardinage. X. 618. a.
Molltte , ) inrtrumem dont fe fervent les ouvriers
qui travaillent au poli des glaces. Morceau de bois
de même nom dont les miroiriers-lunetiers fe fervent pour
tenir en ciment les pieces de verre qu'ils veulent travailler.
Défauts de ces molettes ou poignées. Comment elles doivent
être conRruites pour en rendre Tufage plus commode. X
628. b.
Molette, {ALiréc/i.) DitTérentes acceptions de ce mot.
X. 629. a. Voyc^ Ép i . & Suppl. III. 409.
Molerte, terme d’orfevre en grolTerie , de peinture, inf-
trument de chymie 6c de pharmacie : outil de rubanier,
autre outil appartenant au verniireur. 'A. 629. <7.
M O LIER E, ( Jean-Baptifle Pocquelin de ) détails fur la
vie , le caraftere Sc les ouvrages de ce poète. XII. 843. a ,
b. III. 682. a , b. 6S3. a, Circonftanccs qui le favoriferem.
MO L Suppl.W. 439. b. 440, J. Des caraéieres Cju’il a peints. II.
668. a. l l i . 668. b. Comment il les faifoic reifortir. Suppl.
III. 949. b. Eloge du dialogue de Moliere. IV . 937. b. Suppl. 11. 710. h. De lii maniéré d’expofer fon fujet. Suppl. IJ. 9 1 7 .
é. D e l’intrigue de fes pieces. Suppl. III. 640. a , b. Des
deiiouemens. Suppl. 11, 693. />. Du jargon que l’auteur des
caraéleres reproche à Moliere d’avoir employé. Suppl. III.
502. a. Obfervation fur fon Ampliltrion. V. 483. a. Sur fon
Fartuffe. Suppl. 1. 154. b. 138. a. Haniumie de fapro fe .
y . 323. a. Parallèle de Terence 6c de Moliere. III. 669. a.
Epitaphe de ce poète par la Fontaine. XII, 844. a.
Molieres, (^Jojcph Privât de~) fes ouvrages phllofophi-
ques. X V . 903. a.
M O L ÏN E L L I ,( / ’ifrrc-TjK/) anatomifte. I, 408. b.
MOLINISME , ( Tkéolog. ) hifloire du molinifme, Expo-
lîtion du fyilêmc de Molina , felon l'ordre que cet auteur
imagine dans les décrets de Dieu. X. 629. b. Sentiment de
cet auteur lur la grace. Les ciéfenfeurs de cette doéh'iue
prétendent qu’on ne peut la comparer aux erreurs du pêla-
glanilnie ou du fcinipélagianifme. Avantages de ce lyhème.
Ibid. 630. a.
Molinifme, difputes des Janfénifles 6c des Moliiiiftes fur
les cinq propollrions de Janfenius. V i l. 183. ,z,^. Doélrine
des Moliniftes fur la grace. 802. a X V . 634. b. Sur la fcience
des conditionnels attribuée à Dieu. XIV, 791. a. Poyc^
JÉSUITES. ^
M O L IN O S , (Michel) chef des Quiétifles : fon hidoire.
X l l l . 709. a. Et fes ouvrages. X IV . 644. <7. Payer MOLINOSISME.
Molinos,(M .zfc) fon hiftoire de L i l l e . I I I . 748. a.
M O L IN O S ISM E , ( Théolop. ) fyllêine de Michel Moli-
nos. Sa condamnation a Rome. Propofitions dangereufes qu’il
a enfeignées. X. 630. i. Poye^ Q uiétisme.
M O l IO NID ES, (M y iho l.) {un\om de deuxfrere s, fils
d’A d o r 6c de Mollone. Ce que ia fable raconte fur eux. X .
650. b.
MOLTSE , (Géogr.) comté du royaume de Naples ; pont
de pierre antique bâti dans ce p a y s , appelle/»e/tn; di Limo-
fano. XIII. 77. a.
Molijè , vil.e du royaume de Naples : fon ancien nom.
X V I. 326.
M O L L A S , officiers turcs. X V I . 737. b.
M O L L A IN E , (B o t .) voye^ Bouillon blanc, V erbas-
CUM 6c T hapsum. Elpece de mollainc appellee thryalhis.
X V I . 301. b. ^
M O L L E , ou lentifquc du Pérou , (Bo t. exot.) carafteres
de ce genre de plante. Les François le nomment poivrier du
Pérou. Defeription de cet arbre. X. 630. b. Ufage que les
Indiens font de fon fruit. Peu de fuccès de cet arbre dans
nos cliitiats. Ibid, 631. a.
Molle, (Tonnel.) X. 631, a.
MOLLEKUS , ( Daniel-Guillaume) obfcrvations fur cct
auteur. XIII. 309. a.
MOLLESSE, (P h y fq .) en quoi confirte cette qualité.
On ne peut affigner les bornes qui féparent les corps mous
des corps durs. Suppl. 111. 934. a. L'idée de molleffe 5c de
dureté n’ert que relative. Caufe de ia mollelTe. Ibid. b.
Mollesse , (Morale) maux caufés par ce vice. Moeurs
de ces robuftes Gaulois, qui s’étoient endurcis aux pénibles
travaux de la campagne. Degénération des moeurs d'âge en
âge. X. 631. a.
Mollejfe , combien le défaut d’exercices fatigiians a nourri
chez nous la mollelTe : ce que difolt le pere Daniel de la
mollelTe des foldnts de fon tems. V I. 240. a.
M O LM U T IN E , loi. IX. 663.
M O LO CH , (A/yMo/.) culte qu’on lui rendoit. Quelques
auteurs croient que le moloch des Amonites eft le foleil.
Ouvrage à confulter. X. 631. b.
Moloch, quelle étoit cette divinité. IX. 128. a. C e dieu
nommé Adramelech. Suppl. I. 173. a. Sacrifices à ce dieu.
II. 194. b. /^oyq B a a l .
MO LO SSE , (L u t . ) forte de mefure ou pié de vers
dans l ’ancienne poéfie grecque & latine. Origine du nom.
X. 931, b.
Molosse, (Géogr. anc.) tems auquel ces peuples vinrent
s’établir en j^ irc. Les MololTes fournis aux Romains par
Paul Emile. Eloge de leurs chiens. X. 631. h.
M O L S .4 , ( Fr.tnçois-Marle ) poète. X. 600. b.
Molsa , (Tarquinie) érudition de cette femme , petite-
fille du précédent. XIII. 630. b.
M O LU C A N E , ( Bot. ) defeription de cette plante des Mo-
luques 6i de l’Indoflan. Ses propriétés. X. 632. a. 'y-
M O LU Q U E , (Bot. ) carafteres de ce genre de plante.
Sss efpeccs. Defeription de la moluque liflè & de la mo-
luque épineufe. X. 632. a.
M O LU QU ES , ( Geogr. ) îles de l’Océan oriental. Q uelles
font les principales. Leur fituation. Leurs produéHons. D ivers
peuples qui les ont occupées. Obfcrvations fur l«s oa:
turçls du p»ys- X, 632. b.
M O N M O N
Mo'uqitts-
243
ruiu--- Phii’ f'îs dont les habituns fe fervent pour dé-
co-er ïciirs apparicmens. S/i/i/i/. 1. 432. a. Javelots dont ils
<■ 'V ivent. 77S. b. Maladie épidemique de ces iflo s ,nom-
m ù d \ fu r ic: rernedes. 78S. b.
MÜLURIS , rocher ou montagne de la Grèce. X i v .
^’ M O L Y , (Bot. exot.) planre qu’Homere a rendue célèbre
Sentiment de Théoplirade 6c de Pline fur le moly.
X 6'’ 2. b. L’opinion des boianihes modernes conforme .à
cclleVle Théophralle. Ce moly cfl l’efpece d’ail nomme
r-llntm latifoliuni lilijlorun: par Bauhin & Touriiefort. Sa
deferiotion. Ibid. 633. a.
M Ô L YB îJÆNA , ( Af/>?cr.7/.) fubftancc muicrale, comme
fous le nom de cr.iyon. S.i nature. Eftêcs du feu violent fur
tetee fiiblbnce. X. 633. a. Poyci Blende , C rayon , Plombagine.
M O .M B AZ A, Pierre de (H iß . nat.) ou lapis de Born-
l.u-o: clpeee de befoar. Sa defeription. Ses propriétés. X.
M i O M E N T , IN S T A N T , ( 5 )vm/iyn:.) dilTérenee entre
ces mots. X. 633. /’■ v , -
Moment, dans le tems, ( Méch. ) dchnition. Moment dans
les nouveaux calculs de l’infini. Moment en méchanique ,
fi^^nifie quelquefois la mérite chofe egyt impetus , &c. Le mo-
.. . ment d'un corps en mouvement peut être regardé comme
I 3 le produit de fa quantité de matière 6c de fa vitefle. Si
'■ ^ des mobiles ont des momens égaux, leurs quantités de matière
feront en raifon inverfe de leurs vitefles, 6cc, Le moment
de tout mobile peut auffi être confidéré comme la
fomme des momens de toutes fes parties. X. 633. b.
Moment , voyeg MOUVEMENT. X. 834. a.
Mo.MENT, (Statique) X. 633. b.
M OM EN TA N É E , condition. III. 838. b.
MO.MERIE, ( G ’-.imm.) Divers exemples qui donnent l’in-
celligcnce de ce mot. X. 633. b.
M OM IE , étymologie de ce mot. Ancienneté de l’uftge
de préparer les momies. Médecin qui les a miles en ufage
contre certaines maladies. Deux forces de corps qu’on appelle
momies. On affiire que toutes celles qu’on vend dans
les boutiques des marchands , font faétlces. A rt de préparer
les momies pratique par quelques charlatans. Auteurs
qui ont écrit fur les momies pour en dilTuader l’ufage. X.
634. a.
Momies , fubfiance avec laquelle on les preparolt en
Egypte. II. 791. b. Bandes de toile donc clics font enveloppées.
V . 335, b. Village d’Egypte où on les trouve.
X IV . 331. <7.
Monr.es, autres acceptions de ce mot. i^. Efpece de fuc
qui fort des corps embaumés. X. 634. a. 2". Efpece de drogue
qu’on trouve dans quelques pays chauds du Levant.
3". Sorte d’cfprit qui fe trouve dans les cada\res lorfque
l ’ame les a quittés. 4“ . L’cfprit qui anime les lujcts vivans
appelle momie par quelques phyfieiens. Cet efprii fert,dic-
011, à la tranlplamaiion, 6cc. 3". Efpece de cire donc on
fe l'ert dans la planiaiion 6: la greffe des arbres. Manière
de la préparer ÖC de l'appliquer à la racine d’un arbre.
Ibid. b. Poyeg ACTION de planter.
M OM O R D iC A , ( Bot. ) genre de planre énrangere, dont
le fruit s’appelle pomme de mervci'.lc. Ses elpeces, X. 634.
b. voyeg^ POM.VIE de merveille, & B.alSAMINE. Defeription
du momordiea d’Amérique, 6c de fou fmir. Ufage 6c propriétés
de ce fiult. On ne cultive en Emope quelques
cfpcces de momordica , que pour leur Imgularité. Culture
de ces plantes. X. 633. .7.
MON , rn.i , ( Z.zi’tg. franc. ) irrégularité de cet adjcélif.
1. 136. h. Autj-cs übfervations. 731- b.
MÜNACTLALES, places, X ll. 671. b.
MONA.CHELLE , Caftagnole, Chromis, (Ickihyol.) def-
criptiou de ce poiffon de mer. Qualité de la chair. X.
633. a.
M O N A CH ISM E , (H i f . eccl.) le monachifme a ce défa-
vamage , qu'il augmente les mauvais efiets des climats chauds
où il cil le plus généralement embrailé, c’cfl-à-dire la pa-
reflè naturelle. X. 633. b.
Monachifme , voyc^ Vie monafique, Monafcrc , & Ordre
M O N A C O , (Géogr.) ville d’Italie. Sa fituation. T emple
d'Hcrculc qui étoit autrefois dans ce lieu. C e lieu
connu de Virgile. Importance de cette place. Defeription
de fon port par Lucain. Son cliâteau. L:i maifon de Grimaldi
a polTédé la principauté de Monaco. Délivrance de
cette ville du joug des Kfpagnols , par Honoré Grimaldi,
en 1641. Püfition géographique de Nlonaco. X. 635. b.
Mon.tco ancienne, Suppl. IV. 10. b.
MONADES , dans la piiilofophie de Léibiûtz. IV . 1076.
b. IX. 374. a , b. 6-e.
'v lON AD E LCO , (Ludovico) homme de lettres. XI. 676. b.
M O NANTHEU IL , (Henri d e ) mathématicien. XIV.
M O N A RCH IE , ( Gouvem. Polir. ) nature de la moir/--
cliic. Principe de ce gouvernement. Moeuis de la mon.u-
thie. Effets de rhoiineur. Avantage de l’état inonardiiquc.
Sûreté du prince. Comment le principe de la monarclrie fe
corrompt. X. 636. a. Comment la mouarchie fe perd. Combien
il eft difficile que le fucceffeur d’un prince qui a lailTé
cori'ümpfe le principe de la moiiarchi': , Ibit en état de le
rétablir. Ibid. b.
Monarchie , fon origine. VII, 789. a. La cliaffc- a donné ,
félon Pline , naiffance au.x monarchies. X^’ I, 917. b. Des
quatre grandes monaiciiics connues clans l’Iiifloirc ancienne.
V . 382 .7, b. V llt . 222. .7, b. Ohfervations fur Us monar-
chics. Des grands dans l’éiat monarchique. VJI. 849. a , b.
De la nobleffe. XI. 166. a. Examen du |>rincipc ou reliort
des monarchies, felon Mmuefquicu. Y 111. 288. NécefTué
de la verm dans cette cfpuce de gouvernement. XVII . 859.
a , b. Moyen de la ranimer iorrqu’clle efl prête a s éteindre.
860. U. Du luxe clans les moirarcliics. 111. 3S3. b. I oye^ audi
l’article LuXE. Efpece de pa.ffion qu’il faut cxdtcr dans
les fujcts du monarque, V ü l , 287. u. Maximes cjue le légffia-
teiir doit fuivre pour malmcniv en eux le véritable honneur
ou le rétablir. 290. a. Etats auxcujels ia monardile convient.
IX. 337. b. Des maniérés fous le gouvernementmo-
nardiique. X. 3 3. é. Des moeurs. 6 i I. b. D e s graces accordées
par le fouverain. XII. 921. a. Des repreientans dans
les monarchies. X lV . 143. .7, t. Des féditions dans ces
gouvernemens. 886. b. Eloge du gouvernement monarclii-
que. XI. 382. a, b. 383. a. 'Iiiconvéniens des grandes monarchies
de nos jours par rapport à ia population. X l l l .
94. a , b.
Monarchie j/;/ù/«r, définition. Différence entre cette forte
de monarchie 6c le defpotifme. X. 636. b.
Monarchie éUaive. A d e de l’éleélion d’un monarque. Deux
fortes de monarchies éleRives. Difeours que poiirroii tenir
au nouveau nionarc|ue , une nation encore foumife aux loix
de la nature. X. 637. a.
Monarchie limiièe. La monarchie limitée héréditaire, pa-
roît être la meilleure forme de monarchie. Obfèrvations
fur le gouvernement d’Angleterre , 6c fur quelques autres
monarchies européennes. X. 637. b.
ÎÿIONARD ÈS , ( N lcoLic ) médecin, X V . 137. a.
M O N A R Q U E , (Gotive;/;.) amoui & confiance, fenti-
mens auxquels les peuples font naturellement portés envers
leur monarque. Venu s d’un monarque : qu’il folt populaire j
maii qu’il fache auffi, dit Montaigne, jouir de foi à part, 6cc.
La clémence doit être f.i vertu diilmflivc. Les moeurs d’un
monarque contribuent autant à la liberté que les ioix , Scc.
X. 637. .7.
MONASTEPcE , ( Hiß. eccl. ) lès premiers monafieres ont
confervé la religion dan^ dis tems miferab’es. Mais aujourd'hui
le nombre prodigieux de monaflevcs eft devenu à
charge au puLlic. Cc ft-là une des principales caufes de dépopulation.
Exemple tiré de TEfpagne. liepréfcntation faite
à Fhilippe III. par le confeil de Caftilie , fur le nombre
exceffif de monafteres dans ce roy.iumc. X. 638. a. Avantages
que les Angiois ont retirés de la deftriuftion des mo-
nalleres. Ibid. b.
Monaflere , différence entre monaftere 6c couvent. IL
816. b. Entre les monafteres 8c les anciens laures. IX. 3 13.
b. Après l’écabliffement du chriftianifme , chaque monaftere
étoit un college. lU. 634./«. Premier étab'iffement des mo-
nafteies en E'urope , X. 613. b. Premier monaftere des
Gaules. IX. 330. a. A fyle que donnoient les monafteres. I.
794. b. En quel lems celles qui avoicnc fait voeu de virginité
commencèrent à fe renfermer. X V II . 319. .7, b. Monafteres
de Tabennc. X. 613. b. Réflexions fur la barbare
coutume d'enfermer dans les monafteres les enfans de famille
que l’ambition fait immoler. X ü l. 97. b. Poyeg_ Couvent
, Monachisme, C loître 6c Communauté.
MONASTERE , ( Jurifp.) conditions néccllair^s pour qu’une
nialfon religieufe ait le caraftere de monaftere ou de couvent.
Premiers monafteres d’Egypte. Quel eft le plus ancien
de la France. Les moines fournis à l'évêque. Gouv ernement
des monafteres d'Occident, pendant les premiers
fieclos de leur établiffenient. Gouvernement ancien de ceux
d’Orieiu. Saint Benoît d’Aniane , créé par Louis le Débonnaire
, abbé général de pluficurs monafteres. X. 638. b. Réunion
fcmblable de plufieurs monafteres Ibus labbe de Clu-
gni au dixième fieclc. Congrégations auxquelles les réformes
donnèrent lieu dans la fuite. Adminiftration du temporel
des monaftere.s. Eu France , l’évéquo eft fupérieur immédiat
de toutes les inaifons religieufes qui ne font pas fou-
mifes à une congrégation , 6c lujettes à des vifiteurs. Eu
quoi confifte fon autorité. Quels font les monafteres fur
lefquels il n’a pas droit de vifite. X. 639. a. La vifite de
l’archevêque ou de l’évéquc , n’empêche pas celle des fu-
périeurs réguliers. Autres obfervatious de jurifpnidence fur
les monafteres 6c leur gouvernement. Auteur i confulter.
Ibid. b.