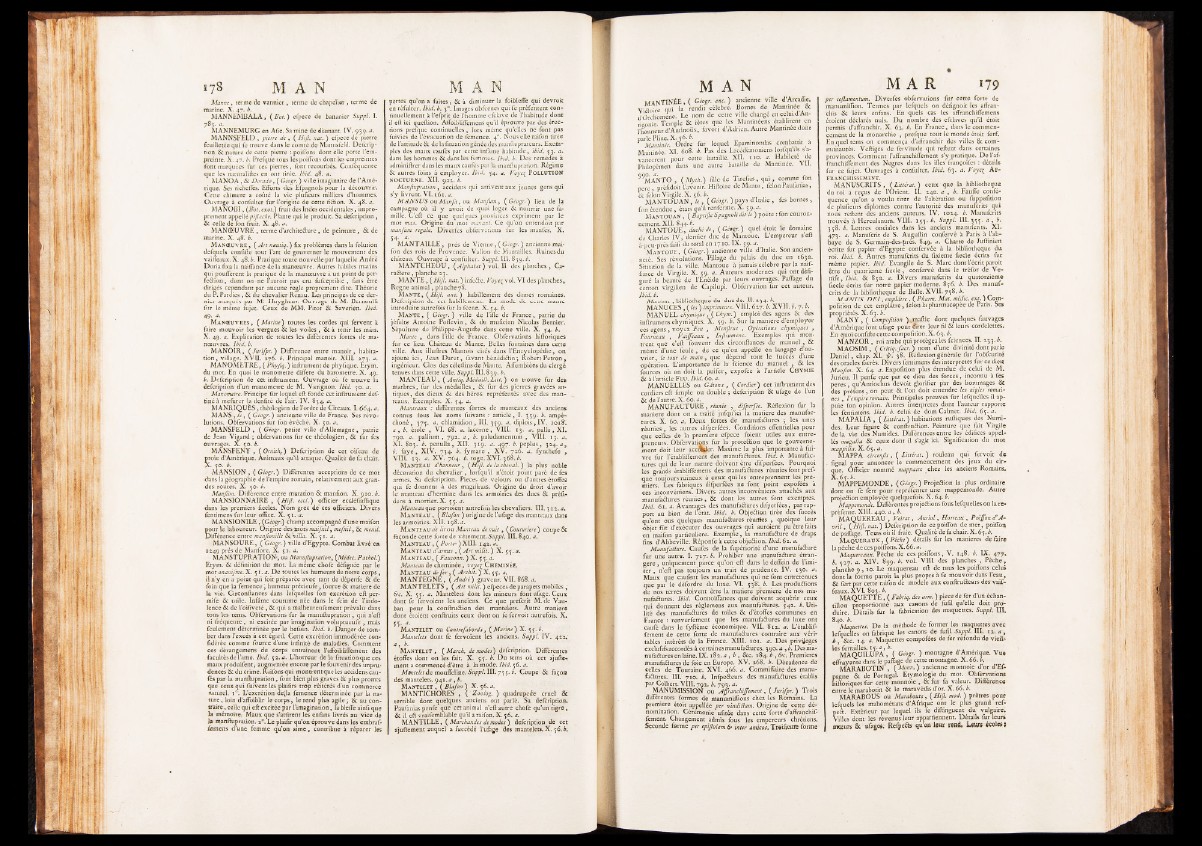
TW W
178 M A N M A N MAN MAR 179
.1 it
Ml: Mi
1' l! ^
Mjnne, terme dc vannier, terme de chapclijr , terme de
marine. X. 47. h.
M AN N KM liA L A , {B o t.) efpeee de bananier Suppl. 1.
785.
AlANNEMURG en Aiic. Sa tnine de diamant. IV. 939. j .
MANNSFELD . pierre de , ( Hijh uai. ) cl'pecc de pierre
feuilletée qui le trouve dans le coimé de Maniibtcld. Del'crip-
tion & nature de cette pierre : poilTons dont elle porte l’em-
preime. X. 47. b. Frel'que tous les poifl'ons dont les empreintes
font marquées fur ces pierres, font recourbes. Conl'ccjuence
que les naturalises en ont tirée. Ibid. 48. a.
M A N Ü A , & Dor.tdü, ( Geo^r. ) ville imaginaire de l’Amérique.
Ses riclielTes. Efforts des Elpagnols pour la découvrir,
('eue cliiffierc a coûté la vie plufieurs milliers d’hommes.
Ouvrage à confultcr fur l’origine de cette fidion. X. 48. u.
M A N O B I , (.^0/. fruit des Indes occidentales, improprement
appellepijhche. Plante qui le produit. Sa defeription ,
&. celle de fon fruit. X. 48. .1.
M ANOE U V R E , terme d’archiiefrure , de peinture, 8c de
marine. X. 48. b.
M an i îu v r e , ( .An nAutiq. ) fix problèmes dans la foluiion
delquels confiile tout l'art de gouverner le mouvement des
vailfeaux. X. 48. b. Pratique toute nouvelle par laquelle André
Doria fixa la nailTance de h manoeuvre. Autres habiles marins
qui pou/Terent la pratique de la manoeuvre à un point de per-
feélion, dont on ne l’auroit pas cru fiifceptib.e , fans être
dirigés cependant par aucune regle proprement dite. Théorie
du P. Pardies, Sc du chevalier Renau. Les principes de ce dernier
attaqués par M. Huyghens. Ouvrage de M. Bernoulli
f’ir le même i'ujet. Ceux de MM. Pitot & Saverien. Ibid.
49-
Manoe u v r e s , {Marine) toutes les cordes qui fervent à
faire mouvoir les vergues 8c les voiles , 8c à tenir les mâts.
X. 49. a. Explication de toutes les dhférentcs fortes de manoeuvres.
Ibid. b.
M A N O IR , {Jarifpr.) Différence entre manoir, habitat
io n , village. XVII. 276. b. Principal manoir. X llI . 273. a.
M AN OM E T R E , ( Pkyjiq. ) inlirumem de phyfique. Etym.
du mot. En quoi le manomètre différé du baromètre. X. 49.
b. Defeription de cet inflrument. Ouvrage où fe trouve la
defeription d'un manomètre de M. Vangnon. Jbid. 30. a.
Maromtire. Principe fur lequel eft fonde cet inllrument def-
tinéà mefurcr la denfité de l'air. IV . 834. a.
MANRIQU ÈS , théologien de l'ordre de Citeaux. I, 664. a.
MANS , A , ( Géogr. ) ancienne ville de France. Ses révolutions.
Obfervations fur fon évêché. X. 50. a.
MANSFELD , ( Géogr. petite ville d’Allemagne, patrie
de Jean Vigand ; obfervations fur ce théologien, 8c fur fes
ouvrages. X. 30. b.
MANSFENY , ( Omithj ) Defeription de cet oifeau de
proie d’Amérique. Animaux qu’il attaque. Qualité de fa chair.
A. 30. b.
MANSION , ( Géogr.) Différentes acceptions de ce mot
dans la géographie de l’empire romain, relativement aux grandes
routes. A. 30. b.
Mdnjion. Ditférence entre mutation 8c manfion. X. 910. b.
MANSIONNAIRE , {Hi^. eocl.) officier eccJéfiaRique
dans les premiers fiecles. Nom grec de ces officiers. Divers
fentimens fur leur office. X. 31. a.
M AN S IO N IL E , (Geogr.) champ accompagné d’une maifon
pour le laboureur. Origine des mots maifnil^ mefnil, 8c menil.
Différence entre m.infionilU SrLVdla. X. 5 1. 4.
M AN SO U R E , ( Géogr. ) ville d’Egypte. Combat livré en
1249 prés de Manfore. X. 31. j .
MAN STU PR A T IO N ', ou Manußupration, {Médec. Patholé)
Etym. 8c définition du mot. La même chofe défignée par le
mot onanifme. X. 51. a. D e toutes les humeurs de notre corps ,
i ln y en a point qui foit préparée avec tant de dépenfe 8c de
foin que la femence , humeur précieufe , fource 8c maciere de
la vie. Circonfrances dans lel'quelles fon excrétion ert per-
mife 8c utile. Infâme coutume née dans le fein de l’indolence
8c de l'oifiveté , 8c qui a malheureufemem prévalu dans
tous les tems. Obfervations fur la manulhipration , qui n’eft
ni fréquente , ni excitée par imagination voliiptucufe , mais
feulement déterminée par le befoin. Ibid. b. Danger de tomber
dans l’excès à cet égard. Cette excrétion immodérée con-
fidérée comme fource d'une infinité de maladies. Comment
ces dérangemens du corps entraînent I’affoibliffemcnt des
facultés de fam e ./éid. 32.4. L'horreur de la fituationque ces
maux produifem, augmentée encore par le fouvenir des imprudences
8c du crime. Raifons qui montrent que les accidens cau-
fés par la manftupration, font bien plus graves 8c plus promts
que ceux qui fuivent les plaifirs trop réitérés d'un contmerce
naturel. 1". L’excrétion de^la femence déterminée par la nature
, loin d'affoiblir le corps, le rend plus agile ; & au contraire
, celle qui eft excitée par l’imagination, la bléffe ainfi que
la mémoire. Maux que s’attirent les enfans livrés au vice de
la manftupration. a°. Le plaifir qu’on éprouve dans les einbraf-
femens d'une femme qu’on aime, contribue à réparer les
pertes qu’on a faites. 8c à diminuer la foibleffe qui devroit
en réfultcr. Ibid. b. 3". Images obfccncs qui fe préfentent continuellement
à l’efprit de l’homme efclave de l’habitude dont
il ell ici queftion. AffoiMilfemens qu’il éprouve par des érections
prcl'que continuelles, lors même qu’elles ne font pas
fiiivies de l'évacuation de femence. 4''. Nouvelle raifon tiree
(le l’attitude 8c de la fituation genée des manftuprateurs. Exemples
des maux caufés par cette infâme liabitude, ibid. 33. 4.
dairs les hommes 8c dans les femmes. Ibid. b. Des romedes à
dminiftrer dans les maux caufés pat h manlUipration. Régime
Sc autres foins .à employer. Ibid. 34, u. f'oyei^ Po llu t io n
NOCTURNE. XII. 922. b.
M.irijlup’ iliion ^ accidens qui arrivent aux jeunes gens qui
s 'y livrent. VI, 16 1.4.
M A N SU S Q\\ M.infa, ü\i Manjuin , {Géogr.) lieu de la
campagne où il y avoir de quoi loger 8c nourrir une famille.
C ’eft ce que quelques piovinces expriment par le
mot mas. Origine du mot manant. Ce qu’on ciuciuioit p.ir
manfum regale. Diverfcs obletvetions lur les m.mfes. X.
34, 4.
M A N T A IL L E , près de Vieiiue, ( G.-ng/-. ) ancienne maifon
des rois de Provence. Vallon de Mantatlles. Ruines du
château. Ouvrage à eoniiiher. Suppl. III.839.
M AN T CH EO U , {Alphabet) vol. Il des planclies , Ca-
raéiere, planche 23.
M AN T E , ( Hiß. nat. ) infeéle. Voye^^ vol. V I des planches.
Rogne animal, planche 78.
Mante, {H iß . anc.) habillement des dames romaines.
Defeription de cet liabillement. L.i mode de cette mante
introcliiite autrefois fur la fceiie. X. 34. b.
Mante , ( Géogr. ) ville de l’ifle de France, patrie du
jéfiiite Antoine Polfevin , 8c du muficien Nicolas Bernier.
Sépulture de Philippe-Augufte dans cette ville. X, 34. b.
Mante , dans l'iilo de France. Obfervations hlftoriques
fur ce lieu. Château de Mante. Belles fontaines dans cette
ville. Aux illullres Mamois cités dans l’Encyclopédie, on
ajoute i c i , Jean D a r c t , favant bénédiéiin 3 Robert Petron ,
ingénieur. Clos des célellins de Mance. Aifembiées du clergé
tenues dans cette ville. Suppl. 111. 839. b.
M A N T E A U , { Antiq.Mcdaill.Liri.) on trouve fur des
marbres, fur des médailles, 6c fur des pierres gravées an-
tiqiie.s, des dieux 8c des héros repréfentés avec des manteaux.
Exemples. X. 34. a.
ALtnceaux : différentes fortes de manteaux des anciens
connus fous les noms fuivans : am id e , I. 339, b. ampé-
choné , 373. a. chhiniidioii, III. 339. a. di|)lois, IV . 1018.
a , b. étolc , VI. 68. a. lacerne, VII I. 13. a. palla , XI.
790. 4. pallium, 792. a , b. paludamentimi , V llI . 13. 4.
XI. 805. b. penulla, XII. 319. a. 497. b. pépins, 324. 4,
b. faye , X IV . 734. b. fymare , X V . 726. a. fynihefe ,
V l i l . 13. 4. X V . 764, b. toge. X V I . 368. E
Manteau d'honneur, {Hiß. de la cheval.) la plus noble
décoration du chevalier , lorfqu’il n’étoit point pavé de fes
armes. Sa defeription. Pieces de velours ou d’aimes étoffes
qui fe donnent .à des magiilracs. Origine du droit d’avoir
le manteau d'hermine dans les armoiries des ducs 8c préft-
dens .à mortier.X. 33. a.
Alanuati que portoient autrefois les chevaliers. III. 312.4.
Manteau , {Blafon ) origine de l’ufage des manteaux dans
les armoiries. X ll, 198.4.
Manteau de lit ou Manteau de nuit , {Couturière ) coupe &
façon de ceitc foi te de vêtement. Suppl. III. 840. a.
Manteau , ( Pone- ) XIII. 142. a.
Manteau d'armes , {Art milit. ) X. 33. a.
Manteau, ( Faueonn. ) X. 3 3.4.
Aianteaudt cheminée, voye^ Cheminée.
Manteau defer, ( Archit.) X.33. a.
M A N T E G N E , {A n d ié ) graveur. VII. 868.4.
M AN T E LE T S , ( Art milit. ) efpeces de parapets mobiles ,
frc. X. 33. 4. .Mantelets dont les mineurs font ufage. Ceux
dont fe fervoient les anciens. Ce que preferit M. de Vau-
ban pour la conftruéUon des mantelets. Autre maniéré
dont étüieni conftruits ceux dont ou fe fervoit autrefois. X.
Mantelet ou Comrefabords, {Alarine) X. 33. b.
Mantelets dont fe fervoient les anciens. Suppl. IV . 422;
4 , b.
Mantelet , ( March, de modes) defeription. Différences
étoffes dont on les fait. X. 33. b. Du tems où cet ajuft«-
mem a commencé d’être à la mode. Ibid. 36. a.
A/ji-iff/crde mouffeline. III. 733. t!». Coupe Sc façon
des mantelets. 941.4 , b.
Mantelet, {B lafon) X. 36.4.
M ANT ICHO RES , ( Zoolog. ) quadrupède cruel 8c
terrible dont quelques anciens ont parlé. Sa defeription.
Paufanias penfe que cet animal n’cft autre chofe qu’un tigre ,
Sc il cft vraifemblable qu’il a raifon. X. 36. a.
M A N T IL L E , {Marchandes démodés) defeription de cet
ajuftemeni auquel a fuccédé l’ufagc des mantelets. X . 36.0«
MANT INÉ E, ( Géogr. anc.) ancienne ville d’Arcadie.
V frolre ciui la rendit célèbre. Bornes de Mantmce Sc
aô.'chomcnc. Le nom de cctce ville change en celui d’An-
'•'oiiic Temple Sc rétes que les Maïuincens établirent en
l'honneur d’Ancinoiis, favori d’Adrien. Autre Maiitinéc dont
parle Pline. X . 36. ,
Alantinée. Ordre fur lequel Epanimondas combattit^ a
Mantinée. XL 608. b. Pas des Lacédémoniens lorfqu’ils s’a-
vanecrent pour cette bataille. XII. i i o . a. Habileté
Philopcmen dans une antre '.....a.'ille de Maïuinée. VU.
M.'VNTO , {M yth.) fille de Tirefias, q u i, comme fon
pere", pvéfidoit l’.ivcnir. Hiftoire deManto , félon Paufanias,
8c félon V iig ilc .X . 36. f».
M A N T O U A N , le , { Géogr. ) pays d Italie , fes bornes ,
fon étendue , états qu’il renferme. X. 39.4.
M a n ïOUAN , ( Baptijle Sp.tgnoli dit le ) poète : fon couronnement.
XII. S44. é. , . • 1 1
M A N T O U E , duché de, {Geogr.) quel etoit le domaine
de Charles IV , eternier duc de Mantoiie. L’empereur s’eft
à'-pcu-présfaifi’d n t o t a le n iy io . lX . 39.4.
M antou e , {Géogr.) ancienne ville d Italie. Son ancienneté.
Ses révolutions. Pillage du palais du duc en 1630.
Situation de la ville. Mantoue à jamais célébré par la naif-
fance de Virgile. X. 39. a. Aiucurs modernes qui ont défiguré
la beauté de l’Enéide par leurs ouvrages. Paffage du
eemon virgilien de Capilupi. Übfervaiion lur cet auteur.
ibtd. b.
Mantoue , bibliothèque du duc de. II. 254. b.
MANUCES , { l e s ) imprimeurs. VIII. 627. b. X V II . b. 7. b.
MANU EL chymtquc, {Chym.) emploi des agens 5c des
in ftrumenschymiques. X. 39. b. Sur la manière d’employer
ces agens, v o ye z Feu , Aicnjhuc , Opérations chymiques ,
Fourneau , Vaijfeaux , Infirumens. Exemples qui montrent
que c’eft fouvent des circonftances de manuel , 8c
même d’une feule , de ce qu'on appelle en langage d’ouv
rier, le tour de main, que dépend tout le luccès d’une
opération. L’importance de la fcience du manuel , 8c les
fources où on doit la puifer, expofée à l’article C h ym iE
8c l’article F tu . Ibid. 60. a.
MANUELLES ou Gâtons , ( Cordier) cet inftruraent des
cordiers eft fimple ou double ; defeription 8c ufage de l’un
8c de l’autre. X . 60.4.
M A N U F A C TU R E , réunie , difperfée. Réflexion fur la
maniéré dont on a traité jufqn’ici la matière des manufactures.
X. 60. 4. Deux fortes de manufaélures ; les unes
réunies , les autres difperfées. Conditions cffentielles pour
que celles de la premiere efpcce foienc utiles aux entrepreneurs.
Obfervations fur la proteéHon que le gouvernement
doit leur acciâlder. Maxime la plus importante à fui-
vre fur l’ètabliffemcnt des maïuifafriires. Ibid. b. Manufactures
qui de leur nature doivent être difpetfées. Pourquoi
les grands établiffemens des manufaélures réunies font pref-
que toujours ruineux à ceux qui les entreprennent les premiers.
Les fabriques difperfées ne font point expofées à
ces inconvéïfiens. Divers autres inconvéniens attachés aux
manufaélures réunies, 8c dont les autres font exemptes.
Jbid. 61. 4. Avantages des manufaélures difperfées, par rapport
au bien de l’état, Ibid. b. Objeélion tirée des fuccès
qu’ont ons quelques manufaélures réunies , quoique leur
objet fût d’exécuter des ouvrages qui auroient pu être faits
en maifon particulière. Exemple, la manufaélure de draps
fins d’Abbeville. Réponfe à cette objeélion. Ibid. 62. a.
Aîanufaélure. Caufés de la fupériorité d’une manufaélure
fur une autre. I. 717. b. Prohiber une manufaélure étrangère
, uniquement parce qu’on eft dans le deffein de l’imiter
, n’cft pas toujours un trait de prudence. IV . 130. a.
Maux que caufeni les manufaélures qui ne font entretenues
que pat le défordre du luxe. V I. 338. b. Les produélions
de nos terres doivent être la matière premiere de nos manufaélures.
Ibid. Connoiffances que doivent acquérir ceux
qui donnent des réglemens aux manufaélures. 342. i . Utilité
des manufaélures de toiles 8c d’étoffes communes en
France : renverfement que les manufaélures du luxe ont
caufé dans le fyftême économique. VII. 812. a. L ’établif-
fcinent de cette forte de manulaélures contraire aux véritables
intérêts de la France. XIII. lo i . 4. Des privileges
exchififsaccordés à certaines manufaélures. 390. a ,b. Desma-
nufaélures en laine. IX. 182.4 , b , Sec. 184. ^ , Oc. Premieres
mamjfaélures de foie en Europe. X V . 268. b. Décadence de
celles de Touraine. X V I. 466. a. Commiffaire des manu-
fuclures. III. 710. b. Infpeéleurs des manufaélures établis
par Colbert. V III. 792. b. 793. a.
MANUMISSION ou Aÿ'ranchijfement, ( Jurifpr. ) Trois
différentes formes de manumiftions chez les Romains. La
premiere étoit appellée per vindiéîam. Origine de cette dénomination.
Cérémonie ufitée dans cette forte d’affranchir-
femem. Changement admis fous les empereurs chrétiens.
Seconde ferme per epifolam 0 inter amicos, TreifiCiiK forme
per leßamentum. Diverfes obfervations fur cette forte de
maiiumiffion. Tenues par Icfcjucls on dcfignoit les affranchis
8c leurs enfans. En quels cas les affranchiffemen.s
ctoient déclarés nuis. Du nombre des efeiaves qu’il étoit
permis d’afi'ranchir. X. 62. b. En France, dans le commencement
de la monarchie , prefcjiic tout le monde étoit ferf.
En quel tems on commença d’affranchir des villes 8c communautés.
Veftiges de fewitude qui reftent dans certaines
provinces. Comment l’aff'ranchiffement s’y pratique. D e l’af-
franchiffeinent des Negres dans les iftes françoifes : détails
fur ce fujet. Ouvrages à confiilter. Ibid. 63. a. Foyc^ A ffranchissement.
M A N U S C R IT S , {Litiérat.) ceux que la bibliothèque
du roi a reçus de rfJrient. IL 240. a , b. Faiiffe confé-
qiience qu’on a voulu tirer de l’altération ou fiippofitioa
de plufieurs diplômes contre l’autorité des mamifcrits qui
nous reftent des anciens auteurs. IV . 1024. b. Manuferits
trouvés à Herculanum. VII I. 133. b. Suppl. 111. 333. a , b,
338. b. Lettres onciales dans les anciens mamifcrits. XI.
473. a. Manuferit de S. Auguftin confervé à Paris à l’abbaye
de S. Germain-des-prês. 849. 4. Charte de Juftiniert
écrite fur papier d’Egypte confervée à la bibliothèque dvi
roi. Ibid. b. Amres manuferits du fixiemc fiecle écrits fur
même papier. Ibid. Evangile de S. Marc dont l’écrit paroit
être du quatrième fiecle, confervé dans le tréfor de V e -
n\ (t,Ibid. 8c 830. 4. Divers manuferits du quatorzième
fiecle écrits fur notre papier moderne. 836. b. Des manuferits
de la bibliothèque de Balle. X VH. 738. b.
A lA N U S D E I , emplâtre , ( Pharm. Mat. médic. ext. ) Com-
pofition de cet emplâtre, félon la pharmacopée de Paris. Ses
propriétés. X. 63. b.
M A N Y , ( Compofuion ) maftic dont quelques fauvages
d’Amérique lonc ufage pour <firer leur fiJ 8c leurs cordelettes.
En quoi confifte cette compofuion. X . 63. b.
MAN ZO R , roi arabe qui protégea les fdcnces. II. 233.
MAOSIM , {Critiq.facr.) nom d’une divinité dont parle
Daniel , chap. XI. ilr. 38. Réflexion générale fur robfcurité
des oracles facrés. Divers fentimens des interprètes fur ce dieu
Aiaofim. X. 64. 4. Expofition plus étendue de celui de M.
Juricu. Il penfe que par ce dieu des forces, inconnu à fes
peres , qu’Antiochus devoit glorifier par des hommages 8c
des préfens, on peut 8c l’on doit entendre les aigles romaines
, l'empire romain. Principales preuves fur lefqucllcs il appuie
Ion opinion. Autres interprétés dont l’auteur rapporte
les feniimeiis. Ibid. b. celui de domCalmct. Ibid. 63- a.
M A PAL IA , ( Litiérat. ) habitations ruftiques des Numides.
Leur figure 8c conftruéllon. Peinture que fait Virgile
de la v ie des Numides. Différences entre les édifices appelles
msgalia 8c ceux dont il s’agit ici. Signification du mot
mappiUa. X . 63. a.
M A P PA chcenfis, { Littéral. ) rouleau qui fervoit de
fignal pour annoncer le commencement des jeux du cirque.
(JfficLer nommé mappaire chez les anciens Romains,
X .6 3 .A
M AP PEM O N D E , {Géogr.) Projcélion l.i plus ordinaire
dont on fe fert pour repréfenter une mappemonde. Autre
projeélion employée quelquefois. X . 64. b.
Aîappemondc. Différentes projeéliüiis fous lefquelles on la re-
prefente. XIII. 440. a , b.
M A Q U E R E A U , Veirat, A urïol, Horreau , Potjfotid'A‘
v r il, ( Hiß. nat. ) Defeription de ce poiffon de mer, poiffon
de pWage. Tems où il fraie. Qualité defa chair. X. 63.
MaQUERAUX, {Pêche) détails fur les maniérés défaire
la pêche de ces poilTons. X . 66.4.
Maquereaux. VtùiQ de ces poiffons, V . 148. b. IX. 477.
b. 327. 4. X IV . 899. b. vol. V l l l dos planches , P èche ,
planche 9 , 10. Le maquereau eft de tous les poiffons celui
dont la forme paroit la plus propre à fe mouvoir dans l’eau,
8c fert par cette raifon de modele aux coiiftruéleurs des vaif-
feaux. X V I , 803, f». , r 1- • 1
M A Q U E T T E , ( Fabriq. des arm. ) piece de ter d un échantillon
proportionné aux casons de fufil qu’elle doit produire.
Détails fur la fabrication des maquettes. Suppl. III.
840. b. , r 1
Alaquettes D e la méthode de former les maquettes avec
lefquelles on fabrique les canons de fufil. S^fpl. 111 12. ç
b 8cc. 14. 4. Maquettes compofées de fer refondu de v ieilles
ferrailles. 13 .4 , é. 1, * . • , ,
M AQ U ILU PA , ( Géogr. ) montagne d Amérique. V u *
effrayante dans le paffage de cette montagne. X. 66. b.
M A R A BO T IN , {Monn.) ancienne monnoie d’or d’Ef-
paene 8c de Portugal. Etymologie du mot. Obfervations
hlftoriques fur cette monnoie , 8c fur fa valeur. Dift'érence
entre le marabotin 8c le maravédisd’or. X, 66. E
MARABOU S ou Afarabouis, {H iß . mod.) prêtres pour
lefquels les mahométans d’Afrique ont le plus grand ref-
pea. Extérieur par lequel ils fe diftinguent du vulgaire.
Villes dont les revenus leur appartiennent. Détails fur leur#
nxsurs & ufages. RefpeéU qu’on leur rend. Leurs écoles;