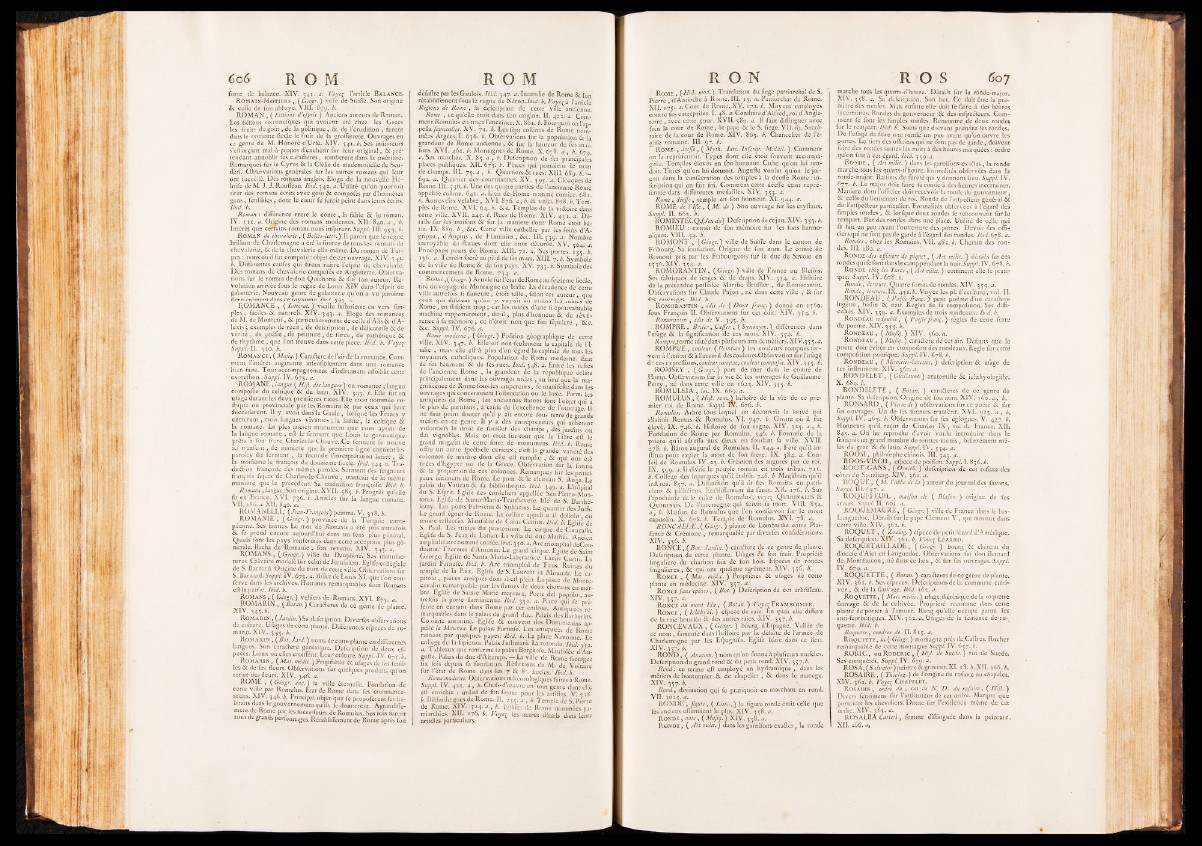
, , , , J
■ !*
. yf ‘ l‘Aiîi
i l ' in
606 R O fürre dû balance. X IV . ^41. <3. .T’oyc;^ l’article BALANCE.
Romain-Motiei^s » ( G^’op-. ) ville de Suide. Son origine
Sl celle de l'on abbaye. VIII. 899. /».
ROM A N , ( l'itlions d'efprh ) Anciens auteurs de Roman.
Les tiiilions vonianelques qui avoient etc cho?. les Grecs
k s t'niiis cliigoùcjde l.n politique, & de l’érudition, furent
d. ins le onzième fiecle le fruit de la groinèreié. Ouvrages en
ce genre de M. Honoré d’Urfé. X IV . 341./!. Ses imitateurs
.s'eri'ovçaiit mal-à-propos d'euebérir fur leur original, & prétendant
annoblir lés caraéleres, tombèrent dans la puérilité.
Remarques fur le Cyrus & la Clclie de niademoifelle de Scu-
déri. Obférvations generales fur les autres romans qui leur
ont fuccédé. Des romans anglois. Eloge de la nouvelle Hé-
loïfe de M. J. J. Rouffeau. Ibid. ^42. a. Utilité qu’on pourroit
tirer des romans écrits avec gout & compofés par d’iîoimétes
gens, fenfibles , dont le coeur fe feroit peint d.ins leurs écrits.
Ibid. b.
Roman : différence entre le conte , la fable Si le roman.
IV . I I I . Origine des romans modernes. X ll. 840. a , b.
Intérêt que certains romans nous infpirenr. Suppl. l i l . 933. h.
Roman de chevalerie yt^BolUs-ktir.') Il pnroit que le régné
brillant de Cliarlcmagne a été la fource de tous les romansde
chcvalei ie, & de la chevalerie elle-même. Du roman de Tu rpin
; terns ou il fut compofé ; objet de cet ouvrage. X IV . 342.
b. Différentes caufes qui firent naître l'efprit de cliovaierie.
Des romans de chevalerie compofés en Auigleterre. Obiorva-
fions fur le roman de don Quichotte & fur fon auteur. Révolution
arrivée fous le régné de Louis X IV dans l’efprit de
galanterie. Nouveau genre de galanterie qu’on a vu paroitre
dernièrement dans ce royaume. Ibid. 343. a,
ROM AN CE , ( Liiürac. ) vieille lùlloriette en vers fim-
p le s , faciles 6c naturels. X IV . 343. a. Eloge des romances
de M. de Montcrlf, Sc particuliérement de celle d'A lis & d'Alexis
; exemples de réc it, de defeription , de déllcateife & d e
vérité , de poéfie , de peinture, de fo r c e , de patliétique 6c
de rbythme , que l’on trouve dans cette piece. ïtnd. b. Foye^
Suppl. II. 320. b.
Romance, ( Mujlq.) Caraftere de l’air de la romance. Com-
rnent 1 Interet augmente inlenfiblemcnt dans une romance
bien faite. Tout accompagnement d'inflruraeni affoiblit cette
e. xprelTion. Suppl. IV. 675. a.
R O M A N E , lajtgue ( Hijl. des langues ) ou romance ; langue
compolée du celtique 6c du latin. X IV . 345. /■ .Elle fut en
ufage durant les deux premieres races. Elle etoit nommée ru-
lUque ou provinciale par les Romains 8c par ceux qui leur
fuccéderent, Il y avoir dans la Gaule , lorfque les Francs y
entrèrent , trois Lngues vivantes ; la latine, la celtique 6c
la romane. Le plus ancien monument que nous ayons de
la langue romane, eü le ferment que Louis le germanique
prêta a Ion ircre Cliarles-le-Cbauve. C e lermcni fe trouve
ici tranfc.it , de maniéré que la premiere ligne contient les
paroles du ferment , la fécondé l’interprétation latine , 6c
la troifieino le françols du douzième fiecle. Ibid. 344. a. Tra-
diiRion françoife ties mêmes paroles. Serment des feigneurs
français fujets de Cliarles-le-Cliauve , iranferit de la même
manicie que le précédent. Sa traduâion françoife. Ibid. b.
Romane Son origine. X V II . 585. L Progrès qu’elle
fit en France. X VI. 736. b. Articles fur la langue romane
V11.286.U.X1I. 840.U. ^
RÜM AN ELL I, {Jean-François) . 318. b.
R Ü M A N IE , {Geogr.) province de la Turquie européenne.
Ses bornes. Le mot de Romanic a été pris autrefois
8c fe prend encore aujourd’hui dans un feus plus général.
Q uels font les pays renfermés dans cette acce()tion plus Générale.
Bacba de Romanic, fon revenu. X IV . -54«. a. °
R O M A N S , {Geogr.) ville du Dauphine. Ses manufactures.
Calvaire modelé fur celui de Jérufalem. Eglife collégiale
de S. Barnard. Origine du nom de cette ville. Oblervations fur
S. Barnard. Suppl. IV, 675. a. Billot de Louis XL que l’on con-
lerve dans les archives. Hommes remarquables dont Romans
ell la patrie. Ibid. b.
Romans , ( Géogr. ) vehiers de Romans. X VI. 871 a
ROM A RIN , {Bü,.tn.) Carafteres île ce genre de plante.
X IV . 34^./>. ‘
Romarin ,{Jardin.)Sz defeription. Diverfes obfervaiions
de culture. Ulagcs de cette plante. Différentes efpeces de romarin.
X IV . 345. b.
Romarin , {Bot. Jard.) noms de cette plante en différentes
langues. Son caraaere générique. Defeription de deux efpeces,
Lieux ou elles croiffent. Leur cxAmxQ.Suppl. IV. Gyç.b.
ROaMAïUN , {Mat médic.)?ropnéiis 8c ufiages de fes fctill-
Ics 6c de les fleurs. Obférvations fur quelques produits mi’on
retire des fleurs. X IV . 346. 4. ■ ^
ROME , ( Geogr. anc. ) la ville éternelle. Fondation de
cecie ville par Romulus. Etat de Rome dans fes commcncc-
mens. X IV, 346. L Principal objet que fc propoferentfes ha-
bitans dans le gouvernemenrqu'ils fe doaucrein. AgrandilTe-
meus de Rome par les (uccelTeurs de Romulus. Scs rois furent
unis e grands perfonnages. Rvétabliffcmcnt de Rome après fon
R O M
défafire par les Gaulois. Ibid. 3 47. a. Incendie de Rome 8c fon
rétablifl'ement fous le regiie de N é r o n . i . Voyc^^ l’article
Régions de Rome , la defeription de cette ville ancienne.
Rome , ce qu’elle étoit dans fon origine. II. 422. a. Comment
Romulus en traça l’enceinte. X. 861. i-. Pourquoi o iil’ap-
pelhjepiicollis. X V . 7 1 . b. Les fept collines de Rome nommées
Argées. 1. 636. b. Obfervaiions fur la population 6c la
grandeur de Rome aiicieune, 6c fur la hauteur de fes niai-
lons. X V I . 461. b. Montagnes de Rome. X. 678. a , b. (j~c).
*7. Ses marchés. X. 83.4 , b. Delcription de fes principales
places publiques. XII. 673. b. Places qui portoieiu le nom
de champs. 111. 7 5 .4 , b. Quartiers 6c rues. XIII. 689,/>.—
692. a. Quartier des courtilannes. X V . 59^, Cloaques de
Rome. 111. 538. b. Une des quatre parties de l’ancienne Rome
appellee coUine. 641. a. Lieu de Rome nommé comice. 681.
b. Autres dits velabre, X V I. 876. a ,b .lk . velia. 878. b. Temples
de Home. X V I . 64. b. 6c<i, Temples de la viéloire dans
cette ville. X V ll. 245. b. Rues de Rome, X iV . 431. a. D étails
fur les maifons 6c fur la maniéré dont Rome étoit bâtie.
IX. 889. b , 6cc. Cette ville embellie par les foins d’A -
grippa , d'Appius , de Flaininius, 6cc. 111. 539. ,2. Nombre
incroyable de llatues dont elle étoit décorée. X V . 304, a.
Principaux ponts de Rome. X I ll. 71. a. Ses portes. 135. b.
136. U. Terrein facré au pied de fes murs. X l l l . 7. b. Symbole
de la v ille de Rome 6c de fon pays. X V . 733./-. Symbole des
commencemens de Rome. 734. a.
RüME,(Gi.'t>gr. ) Article (ui l’état deRome au feiziemefiecje,
tiré du voyage de Montaigne en Italie. La décadence de cctic
ville autrefois fi fameufe, étoit telle , felon cet auteur, que
ceux qui difoient qu’on y voyoit au moins les ruines de
Rome , en difoient trop 3 c.ir les ruines d’une fi épouvantable
machine rapporteroient, dit-il, pins d’iionneur 6c de rév é rence
à fa mémoire 3 ce n’étoit rien que fon fépulcre 8cc.
8cc. Suppl. IV. 676. a.
Rome moderne , ( Géogr. ) Pofition géographique de cette
ville. X IV , 347. b. Elle eit non-feulement la capitale de l’Italie
, mais elle efi à plus d’un égard la capitale de tous les
royaumes catholiques. Population de Rome moderne. Etat
de fos bâtimens 6c de fes rues. Ibid. 348. a. Entre les relies
de l'ancienne Rome , lu grandeur de la république éclate
principalement dans les ouvrages utiles , nu lieu que la magnificence
de Rome fous les empereurs, fe manifclle dans les
ouvrages qui concernoient l’olientation ou le luxe. Parmi les
antiquités de Rome , les anciennes flatues font l’objet qui a
le plus de panilans, à caufe de l’excellence de l’ouvrage. Il
ne faut point douter qu’il y ait encore fous terre de grands
trcTurs en ce genre. Il y a des entrepreneurs qui acJietenc
volontiers le droit de fouiller des cliamps, des jardins ou
des vignobles. Mais on croit fur-tout que le Tibre ell le
grand magafin de cette forte de monumens. Ibid. b. Rome
offre un autre Qec^ncie curieux , c'efl la grande variété des
colonnes de marbre dont elle ell remplie , 6c qui ont été
tirées d’Egypte ou de la Grece. Obfervation l'ur la forme
6c la proportion de ces colonnes. Remarques fur les principaux
bâtimens de Rome. Le pont 6c le chateau S. An>’e. Le
palais du Vatican 6c fa bibliothèque. Ibid. 349. a. L ’Iiôpital
du S. Efprit. Eglife des cordeliers appellee ban Pietro-Mon-
torio. Eghfe de Santa-.Maria-Tranllevere. Ifle de S. Barthélemy.
Les ponts Fabricius 6c Sublicius. Le quartier des Juifs.
Le grand égout de Rome. La colline appdl.e il doliolo, oii
monte tcllaccio. Maiifolée de Cnius CcUius. Ibid. b. E»lifè de
S. Paul. Les ruines du proetorium. Le cirque de Cai-.icalla.
Eglife de S. Jean de Latran. La villa du duc Maihéi, Ancicii
amphitliéacrc nommé zoWdt.lbid. 330. a. Arc triomphal deCon-
ilantin. Thermes d'Amonin, Le grand cirque, Eglife de Saint
George. Eglife de Sania-Maria-Liberatrice. Lacus Curtii Le
jardin Farnefe. Ibid. b. A rc triomphal de Titus. Ruines du
temple de la Paix, Eglife de S. Laurent in Miranda. Le ca-
pito ie , pieces antiques dont il ell plein. La place de Monte-
cavallo remarquable par Icsilatucs de xlcux chevaux en marbre,
Eglife de Salme Marie majeure. Porte del popolo, autrefois
la porte (laminicnne. Ibi.i. 331. a. Place qui fc ^pré-
fente en entrant dans Rome par cet endroit. Antiquités remarquables
dans le palais du gnmd due. Palais des Barberins.
Cu onne aiitonine. Eglife 6c couvent des Dominicains ap-
pellé la Minerva. Le palais Farnefe. Les antiquités de Rome
ruinées par quelques papes. Ibid. b. La place Navounc. Le
college de la fapienza. Palais Julliniaui. La rotonde. Ibid. 352.
a. Tableaux que renferme le palais Borgliefc. Maul'ulce d’Au-
guflc. Palais du duc d’Altenips. — La ville de Rome faccagée
lix Ibis depuis fa fondation. Réflexions de M. de Voltaire
fur l’état de Rome dans les 7 6c 8-. fiecles. Ibid. b.
Rome moderne, übfervations mèiéorologiques faites à Rome.
Suppl. IV, 421. 4 , Chels-tl oeuvre en lotit genre donc elle
efl enrichie : utilité de fon féjour jiour les artilles. V. 22S.
b. Bibliothèques de Rome. II. 2 3 3 .4 , é. Tcmfilc d'e S Pierre
de Rome. X IV . 324. a , b. Eglife,, de Rome nommées patriarchies.
XII. 176. b. Foye:^ les autres détails dans leurs
articles particuliers.
R O N RO-’^E , {Ui(l- rtiod.) Tranflation duuege patriarchal de S.
Pierre d’Antioche à Rome. III. 13. a. Patriarchat de Rome.
XII. 173- Cour de Rome. X V . 17a. b. Moyens employés
contre k s cntreprilès. I. 48. a. Conduite d’Alfred, roi d'Angleterre
, avec cette cour. XVII. 389. a. II faut dillinguer avec
foin la cour de Rome, le pape 6c le S. fiege. VII. lij. Secrétaire
de la cour de Rome. X IV . 863. b. Chancelier de l’é-
glife romaine. III. 97- b.
Rome , dccjfe, ( Myth. Litt. Infcrip. Méd.til. ) Comment
on la repréfentoit. Types dont elle étoit fouvent accompa-
oiiée. Temples élevés en fon honneur. Culte qu’on lui ren-
doit. Titres qu’on lui donnoit. Augufle voulut qu’on le joignit
dans la confécratioii des temples à la déeffe Rome : in-
feription qui en fait foi. Comment cette déefib étoit repré-
fentés dans différentes médailles. X IV . 333. a.
Rome, déejfe, temple en fon honneur. XI. 944. a.
ROMÉ de l'I f le , {M . de ) Son ouvrage fur les cryflaux.
Suppl. 11. 6(^3. b.
ROM E STE CQ ,(7r u D e f e r ip t io n d c c e j c u .X IV . 333.
ROMIEU : extrait de fon mémoire fur les fons harmoniques.
V I ll. 34. b.
R OM O N T , {Géogr.) ville de Suiffe dans le canton de
Fribourg. Sa foiulatiou. Origine de fon nom. Le comté de
Rumont pris par les Fribourgeois fur le duc de Savoie en
1336. X IV . 334. -1.
R O M O llA N T IN , (Gebgr. ) ville de France au Blcfois.
Ses fabriques de forges 6c de draps. XIV. 354. a. Hifloirc
de la prétendue polTédée Marthe Broflier , de Romorantin.
Obférvations fur Claude Pajon , né dans cette ville , 5c fur
fes ouvrages. Ibid. b.
Romorantin , édit de {Droit franc.) donné en 1360.
fous François II. Obférvations fur cet édit. X IV . 334. b.
Romorantin , édit de V . 393. />.
ROMPRE , Brifer, Caß'er , {Synonym.) différences dans
î ’ufage 8c la fignificarion de ces mots. X IV . 334. b.
Rompre,xcrmc ulitédansplufieursarts 6c métiers.XIV.33 3.4.
ROMPUE , couleur {Peinture) les couleurs rompues fervent
à l'union S cà l’accorcl descouleurs.Obfervation fui l’ufage
d : ces cxpreflions,cvK/e«rro;Hp«r, couleurcompofée. X IV . 333. b.
ROMSEY , {Geogr.) port de mer dans le comté de
Hamp. Obférvations fur la vie Sc les ouvrages de Guillaume
P e t t y , né d.uis cette ville en 1623. XIV. 333-L
ROM ULEIA , loi. IX. 669. 4.
R OM U L U S , {Hiß- rom.) hilloire de la v ie de ce premier
roi de Rome. Suppl. IV . 676. b.
Romulus. Arbre fous lequel on découvrit la louve qui
allaitoit Remus 6c Romulus. V I . 747. b. Grotte où il fut
élevé. IX. 746. b. Hilloire de fon regne. XIV. 323. a , b.
Fondation de Rome par Romulus. 346. b. Formule do la
priera qu’il adreffa aux dieux en fondant fa ville. XVII .
278. b. Bâton augurai de Romulus. II. 144.4. Fête qu’il in-
flitua pour ex-pier lu mort do fon freie. IX. 384. a. Con-
fcil de Romulus. IV. 23. b. Création des augures par ce roi.
IX. 399. 4. Il divlfe le peuple romain en trois tribus. 7 1 t .
b. College des luperques qu’il établit. 746. b Magillrats qu’il
inllitua. 837. il. Difiinélion qu’il fit des Rom.iùis en patriciens
8c plébéiens. Etabliffemcnt du fciiat. XU. 176. b. Sur
i ’apoihéofe 6c le culte de Romulus', vvyeç Q uikinales 8c
Q uirinus. De l’intcrrcgue qui fuivit fa mort. VIII. 834.
4 , b. Maifon de Romulus que l’on confervoit fur le mont
capitolin. X. 678. b. Temple de Romulus. X V I . 78. 4.
R O N C À L IÆ ,{G é o g r .) pWmt de Lombardie entre Plai-
faiicc 8c Crémone , remarquable par diverfes confidératious.
X IV . 336. b.
R O N C E , {Bot. Jardin. ) caraélere de ce genre de plante.
Defeription de cette plante. Ufages de fon fruit, Piopriété
fingulicre du charbon fait de Ion bois. Elpcces de ronces
fiijgulieres , 6c qui ont quelque agrément. XIV. 336. b.
Ronce , ( Mat. médic. ) Propriétés 5c ufages de cette
plaine en médecine. X IV . 337. a..
RoNCE/ans épines, {B o t .) Defeription de cet arbriffeau.
X iV . 337. 4.
Ronce t/tt mont Ida, {Botan.) Framboisier.
Ronce, ( fdtihyol. ) efpece de raie. En quoi elle diflere
de la mie bouclée 8c des autres raies. X IV . 337. b.
R O N C E V A U X , ( Gbigr. ) bourg d’Efpagnc. Vallée de
ce nom , fameufe dans l’hilloirc par la défaite de l’année de
Charlemagne par les Efpagnols. Eglife bâtie dans ce lieu.
X IV . 337. b.
IIONI) , ( Jriatorn. ) nom qu’on donne à plufieurs unifclcs.
Defeription du grand rond 6c du petit rond. X IV . 337.
Rond: ce terme eft employé en hydraulique, dans les
métiers de boutonnier ôc de chapelier, Sc dans le manege.
X IV , 337. i.
Rond, divination qui fe pratiqiiolt eu marcliant en rond.
VII. 1023.4.
RO ND E , figure, ( Litter. ) la figure ronde étoit celle que
les anciens ellimoient le plus. X IV . 3 38. 4. Ronde, note , {Mufiq.) X IV . 338. a.
Ronde , ( A n milir. ) dans les garnifons exaéles, U ronde
R O S 607
marche tous les quarts-d’heure. Détails fur la ronde-major.
X IV . 338, 4. Sa defeription. Son but. Ce doit être la première
des rondes. Mais enfuite elle doit fe faire à des heures
incertaines. Rondes du gouverneur 8c des infpeéleurs. Comment
fe font les finiples rondes. Rencontre de deux rondes
fur le rempart. Ibid. b. Soins que doivent prenrire les rondes.
D e 1 ufage de faire une ronde un peu avant qu’on ouvre les
portes. Le tiers des officiers qui ne font pas de garde, doivent
faire des rondes toutes les nuits à des heures marquées : ordre
qu’on fuit à cet égard. Ibid. 339.4.
Ronde , ( Arc milit. ) dans les garnifons exaéles, la ronde
marciie tous les quarts-d’hcurc. Formalités obfcrvces dans la
ronde-major. Raifons de fùrctc qui y donnent lieu. Suppl. IV .
677. b. Le major doit faire fii ronde à des lieures incertaines.
Maniéré dont l’officicr doit recevoir la ronde du gouverneur,
Sc celle du lieutenant de roi. Ronde de l’infpcélctir général 8c
de l’infpeélcur particulier. Formalités obfervées à l’égard des
fimples rondes, 6c lorfque deux rondes fe rencontrent fur le
rempart. But des rondes dans une place. Utilité de celle qui
fc fait un peu avant l’ouverture des portes. Devoir des officiers
qui ne font pas de garde à l’égard des rondes. Ibid.67^. a.
Rondes, chez les Romains. VÎI. 482. i. Cliemin des rondes.
III. 280. 4.
Ronde des ofiîciers de piquet, {A r t milit. ) détails fur ces
rondesquifefoncdansle camp pendant la mût.SuppL IV . 678. b.
Ronde Chelles Turcs, { A n mUn.) comment elle fc pratique,
IV. 678. L
Ronde , écriture. Quatre fortes de rondes. X IV . 339. 4.
Ronde, eér/V/w. IX, 4 3 1. Z>. V o y e z les pl. d’écriture, vol. II.
R O N D E A U , {Poéfie franc.) petit poème d'un caraélere
ingénu, badin 8c naiï. Réglés de fa compofition. Ses difli-
culrcs. XIV. 339. 4. Exemples de trois rondeaux. Ibid. b.
Rondeau redoublé, { Poéjie franc.) réglés de cette forte
de poème. XIV. 3 39. b.
R o n d e a u , {Mujiq.) XIV. 360.4.
Rondeau , ( Mujiq. ) caraélere de cet air. Défauts que le
poète doit éviter en compofant des rondeaux. Regle fur cette
compofition poétique. Suppl. IV, 678. b.
Rondeau , ( Miroitier-lunetier. ) defeription Sc ufage de
cet infiniment. X IV . 360. a.
R O N D E L E T , {GuilLtiimt) anaromifle Sc icluliyologifie.
X. 689. h. J O ■
ROfs'DELETE , ( Botan. ) caraélercs de ce genre de
plante. Sa defeription. Origine de fou nom. X IV . 360. a , b.
R.ONSARD , {Pierre de) obférvations fur ce poète 6c fur
fes ouvrages. Un de fes fonnets tranferit. X V I . 913. 4 , b.
Suppl. IV . 463. b. Obférvations fur fes églogues. V . 427, b.
Honneurs qu’il reçut de Charles I X , roi de France. XII.
843. 4. On lui reproche d’avoir voulu introduire dans le
François un gr.mt! nombre de termes inouis, bifarrement mêlés
de grec 6c de latin. Suppl. IV. 334. a.
ROÔ.SI, pliilofoplie chinois. ï l l . 343. a.
ROO.S-VISCH , efjjcce de poiffon. Suppl. I. 836. b.
R O O T -G A N S , ( Ornith. ) defeription de cet oifeau des
corc.s du Spitzberg. XIV. 361. .i.
R O Q U E , ( M. l\ihbé de la ) auteur du journal des favans.
Supfi. 111.63-7.4.
RÜQUL'.FEUIL , maifon de ( Blafon ) origine de fes
armes. Si/ppl. 11. 6ot. a.
R O QU EM.AU RS, ( Géogr. ) ville de France dans le bas-
Languedoc. Détails fur le pape Clément V , qui mourut dans
ceite ville. X IV . 361. b.
ROQU E.T , ( Zoolog. ) efpece de petit lézard d’Amérique.
Sa defeription. X IV . 361. b. Foyer LÉZARD.
R O Q U E T A IL L A D E , {Géogr. ) bourg 8c château du
diocefe d’Alet en Languedoc. Obférvations fur don Bernard
de Montfaucon , ué dans ce lieu , Sc fur fes ouvrages. Suvpl.
IV. 679-
R O Q U E T T E , ( Botan. ) caraéleres de ce genre de plante.
X IV . 361. b. Scs efpeces. Deferiptions de la commune cultivée
, 6c de la fauvage. Ibid. 362. a.
Roquette, ( Mat. méJic. ) ufage diététique de la roquette
fauvage 6c de la cultivée. Propriété recomnie dans cette
plante de porter à l’amour. Rang qu’elle occupe parmi les
ami-feorbutiques. X IV , 362. 4.Uiages de la fcmence de ro-_
quette. Ibid. b.
Roquette, cendres de. II. 813. a.
Roquette, la ( Géogr. ) montagne prés de Cafircs. Rocher
remarquable de cette montagne, IV, 637. h.
R O R IC , ouRoderic, {Hifi. de Suede.) roi de Suède.
Ses conquêtes. Suppl. IV. 679- a.
ROSA, (b4/v4/o; ) peintre & graveur. XI. 18. b. X!I. 266. b,
R O SA IR E , ( Théülog. ) de l’origine du rofaive ou chapelet.
X IV . 362. b. Foyei CHAPELET.
Rosaire , ordre du , ou de N. D . du rofairc, ( Hifi. )
Divers femimens fur l’infiitutcur de cet ordre. Marque que
portoient les chevaliers. Doute fur i’exiflence même de cet
ordre. XIV. 363. a.
ROSALBA Carieri, femme clifiinguée dans la peinture.
XII. 266. 4.