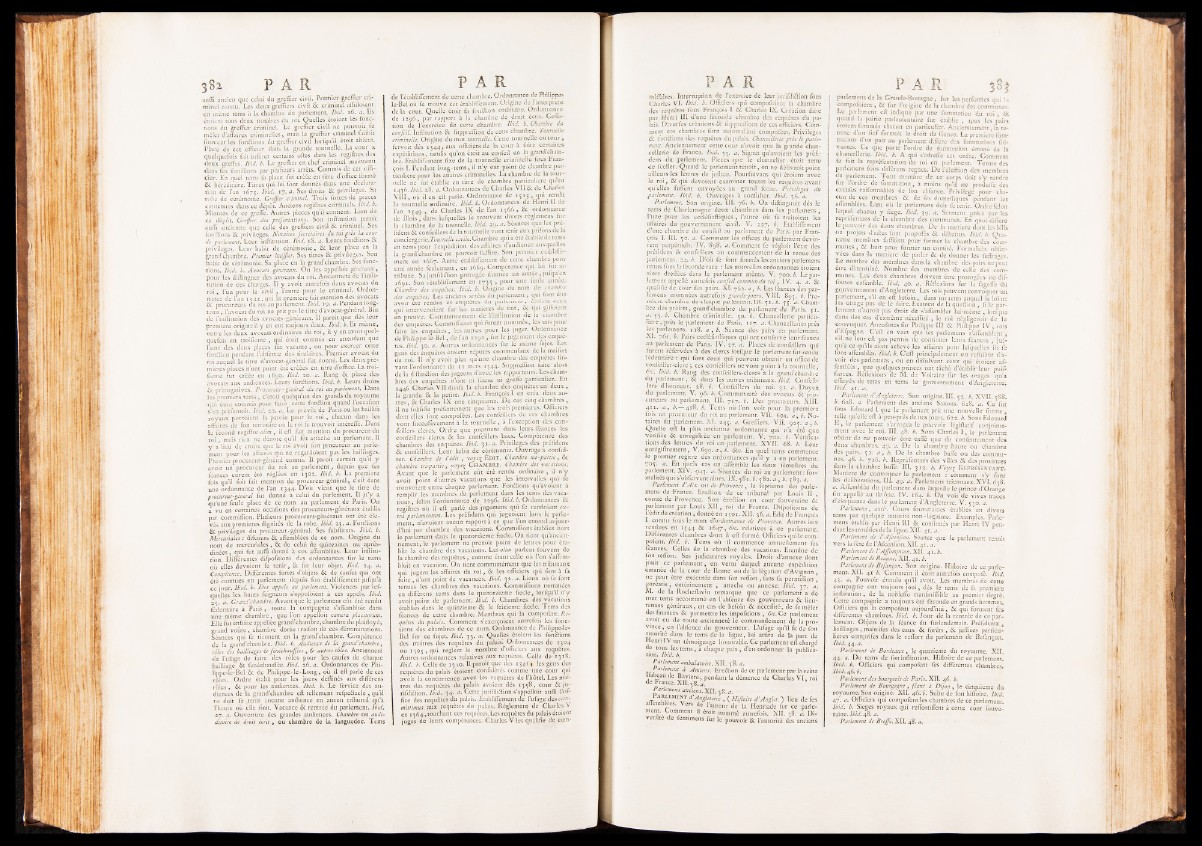
é '
; ’.iîlt!
T qüfi
" 1'h 1(' "I 11
Lis
m SI
î-If'Pl LiiJl n i ^ !' ■'•iiTéhi] h1 ■liiiû ■ItP
■ ■ slill
Æ L È 0
582 P A R
aiiffi ancien que celui du gcefl'icr civil. Premier grcflîcr criminel
coiiiiii. Les deux greffiers civil & criminel aliiiioiciic
en même reins ù la chambre du parlement. U-iJ. 16. a. Ils
etei-m tous deux notaires du toi. Quelles ctoient les fonctions
du grciTur criminel. Le gielHer civil ne iiouvoïc ie
mêler d'affaires criminelles, mais le greffier criminel tailou
lüuvcnf les i'onfUons du greffier civil lorlqii'd étoit abfent.
Place de cet officier dans la grande lournelle. La cour a
quelquefois fait inférer certains aêles dans les regilbes des
deux greffes. Uid. b. Le grcflier en chef criminel maintenu
dans fes fonêfions par pluiïeurs arrêts. Commis de cet olii-
cicr. En quel icms lit place fut créée eu titre d’office tonne
6c héréditaire. Turcs qui lui font donnés dans une décl.ara-
tion de l’an 1675. Ibid. 17. a. Ses droits & privileges. Sa
rol)c de cérémonie. Grcjjier criminel. Trois fortes tic
contenues dans ce dépôt. Anciens rogiflres criminels. IbiJ.h.
Mimiîcs de ce greffe. Autres pièces qu'il contient. Lieu de
ce dépôt. Greÿicr des prcjent.uions. Son inÜitmiou paroic
auffi ancienne que celle des greffiers civil Sc criminel. Ses
fondions Sc privileges. Noi.iires Jccrctjircs du roi près l.i cour
de p.itUnicni. Leur infVuution. Ibid. 18. .1. Leurs foulions 6c
privileges. Leur habit de cérémonie, 6c leur place en la
graiurdumbre. Premier hui(Jicr. Ses titres 6c privileges. Son
lubit de cérémonie. Sa place en la grand'chambre. Ses fonc-
t'ions. Ibid. b. Avoc.its ^éncruiix. On les a])pe!loit
pour les diîbngucr des avocats du roi. Ancienneté de linui-
tution de ces charges. Il y avoir autrefois deux avocats du
r o i , l'un pour le civil , l'autre poiir le criminel. Ordonnance
de l'an 1544 , qui la premiere fait mention des avocats
èx procureurs du roi au parlement. Ibid. 19. u. Pendant long-
t.'ins, l’avocat du roi ne prit pas le titre d'avocat-gcnéral. But
de rmlbuitioii des avocats-généraux, il paroit que dès leur
premiere origine il y en eut toujours di-ux. Ibid. b. Et même,
outre les deux avocats ordinaires du r o i, il y en avoit quelquefois
un iro-fivine , qui étoit commis en attendant que
l'une des deux places fut vacante, ou pour exercer cette
fonébon pendant l’ablence des tiiulaircs. Premier avocat du
roi auquel le titre d’avocat-géncral fut donné. Les deux premieres
places n'ont point été créées en titre d office. La troi-
fieme fut créée en i6qo. IbiJ. ao. u. Rang 6c place des
avocats aux audiences. Leurs fonébons. Ibid. b. Leurs droits
prérogatives. Proctircur-gènér.il du roi ,ui parlement. Dans
les premiers tems , c’étoit quelqu'un des grands du royaume
qui croit commis pour taiie cette fonflion quand loccafion
ic n prélcntoit. Itid. 22.. a. Le prévôt de Paris ou les baillifs
royaux portoiciit la partde pour le roi , chacun dans les
affaires de fon territoire ou le roi fe trouvoic intéreflé. Dans
L fécond rcgilire oli/n , il eA fait mention du procureur du
r o i, mais rii.n ne dénote qu’il fut attaché au parlement. U
y a lieu de croire que le roi avoir ibn procureur au parlement
pour les aAaires qui ne regardoient pas les bailliages.
Premier procureur-général connu. Il paroit certain qu’il y
avoit un procureur du roi au parlement, depuis que fes
féanccs eurent été réglées en 1302. Ibid. b. La premiere
fois qu'il foit fait mention du procureur-général, c'eA dans
une ordonnance de l’an 1344. D ’on vient que le titre de
procurcur-gérièrul fut donné a celui du parlement. Il (il’y 3
qu’une feule place de ce nom au parlement de Paris. On
a vu en certaines occafions des procureurs-généraux établis
par commiffion. PluAeurs procureurs-généraux ont été élevés
aux premieres dignités de la robe. Ibid. 23. j . Fondions
&. privileges du procureur-général. Scs fubAiluts. IbiJ. b.
Mercuriales : difcours & affemblécs de ce nom. Origine du
nom de mercuriales , Sc de celui de quinzaines ou après-
dinée.s, qui fut aiilTi donné à ces affcmblces. Leur inibtii-
tion. Différentes difpofiiions des ordonnances fur le tems
où elles dévoient fe tenir, ôc fur leur objet. Ibid. 24. a.
Competence. Dift'érentes fortes d’objets & de caufes qui ont
été connues en parlement depuis fon établiffcincnt jufqu’à
ce jour. Ibid. h. Des appels au parlement. Violences par Icf-
qucllcs les hauts feigneurs s’oppofoient à ces appels. Ibid.
23. a. Grand'chambre. Avant que le parlement eut été rendu
fédentaire à Paris , toute la compagnie s’affiembloit dans
une meme chambre, que l'on appelloit camera pLcitonim.
Elle fut enfuite appellée grand’chambre, chambre du plaidoyé,
grand voûte , chambre dorée : raifon de ces dénominations.
Séances qui le tiennent en la grand’chambre. Compétence
de la giaiid’chambie. Ibid. b. Audience de la grand’chambre,
lôles des b.iilliagcs 6’ fcncckaujfccs , & autres rôles. Ancienneté
de l’ufagc de faire des rôles jiüur les caufes de ciiaqiic
bailliage 8c féncchaufféc. Ibid. 26. a. Ordonnances de Plii-
lippc-lc-Bel Ôc de P liilippe-le-Long, où il cA parlé de ces
rôles. Ordre établi pour les jours dcAinés aux différens
rôles , Sc pour les audiences. Ibid. b. Le fcrvicc des audiences
de la grand’chambre eA tellement rcfpeâacle , qu’il
ne doit fe tenir r.iicime audience en aucun tribunal qu’à
riieiirc où elle finit. 'Vacance 6c rentrée du parlement. Ibid.
27. a. Ouverture des grandes audiences. Chambre ou audi-
diioite de divti éciit , ou chambre de la langucdoc. Tems
P A de l'ctabliiTement de cette chambre. Ordonnance de Pliilippe-
Ic-Bcl oil fe trouve cet établiiremem. Origine de l’imerprete
de la cour. Quelle étoit fa fouébon ordinaire. Ordonnance
de 1296, par lapjiorc à la chambre de droit écrit. Cefla-
tion de l’exercice de cette chambre. Ibid. b. Chambre du
a»/?yéi/. Inllituiion 6c (upprelboii de cotte cliambre. lournelte
criminelle. Origine du mot toiirnelie. Cette tournelio ou to u r ,
lervoit dès 1344, aux oiheiers de la cour à taire certaines
expéditions, tandis qu’on étoit au coiifeil en la grandchaui-
bie. Etabliffomeiu Axe de la tournelle criminelle fous François
l. Pendant long-tcms, il n’y eut point de chambre particulière
pour les attaircs criminelles. La chambre de la rour-
uclle ne fut établie en litre de chambre pariieulievc qu’en
1436. Ibid. 28. a. Ordonnances de Charles VII 6c do l.h.irlcs
Y i i l , oil il en eA parlé. Ordonnance de 1 5 1 5 , qui rendit
la tournelle ordinaire. Ibid. b. Ordonnances de Henii 11 de
l’an 1349 , de Charles IX de l'an 136Û , 6c ordonnance
de Blois, dans lefquclles fe trouvent divers réglcmens fur
la chambre de lu tournelle. Ibid. 29. a. Séances que les pre -
fidens 6c confcillcrs de la tourneUe vont tenir aux priions dcl.i
concierg-eiie.reW/rctvi/c'.Chambre qui a été étabhede tems
en tems pour l’expédition des affaires d’auclienco ;uixi|Ul-11cs
la grand'chambre ne pouvoit fi.ffire. Son premier éiablifie-
meiu en 1667. Autre établiffement de tcite chambre pour
une année feulement, en 1669. Conqieccnce qui lui Ait attribuée.
Sajurifdiébon prorogée d'année en année , julqu en
1691. Son ictabliliémcnt en 1733 , pour une feule année.
Chambre des enquêtes. Ibid. b. Origine du nom de chambre
des enquêtes. Les anciens arrêc.s du paricmem, qui ioiu dus
avoir été rendus és enquêtes du parlement, etoicnt Cuii.»
qui intervenoient fur les luaticres de tait, 6c qui gilîbiciu
en preuve. Commencement de rmAiiution de !a uiambre
des enquêtes. Commiüaires qui furent nommés, les uns pour
faire les enquêtes, ies autres pour les juger. Ordonnance
de Phi'-ippe-le-Bcl , de l’an 1291 , fur le jugement des enquêtes.
Ibid. 30. a. Aiiires ordonnances fur le meme fujet. Le.s
vens des enquêtes écoieiit réputés commonfaux de la muil'on
du roi. Il n’y avoit plus qu’une cliambre des enquetes fifi-
vant l’ordonnance du i i m .rs 1344- Supprclhon laite alors
de la d Aiuélion des jugeurs d'avec les rapporteurs. Les chambres
deS enquêtes n'oiit ni leeau ni grcAe particulier. En
1446 Charles V U divifa la cliambre des enquêtes en deux ,
la grande Sc la petite. Ibid. b. François 1 en créa deux autres,
6c Charles IX une cinquième. D e ces cinq ehumbres,
il ne fubfiAe préfentement que les trois premieres. Officiers
dont elles font compofées. Les conleillors de ces cliambres
vont fucceffiivemcnt à la tournelle , a Ic.xeeption des eon-
fcillers clercs. Ordre que prenneut dans leurs féanccs les
confeillers clercs & les confeillers hues. Compétence des
chambro.s des enquêtes. Ibid. 31. J. Privileges des pvéfidens
6c confcillcrs. Leur liabit de cé-rémonic. Ouvrage à confiil-
ter. Chambre de l'édit , royc-3; F-DIT. Chambre nu-partie, Sc
chambre tri-p.irik, voyc{ CHAMBRE. Chambre des vacations.
Avant que le parlement eût été rendu ordinaire , il n’y
avoir point d’autres vacations que les intervalles qui fe
trouvoient entre chaque parlement. Fonélions quavoiciu à
remplir les membres du parlement dans les icms des vacations,
felon l'ordonnance de 1296. //dd./>. Ordonnances 6c
rcgiArcs où il eA parlé des jugemens qui fe rendoient ex-
trïparlamcnttim. Les préfideiis qui jugeoient hors le parlement,
n’avoient aucun rapporta ce que l’on entend aujourd’hui
par chambre des vacations. Commiffions établies hors
le parlement dans le quatorzième ficcle. On tient qu’ancicn-
ncmem,le parlement ne prenoic point de lettres pour établir
la chambre des vacations. Lc^olim parlent fouvent de
la cliambre des requêtes , comme étant celle oii l’on s’nffcm-
blüit en vacation, On tient coinmunément que les rribunaii.x
qui jugent les affaires du ro i, 6c les ofiieiers qui font à fa
Alite , n’ont point de vacances. Ibid. 32. a. Lieux oii fc font
tenues les chambres des vacations. Commiffions nommées
en différens teins dans le quator7-icme fic clc, lorf'qii’il n’y
avoit point de parlement, Ibid. b. Chambres des vacations
établies dans le quinzième 6c le fcizicme ficcle. Tems dos
féanccs de cette cliambre. Membres qui la com[)ofent. Requêtes
du piiLiis. Comment s’exerçoient autrefois les fonctions
des cliambres de ce nom. Ordonnance dt Pliilippc-le-
Be! fur ce fujet. Ibid. 33. a. Quelles étoient les fondions
des maîtres des requêtes du palais. Ordonnances de 1304
ou 1303 , qui règlent le nombre d’oAîciois aux requêtes.
Autres ordonnances relatives aux requêtes. Celle de 1318.
Ibid. é. Celle de 1320. Il paroit que dés 134M les gens des
requêtes du palais étoient confidcrés comme une cour qui
avoit la concurrence avec les requêtes de l’hôtel. Les nuu'-
tres des requêtes du palais avoicm dés 13 38, cour 6cju-
rifdiétion. Ibid. 34- 'J- Cette jiirifcliélion s’appciloit aiiffi l’ol-
fice des reciuércs du palais. Etabliffement de l’iifagc des com-^
mittimus aux requêtes du [lalais. Réglement de Charles ’v
en 1364, touchant ces requêtes.Les requêtes du palais étoient
juges de leurs compétences. Charles V les qualifie de corn-
P A R
'iblffalrcs. interruption de rexerdee de leur jurifdiéiion fous
O u rle s VI. Ibid. b. OAiders tpii compofoienc La chambre
des requêtes fous François l 6c Charles IX. Création faite
par Henri UI d’une fécondé diambrc dos requêtes du palais.
IXverfes créations 6c I'lqipreffions de ces officiers. Comment
ces clunibres font aujourd’hui compofées. lù'ivileges
6c fondions des i -.-qucces du palais. Chancellerie près le parlement.
Andennemeiit cette cour n’avoit que la grande chancellerie
de France. Ib'id. 33. a. Signet qu’avolènt les préfi-
dens du parlement. Pieces que le chancelier étoit tenu
de l'ccller. Quand le parlement tenoit, on ne délivroic point
ailleurs les lettres de juAicc. Pouriùivans qui étoient avec
le ro i, 6c qui devoient examiner toutes les requêtes avant
qu’elles hiffem envoyées au grand fccau. Privileges du
parlement. Ibid. b. Ouvrages à confulccr. Ibid. 36. a.
Parlement. Son origine. IIL 76. b. On diAiiiguoIt dés le
tems de Charlemagne deux chambres dans les parlLiiiens,
l ’une pour les eccléfiaAiques , l’autre où fc traitaient les
affaires du gouvernement civil. V. 227. b. Etabliffement
tl’ime chambre du coufeil au parlement de Paris par Fiau-
çois L III. 50. a. Comment les offices du ])ariement devinrent
perpétuels. IV. 898. «/.Comment fe régioit l’ct.ic des
préfidcns 6c confeillers au comnienccmcr.t de la tenue des
jxarlemens. 24. b. D ’où l'e font formés les anciens parlemens
tenus fous la fécondé race : les nouvelles ordonnances étoient
alors dreAées dans le parlement mé'me. V . 700. b. Le parlement
appelle autrefois confeil commun du : ■ oi , IV. 4. m 6C
quaunc de cour des pairs. XI. 762. a , b. Les féances des parlemens
nommées autrefois grands-jours. V l l l . 893. b. Premiere
chambre de chaque parlement.III. 31, i. 33. .1. Chambre
des prél.^ts, grand’ciiambre du parlement de Paris. 31.
a. 35. b. Chambre criminelle. 30. b. Chancellerie particulière,
piés le |)arlement de Paris. 117. a. Chancelleries prés
les parlemens. 118. a , b. Séance des pairs au parlement.
XI. 761. b. Pairs eccléfi.iAiques qui ont confervé- Iciirféance
au parleincnt de Paris. IV. 27. a. Places de confeillers qui
turent refervées à des clercs lorfquc le parlement fut rciiclu
lédemaire : qui font ceux qui peuvent obtenir un office de
confeiilei-clet c ; ces confeillers ne vont point à la to uni. 11c,
ê-v. Ibid. b. Rang des confeillers-elercs à la grand’chambre
ou parlement, & dans les autres tribunaux.//>/u'. Coiifeil- 1ers (I honneur. 28. b. Confeillers du roi. 31. u. Doyen
du parlement. V . 96. b. Communauté des avocats 6< procureurs
au parlement. III. 717. b. Des procureurs. XIII.
4 Î I . a , b.— 418. b. Tems où l’on volt pour la premiere
fois un procureur du roi au parlement. VU . 601. a , b. Notaires
du parlement. XL 243. a. Greffiers. VH. 923. a , b.
Q uelle cA k plus ancienne ordonnance qui n’a été que
vériiiée 6c enregiArée en parlemenr. V . 701. b. Vérifications
des lettres <lu roi en parlement. X V II , 68. b. Leur
cnregiftrement, W.6>)^.a,b. Scc. En que! tems commence
le premier regitre des ordonnances qu'il y a eu parlement.
703. a. En quels cas on affemble les deux fémeAres du
parieinent. X IV . 943. S-éances du roi au parlement: formalités
qui s’übfcrvent alors. IX. 381./>, 382. «/, i . 383. c.
Parlement d A ix ou de Provence, le feptieme des parle*
mems de France. Ereaioii de ce tribunal par Louis H ,
comte de Provence. Son ére-ffion en cour fouverninc &
parlement par Louis X I I , roi de France. IDifpofitions de
l'édit de création , donne en 1301. XII. 36. «t. Edit de François
I connu fous le nom l^’ordonnance de Provence. Autres lolx
rendues en 1544 6c 16 47, relatives à ce paricmoiir.
Différentes chambres dont il ell formé. Officiers ijui le com-
polent. Ih’.d. b. Tems 011 il commence aniniclleiuonc fes
leances. Celles de la chambre des vacations. Etendue de
fon refforr. Ses judicatures royales. Droit d’annexe dont
jouit ce pailemcnr, eu vertu duquel aucune expédition
émanée de la cour de Rome ou de la légation d’Avignon ,
ne peut être exécutée dans fon rcAbrt, l'ans fa ponnilfion ,
jiareaiis , entérinement , attache ou annexe. Ibid. 37. a.
M. de la llochcflav'ii remarque que ce parlement a de
tout tems accoutumé en I’ubfencc des gouverneurs 6c licii-
Tcuans généraux, eu cas de befoin 6c iiéceffité, de fc mêler
des finances 6c permettre les impofitions, éi-c. Ce parlement
avoit eu de toute ancienneté le conimaiulcment de la province
, en l’abfencc du gouverneur. L’ufagc qu’il fit de fon
autorité dans le tems de la ligue, lui attira de la part de
Henri IV un témoignage Imnorable. Ce parlement eA chargé
de tous les tems , à chaque paix , d’on ordonner la publication.
Ibid, b. ‘
Parlement ambulatoire. X II. 3 8. a.
Parlement à Amiens. Ercélioii de ce parlement par la reine
■ menu de Bavière, pendant la démence de Charles V I , roi
de France. XII, 38. J
Parlemens <//7ck/7.î. X II. 38. .7.
Parlement d’Angleterre Hiûoirc d’Angler. •) lieu de fes
affemblce.s. \ ers de l’auteur de la Hcnriàde fur ce parlc-
nicm. Comment il étoit nommé autrefois. X ll. 38. «/ Di-
veihte de lenumens lur le pouvoir 6c l’autorité des anciens
"P A R
parlemens de la Grande-Bretagne, fur les perfonnes qui ’
compofoient, 6c fur roriginc de la chambre des communes.
Le parlement cA indiqué par une fommation du roi , 6c
quand îi pairie pailementaire fut orabiie , tpus les pairs
etoicnt fommés ciiacim eu parricuHcr. Anciemiemeiu , la te-
mirc dull fief formoit le droit de féaiice. La prc.miere foni-
m.icion d’un pair au parlement diffère des fommations fui-
vantes. Ce que porte l'ordre de fommation émané de la
chancellerie. Ibid. b. A qui s’adreffe cet ordre. Comment
fe fait la repréfemation du roi eu pariemem. Terme des
jiarieniens Ions différens rognes. D e i’éieélion des membres
du parlement. Tout membre de ce corps doit s’y rendre
fur 1 ordre de fomm.ition, :'i moins qu'il ne produife des
exeufes raifonnables de fon abfence. Privilege pour clia-
cuii de CCS membres & de fes domeAiques j/endam les
affemblécs. Lien où le parleiiieiu doit l'e tenir. Ordre l'clon
lequel chucim y fiege. Ibid. 39. a. Serment préié par les
repréfentans de la chambre des communes. En quoi diffère
le pouvoir dos deux chambres. De h manière dont les bills
ou projets d’ailes font propofés 6c débattus. Ibid. b. Quarante
nieinbres fuffifenc pour former la chambre des communes
, & Iniit pour former un comité. F'ormalités obfer-
vées dans la manière de paik-r 6c de donner les fuffrages.
Le nombre des membres dans )a eiiambie des pairs ne peut
être déterminé. Nombre des membres de celle des communes.
Les deux chambres doivent être prorogées on dif-
foutes enfemble. Ibid. 40. <7. Réflexions fur la fagcA'e du
gouvernement d’Angleterre. Les rois peuvent convoquer un
paricment, s’il en eA befoin, dans un tems auquel la loi ne
les oblige pas de le faire. E.xamen d e laq u efîio n , file parlement
n’amon pas droit de s’aAembler lui-nicme , lorfquc
dans des cas d’extrême néceAlté , le roi négligeroit de le
convoquer. Anecdotes fur Philippe III 6c Philippe I V , lols
d Efpagne. ( ,’eA en vain que les parlemens s’aifcmbLiu .
silène leur cA pas ]>ermis de continuer leurs féances , jui-
qu’à ce qu'ils aient achevé les affaires pour lefquelies iis fe
loin afiembiés. Ibid. b. C'eA principalement en rcfulhnr cî'a-
s'oir des parlemens , ou en dilîolvanr ceux qui étoient af-
femblés , que quelques princes ont tâché d’établir leur piiif-
finees. Réflexions de M. de Voltaire fur les otages ou’a
effuyés de
mis en tems le gouvernement d’Angleterre.
Ibid. 41. .7
Parlement d'A/tglcicrr:. Son origine. III. 32. b. XVIÏ . 3S8.
b. 628. a. Parlement des anciens' Saxons. 628. a. C e fut
fous Edouard 1 que le parlement prit une nouvelle fo rme ,
telle qu'elle eA à-peu-près de nos jours. 622. /•. Sous Edouard
H , le parlcmeut s’.-:iTOgca le pouvoir léglAatif conjointement
avec le roi. III. 48. h. Sons Charles I , le parlement
obtint de ne pouvoir être cafié que du confentement des
deux chambres. 49. Do la chambre h.uite ou cliambre
des pairs. 32. .a, b. D e la chambre baffe ou des communes.
48. b. 726. b. Rspréf'entans des villes 6c de.s provinces
dans la chambre baffe. III. 312. b. l'oyc^ R eprésentant.
Manière de convoquer le parlement : comment s’y font
les (l.diberations. III. 49. a. Parlemens triennaux. X'Vl. 638.
a. /-ilîciiiblé-e du parlement dans laquelle le prince d'Orange
fut appelle au thiqne. IV. 164. b. On voit de vives traces
d'éloquence dans le paricment d’Aiiglcrerre. V . 330.
Parlcmcns, anti-. Cours fouveraines établies en divers
tems par quelque autorité non-légitime. E.xemplc.s. Parlemens
établis par Henri III & continués par Henri IV peu-
dantles rroublesde la ligue, XU. 41. a.
Paricment de l ’Afccnjhn. Séance que le parlement tenoit
vers ht fête de l’Afeenfion. XU. 41. a.
P.irlcmcnt de l 'Ajj'omption. X ll. 41. i.
Parlement de Beaunc.WX.^l. b.
Parlement de Befançon. Sou origine. HiAoire de ce parlement.
XII. 41 b. Comment il étoit autrefois compofe. Ibid.
43. a. Pouvoir étendu qu’il avoir. Les membres de cette
compagnie ont toujours jou i, dés le tems de fii premiere
iiiAitution, de la r.oblelle cranfiniffible au premier degré.
Cette compagnie a toujours été féconde en grands hommes.
Oiheiers qui la compofent aujourd’h u i, 6c qui forment fes
ditTcremes chambres. Ibid. b. Four de la rentrée de ce parlement.
Objets de la fcance du furleixlemain. Préfidiaiix ,
bailliages, niaitrifcs des eaux & forêts , 6c juAices particulières
compril'cs dans le relTort du paricment de Befançon.
Ibid. 44, a.
Parlement de Bordeaux, le quatrième du royaume. XII.
44. a. Du tems de fon iiiAitution. HiAoire de ce parlement.
Ibtd. b. Officiers qui compofent fes differentes chambres
Ibid. 46. b.
P.irUment des bourgeois de Paris. X ll. 46. b.
Parlement de Bourgogne , feant à Dijon , le cinquième du
royaume. Son origine. XII. 46. b. Suite de fon hiAoirc. Ibid.
47. a. Officiers qui compofent les chambres de ce parlcmemr.
Ibid. b. Sieges royaux qui reffortiffent à cette cour fouve-
raiiie. Ibid. 48. a.
Parlement de Drc(J'e. XII. 48. a.
■’ri