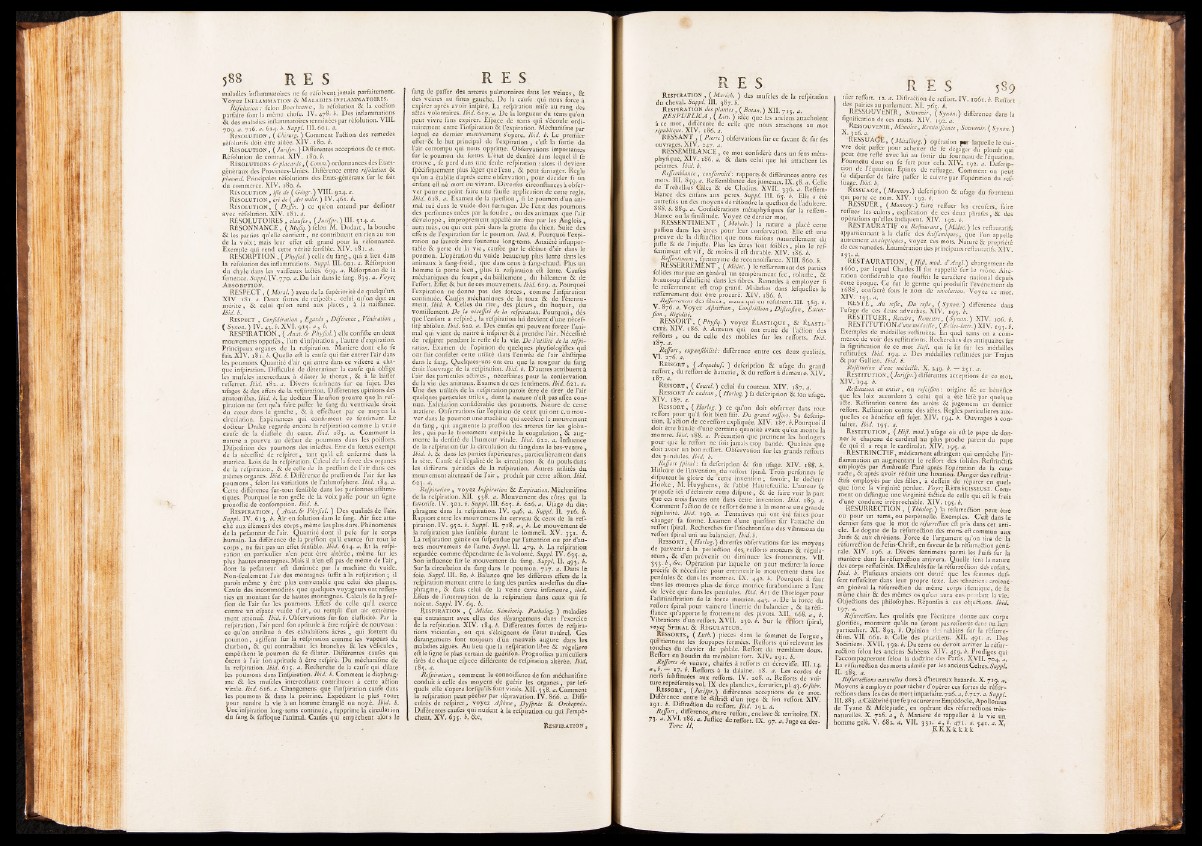
i ^ li'
i l p t r ' '
W -
i i n r H
‘ ' 1'
R E S
n.
innlacUcs infl:immatoucs iie To rcfolveiH jamais parfaitement.
V o y e z I n flammatio n & Maladies in f lamm a to ir es.
RJfolurio/i ; I'don Roorliaavc, ia rdblutioii &. la codion
parfiite Com la iml-me dioCc. IV. 478. b. Des inflammations
ÜL des maladies indammatoires terminées par rolbliition. VIII.
7D(j. a. 716- ‘t- 614. b. Unppl. III. 601. a.
RL'SOLuriON , ( Chirurp;. ) Comment l’aélion des remedes
rcColiiriCs doit être aidée. X IV . 180. b.
Résolution , ( Jurifpr. ) Différentes acceptions de ce mot.
Réiblmion de contrat. X lV . 180./>.
Résolutions 6-placj.rJs, ( Comm.) ordonnances des Etats-
généraux des Provinces-Unies. Difterence entre réfolution &
placard. Principales réCoUitions des Etats-géneraux lur le fait
du commerce. X IV . 180. b.
Resolution , ijlc de ( Geo^r. ) VII I. 924. a.
Résolution , cri de ( A n milit. ) IV. 461. /».
Résolution, ( Dc^'m. ) ce qu’on entend par deflincr
avec réfolution. X IV. 181. a.
RÉSOLUTOiRbiS , claufes , ( Jurifpr. ) III. 514.
R É SO N N AN C E , {Mu/iq.)(i\ow M. Dodart, la boudie
& les parties qu’elle contient, ne contribuent en rien au ton
de la v o ix ; mais leur effet efl grand pour la réfonnancc.
Exemple qui rend cette vérité fenliblc. X IV . tS i. a.
RESORPTION , ( Phyfiûl. ) celle du lang , qui a lieu dans
la réfolution des inflammations. Suppl. III. 601. a. Réforption
du cliyle dans les vailTeaux laéfés. 699. a. Réforption de la
Ibmence. Suppl. IV . 770. a. Du lait dans le fang. 83 9. a. T oyc^
A bsorption.
RESPECT , ( Moral. ) aveu de La fupérioriré de quelqu’un.
X IV . 181, a. Deux fortes de refpeéb, celui qu’on doit au
mérite , Si celui qu’on rend aux places , à ia naiflance.
Ibid. b.
Respect , Confîdèraiion , Egards , Déférence, Veneration ,
( Synon. ) IV. 43. é. X V I . 9 j 3. rf , b.
RESPIRATION , ( Anat. & Phyf.ol.) elle confille en deux
mouveinens oppofés-, l'im d’infpiration , l’autre d'expiration.
Principaux organe.s do la relpiration. Maniéré dont elle fc
fait. X IV . 181. b. Quelle eft la caiife qui fait entrer l’air dans
les poumons. Quantité d’air qui entre dans ce viteere à chaque
infpiration. Difficulté do déterminer la caiife qui oblige
les mufcles imercoflaux à dilater le thorax , 8c à le laiffer
refferrer. Ibid. 182. Divers fcntimeiis fur ce fujet. Des
ufages Sc des cftets de la refpiration. Diflérentes opinions des
anatomiftes. Ibid. b. Le dofteur Thrufton prouve que la refpiration
ne fort qu’à faire pafler le fang du ventricule droit
du coeur dans le gauche , & à effeélucr par ce moyen la
circulation. Expériences qui confirment ce fentiment. Le
doéleur Drake regarde encore la refpiration comme la vraie
caufe de la diaftole du coeur. Ibid. 183. a. Comment ia
nature a pourvu au défaut de poumons dans les poilfons.
Difpofition des poumons des infeéles. Etat du foetus exempt
de la nécefiîcé de rcfpirer, tant qu il cfl enfermé dans la
matrice. Loix de la refpiration. Calcul de la force des organes
de la refpiration, Sc de celle de la preffion de 1 air dans ces
mèmesorganes. Ibid. b. Différence de preffion de l’air fur les
poumons, felon les variations de l’athmofphere. Ibid. 184. a.
Cette différence fur-tom fenfible dans les perfonnes aflhma-
tiques. Pourquoi le ton grêle de la voix pafie pour un figne
pronoflic de confomption. Ibid. b.
Respiration, (A n a c .& Phyfiol. ) Des qualités de l’air.
Suppl. IV. 613. b. Air en folutioii dans le fang. Air fixe attaché
aux élémens des corps, même les plus durs. Phénomènes
de la pefanteur de l’air. Quantité dont il pefe fu r ie corps
humain. La différence de la preffion qu’il exerce fur tout le
co rp s , ne fait pas un effet fenfible. Ibid. 614. a. Et la refpiration
en particulier n’en peut être altérée, même fur les
plus hautes montagnes. Mais il n’en ell pas de même de l’a ir ,
dont la pefanteur efl diminuée par la machine du vuide.
Non-feulement l’air des montagnes fuffit à la refpiration ; il
paroît même y être plus convenable que celui des plaines.
Caufe des incommodités que quelques voyageurs ont reffen-
tics en montant fur de hautes montagnes. Calculs de ia preffion
de l'air fur les poumons. Effets de celle qu’il exerce
contre un efpace vuide d’air, ou rempli d’un air extrêmement
atténué. Ibid. b. Obfervations fur fon élafliciié. Par la
refpiration, l'air perd fon aptitude à être refpiré de nouveau :
ce qu’on attribue à des exhalaifons âcres , qui fortent du
poumon, agiffent fur la refpiration comme les vapeurs du
charbon, 8c qui contraâant les bronches 8c les véficules,
empêchent le poumon de fe dilater. Différentes caufes qui
ôtent à l’a'ir fon aptitude à être refpiré. D u méchanifine de 1a refpiration. Ibid. 615. a. Recherche de la caufe qui dilate
les poumons dans l’infpiration. Ibid. b. Comment le diaphragme
Sc les mufcles intercoflaux contribuent à cette aftion
v i t a l e . 616. U. Changemens que l’infpiration caufe dans
les poumons 6c dans la poitrine. Expédient le plus court
pour rendre la vie à un homme étranglé ou noyé. Ibid. h.
Une infpiration long-tems continuée, fupprime la circulation
du fang &, fuftbque l’atiimal. Caufes qui empêchent alor 5 le
R E S
fang de paffer des arteres pulmonaires dans les v eine s , Sc
des veines au finus gauche. De la caufe qui nous force à
expirer après avoir infpiré. La refpiration mife au rang des
affes volontaires. Ibid. 617. a. De la longueur du tems qu’on
peut vivre fans expirer. Efpace de tems qui s’écoule ordinairement
entre l’iofpiiation & l’expiration. Méchanifme par
lequel ce dernier mouvement s’opère. Ibid. b. Le premier
effet 8c le but principal de l’expiration , c'eff la fortic de
l'air corrompu qui nous opprime. Obfervations importantes
fur le poumon du foetus, L ’état de denfité dans lequel il fe
trouve , fe perd dans une feule refpiration ; alors il devient
fpécifiquement plus léger que l’eau, 8c peut furnnger. Regle
qu’oii a établie d’après cette obfervation , pour décider fi im
enfant cil né mort ou vivant. Diverfes circonfiances à obfer-
ver pour ne point faire une fände application de cette regle.
Ibid. 618. a. Examen de la quefiion , Il le poumon d’un animal
nié dans le vuide doit lurnager. D e l’état des poumons
des perfonnes mecs par la foudre, ou des animaux que l’air
développé , improprement appcllé air fixe par les Anglcis ,
aura tués, ou qui ont péri dans la grotte du chien. Suite des
cricts de l’expiration lur le poumon. Ibid. h. Pourquoi l’expiration
ne fauroit être foutenue long-tems. Anxiété infuppor-
table 8c perte de la v i e , caiifée par le défaut d’air dans te
poumon. L’opération du vuide beaucoup plus lente dans les
animaux à faiig-froid , que dans ceux à fang-chaucl, Plus un
homme fe porte b ien, plus fa refpiration eff lente. Caufes
mechaniques du foupir , du bâillement, du hàlement 8c de
l ’effort. Effet 8c but de ces mouvemens. Ibid. 619. a. Pourquoi
l’expiration ne donne pas des forces , comme l’infpiration
continuée. Caufes mechaniques de la toux 8c de l’étcmn-
ment, Ibid. b. Celles du rire, des pleurs, du hoquet, du
vomilTement. De la neeeßte de la refpiration. Pourquoi, dès
que l'enfant a relpiré, la refpiration lui devient d’une nécef-
fité ablbhie. Ibid. 620. a. Des caufes qui peuvent forcer l’animal
qui vient de naître à infpircr 8c à prendre l’air. Néceffité
de refpirer pendant le relie de la vie. De l'utilité de la refpiration.
Examen de l'opinion de quelques phyfiologillcs qui
ont fait confiiler cette utilité dans l’entrée de l’air élallique
dans le fang. Quelques-uns ont cru que la rongeur du fang
étoit l’ouvrage de la refpiration. Ibid. b. D ’autres attribuent à
l’air des particules a fliv e s , ncceffaires pour la confervatiort
de la vie des animaux. Examen de ces fentimens. Ibid. 621. a.
Une des utilités de la refpiration paroit être de tirer de l’air
quelques particules utiles , dont la nature n’ell pas alTez connue.
Exbalaiiou confidérablc des poumons. Nature de cette
matière. Obfervations fur l’opinion de ceux qui ont c .u trouver
dans le poumon une machine qui accéléré le mouvement
du fang, qui augmente la preffion des arteres fur les globules
, qui par le frottement empêche la coagulation , Sc augmente
la denfité de l’humeur vitale. Ibid. 622. a. Influence
de la refpiration fur la circulation du fang dans le bas-verjire ,
Ibid. b. Sc dans les parties fupêrieures, particuliérement dans
la tête. Caufe de l’égalité de la circulation 8c du pouls dans
les différens périodes de la refpiration. Autres utilités du
mouvement alternatif de l’air , produit par cette aélion, Ibid.
623. a.
Refpiration , voye z Infpiration 6c Expiration. Méchanifme
de la relpiration. XII. 538. a. Mouvement des cotes qui la
favorife. IV. 301, b. Suppl. III. 625. b. 626. a. Ufage du diaphragme
dans la refpiration. IV . 946. a. Suppl. II. 716. h.
Rapport entre les mouvemens du cerveau 8c ceux de la refpiration.
IV. 932. b. Suppl. IL 718. a , b .L s mouvement de
la refpiration plus fenfible durant le fbmmeil. X V . 331. b.
La refpiration gênée ou fufpcndue par l’attention ou par d’autres
mouremens de l’ame. Suppl. II. 479. b. La refpiration
regardée comme dépendante de la volonté. Suppl. IV . 633. a.
Son influence fur le mouvement du fang. Suppl. II. 493. b.
Sur la circulation du fang dans le poumon. 717 . a. Dans le
foie. Suppl. III. 80. b. Balance que les différens effets de b
refpiration mettent entre le fang des parties au-deffus du dia-
pliragme, 8c dans celui de la veine ca ve inférieure, ibid.
Effets de l’interruption de la refpiration dans ceux qui fe
noient. Suppl. IV. 69. b.
Respiration , ( -Médec. Séméiotiq. Patholog. ) maladies
qui entrainent avec elles des dérangemens dans l’exercice
de la refpiration. X IV . 184. b. Différentes fortes de refpira-
tions vicicLifes, ou qui s’éloignent de l’état natiirel. Ces
dérangemens font toujours d’un mauvais augure dans les
maladies aiguës. Au lieu que la refpiration libre -8c reguliere
cfl le figne le plus certain de guérifon. Progiiofitcs particuliers
tirés de chaque cfpece différente de refpiration altérée. Ibid.
183. . .
Refpiration, comment la connoilTance de fon méchanifme
conduit à celle des moyens de guérir les organe.s, par lef-
quels elle s’opère lorfqu’ils font viciés. XII. 338. <2. Comment
la refpiration peut pécher par dépravation. IV . 866. a. Difficultés
de rcfpirer, v o ye z Aßhme, Dyfpnie 6c Orthopnée.
Différentes caufes qui nuifent à la refpiration ou qui l’empè-
ch e n t.X V .6 3 5 . ^ ‘
Respiration,
R E S
Respiration , ( Mareeh. ) des mufcles de la refpiration
du cheval. Suppl. Ill, 3S7. b.
Respiration des plantes, {Botan.) XII. 713. .2.
R E S P U B L IC A , I Lin. ) idée que les anciens attachoient
à ce mo t, différence de celle que nous attachons au mot
république. X\y . lU . a.
RESSANE , ( Pierre) obfervations fur ce favanc Sc fur fes
ouvrages. X IV . 247. a.
RESSEM BLANCE, ce mot confidéré clans un feus meta'
phyfique, X IV . 186. a. &, dans celui cpie lui attachent les
peintres. Ibid. b.
Rejfemblanee , conformité: rapports & difl'ércnces entre ces
mors. III. 839. U. Rclfcmblance des jumeaux. IX. 38. .2. Celle
de Trebellius Calca Sc de Oodius. XVII. 336. a. Refi'em-
blance des enfims aux peres. Suppl. lU. 63. b. Elle a été
autrefois un des moyens de réfoiidrc la quellion de l’adiiltcre.
888. b. 889. a. Coufidérations métaphyliques fur la reircm-
blance ou la fimilitude. V o y ez ce dernier mot.
RESSEN T IM EN T , (^MoYalc.) la nature a placé cette
palfion dans les êtres pour leur confervacion. Elle efl une
preuve de la diflimflion que nous faÜbns nacurellemem du
jufle Sc de l’injulle. Plus les êtres font foibles, plus le ref-
fentiment efl v i f , 8c moins il efl durable. X IV . i86. b.
Rejjcnrimait , fynonyme de reconnoilfance. XIII. 860. i.
RESSERREMENT , ( Médec. ) le relferrcment des parties
folides marque en général un tempéiamenc fe e, robultc, 8c
b.-aucoup d’élaflicité dans les fibres. Remecles à employer fi
le relferremeiu cfl trop grand. M.iladies dans lefquelles le
leffcrrement doit être procuré. X IV . 186. b.
Rejfcrrcment des fibres, maux qui en réfulteiit. III. 389. b.
V . 876. «. V o y ez Aflriaion, Coufriaion, Diflcnfion, Exten-
fion , Rigidité.
R E S SO R T , {Phyjîq.) vo ye z Élastique, & Élasticité.
X IV . 186. E Auteurs qui ont traité de l’adion des
refforts , ou de celle des mobiles fur les refforts. Ibid
187.
Rejfon, exp.injibilité: différence entre ces deux qualités.
V I . 276, a.
R essort , ( Arquebuf, ) defeription 8c ufage du grand
reffo rt, du relTort de batterie, 8c du reffort à dcmeuie. XIV
187. 4.
R e s s o r t , ( Coutcl.) celui du couteau. X IV . 187. a.
) b defeription 8c Ion ufage.
R essort , ( Horlog. ) ce qu’on doit obfcrver dans tout
reffort pour qu'il foit bien fait. Du grand reffort. Sa deferip-
tion. L’aélion de ce reffort expliquée. X IV . 187. b. Pourquoi il
doit être bandé d’une certaine quantité avant qu’on monte la
montre. /è/V. 188. a. Précaution que prennent les liorlo‘’ ers
pour que le reffort ne loit jamais trop bandé. Qualités que
doit avoir un bon reffort, Obfei vatio.n fur les grands refforts
des p. ndules. Ibid. b.
Reffort Jpiral : fa defeription 8c fou ufage. X IV . 188. b.
Hifloire de l’invention du reffort fpiral. Trois perfonnes fe
difputent la gloire de cette inventinn; favoir, le doflour
Ü ü o k e , M. Huyghcns, 8c fabbè HautefeuiUe. L’auieur fe
propofe ici d’éclaircir cette difpute, Sc de faire voir la part
que ces trois favans ont dans cetre invention. Ibid. 189. a.
Comment l’aftion de ce reffort donne à la montre une grande
régularité. Ibid. 190. a. Tentatives qui ont été faites pour
changer fa forme. Examen d’une quellion fur l’attache du
reffort fpiral. Recherches fur l’ifochronifme des vibrations du
reffort fpiral uni au balancier. Ibid. b.
R e s s o r t , {Horlog.) diverfes obfervations fur les moyens
de parvenir à la perleélion des. rcllbrts moteurs 8c régulateurs,
8c d’en prévenir ou diminuer les frottemens. VII.
333.^',6'c, Operation par laquelle on peut mefurer la force
précife 8c néceffaire pour encreienir le mouvement dans les
pendules & dans les montres. IX. 442. b. Pourquoi il faut
dans les montres plus de force motrice fnrabondanre à l'arc
de levée que dans les pendules. Ibid. Art de l’horloger pour
l’adminiflration de la force motrice. 443. a. De la force du
reffort fpiral pour vaincre l'inertie du balancier , Sc la réfi-
fiance qu’apporte le frottement des pivots. XII. 668. a , b.
Vibrations d’un reffort. X V ll. 230. b. Sur le réflbrt fpiral,
■ i'tyei Sp ir a l 8c R é g u la teu r . ’
R e sso r t s, {L uth.) pieces dans le fommet de l’orgue,
qui tiennent les foupapes fermées. Refforts qui relevent les
touches du clavier de pédale. Reffort du tremblant doux.
Reffort en boudin du tremblant fort. XIV. 191. b.
Refforts de voiture, chaifes à refibrts en écreviffe. III. 14.
<t,b. 17. b. Refforts à la dalaine. 18. a. Les cordes de
nerfs fiibflituées aux refforts. IV. 208. a. Refi'orts de voi-
tu « repréfentésvol. IX des planches, ferrurier,pl.43. &fuiv.
différentes acceptions de ce mot.
D iffe r en t entre le dillriél d ’un juge 8c fon reffort. XIV
191. b. Diflraâion du reffort. Ibid. 192. a.
'■ effort, enclave 8c territoire. IX.
73. X V I . 186. d. Juflice de reffort. IX. 97. Juge en der-
Tome II. y' B
R E S 5S9
nier reffort. i i , . r . Dlfir.iélion de reffort. IV . 1061. Refi'ort
des pairies au pnrlemuu. XI. 763. b.
RESSOUVENIR, Souvenir, {Synon.) différence dans U
lignification de ces mots. XIV, u j i .a .
i^^ssovVLmii, Mémoire, Rcmimjcence,X. 326. Souvenir. (Sy\ noO n.) J
RES SU A^ E, (Metallurg.) Opération f r laquelle le cuivre
doit paffer pour achever de fe dégager du plomb qui'
peut a r e reffe avec lui au fortir du fourneau de l’équation.
Eourneau dont ou fe fert pour cela. X IV . 192. a. Deferip-
tion de I équation. Epines de reffuage. Comment on peut
le difpenfcr de faire palier le cuivre par l’opération du rof-
fuage. Ibid. b.
Ressuage, (Monnoy.) defeription 8c ufage du fourneau
qui porte ce nom. XW , 192. b.
RESSUER, (Monnoy.) faire reffucr tes creufers, faire
reffticr les culots, explication de ces deux phrafes, 8c des
opérations qu’elles indiquent. XIV, 192.6.
R E ST AU R A T IF ou Rejhuiant, (Médec.) les rcffaiiratifs
apparriennent à la claffe des balfumiqucs, que l’on appelle
autrement analepûques, vo ye z ces mots. N.atiire 6c propriété
de ces remedes. Enumération des principaux reftaiiratifs X IV
193. a.
R E S T AU R A T IO N , (Hiß. mod. d'Angl.) changement de
1660, par lequel Cb.irles II fut rappelle fur le trône. Alte ration^
confidérablc que fouftrit le caraélere national depuis
•cette époque. Ce fut le germe quiproduific l’événement do
1688, confacré fous le nom de tévoluiion. V o y ez ce mot
X IV . i 93.m
R E S T E , Au refle. Du refle, (Synon.) différence clans
l’ulage de ces deux adverbes. XW . 193. b.
R E ST ITU ER , Rendre, Remettre, (Synon.) X IV 106 b
REST iTU T ION i/ ’tmcmc-bui//^, (Bc lles-leitr.)X[\ . 193. b.
Exemples de médailles reffituées. En quel teins on a commencé
de voir des refticutions. RecherclKS des antiquaires fur
la figniheation de ce mot Reß. qui fe lit fur les médailles
reffituées. Ibid. 194. a. Des médailles reffituées par Traian
& par Gallien. Ibid. b.
Reßitution d ’une médaille. X. 249. b. — 231. a.
Restitution, (Jurijpr.) différentes acceptions de ce mot.
X IV . 194. b.
Reßitution en entier, ou refcifiOn: origine de ce bénéfice
que les loix accordent à celui qui a été léfé par quelque
aéle. Reffitution contre des arrêts Sc jugemens en dernier
reffort. Rellitiiiion contre des aéles. Regies particulières auxquelles
ce bénéfice eft fujet. XIV. 194. b. Ouvrages à con-
fulter. Ibid. 193. a.
Restitution , ( Hiß. mod. ) ufage oit eft le pape de donner
le chapeau de cardinal au plus proche parent du pape
de qui il a reçu le cardinalat. X IV . 193. a.
R E ST R IN C T IF , médicament affringent qui empêche l’inflammation
en augmentant le reffort des folides. Reffrinélifs
employés par AmbroiCe Paré après l’opération de la cara-
raéle, & après avoir réduit une luxation. Danger des reffrin-
élifs employés par des filles, à deffein de réparer en quelque
forte la virginité perdue. Voye:^ RÉTRÉCIsseuse. Comment
on diftingue une virginité faiffice de celle qui eft le fruit
d’une conduite irréprochable. X IV . 193.6.
RÉ SU R R E C T IO N , (Théolog.) la réfurreélion peut être
ou pour un tems, ou perpétuelle. Exemples. C e l l dans le
dernier fens que le mot de réfurreaion eft pris dans cet article.
Le dogme de la réfurreélion des morts eft commun aux
Juifs 8c aux chrétiens. Force de l’argument qu’on rira de la
réfurreélion de Jefus-Chrift, en faveur de la réfurreftion générale.
XIV. 196. a. Divers fentimens parmi les Juifs fur la
maniéré dont la réfurreftion arrivera. Quelle fera la nature
des corps reffufeités. Diffictiltés fur la réfurreftion dés enfans.
Ibid. b. Plufieurs anciens ont douté que les femmes duffem
reffufeiter dans leur propre Éexe. Les chrécicnj croient-
en général la réfurreélion du même corps identique, de la
même chair 8c des mêmes os qu’on aura eus p:::danc la vie.
Objeélions des philolbphes. Répoiifes à ces objeftions. Ibid.
\ç,y.a.
Réfurreaion. Les qualités que l’écriture donne aux corps
glorifiés, montrent qu’ils ne feront pas refferrés dans un lien
particulier. XI. 893. 6. Opinion d-.f rabbins fur la réfurre-
élion. VII. 661. 6. Celle des pharifiens. XII. 491. a. Des
Sociniens. XVII. 392. 6. Du teins où devoir arriver la réfur-
reélton felon les anciens Sabéens. XIV. 439. 6. Prodiges qui
l’accompagneront félon la doélrine des Parfis. X V I I . 704. a.
La réfurreélion des morts admife par les anciens Celtes. Suppl,
II. 283.
Réfurreaions naturelles dues à d’heureux hazards. X. 719. a.
Moyens à employer pour tâcher d’opérer ces fortes de réfur-
reélions dans les cas de mort imparfaite. 726. a, b.yzy. a. Suppl,
III. 883. d,Célébrité que fcprocurerentEmpédocle, Apollonius
de Tyane & Afclépiade, en opérant des réfurreélions très-
naturelles. X. 726. a , 6. Maniéré de rappellcr à la vie un
homme gelé. V . 682. <2. VII. 331. a , b. 471. a. 341, a. X,
K K K k k k k