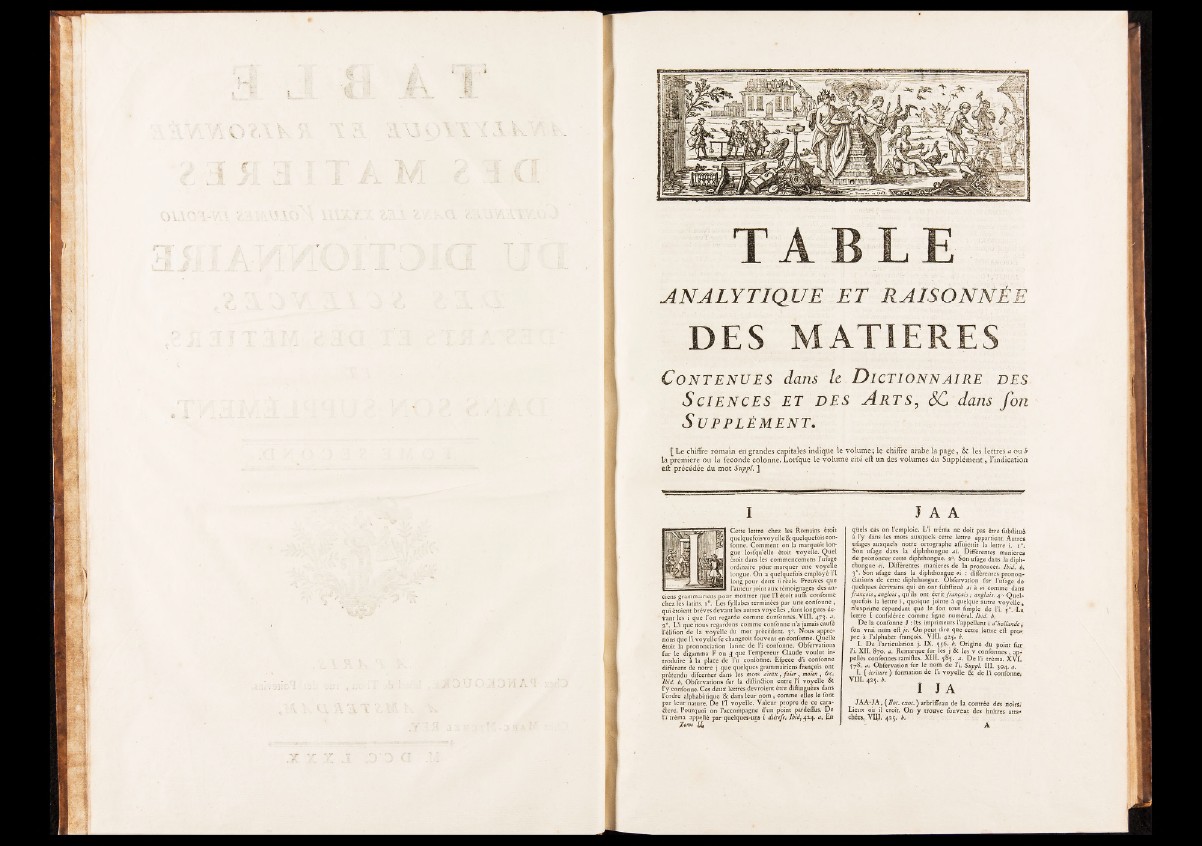
TABLE
ANALYTIQUE ET RAISONNÉE
DES MATIERES
C ontenues dans le D ictionnaire des
S ciences et des A rt s , SC dans fo n
S UPPLÉMENT,
[ Le chltfre romain en grandes capitales Indique le volume ; le chiffre arabe la page, & les lettres a ou b
la premiere ou la leconde colonne. Lorfque le volume cité eft un des volumes du Supplément, l’indication
èfl: précédée du mot Suppl. ]
J A A
Cette lettre chez les Romains ctoit
quelquefois vo yelleSc quelquefois coi>
lonnc. Comment on la marquo-t longue
lotfqu’elle étoit voyelle. Quel
étoit clans les commencemens l’iiiage
ordinaire pour marquer une voyelle
longue. On a quelquefois employé l’I
long pour deux ii réels. Preuves que
l’auteur joint aux témoignages des anciens
grammairiens pour montrer que l’I étoit aulTi confonne
chez les latins. i°. Les fyllabes terminées par une confonne ,
qui étoient brèves devant les autres voyelles , font longues devant
les i que Ton regarde comme confonnes. V III. 473- ‘t-
4°. L’i que nous regardons comme confonne n’a jamaiscaufé
l’élifion de la voyelle du mot précédent. 3“. Nous apprenons
que l’i v o ye lle fe changeoit fouvent en confonne. Q uelle
étoit la prononciation latine de l’i confonne. Obfervations
fur le digamma F ou J que l’empereur Claude voulut introduire
a la place de l’ii confonne. Efpece d’i confonne
différent de notre j que quelques grammairiens françois ont
prétendu difcertier dans les mots a h u x , foier ^ moïen , &c.
Ibid. b. Obfervations fur la dUlinflion entre l’i voyelle &
î’y confonne. C es deux lettres devroient être diflinguées dans
l’ordre alphabétique & dans leur nom , comme elles le font
par leur nature. D e l’I voyelle. Valeur propre de ce cara-
élcre. Pourquoi on l’accompagne d’un point pardeflus. De
l'i tréma appelle par quelqucs-iins ï d'Urefe, Ibid, 4Î4, a, En
Tortu Ut
qiieis cas on l’emploie. L’î trénia ne doit pas être fubrtituè
à l’y dans les mots auxquels cette lettre appartient. Autres
ufages auxquels notre ortographe alTujettit la lettre i. i*’..
Son iifage dans la diplirhongue ai. Différentes maniérés
de prononcer cette diphthongue. 2«; Son ufage dans la diph-
thongiie ei. Différentes maniérés de la prononcer. Ibid. E
3“. Son ufage dans la diphthongue oi : différentes prononciations
de cette diphthongue. Obfervation fur l’ufage de
quelques écrivains qui en ont fubllituc ai à oi comme dans
f'ra/içois, anglais , ([U i\s ont écrit français^ 4 Q u elquefois
la lettre i , quoique jointe à quelque autre voyelle ,
n'exprime c^endant que le fon tout fimple de l’i. La
lettre 1 conhdérée comme figne numéral. Ibid. b.
D e la confonne J : Ifes imprimeurs rappellent i d’hollande ^
fon vrai nom efl je. On peut dire que cette lettre eff pro».
pre à l’alphabet françois. VIII. 425. b.
I. De l’articulation j. IX. 556. b. Origine du point fur
l’i. XII. 870. a. Remarque fur les j & les v confonnes , appelles
confonnes ramilles. XIII. 585. a. D e l’i tréma. X V L
578. ûi Obfervation fur le nom de l’i. Suppl. III. 504. a.
I. ( écriiure ) formation de l’i vo ye lle Sc de l ’i confonne^
VII I. 42c. é. I J A
J A A - J A ,( .5of . «Dt. ) arbriffeau de la contrée des noirs;
Lieux où il croît. On y trouve fouveat des hnicres attachées,
YU I, 425. b,
A