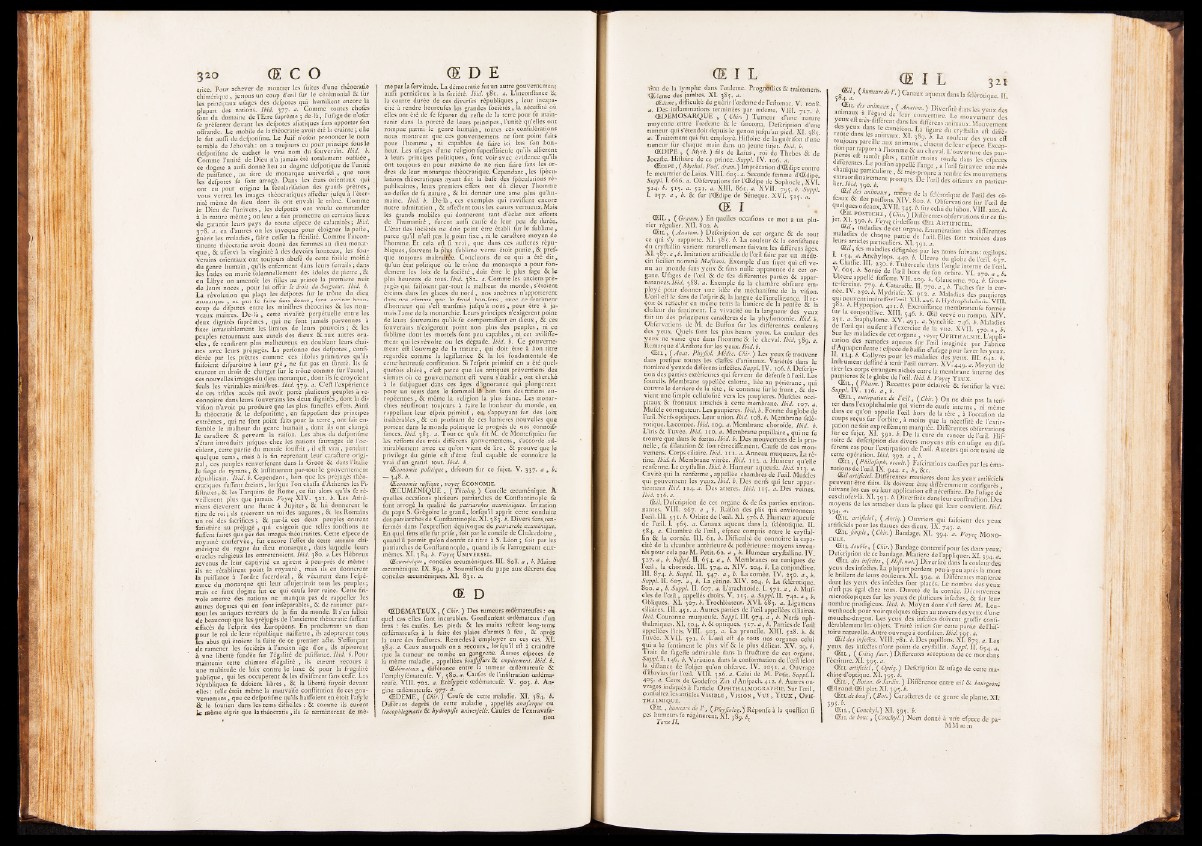
3 i o ( ICO (E D E
ji' '1
tricc. Pour achever de montrer les fuites d’une théocratie
chimérique , jeirons uii coup d’oeil iur le cérémonial Si lur
les principaux ufages des defpotcs qui humilient encore la
plupart lies nations. Ibid. -377. ‘t- Comme^ toutes chofes
font du domaine de l'Etre fuprème ; de là, 1 ufage de n ofer
fe préfenter devant les defpotes afiatiques fans apporter Ion
offrande. Le mobile de la théocratie avoir été la crainte ; elle
le fut auffi du clefpotifme. Le Juif n'ofoit prononcer le nom
terrible de Jehovah ; on a toujours eu pour principe tous le
defpofifme de cacher le vrai nom du fouverain. Ibid. b.
Comme l’unité de Dieu n’a jamais été totalement oubliée
ce dogme a auffi donné lieu nu dogme ddpotique de 1 unité
de puiffancc , au titre de monarque uiiiverfel , que tous
les defpotes fe font arroge. Dans les états orientaux qui ,
ont en pour origine la fécularifation des grands prêtres,
vous verrez, les images théocratiques affeéler jufqu'à l’éier-
riré même du dieu dont ils ont envalii le trône. Comme
le Dieu de l’univers, les defpotes ont voulu commander
à la nature même 3 011 leur a fait promettre en certains lieux
de garantir leurs pays de toute dpec e de calamités ; Ibid.
378 en d'autres on les invoque pour éloigner la pelle,
guérir les maladies, faire celTer la ftérilité. Comme l’incontinente
théocratie avoit donne des femmes au dieu monarq
u e , Scaffervi la virginité à des devoirs honteux, les lou-
verains orientaux ont toujours abufe de cette foible moitié
du genre humain , qu’ils enferment dans Icui s ferrails 3 dans
les Indes on marie folemnellement des idoles de pierre ,6c
en Libye on amenoit les filles au prince la première nuit
de leurs no c es , pour lui offrir le droit du Seigneur. Ibid. h.
La révolution qui plaça les defpotes fur je trône du dieu
monarque , ne put le faire fans doute, fans exciter beaucoup
de difputcs entre les miniffres théocrices & les nouveaux
maîtres. De-là , cette rivalité perpétuelle entre les
deux dignités fuprcines , qui ne fout jamais parvenues à
fixer invariablement les limites de leurs pouvoirs Si les
peuples retournant aux autels des dieux & aux autres oracles
, fe rendirent plus nuilhcureux en doublant leurs chai-
«cs avec leurs préjuges. La perfonne des defpotes , conf.-
dérée par les prêtres comme ces idoles primitives qu’ils
faifoient difparoitre à leur g r é , ne fut pas en fureté. Ils fe
crurent en droit de changer fur le trône comme fur l’au te l,
ces nouvelles images du dieu monarque, dont ils fe croyoient
feuls les véritables miniffres. Ibid. 379. C ’eff l’expérience
de ces triftes accès qui avoit porté pluficurs peuples à re-
connoître dans leurs foiiverains les deux dignités, dont la di-
viffon n’avolt pu produire que les plus funeffes effets. Ainfi
la théocratie & le defpotifme, en fuppofant des principes
extrêmes, qui ne font point faits pour la terre , ont fait en-
femble le malheur du genre Inmiain , dont ils ont changé
le caraffere perverti la raifon. Les abus du defpotifme
»’étant introduits jufques chez les nations laiivages de 1 occident,
cette partie du monde fouffrit , il eff v rai, pendant
quelque tems, mais à la fin reprenant leur caraélere origi-
jia l, ces peuples renverferent dans la Grece & dans l’Italie
le fiege de tyrans, & inffituerent par-tout le gouvernement
républicain. Ibid. b. Cependant, loin que les préjugés théo-
ci-atlqucs fuffent éteints, lorfque l'on chaffa d’Atlicnes les Pi-
fillr a te s ,& lesTarquiiis de Rome, ce fut alors qii’ils fe réveillèrent
plus que jamais. X IV . 321. b. Les Athéniens
éleverent une ffaiiie à Jupiter, & lui donnèrent le
titre de roi ; ils créèrent un roi des augures , & les Romains
un roi des facrifices 3 & par-là ces deux peuples crurent
faiisfaire au préjugé , qui exigeoit que telles fonélioiis ne
fuffent faites que par des images théocratltes. Cette efpece de
royauié confervée, fut encore l’effet de cette attente chimérique
du régné du dieu monarque , dans laquelle leurs
oracles religieux les entretenoient. Ibid. 380. u. Les Hébreux
revenus de leur captivité en agirent à peu-prés de même ;
ils ne rétablirent point la royauté , mais ils en donnèrent
la puiffancc à l’ordre facerdoial, & vécurent dans refpé-
rancc du monarque qui leur aflujettiroit tous les neuples;
mais ce faux dogme fut ce qui caufa leur ruine. Cette frivole
attente des nations ne manqua pas de rappeller les
autres dogmes qui en font inféparables, & de ranimer partout
les antiques terreurs de la fin du monde. Il s’en falloir
de beaucoup que les préjugés de l’ancienne théocratie fuffent
effacés de refprit des Européens. En proclamant im dieu
pour le roi de leur république nailfante , ils adoptèrent tous
les abus qui écoîent la fuite de ce premier aéle. S’efforçant
de ramener les fociétés à l'ancien âge d’o r , ils afpirereiit
à une liberté fondée fur l’égalité de puiffancc.//’lu'. i. Pour
maintenir cette chimère d’égalité , ils curent recours à
une multitude de loix contre le luxe Sc pour la frugalité
publique, qui les occupèrent & les diviferent fans ceffe. Les
républiques fe difoient libres , Si la liberté fuyoit devant
elles: telle étoit même la mauvaife conffitution decesgou-
vernemens, que ce defpotifme qu’ils haiffoient en étoir l’afylc
6c le foutien dans les tems difficiles : & comme ils eurent
le niême efprlt que la théocratie , ils fe terminèrent de mêmeparlafervltnde.
La démocratie fiitun autre gouvernement
auffi pernicieux à la fociété. Ibid. 381. a, L’inconffance 6c
la courte durée de ces diverfes républiques , leur incapacité
à tendre heureufes les grandes fociétés , la néccffité où
elles ont été de fe féparer du reffe de la terre pour fe maintenir
dans la pureté de leurs principes, l’imité qu’elles ont
rompue parmi le genre humain, toutes ces confidératlons
nous monnent que ces gouvernemens ne font point faits
pour l'homme , ni capables de faire ici bas l'on bonheur.
Les ufages d’une religion fiiperffitieiife qu’ils allièrent
à leurs principes politiques, font voir avec évidence qu’ils
ont toujours eu pour maxime de ne rien faire fans les ordres
de leur monarque théocratlque. Cependant , les fpécu-
lations théocratiques ayant fait la bafe des fpéculations républicaines,
leurs premiers effets ont dû élever l’homme
au deffus de fa nature, & lui donner une amc plus qu’humaine.
Ibid. b. De-là , CCS exemples qui rnviffént encore
notre admiration , Sc affesffent tous les coeurs veriuciix.Mais
les grands mobiles qui donnèrent tant d'éclat aux efforts
de riuimanité , furent auffi caufe de leur peu de durée.
L’état des fociétés ne doit point être établi fur le fubliiue,
parce qu’il n’eff pas le point fixe , ni le caraélere moyen de
l’tiommc. Et cela eff ff vnu , que dans ces niiffercs républiques,
fouvent lapins fublimc vertu étoit punie , Sc pref-
que toujours maltraitée. Concluons de ce qui a été d it ,
qu'un état politique où le trône du monarque a pour fondement
les loix de la fociété , doit être le plus fage Sc le
plus heureux de tous. Ibid. 382. <1, Comme les ancienspré-
jugésqui faifoient par-tout le malheur du monde , s'étoient
éteints dans les glaces du nord , nos ancêtres n’apponerent
dans nos climats que le froid bon-fens, avec ce fentimenc
d’honneur qui s’eff tranfmÎN jufqu’à nous, pour être à jamais
l’ame de la monarchie. Leurs principes n’exigerent point
de leurs fouverains qu'ils fe comportaffent en dieux, & ces
fouverains n’exigerent point non plus des peuples, ni ce
fiibüme dont les mortels font peu capables , ni cet aviliffc-
ment qui les révolte ou les dégrade. Ibid. b. Ce gouvernement
eff l’ouvrage de la nature , qui doit être à bon titre
regardée comme la légiflatrice Si la loi fondamentale de
cctte’heiireiife conffitution. Si refprit primitif en a été quelquefois
altéré , c’eft parce que les antiques préventions des
climats oii ce gouvernement eff venu s’établir , ont cberUiè
à le fubjuguer dans ces âges d'ignorance qui plongèrent
pour un tems dans le fommeil lê bon fens des nations européennes
, Sc même la religion la plus faine. Les monarchies
réulTironc toujours à taire le bonheur du monde, en
rappellant leur efprit primitif , en. s’appuyant fur des loix
inaltérables, & en profirant de ces lumières nouvelles que
portent dans le miinde politique le progrès de nos connoif-
(hnees. Ibid. 383. u. To ut ce qu’a dit M. de Montefquieii fur
les refforts des trois différens gonvernemens, s’accorde admirablement
avec ce qu’on vient de lire, Sc prouve que le
privilege du génie eff d’être feul capable de connoitre le
vrai d’un grand tout. Ibid, b
(Economie politique, difcoiirs fur ce fujet. V . 337. a , b.
— 348. i,
(Economie rufiiqitc , voyei^ ÉCONOMIE.
OE CUMEN IQUE , ( Tbéolog. ) Concile oecuménique. A
quelles occafions pluffeurs patriarches de Conffantinople fe
font arrogé la qualité de patriarches acuméniques. Irritation
du pape S, Grégoire le grand, lorfqu’il apprit cette conduits
des patriarches de Conffantinople. X I. 383. b. Divers fens.ren-
fermés dans l’expreffion équivoque de patriarche oecuménique.
En quel fens elle fut prife, foit par le concile de Chalcedoine ,
quand il permit qu’on donnât ce titre à S. Léon ; fuit par les
patriarches de Conffantinople , quand ils fe l’arrogerent eu.x-
mémes. XI. 384. b. Voyc^ UNIVERSEL.
(Ecuménique, conciles oecuméniques. III. 808. rz, i. Maître
oecuménique. IX. 894. b. Soiimiflîon du pape aux décrets des
conciles oecuméniques. XI. 831. a.
(E D
OE D ÉM A TEUX , ( Chir. ) Des tumeurs cedémateufes ; ea
quel cas elles font incurables. Gonflerrient oedémateux d’un
bras : Tes caufes. Les pieds & les mains reffent long-tems
oedémateiifes à la fuite des plaies d’armes à fe u , Sc après
la cure des frafliires. Remedes à employer en ces cas. XI.
384. a. Ceux auxquels on a recours, lorfqu’il eff à craindre
que la tumeur ne tombe en gangrene. Autres efpeces de
la même maladie , appellees boujpjjure Si empâtement. Ibid. b.
(Edim.tteux , différence entre la tumeur oedémateufe 8c
remphyrémateiife. V . 380. u. Caufes de l’infiltration oedéma-
teufe. V lII . 702. a. Éréfypeie oedémateufe. V . 903. b. A ngine
oedémateufe. 977-
OED EME, {Chir.) Caiife de cette maladie. XI. 384. b.
Différens degrés de cette maladie , appellés anafarqiu ou
leucophlegmaüe 8c hydropijîe univerfeile. Caufes de l'extravafation
(E I L 3 2 1
(E I L
thi) de la lymphe dans l'oedeme. PrognOfflcs 8c traitemeiis.
OE'ieme des jambes. XI. 383. a.
Ijilàc-OTC, difficulté de guérir l’oedeme de l’effomac. V . 1008.
a. Des inflammations terminées par oedcinc. VIII, 7 17 . b.
OED EMO SARQ UE , ( Chir. ) Tumeur d’une natiire
moyenne entre l’oedeme Sc le farcoma. Defchption d’iine
tumeur qui s’étendoit depuis le genou jiifqu’aii pied. XI. 383.
a. Traitement qui fut employé. Hiffoire de laguérifon d'imc
tumeur fur cliaquc main dans un jeune fiijct. Ibid. b.
OEDIPE , ( Myth. ) fils de Laïus , roi de Tlicbcs Sc de
Jocallc. Hiffoire de ce prince. Suppl. IV. 106 a
OEdipe , ( MythoL Poif. dm,,,. ) Impi édition tTOEdipe contre cintnitmc ' “ .......................................- ■ ■ ■ -
le inenrtner de Lnms. VIII. 603. n. Seconde teninic d’OEdioe eer.-.o.,r '■ ^ lEes-ptopre n rendieles monveincns
S .,.fl. I. 666. „. Obfervations fin l’OEdîpe de Sopitoelc, X V l! S I / L D» loe - - - -
ÎM . i . 3.5- Î Î I . n. XIII. 86t. 4 . " i
1 . 137. a , b. Sc fur l’OEclipe de Séneque. X V I . 513. a. OE I OE IL , {Gramm.) En quelles occafions ce mot a un plu-
rier régulier. XII. 802. b.
OE i l , {Jn.itom .) Defeription de cet organe & de tout
ce qui s’y r.apportc. XI. 383. b. La couleur Sc la confiffancc
du cryffallin varient naturellement fuivant les différens âges.
•XI. ,b. Imitation artificielle de l’oeil faite par un mé”dc-
ciii ficilien nommé Mafiiani. Exemple d'un fujet qui eff v e nu
au monde fans yeux Sc finis nulle apparence de cet organe.
Ufages de l’oeil Sc do fes differentes parties Sc appartenances.
388. a. Exemple de la chambre obfcure employé
pour donner une idée du méchanifme de la vifion.
L’oeil eff le fens de i’efprii Sc la langue de l’intelligence. Il reçoit
Sc réfléchit en même tems la lumière de la penfée Sc la
chaleur du feinlment. La vivacité ou la langueur des yeux
fait un des principaux caraéleres de la phyfionomic. Ibid. L.
Obfervations de M. de Buffon fur les dift'éremes couleurs
des yeux. Quels font les plus beaux yeux. La couleur dos
yeux ne varie que dans l’homme Sc le c h e v a l . 389. a.
Ri-marqiie d’Arifiote fur les yeux. Ibid. b.
OE i l , {Anal. Phyfiol. Mcdcc. Chir.) Les yeux fe trouvent
dans prefqiic tomes les claffcs d’aniinau.x. Variétés dans le
nombre d'yeux de différens ml^dcs. Suppl. IV . 106. b. Defeription
des parties extérieures qui fervent de défenfe à l'oeil. Les
fourcils. Membrane appellee calotte, lice au péricrane , qui
couvre le derrière de la tête , fe continue fur le front, Sc devient
une finiplc cellulofité vers les paupières. Mufcles occipitaux
Sc frontaux attachés à cette membrane. Ibid. 107. <j.
Mufcle corrugateur. Les paupières, Ibid. b. Forme du globe de
l’oeil. Nerfs optiques. Leur union. Ibid. 108. b. Membrane fclé-
rotiqiie. Lacornée./é/i/. 109. 4. Membrane choroïde. Ibid. b.
L'iris Sc l’ iivée. Ibid. 1 10. a. Membrane pupillaire , qui ne fe
trouve que dans le foetus. Ibid. h. Des mouvemens de la prunelle,
fa dilatation Sc fon réireclffemént. Caufe de ces mouvemens.
Corps ciliaire. Ibid. i i i . a. Anneau muqueux. La rétine.
Ibid. b. Membrane vitrée. Ibid. i i i . a. Humeur qu’elle
renferme. Le cryffallin./ii*/. i . Humeur aqueiife. Ibid. 113.
Cavité qui la renferme , appellee chambres de l’oeil. Mufclcs
qui gouvernent les yeux. Ibid. b. Des nerfs qui leur appartiennent
Ibid. 1 14. a. Dos arteres. Ibid. 113. a. Des veines Ibu{.ii6..t.
(EU. Defeription de cet organe Sc de fes parties environnantes.
VIII. 267. a , b. Raifon des plis qui environnent
l’oeil. III. 331. é. Orbite de l’oeil. XI. 376. b. Humeur aquciife
de l’oeil. I. 363. a. Canaux aqueux dans la fclérotiqiie. II.
384. il. Chambre de l’oe il, efpace compris entre le cryffallin
Sc la cornée. III. 61. b. Difficulté de connoitre la capacité
de la chambre antérieure Sc poftérieure : moyens inventés
pour cela par M. Petit. 62. a , b. Humeur cryffallinc. IV.
327. .î, b. Suppl. II. 634. a , b. Membranes on tuniques de
l'oe il, la choroïde. III. 374. a. X IV . 204, b. La conjonélive.
1 1 1 . 874. b. Suppl. II. 347. a , b. La cornée. IV . 230. a , b.
Suppl. II, 607. a , b. Lz rétine. X IV . 204. b. La fclérotique.
Zoo. a , b. Suppl. Il, 607. a. L’arachnoïde. I. 571.42, é. Mufcles
de l’oe i l, appellés droits. V . 1 15. a. Suppl. II. 742. a , b.
Obliques. XI. 307. i . Trochiéateur. X V I . 683. a. Ligamens
ciliaires. III. 4 3 1. d. Autres parties de l’oeil appellees ciliaires.
Ibid. Couronne nniqiicufc. Suppl. III. 974. a , b. Nerfs oph-
thalmiques. XI. 304. b. Sc optiques. 317. d , b. Parties de l’oeil
appellees l’iris. V llI . 903. <2. La prunelle. XIII. 328. b. Sc
I’livcc. X VII . 371. h. L ’oeil eff de tous nos organes celui
ma a le fentiment le plus v i f Sc le plus délicat. X V . 29. b.
Trait de fageffe admirable dans la ffrufture de cct organe.
Suppl. I. 146. Variation dans la conformation de l’oeil felon
la diftance de l’objet qu’on obferve. IV. 1031. a. Ouvrage
d Hüviiis lur l’oeil. VIII. 320. a. Celui do M. Petit. Suppl, l.
403. d. Ceux de Godefroi Zin d’Anfpadi. 412. b. Autres ouvrages
indiqués à l’arricle O ph th a lm oGRAPHie. Sur l’oeil,
cüuiultez les articles V is ib le , V is io n , V u e , Y e u x , O ph-
THALMIQUE.
OEil , humeurs de l’, {Phyfiolog.) Réponfe à la qiieftion fi
ces luimcursie regencrent. XI. a8o. A Tome II. ^ ^ '
, 8 ^ 1 ’ »queuxclans la (-dérotique. II.
uni® ux*( '> d“ ’ le» yeux 8c, iinimaux a l egard de leur couvmurc. Le mouvement de,
t e v ra x a e s y e iix ddaanis s l'eî rc'a"m' éléon. La figure du cryffallMine uefvf emdifetn'ét-
toiijoins paicille aux animaux , chacun de leur efnece^ Excenpicres
eff tantôt pins , tantôt moins ronde dans les efncces
I mm"“ ’ ' “ l'eell f»« v e’ , 'm é.
clummuc „ernculmre v, ...i. ^ rendre fes mouvemens
i’oeil des oifeaux en particuf
e ™ & 1“ " " ^ ’ ' v r e ' <'e'"etique de rcell de, cloue
y ’ • S“ “ - Obferla.ion, fur l'oeil de
qudjues O ifeaux,XVII. 34;. 4. fur celui du hibou. VIII. aoo. 4 .
OEil p o s t ich e , ( Ou, ) üliréreme, obferva.iou, fur ce fii-
je t .X l 390 4 . Lejrîc.-dcirous OEil A r t if ic ie l .
n n h d ié .'" l" " 1“ ’ organe. Lmunération des différentes
le. f a S rW P "™ ,<1-= l’oeil-Elles font trai.ées dan,
leurs articles particuliers. XI. 391. a.
I l“» " ' ’ “ lu»'IMgnées par les noms fui.ans: oegilops;
r u V ' " " ’ l’ylup»- 440. b. Ulccre du globe de l'oeil. 637.
m Chaffie. m . 130 4 . Tubercule dans l'angle interne de l'oeil.
V 605. 4 . Sortie de 1 m l hors de fon orbite. VI. jyo. a . 4 .
Uleere appelle foirette. VII. ao ,. 4 . Glaucome. 704.4. Gmitu
T f ' l v “ ' ^ 7 ' M T “ l>'» fur la cornée.
IV. 230.4. Mydriafe. X. 9.2 . Maladies des paupières
qm peuvent mterelfer l'oeil. X II. 206.4 . HydropInhalmie. V I ll.
3S2. 4 . Hypopion. 41 1.4. Excroiffance inembraneufe formée
lur la comonflive. XIII. 546. 4 . OEil crevé ou rompu. X IV.
231 U. Staphylome. X V . 493. a. Synchlfe. 746. 4. Maladies
de loeiltiu . nu.fent a 1 exercice de la vue. XVII . 370. a , 4 .
biirle s maladies de cct o rgane, voysr O ph th a l .mie L’application
des remedes aqueux fur l’oeil imaginée par Fabrice
d Aqnapendeme ; efpece de baffin d’ufiigepour laver les yeux.
11. 124. b. Collyres pour les maladies des yeux. III. 642. b.
Inffrument deffiné à tenir l’oei! ouvert. X V . 449.47. Moven de
tirer les corps etrangers nichés entre la membrane interne des
paupières & le globe de l’oeil. Ibid. b. Voyc^ Y eux
OEil ( Pharm. ) Recettes pour éclaircir Sc fortifier la vue.' Suppl. IV . I16. 4 2 ,
OE il cxiirpa,io„ d, I V ,l, ( Chir. ) On ne doit pas la ten-
ter dans 1 exoplithalmic qm vient de caufe interne, ni même
dans ce qiion appelle l’oeil iiors de la tète , à l’occafion de
coups reçus fur l’orbite, à moins que la néceffité de l’extirpation
ne foit expreffémenr marquée. Différentes obferv.aiions
lur ce fujet. XI. 391. b. De la cure du cancer de l'oeil. Hif-
toire Sc defeription des divers moyens mis en ufiigc en dif-
ferens cas pour l’extirpation de l’oeil. Auteurs qui ont traité de
cette operation. Ibid. 392. a , b.
(E\h {P/itlofoph. occuli.) Fafeinations caufées par les émanations
de loeil. IX, 944, a , b, Scc.
(Eli artificiel. Différentes nianiere.s dont les yeux artificiels
peuvent etre faits. Ils doivent être différemment configurés ,
luivant les cas ou leur application eff néceffairc. De l’u/aee de
ces chofes-là. XI. 393. é. Diverfités dans leur conftruélion Dos
moyens de les attacher dans la place qui leur convient. Ibid
394. 42.
OEil artificiel, {A niiq.) Ouvriers qui faifoient des yeux
artificiels pour les ffaïues des dieux. IX, 743. a.
OE il Jîmplc, {Chir.) Bandage. XL 394. a. Voyer Mono-
OEil double, ( Chir.) Bandage contentifpour les deux yeux '
Delcription de ce bandage. Maniéré de l’appliquer. XL 204. a.
OEil des mfcHes, ( Z/t/ù «.2f.) Diverfité dans la couleur des
yeux des infeffes. La plupart perdent peu-à-peu après la mort
le brillant de leurs couleurs. X I. 394. ,7. Différentes maniérés
dont les yeux des mfeéles font placés. Le nombre des yeux
n eff pas égal chez tous. Dureté de la cornée. Découvertes
microfcopiques fur les yeux de plufieurs iiifcffes, & fur leur
nombre prodigieux. Ibid. b. Moyen dont s’eff fervi M. Leii-
wenhoeck pour voir quelques objets an travers des yeux d’une
mouche-dragon. Les yeux des infeéces doivent groffir confi-
clérablement les objets. Traité italien fur cette partie deriiif-
toire naturelle. Autre ouvrage à confulter. Ibid. 393, a.
(EU des infeUes. VIII, 781. b. Des papillons. XL 873, a. Les
yeux des infeéles n’ont point de cryffallin. Suppl. IL 634. a.
OEil , ( C'itiq facr. ) Differentes acceptions de ce mot dans
l’écriture.XL 393. a.
OE il artificiel, {Opiiq.) Defeription & ufage de cette machine
d’optique. Xf. 393. b.
OE il , ( Botiin. & Jardin. ) Différence entre ail Sc bounTeon'
OE'I rond. OEil plîir. XL 393. é. °
OEiLde baufi,{Bor.) Caraélercs de ce genre de plante. X I.
) ÿ b .
OE il , {Conchyl.) XL 393. b.
OEiL de bouc, {Conchyl.) Nom donne à une efpece de pa-
MiMmm
3 9 5
l-\