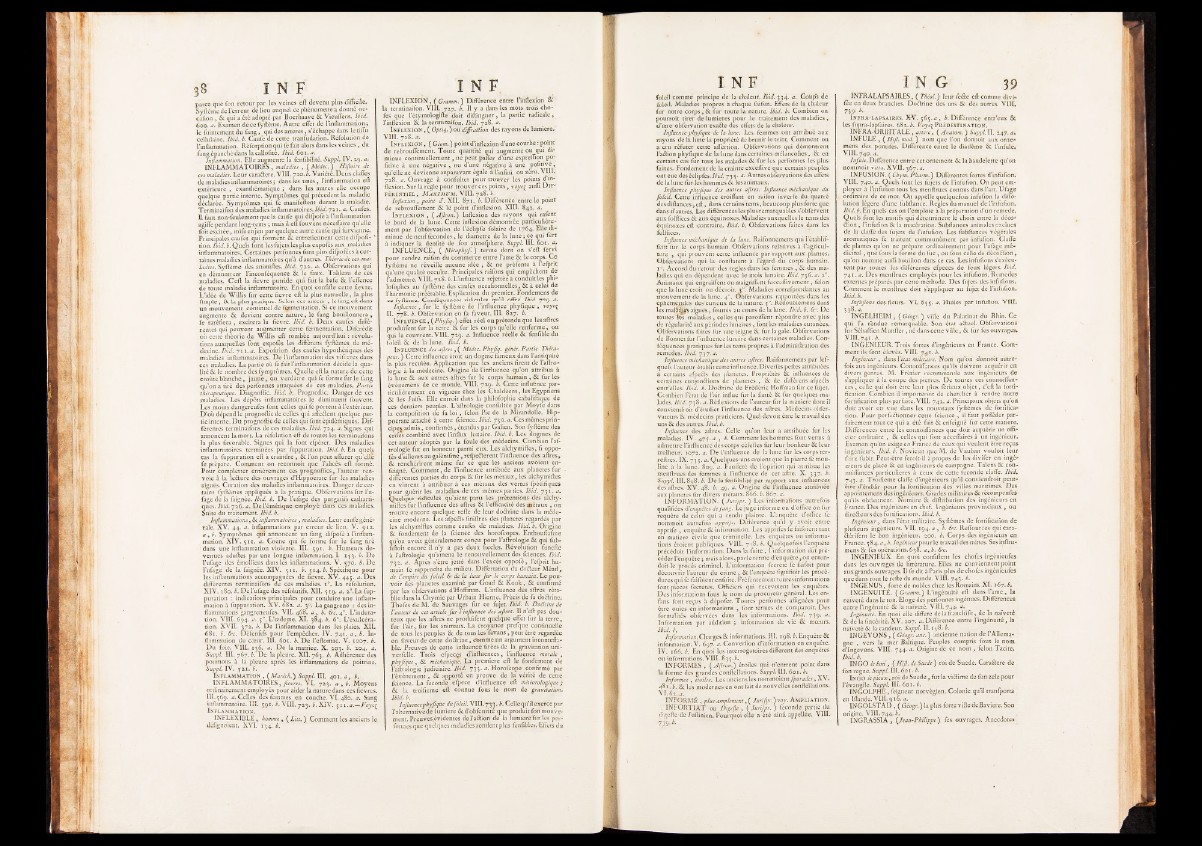
38 I N F parce que fou retour par les veines eft devenu plus difficile.
Syftêmc de l'erreur de lieu auquel ce phénomène a donné oc-
calîon , & qui a été adopté par Boerlvaave & VieufTens. IbiJ.
<Soo. Examen de ce fyftéme. Antre cftet de rinflamination;
le fuintement du fang, qui des arteres, s échappe dans le tilTu
cellulaire. Ibid. b. Caufe de cette tranfndation. Réiolntion de
rinflamiuation. Réforption c[ui fe fait alors dans les veines , du
faiig épanché dans la callofité. Ibid. 6 o i. rf.
InfhmmMion. Elle augmente la fenfibilité. Suppl. IV . 19. a.
IN FL AM M ATO IR E S , maLdus , (Médcc.) Hijl^ire de
CCS maladies. Leur caraélere. V III. 720. L Variété. Deux clailes
de maladies inflammatoires; dans les unes, rintlaminaùon eft
extérieure , exanthématique ; dans les autres elle occupe
quelque partie interne. Symptômes qui precedent la maladie
déclarée. Symptômes qui fe manifeftent durant la maladie.
Terminaifon des maladies inflammatoires. Ibid. 7 2 1. a. Cauies.
Il faut non-feulemcnt que la caufe qui difpofe à l’inflammation
agiffe pendant long-iems ; mais il eft fouvent néceffaire qu’elle
foit excitée, mile enjeu par quelque autre caufe qui furvienne.
Principales caufes qui forment & entretiennent cette difpofi- '
lion. Ibid. b. Q uels font les fujets les plus expolés aux jnaladies
inflammatoires. Certaines perfonnes font pins difpofées à certaines
maladies inflammatoires qu’à d’autres. Théorie de ces ma~
ladies. Syftcme des animiftes. Ibid. 722. a. Obfervations qui
en démontrenf l’inconféquence & le faux. Tableau de ces
maladies. C ’eft la fievre putride qui fait la bafe & l'clTence
de toute maladie inflammatoire. En quoi confifte cette flevre.
L ’idée de Willis fur cette fievre eft la plus natuiellc, la plus
fimple , & la plus pratique. Selon cet auteur , le fang eft dans
un mouvement continuel de fermentation. Si ce mouvement
augmente & devient contre nature, le fang bouillonnera,
fe raréfiera , excitera la fievre. Ibid. b. Deux caufes différentes
qui peuvent augmenter cette fermentation. Difcrédit
où cette théorie de Willis eft tombée aujourd'hui : révolutions
auxquelles font expofès les difterens fyftèmes de médecine.
Ibid. 7 1 1. a. Expofition des caufes hypothétiques des
maladies inflammatoires. Do l’inflammation des vifeercs dans
ces maladies. La partie où lé fait rinflammation décide la qualité
Sc le nombre des fymptomes. Quelle eft la nature de cette
croûte blanche, jaune, ou verdâtre qui fe forme fur le fang
qu’on a tiré des perfonnes atracpiées de ces maladies. P.irtie
thérapeutique. Diagnoftic. Ibid. b. Prognoftic. D.inger de ces
maladies. Les dépôts inflammatoires le climiniient fouvent.
Los moins dangereufes font celles qui fe portent à l’extérieur.
D ’où dépend le prognoftic de celles qui aflcélent quelque partie
interne. Du prognoftic de celles qui font épidémiques. D ifférentes
torminaifons de ces maladies. Ibid. 724. n. Signes qui
annoncent la mort. La rcfolution eft de toutes les terminaifons
la plus favorable. Signes qui la font efpérer. Des maladies
inflammatoires terminées par fuppuration. Ibid. b. En quels
cas la fuppuration eft à craindre , & l'on peut afîurer qu'cllè
fe prépare. Conunent on reconnoit que l’abcès eft formé.
Pour complcttcr entièrement ces prognoftics, rauteur renvoie
à la leéfurc des ouvrages d’Hippocrate fur les maladies
aiguës. Curation des maladies inflammatoires. Danger de certains
fyftèmes appliqués à la pratique. Obfervations fur l’u-
fage de la faignée. Ibid. b. De l’ufage des purgatifs cathartiques,
fiiiû. 726. .i. D e l’émétique employé dans ces maladies.
Suite du traitement. Ibid. b.
Inflammations.fèc inflammatoires, maladies. Leur caufe géné-
talc. X V . 44. a. inflammations par erreur de lien. V . 912,
a , b. Symptômes qui annoncent un fang difpofé à l’inflammation.
XIV. 511. a. Coéne qui fe forme fur le fang tiré
dans une inflaniniation violente. III. 591. b. Humeurs devenues
aduftes par une longue Inflammation. I. 153. b. De
l'ufage des émoiliens dans les inflammations. V . 570. b. D e
l ’nfage de la faignée. X IV. 311. b. 314. Spécifique pour
les inflammations accompagnées de fievre. X V . 443. Des
diftérentes terminaifons de ces maladies. 1“. La réfohuion.
X IV . iSo. ^ .D e l’iifage des réfolutifs. XII. 519. a. 2°.La fup-
piiration : indications principales pour conduire une inflammation
à fuppuration. X V, 682. a. 3°. La gangrene : des inflammations
gangreneiifcs. VII. 468. a , b. &c. 4". L’induration.
VIII. 694. a. 3". L’ccdeine. XI. 384. b. 6“. L’cxulcéra-
tion. XVII . 372. b. De l’inflammation dans les plaies. XII.
681. b. &c. Défenfifs pour l’empècher. IV . 741. a , b. Inflammation
du coeur. III. 601. b. D e l’eftomac. V . 1007. b.
D u foie. VIII. 136. a. D e la matrice. X. 203. b. 204. a.
Suppl. III. 767. b. D e la pleure. XII. 763. b. Adhérence des
poumons à la pleure après les inflammations de poitrine.
Suppl. IV. 321. b.
Infl.ammation , (Af<ircr/i.) Suppl. III. 401. a , h,
IN FL AM M ATO IR E S , jîcvr«. V I . 723. a , b. Moyens
ordinairement employés pour aider la nature dans ces fièvres.
111.369. <i. Celles des femmes en couche. VI, 480. a. Sang
inflammatoire. I lî . 591. VIII. 723. i .X IV . ^ ïi.a .— Foyei
Inflammation.
INFLEXIBLE, homme, {Liit.') Comm ent les anciens le
défignoient. W \ . 134. b.
I N F IN FLEX IO N, (Gramm.) Différence entre rinflexion &
la terminaifon. VIII. 727. Il y a dans les mots trois cho-
fes que l’étymologifte doit diftingiier, la partie radicale,
l’inflexion Sc la terminaifon. Ibid. 728.
Inflexion , ( Opiiq. ) ou diffrafUon des rayons de lumière.
VIII. 728.
Inflexion , ( Gécm. ) point d’inflexion d’une courbe : point
de rebrouflément. Toute quantité qui augmente ou qui diminue
continuellement, ne peut paifer d’une expreflîon po-
fiiive à une négative , ou d’une négative à une pofuive,
qu’elle ne devienne auparavant égale à l’infini ou zéro. V I ll.
728. a. Ouvrage à confultcr pour trouver les points d’inflexion.
Sur la règle pour trouver ces points, voyc^ auflÛ D if*
FÉRENTIEL, MAXIMUM. VIII. 728. b.
Inflexion, point tf. XII. 871. b. Dift'èrence entre le point
de rebronflement Si le point d’inflexion. XIII. 842. a.
Inflexion, {Aflron.) Inflexion des rayons qui rafent
ie bord de la lune. Cette inflexion démontrée particuliérement
par l’obfervation de l'éclipfe folairc de 1764. Elle d iminue
de n euf fécondés, le diametre de la lune ; ce qui fert
à indiquer la denfité de fon atmofphere. Suppl. IIL 601. u.
INFLUENCE, ( Métaphyf. ) terme dont on s’eft fervi
pour rendre raifon du commerce entre l’amc & le corps. C e
fyfléme ne réveille aucune idée , & ne préfente à l’efprit
qu’une qualité occulte. Principales raifons qui empêchent de
l’admettre. VIII. 728. é. L'influence rejettéea conduit les phi-
lofophes au fyftéme des caufes occafionnclles, 8c à celui de
l’harmonie préétablie. Explication du premier. Fondemens de
ce fyftéme. Conféquences ridicules qu'il offre. Ibid. 729. a.
Influence , fur le fyftéme de l'influence phyfique , voye^
II. 778. b. Obfcrvntion en fa faveur. III. 827. b.
Influence, (P/jy/ây.) effet réel ou prétendu que lesaftres
produifeiK fur la terre Sc fur les corps qu’elle renferme, ou
qui la couvrent. VIII. 729. a. Influence réelle 8c fenfibledii
foleil Sc de la lune. Ibid, b.
Influence des aflrcs , ( Médec. Phyjîq. gêner. Partie Théra-
peiit. ) Cette influence étoit un dogme fameux dans l’antiquité
la plus reculée. Application que les anciens firent de l’aftro-
logie à la médecine. Origine de l’influence qu’on attribua à
la lune 8c aux autres affres fur le corps humain , Sc fur les
cvéïiemens de ce monde. VIII. 719. b. Cette influence particuliérement
en vigueur chez les Chaldécns, les Egyptiens
6c les Juifs. Elle entroit dans la philofopfîie cabaliftique de
ces derniers peuples. L'aftrologie confultce par Moylc dans
la compofitlon de fa l o i , felon Pic de 1r Mirandolle. Hippocrate
attaché à cette fcicncc. Ibid. 730. a. Ces mêmes principes
admis, confirmés, étendus par Galien. Son fyftéme des
crife's combiné avec l’inflnx lunaire. Ibid. b. Les dogmes de
I cet auteur adoptés par la foule des médecins. Combien l’afi
trologie fut en honneur parmi eux. Les alchymiftes, fi oppo-
fés d’ailleurs au galénifme , refpefterent l’influence des affres,
8c renchérirent même fur ce que les anciens avoient en-
feigné. Comment, de l’influence attribuée aux planètes fur
différentes parties du corps 8c fur les métaux, les alchymiftes
en vinrent à attribuer à ces métaux des vertus fpécifiques
pour guérir les maladies de ces mêmes parties. Ibid. 731. a.
Quelque ridicules qu’aient paru les prétentions des alchy*
niiftcs fur l’influence des affres Sc l’efficacité des métaux , on
trouve encore quelque refte de leur doéfriiie dans la médecine
moderne. Les afpeéfs finiftres des planètes regardés par
les alchymiftes comme caufes de maladies. Ibid. b. Origine
6c fondement de la fcience des horofeopes. Entboufiafme
qu’on avoir généralement conçu pour l ’aftrologie 8c qui ful>-
fiftolt encore il n’y a pas deux fiecles. Révolution funefte
à l’aftrologie qu’amena le renouvellement des fciences. Ibid.
732. a. Après s’étre jette dans l’e-xcès oppofé, l’efprit humain
fe rapprocha du milieu. Differtatiou du doéfeur Méad,
de L’empire du foleil & de la lune fur le corps humain. Le pouvoir
des planctes examiné par Goad 8c K o o k , 8c confirmé
par les obfervations d’Hoffman. L’influence des affres rétablie
dans ta Chyinie par Urbain Hierne. Précis de fa doéfriue.
Thefes de M. de Sauvages fur ce fiijet. Ibid. b. Doürine de
l'auteur de cet article fur l ’influence des aflrcs. Il n’elf pas douteux
que les affres ne produifciit quelque effet fur la terre,
fur l’air, fur les animaux. La croyance prcfque continuelle
de tous les peuples 8c de tous les favans , peut être regardée
en faveur de cette doétrine, comme un argument incontefta-
blc. Preuves de cette influence tirées de la gravitation uni-
verfelle. Trois cfpeces d’influences, rinfluence morale,
phyfique, Sc méchaniqtic. La premiere eft le fondement de
l’aftrologie judiciaire. Ibid. 733. a. Horofeope confirmé par
l’événement, 6c apporté en preuve de la vérité de cette
fcience. La fécondé efpcce d’influence eft météorologique ;
Sc la troifieme eft connue fous le nom de gravitation.
Ibid. b.
Infiucncephyfique dufiolcil. V III. 733. b. Celle qu’il exerce par
rakernativede lumière 8cd’obfciirité que produit fon mouvement.
Preuvesjévidcntcs clel'aiftion de la lumière fur les p-er-
fonnes que quelques maladies rendent plus fcnfiblcs. Efiecs d-j
I N F I N G 3 9
I I
folci! comme principe de la chaleur. Ib'td. 334. a. Coups de
fülcil. Maladies propres à chaque faifon. Eflets de la chaleur
fur notre corps, 8c fur toute la nature. Ibid. b. Combien on
poiirroit tirer de lumières pour le traitement des maladies,
d’une obfervatlon exaéfc des effets de la chaleur.
Influence phyfique de la lune. Les femmes ont attribué aux
rayons de la lune la propriété de brunir le teint. Comment on
a cru réfuter cette afferiion. Obfervations qui démontrent
l’aélion pliyfique de la lune dans certaines mélancolies, 8c en
certains cas fur tous les malades 8c fur les perfonnes les plus
faines. Fondement de la crainte cxcelfwe que certains peuples
ont eue deséciipfes, Ibid. 735. u. Amresobfervations des eft'ers
de la lune fur les hommes 8c les animaux.
Infiuence phyfique des aunes afires. Infiitence méchanique du
folciL Cette influence croiffant en raifon inverie du quarré
dcsdiftanccs, e ft , dans certains tems, beaucoup plus forte que
dans d’autres. Les différencesIcsplusremarquabless’obfervent
aux folftices Sc aux équinoxes. Maladies auxquelles le tems des
équinoxes eft contraire. Ibid. b. Obfervations faites dans les
folftices.
Influence méchanique de la lune. Raifonnemens qui l’ctablif-
fent l'ur le corps humain. Obfervations relatives à l’agriculture
, qui prouvent cette influence par rapport aux plantes.
Obfervations qui la conftatent à l’égard du corps humain.
I'’ . Accord du retour des regies dans les femmes , 6c des maladies
qui eu dépendent avec le mois lunaire. Ibid. 736. a. 2” .
Aniinatix qui engraiffeni ou uiaigrilfcnt fuccclTivcmcnt, fclou
que la lune croit ou décioit. 3’’. Maladies correfpondanres au
nioiivcnicnt do la lune. 4". Obfervations rapportées dans les
ephémérides des curieux de la nature. 5“. Redoublcmcns dans
les malSilifï a iguës, fournis au cours de la lune. Ibid, b. 6". De
toutes les maladies, celles qui paroiffent répondre avec plus
de régularité aux périodes lunaires, font les maladies cutanées.
Obfervations faites fur tine teigne 6c fur la gale. Obfervations
de Bonnet fur rinfluence lunaire dans certaines maladies. Con-
léqttences pratiques fur les tems propres à l’adminiftration des
reincdes, 737.-7.
Influence méchanique des autres afires. Raifonnemens par lef-
quels l’auteur établit cctce influence. Diverfes pelles attribuées
à certains afpeéls des planctes. l•’l•opriéIés 8c influences de
fCftaines conjenélions de planete.s , Sc de diffévens afpeéls
ciur’clles. Ibid. b. Doélrinc de Frédéric Hoffman fur ce fiijet.
Combien l’état de l’air influe ftir la fanté 8c fur quehiues malades.
Ibid. 738. a. Réflexions de rauteur fur la manière dont il
couviendroit d’étudier l’influence des aftrcs. Médecins obfcr-
vatcurs 8c médecins praticiens. Quel d evoit être le travail des
uns 8c dos autres. Ibid. b.
Influence des affres. Celte qu’on leur a attribuée fur les
maladies. IV. 473. *2 , é. Comment les hommes font venus à
admettre l’influence des corps célefles fur leur bonheur Sc leur
malheur. 1072. a. De t’influence de la lune fur les corps ter-
rellrcs. IX. 733. a. Quelques-uns croient que la pierre fc mouline
à la lune. 809- a. laullétc de l’opinion qui attribue les
menfti ues des femmes à l’influence de cet aftre. X. 337. b.
Suppl. 111, 898. b. De la fenlibilitc par rapport aux influences
des affres. X V . 48. b. 49. a. Origine de l’influence attribuée
aux planètes fur divers métaux. 866. b. 867. a.
IN FO RMATION . ( Jurijpr. ) Les informations autrefois
qualifiées d’enquéres deJang. Le juge informe ou d’office ou f'iir
requête de celui qui a rendu plainte. L’^nqtiète d oflice le
nommoit autrefois apprije. Différence qu’il y r.s'oir entre
apprife , enquête 8c information. Les apprifes fe faifoient tant
en maticre civile que criminelle. Les enquêtes ou informations
étoient publiques. VIII. 7 :8 . b. Quelquefois 1 enquête
précédoit l’information. Dans la fuite , 1 information dut précéder
l’enquête ; mais alors, par le terme d’enquête, on enten-
doit le procès criminel. L’information fecrcte fc taifoit pour
découvrir raïucuv du crime , 8c I’c-nquetc fignifioir les procédures
qui fe faifoient cnftiitc. Préfciuemetu toutes informations
font pieces fecretes. Officiers qui recevaient les enquêtes.
Des informations fous le nom du procureur général. Les en-
fans font reçus à dépofer. Toutes perfonnes affignées pour
être ouïes en informations , font tenues de comparoir. Des
formalités obfervées dans les informations. Ibid. 739. a.
Information par addition ; information de vie 8c mcctits.
Ibid, h
Informaiion.Our^Ci8c informations. III. 198. b. Enquête 8c
information. V. 697. a. Converfion d'information en enquête.
IV . 166./’. En quoi les interrogatoires different des enquêtes
ou informations.Vlll, 833.é.
IN FO RM E S, {Aflron.) étoiles qui n’entrent point dans
la forme des grandes conftcllations. Suppl. 111. 601. b.
Informes , étoiles. Les anciens les nommoient/po'vju’e i , X V.
4^ 1. é. 8c les modernes en ont fait de nouvelles conftellations.
VI. 62..;.
in f o r m é , plus amplement,{ Jurifpr.)voy. AMPLIATION.
, IN FOJITIAT ou Digefte , ( Jurijpr. ) féconde partie du
digefte de Juflinicn. Pourquoi elle a été alnfi appellee. V lll.
IN FR ALAP SAIRES, ( Théol. ) leur fede eft comme divi-'
foc en deux branches. Doélrine des uns & des autres. VIII,
739. b.
Infra-lapsaires. X V . 363.«, i. Différence entr’eux 8c
les fiipra-lapfuires. 682. é. Prédestination.
IN FR A-O R B IT A LE , ancre, {Anatom.) Suppl.W. n p j.a ,
INFULE , {Mifi. mod. ) nom que l’on donnoit aux orne-
mens des pontifes. Différence entre le diadème Sc l’infule.
V l l l . 740. a.
Injiile. Différence entre cet ornement 8c la bandelette qu'on
nommoit vin.i. X V II . 367. a.
INFUSION. ( Chyrn. Pharm.) Différentes fortes d’infufion.
VIII. 740. a. Quels font les ftijets de l’infufion. On peut employer
à l’infiilion tous les menftrues connus dans l’art. Ufage
ordinaire de ce mot. On appelle quelquefois inftifion la ilifl'o-
Itition légère d’une ftibftance. Regies du manuel de i’infufion.
Ibid. b. En quels cas on l’enijjloie à la préparation d’un rcinede.
Quels font les motifs qui déterminent le choix entre la déco-
élion , rinfufion 8c la macération. Subftances animales excltics
de la clalTe des fujets de l’infufion. Les fubftanccs végét.iles
aromatiques fe traitent communément par iiifufion. Claffe
do plantes qu’on ne prépare ordinairement pour l’ufage médicinal
, que fous la forme du f'iic , ou fous celle de décoélion ,
qu’on nomme aufl'i bouillon dans ce cas. Les inf'ufums s’exécutent
par toutes les dilferentes efpeces de feux légers./é/t/.
741. a. Des menfti ues employés pour les infufions. Runedes
externes préparés par cette méthode. Des fujets des infufions.
Comment le menftrue doit s’appliquer au fujet de I’infufion.
Ibid. b.
Infufions des fleurs. V I. 853. a. Huiles par infufion. VIII,
’ ^INGELHEIM, (G io g ..) ville du Pelatin.it du Rhin. Ce
qui l’a rendue remarquable. Son éiat aéluel. Obfervations
fur Sébaftien M iinfter, né dans cette v ille , 8c fur fes ouvrages,
y i l l . 741. b.
INGÉNIEUR. Trois fortes d’ingénieurs en France. Comment
ii.s font élevés. VIII. 741. b.
Ingénieur , clans l’ér.it militaire. Nom qu’on donnoit autrefois
aux ingénieurs. Comtoiff.-.nces qu’ils doivent acquérir en
divers genres. M. Frézier recommande aux ingénieurs de
s’appliquer à la coupe des pierres. D e tomes ces connoilTan-
c e s , celle qui doit être leur plus férieux ob jet, c’eft la fortification.
Combien il importeroit de chertlier à rendre notre
fortification pins parfaire. VIII. 742. a. Principaux objets qu’on
doit avoir en vue dans les noiiveaiix fyftèmes de fonitica-
lioti. Pour perfeélionner cette fcience , il faut polféder parfaitement
tout ce qui a été fait Si. enfeigné fur cette matière.
Différences entre les connoiffances que doit acquérir un officier
ordinaire , 8c celles qui font ncceffaires à un ingénieur.
Examen qu'on exige en France de ceux qui veulent être reçus
ingénieurs. Ibid. b. Noviciat que M. de Vaiibaii vouloir leur
fini e fubir. Peut-être feroit-il à propos de les clivifer en ingénieurs
de place 8i en iiigcnicurs de campagne. Talens & con-
noifl'ances particulières à ceux de cette leconde claffe. Ibid.
743. J. Troifieme clafl'e cringénieurs qu’il conviendroit peut-
être d'établir pour la foriificaiion des villes maritimes. Des
appointemens des ingénieurs. Grades militaires Si récompenfes
qu’ils obtiennent. Nombre & diftribution des ingénieurs en
France. Des ingénieurs en chef. Ingénieurs provinciaux , ou
dii eéleiirs des fortification«;. Ibid. b.
Ingénieur , dans l’état militaire. Syftcmes de fortification de
pliifieurs ingénieurs. VII. 194. a , b. &c. RelTources qui cara-
iftérlfent le bon ingénieur. 200. b. Corps des ingénieurs en
France. 384. u , é, Ingénieur^omJe travail des mines. Ses inftru-
mens Sc fesupérations.638. a, b. &c.
INGENIEUX. En quoi confiftent les chofes ingénieufes
dans les ouvrages de littérature. Elles ne conviennent point
aiixgrands ouvrages. Il fe dit h Paris phis de chofes ingénieufes
que dans tout le refte dti monde. VIII. 743. é.
IN GENU S, forte de nobles chez IcsRomains. XI. 167. A
INGÉNUITÉ. {Gramm.) L’ingénuité eft dans l’ame, la
naïveté dans le ton. Eloge des perfonnes ingénues. Différences
entre l’ingcnuité 8c la naïveté. VIII. 7.^4. a.
Ingénuité. En quoi elle diffère de la franchife, do la naïveté
Si de la fincérité. XV, 207. a. Différence entre l’ingénuité, la
naïveté 8c la candeur. Suppl. II. i<.>8. h.
IN GEVONS , ( Géogr. anc. ) ancienne nation de l’Allemagne
, vers la mer Baltique. Peuples compris fous le nom
d’ingevons. VIII. 744. a. Origine de ce nom , felon Tacite.
Ibid. b.
INGO le bon , {H i fl. de Suede ) roi de Siiede. Cara^ere de
fon rogne. Suppl. III. 6oi. b.
In GO le pieux, vo'i de S tiede, fut la viéUme de fon zcle pour
l'évangile. lII. 601. é.
IN G OLPH E, feigneur norvégien. Colonie qu’il tranfporta
en Iflandc. VIII. 916. a.
IN G O L ST AD , ( Grog/-. ) la plus forte v ille de Bavière. Son
origine. V IÎ l. 744. b.
INGRASSIA , {Jean-Philippe) fes ouvrages. Anecdotes