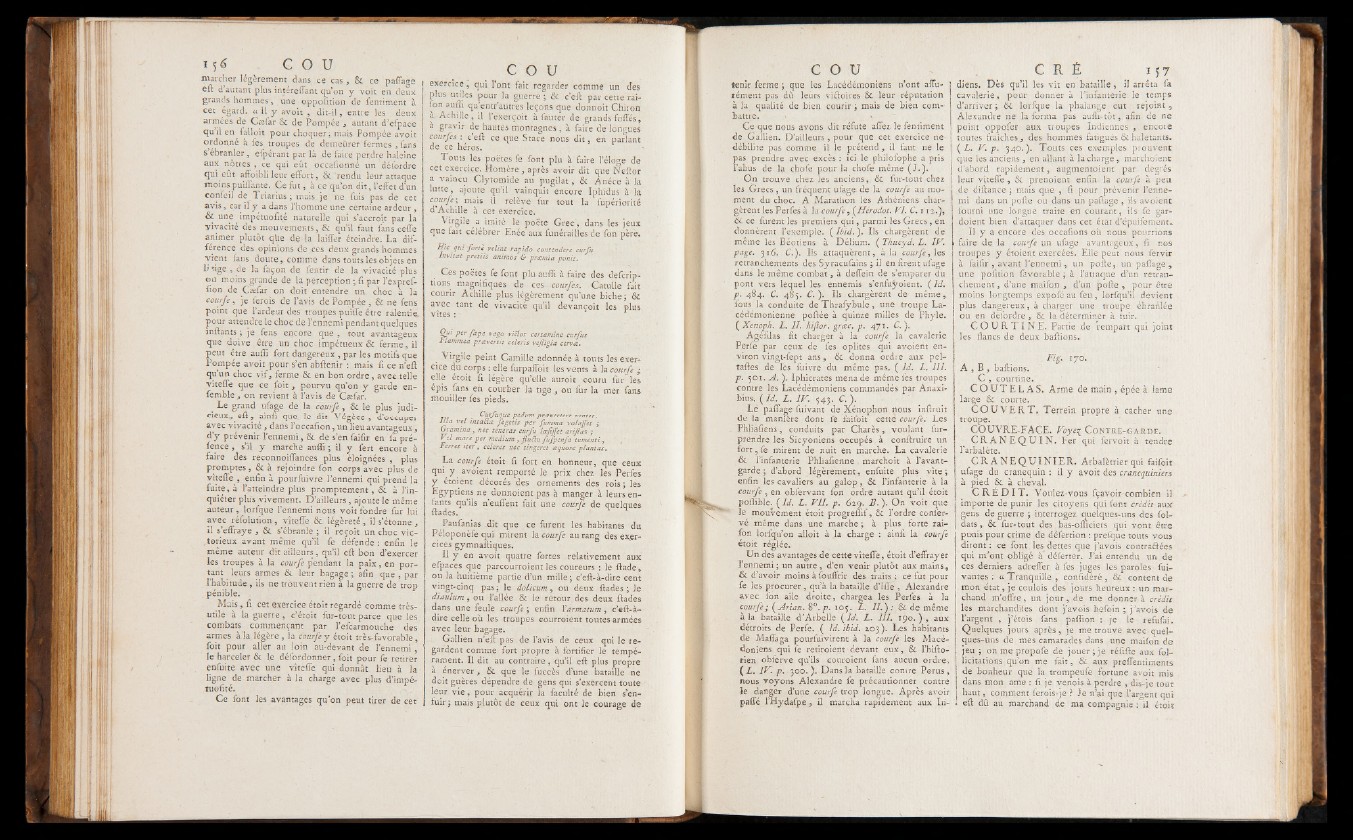
marcher légèrement dans ce cas * & ce pafiagè j
eft d autant plus intéreffant qu’on y voit en. deux |
grands hommes, une oppolition de fentiment à j
cet égard. « 11 y avoit , dit-il, entre les deux
armees de Cæfar & de Pompée , autant d’efpace
quil en falloit pour choquer; mais Pompée avoit •
ordonné à fes troupes de demeurer fermes , fans
s’ébranler, efpérant par là de faire perdre haleine
aux nôtres , ce qui eût occafionné un détordre
qui eût affoiblileur effort, & rendu leur atftaque
moins puiffante. Ce fu t, à ce qu’on dit, l’effet d’un
confeil de Triarius; mais, je , ne fuis pas de cet
a v is , car il y a dans l’homme une certaine ardeur ,
& une impétuofite naturelle qui s’accroît par là
yivacité des mouvements, & qu’il faut fans ceffe
animer plutôt que de là 1 ailler éteindre. La différence
des opinions de ces deux grands hommes
vient fans doute, comme dans toutsles objets en
li tige , de la façon de fentir de la vivacité plus
ou moins grande de la perception ; fi par l’expref-
fxorn de Cæfar on doit entendre un choc à la
courje, je ferois de l’avis de Pompée, & ne fens
point que l’ardeur des troupes puilTe être ralentie,
pour attendre le choc de l’ennemi pendant quelques
ïnftants ; je fens encore que , tout avantageux
que doive être un choc impétueux & ferme, il
peut être auffi fort dangereux , par les motifs que
Pompée avoit pour s’eri abftenir : mais fi ce n’efl
qu un choc v if, ferme & en bon ordre, avec.telle
vîteffe que ce foit , pourvu qu’on y garde en-
femble , on revient à l’avis de Cæfar.
Le grand ufage de la courfe, & le plus judicieux,,
e ft, ainfi que. le dit Végèce , d’occuper
avec vivacité , dans l’occafion, un lieu avantageux,
d’y prévenir l’ennemi, &. de s’en faifir en fa pré-
fence , s’il y marche auffi ; il y fert encore à
faire des reconnoiffances plus éloignées , plus
promptes, & à rejoindre fon corps avec plus de
vîteffe , enfin à pourfuivre l ’ennemi qui prend la
fuite, à l’atteindre plus promptement, & à l’inquiéter
plus vivement. D ’ailleurs, ajoute le même
auteur, lorfque l’ennemi nous voit fondre fur lui
avec réfolution, vîteffe & légèreté , il s’étonne ,
il s’effraye , & s’ébranle ; il reçoit un choc victorieux
avant même qu’il fe défende: enfin le
même auteur dit ailleurs, qu’il eft bon d’exercer
les troupes à la courfe p’endant la paix, en portant
leurs armes & leur bagage ; afin que , par
1 habitude , ils ne trouvent rien à la guerre de trop
, pénible.
Mais, fi cet exercice étoit regardé comme très-
utilé à la guerre, c’étoit fur-tout parce que les.
combats commençant par Tefcarmouche des
armes à la légère , la courfe y étoit très-favorable,
foit pour aller au loin au-devant de l’ennemi,
le harceler & l.e défordonner , foit pour fe retirer
enfuite avec une vîteffe qui donnât lieu à la
ligne de marcher à la charge avec plus d’impé-
tuofité.
Ce font les avantages qu’on peut tirer de cet
exercice, qui l’ont fait regarder comme un des
plus utiles pour la guerre ; & c’eft par cette rai-
fon auffi qu’entriautres leçons que donnoit Chiron
a Achille , il l’éxerçoit à fauter de grands foffés,
a gravir de hautes montagnes , à faire de longues
cour fes \ c’eft ce que Stace nous d it, eh parlant
de ce héros.
Touts les poètes fe font plu à faire l’éloge de
cet exercice. Homère, après avoir dit que Neftor
a vaincu Clytomide au pugilat, & Anéce à la
lutte, ajoute qu’il vainquit encore Iphidus à la
courfe ; mais il relève fur tout la fupériorité
d’Achille à cet exercice.
Virgile a imité le poète Grec, dans les jeux
que fait celebrer Enée aux funérailles de fon père.
Hic qui forte velint rapido contendere curfu
Invitât pretiïs an un os & prctmia ponit.
Ces poètes fe font plu auffi à faire des defcrip*
tions magnifiques de ces courfes. Catulle fait
courir Achille plus légèrement qu’une biche ; &
avec tant de vivacité qu’il devançoit les plus
vîtes :
Qui per fape vago viclor certamine curfus
Flammea pravertit celeris veftigia cervat.
Virgile peint Camille adonnée à touts les exercice
du corps : elle furpaffôit les vents à la courfe g,
elle etoit ft légère qu’elle auroit couru fur les
épis fans en courber la tige , ou fur la mer fans
mouiller fes pieds.
Curfuque pedum prcivertere ventes.
Ijftt vel Intacta fegetis per fumma yolaffet ;
Gràmina, nec teneras curfu tcefiffet arifias ;
V d mare per medium ,. flucfu fufpenfa tumenti,
Ferret iter, celeres nec tingeret aquore plantas.
La courfe étoit fi fort en honneur, que ceux
qui y avoient remporté le prix chez les Perfes
y etoient décorés des ornements des rois; les
Egyptiens ne donnoient pas à manger à leurs enfants
qu’ils n’euffent fait une courje de quelques
ftades.
Paufanias dit que ce furent les habitants du
Péloponèfe qui mirent la courfe au rang des exercices
gymnaftiques.
Il y en avoit quatre fortes relativement aux
efpaces que parcourroient les coureurs : le ftade,
ou la huitième partie d’un mille; c’eft-à-dire cent
vingt-cinq pas; le dolicum, ou deux ftades; le
diaulum, ou l’allée & le retour, des deux ftades
dans une feule courfe ; enfin Yarmatum, c’eft-à-
dire celle où les troupes courroient toutes armées
avec leur bagage.
Gallien n’eft pas de l’avis de ceux qui le regardent
comme fort propre à fortifier le tempérament.
Il dit au contraire, qu’il eft plus propre
à énerver, & que le fuccès d’une bataille ne
doit guères dépendre de gens qui s’exercent toute
leur v ie , pour acquérir la faculté de bien s’enfuir
; mais plutôt de ceux qui ont le courage de
tenir ferme ; que les Lacédémoniens n'ont affu-
rément pas dû leurs victoires &. leur réputation
à la qualité de bien courir ; mais de bien combattre,
\ '
Ce que nous avons dit réfute affez le fentiment
de Gallien. D ’ailleurs, pour que cet exercice ne
débilite pas comme il le prétend, il faut ne le
pas prendre avec excès : ici le philofophe a pris
l’abus de la çhofe pour la chofe même (J .).
On trouve chez les anciens, & fur-tout chez
les Grecs , un fréquent ufage.de la courfe au moment
du choc. A Marathon les Athéniens chargèrent
les Perfes à la courfe, (Hèrodot. VI. C. 1 12.),
diens. D è s qu’ il les v it en bataille , il arrêta fa
ca v a le r ie , pour donner à l ’infanterie le temps
d’arriver ; & lorfque la phalange eut r e jo in t ,
Alexandre ne la forma pas au fli- tô t, afin de ne
point oppofer aux troupes Indiennes , encore
toutes fraîches , des hommes fatigués & haletants.
\ \ L . V.p. 340.). T ou ts ces exemples prouvent
I que les anciens , en allant à la ch arg e, marchoient
d’abord rapidement, augmentoient par degrés
j leur vîteffe , & prenoient enfin la courfe à peu
! de diftance ; mais que , fi pour prévenir l’enné-
mi dans un pofte ou dans un pafiage , ils avoient
fourni une longue traite 'en cou ran t, ils fe gar-
doient bien d’attaquer dans cet état d’épuifement.
& ce furent les premiers qui, parmi les Grecs, en
donnèrent l’exemple. ( Ibid. ). Ils chargèrent de
même les Béotiens à Délium. ( Thucyd. L. IV.
page. 316. C.). Ils attaquèrent, à la courfe, les
retranchements des Syracufains ; il en firent ufage
dans le même combat, à deffein de s’emparer du
pont vers lequel les ennemis s’enfuÿoient. ( ld.
p. 484. C. 485. C. ). Ils chargèrent de^ même,
fous la conduite de Thrafybule, une troupe La-
cédémonienne poftée à quinze milles de Phyl'e.
( Xenoph. L. II. hijlor. grcec. p. 471. C. ).
Agéfilas fit charger à la courfe la cavalerie
Perle par ceux de fes oplites qui avoient environ
vingt-fept ans, & donna ordre aux pel-
taftes de les fuivre du même pas. ( ld. L. 111.
p. 501. A . ). Iphicrates mena de même fes troupes
contre les Lacédémoniens commandés par Anaxi-
bius. ( ld. L. IV. 543. C. ).
Le paffage fuivant de Xénophon nous inftruit
de la manière dont fe faifoit cette courfe: Les
. Phliafiens, conduits par Charès, voulant fur-
prendre les Sicyoniens occupés , à conftruire un
fort, fe mirent de nuit en marche. La cavalerie
& l’infanterie Phliafienne , marchoit à l’avant-
garde ; d’abord légèrement, enfuite plus vîte ;
enfin les cavaliers au galop, & l’infanterie à la
courfe , en obfervant fon ordre autant qu’il étoit
pofiible. ( ld. L. VU. p. 629. B. ). On voit que
le mouvement étoit progremf, & l’ordre conièr-
vé même dans une marche; à plus forte rai-
fon lorfqu’on alloit à _la charge : ainfi la courfe
étoit réglée.
Un des avantages de cette vîteffe, étoit d’effrayer
l’ennemi ; un autre, d’en venir plutôt aux mains,
& d! avoir moins à fouffrir des traits ; ce fut pour
fe les procurer, qu’à la bataille d’Iffe , Alexandre
avec fon aile droite, chargea les Perfes à la
courfe j ( Arian. 8 ° .p . 105. L. I I .) : & de même
à la bataille d’Arbelle ( ld . L. III. 1 9 0 .) , aux
détroits de Perfe. ( Id.ibid. 203). Les habitants
de Maffaga pourfuivirent à la courfe les Macédoniens
qui fe retiroieiît devant eux, & l’hifto-
rien obferve qu’ils co.uroient fans aucun ordre,
( L. IV. p . . 300. ). Dans la bataille contre Porus ,
nous voyons Alexandre fe précautionner contre
le danger d’une courfe trop longue. Après avoir .
paffé l’H ydafpe, il marcha rapidement aux Iri- '*
Il y a encore des. occafions où nous pourrions
faire de la coiffe un ufage avan tageux, fi nos
troupes y étoient exercées. Elle peut nous fervir
à faifir , avant l ’en n em i, un p o lie , un paffage ,
une pofition favorable ; à l’attaque d’un retranchement
, d’une maifon , d’un pofte , pour être
moins longtemps expofé au feu , lorfqu’il devient
plus dangereux, à charger une troupe ébranlée
ou en détordre , & la déterminer à luir.
C O U R T I N E . Partie de rempart qui joint
les flancs de deux baftions.
Fig. 170.
A , B , baftions.
C , courtine.' -
C O U T E L A S . Arme de main , épée à lame
large & courte.
C O U V E R T . T errein propre à cacher une
troupe.
C O U V R E -F A C E . Voyeç C o n t r e - g a u d e .
C R A N E Q U I N . Fer qui fe rvo it.à tendre
l’arbalète.
C R A N E Q U IN I E R . Arbalétrier qui faifoit
ufage du cranequin : il y avoit des cranequiniers
à pied & à cheval.
C R É D I T . V ou lez -vous fç-avoir-combien il
importe de punir les citoyens qui font crédit aux
gens de guerre ; interrogez quelques-uns des fol-
d a ts, & fur-tout des bas-officiers qui v on t être
punis pour crime de défertion : prefque touts vous
diront: ce font les dettes que j’avois contrariées
qui m’ont obligé à déferter. J’ai entendu un de
ces derniers adreffer à fies juges les paroles fui-
vantes : « Tranquille , confidéré , & content de
mon é ta t , je coulois des jours heureux : un marchand
m’o ffre , un jo u r , de me donner à crédit
les marchandilès dont j’avois befoin ; j ’avois de
l’argent , j’étois fans paffion : je le refufai.
Quelques jours ap rè s, je me trouve a v e c quelques
uns de mes camarades dans une maifon de
jeu ; on me propofe de jouer ; je réfifte aux fol-
licitations qu’on me fa it , & aux preffentiments
de bonheur que la trompeufe fortune avoit mis
dans mon ame : fi je venois à perdre , dis-je tout
h a u t , comment ferois-je ? Je n’ai que l’argent qui
eft dû au marchand de ma compagnie ; il étoit