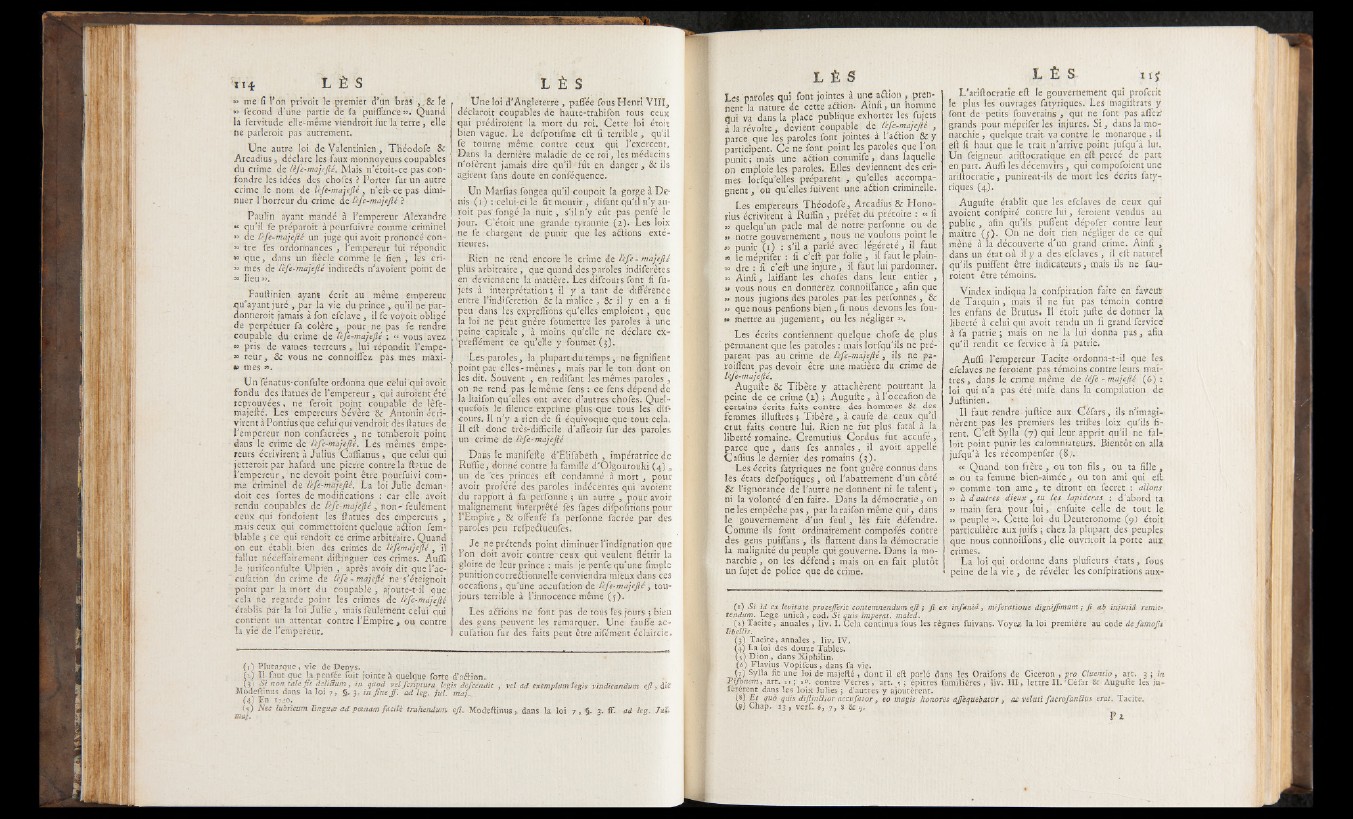
'U4 L Ê S
*> me fi l'on privdit le premier d'un bras ÿ i f c le
» fécond d’une partie de fa puiffance ». Quand
la fervitude elle-même viendroit fur la terre, elle
ne parlèroit pas autrement.
Une autre loi de Valentinien , Théodofe &
Arcadius, déclare les faux monnoyeurs coupables
du crime dt lèfe-majefié. Mais n’étoit-ce pas-confondre
les idées des chofes ? Porter fur un autre
crime le nom de lefe-majefié 3 n’ eft- ce pas diminuer
Phorreur du crime de lefe-majefié ?
Paulin ayant mandé à Pempereur Alexandre
•* qu’il fe préparoit à pourfuivre comme'criminel
» de lefe-majefié un juge qui avoit prononcé con-
33 :tre fes ordonnances , l’empereur lui répondit
50 que, dans un fîècle comme le lien , les cri-
33 mes de lefe-majefié indirects n’ avoient point de
33 lieu».
Fauftinien ayant écrit au même empereur
qu’ayant juré , par la vie du prince , qu’il ne par-
donneroit jamais à fon efclave 3 il fe voyoit obligé
de perpétuer fa colère, pour ne pas fe fendre
coupable du crime de lefe-majefié : « vous avez
» pris de vaines terreurs, lui répondit l’empe-
» reiir, & vous, ne connoilfez pas. mes niaxi-
*> mes *>.
Un fénatus-confulte ordonna que celui qui avoit
fondu des ftatues de l’empereur, qui auroiènt été
réprouvées, ne feroit point coupable de lèfë-
majefté. Les empereurs Sévère & Antonin écrivirent
à Pontius que celui qui vendroit dés ftatues de
l’empereur non confacrées , ne tomberoit point
dans le crime de léfe-tnajefté. Les mêmes empereurs
écrivirent à Julius Caffianus, que celui qui
jetteroit par hafard une pierre contre la fratue de
l ’empereur, ne devoit point être pourfuivi comme
Criminel de lefe-majefié. La loi Julie 'defrian-
doit ces fortes de modifications : car elle avoit
rendu coupables de lefe-majefié 3 non- feulement
ceux qui fond.oient les ftatues des empereurs ,
mais ceux qui comméttoient quelque aélion fem-
blable j ce qui rendoit ce crime arbitraire. Quand
on eut établi bien des crirriès de léftmdjefiè 3 il
fallut néceffairement diftinguer ces Crimes. Auffi
le jurifconfulte Ulp ien, aprèsavoir ditque l’ac-
cüfation du crime de lefe - majèfié ne/s’ éte jg’nôit
point par la mort du coupable, ajoute^-t-il que
cela ne regarde point les crimes de lefe-majefié
établis parla loi Julie", mais feulement celui qui
contient un attentat contre l’Empire , ou contre
la vie de l’empereur.
L È S
I Une loi d'Angleterre , pafîee fous Henri V III,
déclaroit coupables de haute-trahifon tous ceux
qui prédiroient ta mort du roi. Cette loi étoit
bien vague. Le defpotifme ell fi terrible, qu’il
fe tourne même contre ceux qui l’exercent,
Dans la dernière maladie de ce roi, les médecins
n?ofèrent jamais dire qu’ il fut en danger, & ils
agirent fans doute en conféquence.
Un Marfias fongea qu’il coupoit la gorge à Denis
( i ) :-celui-ci le fit mourir , difant qu’ il n’y a-u-
roit pas' fongé la nuit, s’il n’y eût pas penfé le
jour. C ’étoit une grande tyrannie (2). Les loix
ne fe chargent de punir que les avions extérieures.
Rien ne rend encore le crime de lefe-majefié
plus arbitraire, que quand des paroles indifcrètes
en deviennent la matière. Les difcours font fi fu-
jcts à interprétation ; il y a tarit de différence
entre lmdifcretion & la malice, & il y en a fi
peu dans les exprèffions qu’ elles emploient, que
la loi ne peut guère foumettre les paroles à une
peine capitale , à moins qu’elle'ne déclare ex-
’preffément ce qu’elle y -foumet (3).
Les parolès, ta plupart du temps, ne fignifient
point par elles - mêmes , mais par le ton dont on I
les dit. Souvent , en redifant les mêmes paroles , i
on ne rend pas le même fens : ce fens dépend de
la liaifon qu’ elles ont avec d’autres chofes. Quelquefois
le filence exprime plus que tous les dif- j
cours. II n’y a rien de fi équivoque que tout cela.
Il eft donc très-difficile d’affeoir fur des paroles
un crime de léfe-majejté
Dans le mânifefte d’Elifabeth , impératrice de
Ruffie, donné contre la famille d’Olgouroüki (4) ,
un de ces princes eft condamné à mort , pour
avoir proféré des paroles indécentes qui avoient
du rapport à fa perfonne. ; un autre , pour avoir
malignèment interprété fès fages difpofitions pour
l’E m p i r e & offenfé fa perforine'- facrée par des
paroles peu refpé&uéufes.
Je ne prétends point diminuer l’ indignation que
l’on doit avoir contre-'ceux qui veulent flétrir la
gloire de leur prince : mais je penfe qu’ une Ample
punition corredionnelle conviendra mieux dans ces
oceafions, qu’une accufation de lefe-majefié 3 toujours
terrible à l’innocence même ( j ) .
Lés avions'ne font pas de toûsTes jours ; bien
des gens peuvent les remarquer. Une fauffe accu
fa tion fur des faits peut être aifément éclaircie*
f i ) Plutarque,. vie de Denys.
. fe) <îue bpenfée foit jointe à quelque forte d’aélion..
(3J §} non taie ni dziïBum, in qiiod velfcriptura legis defcéndit , vel ad exèmplum legis vindicandiim ejl, diif
Modeftinus dans la loi 7* §. 3>, in fine ff. ad leg. fui. maf-
(4) En 1740.
U) Nec lubrieum lingues ad poenam facitè trahendum ejl. Modeftinusdans la loi 7 ,mat. ' ' * *G . ■ Ja ., ff. ad le°g. J ut
L È S
Les paroles qui font jointes à une a&ion , prennent
la nature de cette aftion- A in fi, un homme
qui va dans la place publique exhorter les fujets
à la révolte, devient coupable de^ lefe-majefié ,
parce que les paroles font jointes a 1 aéfcion & y
participent. C e ne font point les paroles que l’on
punit ; mais une aétion commife, dans laquelle
on emploie les paroles. Elles deviennent des crimes
lorfqu’elles préparent , qu elles accompagnent
, ou qu’ elles fuivent une aétion criminelle.
Les empereurs Théodofe, Arcadius & Hono-
rius écrivirent à Ruffin, préfet du prétoire : ce fi
» quelqu’un parle mal de notre perfonne ou de
»» notre gouvernement, nous ne voulons point le
33 punir (1) : s’il a parlé avec légéreté, il faut
*> le méprifer : fi c’ eft par folie , il faut le plain-
» dre : fi c’eft une injure, il faut lui pardonner.
» Ainfi, lailfant les chofes dans leur entier ,
» vous nous en donnerez, connoiflance, afin que
>» nous jugions des paroles par les perfonnes, &
« que nous penfions bien, fi nous devons les fou-
» riiettre au jugement, ou les négliger ».
Les écrits contiennent quelque chofe de plus
permanent que les paroles : mais lorfqu’ils ne préparent
pas au crime de lefe-majefié, ils ne pa-
roiflfent pas devoir être une matière du crime de
lefe-majefié.
Augufte & Tibère y attachèrent pourtant la
peine de ce crime (2) ; Augufte, à l’occafion de
certains écrits faits contre des hommes & des
femmes illuftres j T ib è r e , à caufe de ceux qu’ il
crut .faits contre lui. Rien ne fut plus fatal à la
liberté romaine. Cremutius Cordus fut accufé,,
parce que , dans fes annales, il avoit appellé
Caffius le dernier des romains (3).
Les écrits fatyriques ne font guère connus dans
les états defpotiques, où l’abattement d’un côté
& l’ignorance de l’autre ne donnent ni le talent ,
ni la volonté d’ en faire. Dans la démocratie, on
ne les empêche pas, par laraifon même qui, dans
le gouvernement d’ un fe u l, lés fait défendre.
Comme ils font 'ordinairement compofés contre
des gens puiffans , ils flattent dans la démocratie
la malignité du peuple qui gouverne. Dans la monarchie
, on les défend ; mais on en fait plutôt
un fujet de police que de crime.
L È S i i j
L'ariftocratie eft le gouvernement qui proferit
le plus les ouvrages fatyriques. Les magiftrats y
font de petits fouverains , qui ne font pas affer
grands pour méprifer les injures. S i , dans la monarchie
, quelque trait va contre le monarque, il
eft fi haut que le trait n’arrive point jufqu’ à lui.
Un feigneur ariftocratique en eft percé de part
en part. Auffi les décemvirs, qui compofoient une
ariltocratie, punirent-ils de mort les écrits fatyriques
(4).
Augufte établit que les efclaves de ceux qui
avoient confpiré contre lu i, feroient vendus au
public, afin qu’ils pufîent dépofer contre leur
maître (5). On ne doit rien négliger de ce qui
mené à la découverte d’ un grand crime. Ainfi ,
dans un état ou il y a des efclaves , il eft naturel
qu’ils puiffent être indicateurs, mais ils 11e fau-
roient être témoins.
Vindex indiqua la confpiration faite en faveufe
de Tarquin, mais il ne fut pas témoin contre
les enfaris de Brutüs. Il étoit jufte de donner la
liberté à celui qui avoit rendu un fi grand fervice
à fa patrie ; mais on ne 1a lui donna pas, afin
qu’ il rendît ce fervice à fa patrie.
Auffi l’empereur Tacite ordonna-t-il que les.
efclaves ne feroient pas témoins contre leurs maîtres
, dans le crime même de lèfe-majefté (6) ï
loi qui n’ a pas. été mife dans la compilation de
Juftinien. '
Il faut rendre juftice aux Céfars, ils n’imagi--
nèrent pas les premiers les triftes loix qu’ils firent.
C ’eft Sylla (7) qui leur apprit qu’il ne fal-
loit point punir les calomniateurs. Bientôt on alla
jufqu’ à les récompenfer (8;.
ce Quand ton frère , ou ton fils , ou ta fille ,
33 ou ta femme bien-aimée, ou ton ami qui eft
» comme • ton ame, te diront en fecret : allons
33 a d autres dieux 3 tu les lapideras : d’abord ta
main fera p'our lu i, enfuite celle de tout le
» peuple ». Cette loi du Deuteronome (9.) étoit
particulière aux juifs ; chez la plupart des peuples
que nous connoiflfons, elle ouvriroit la porte aux
crimes.
La loi qui ordonne dans plufieurs états, fous
peine de la v ie , de révéler les confpirations aux-
(1) Si id ex levitate procejferit contemnendum ejl ; fi ex infanïâ, miferatione dignijfimum ; fi ab injurid remit-,
tendum. Lege unicâ, eod .S i qui s imperat. maled.
(z) Tacite, annales , liv. I. Cela continua fous les règnes fuivans. Voyez la loi première au code defamofis
libellis.
(3) Tacite, annales , liv. IV,
(4) La loi des douze Tables. ( 0 Dion , dans Xiphilin.
(6) Flavius Vopifcus, dans fa vie.
(7) Sylla fit une loi de majefté , dont il eft parlé dans les Oraifons de Cicéron , pro Cluentio, art. 3 ; in
Vifonem, art. 21; i°. contre Verres, art. 5 ; épitres familières , liv. III, lettre I I .‘Céfar & Augufte les inférèrent
dans les loix Julies ; d’autres y ajoutèrent.
(8) Et quo quis dïjlinctlor accufator, eo mugis honores afiequebatur » a£ veluti facrofançtiis erat. Tacite,
(9) Chap. 13 , verf. 6., 7, 8 & 9,
P 2
i