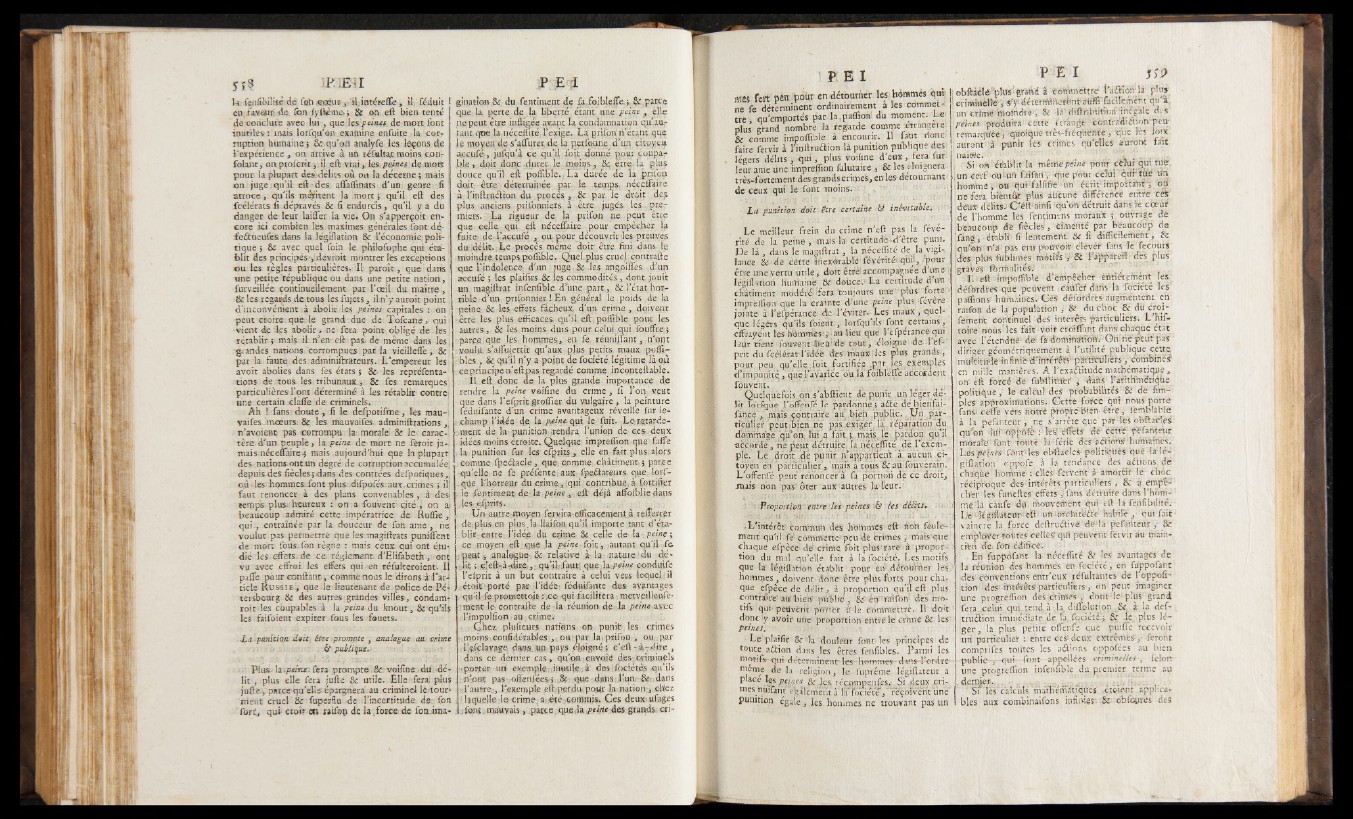
5j$ IKIEil
t a ffa ifib ilk ê de foh rOtâwOÿ^ ilJnte?eÆe , il, Cédait
en fiv^mMte fonjyftème.; & on eft bien tenté
de conclure avec lu i , que les ‘peines de mort font
inutiles : mais lorfqu’on examine enfuite-la cois-
ruption humaine; & qu’on analyfe les leçons de
l ’expérience , on arrive à un séfolta* moins contrôlant,
on proforit 3 . il eft vrai, les, peines de mort
pour la plupart desklélits o.u on la décerne ; mais
on juge 1 qu’il eft des aifalfinats d’ un genre fi
a tro ce , qu’ils méditent la mort ; qu’ il eft des
fcélérats fi dépravés & fi endurcis, qu’il y a du
danger de leur laiffer la vie. On s’apperçoit encore
ici combien les maximes générales font dé-
feâueufes, dans la iégiilation & l’économie; politique
; & avec quel foin le. phibfcphe qui établit
des principes fyrievroit montrer tes exceptions
©a les règles particulières. Ib paraît, que dans
une petite république ou dans une petite nation,
furveiilée continuellement par l’oeil du maître
& les regacds dê tous les fujets, il n’y aurait point
d’inconvénient à abolir les peints capitales on
peut croire que le grand due de Tofcane y qui
vient de îles abolir, ne fêta point obligé de tes
rétablir ; mais iL n e n eft ■ pas> de même- dans les
grandes nations corrompues par la vieillefle, &
par ta faute desadminiftrateurs. L ’empereur les
avoit abolies dans fes états ; &■ les repréfentâtions
de.tous tes tribunaux, & fes remarques,
particulières l’ont déterminé à les rétablir contre;
une certain clafle de criminels.
Ah ! fans; doute , fi le defpotifme, les mau-j
vaifes-moeurs. &; les mauvaifes adrainiftrations
n’ a voient pas corrompu la. morale & le- caractère
d’un, peuple, W.peine de mort ne feroit jamais'néceuaire^
mais aujourd'hui que la plupart:
des nations.ont un degré-de corruption accumulée!
depuis des fiècles »dans des: contrées, defpotiques
où « les hommes font plus; difpofés^aux, crimes ; il!
faut renoncer à des plans convenables , à dès!
temps-plus; heureux : on a fouvent'çité j on ai
beaucoup admiré cette impératrice de: Ruflie ,;
qui:, entraînée par la douceur de foti ame , ne
voulut pas permettre que les magiftrats puniffent
de mort foùs^fon règne : mais céux> qui ont étu-,
dié les dfets- de c e règlement d’EIi&bethyont
vu avec effroi les effets qui en réfulteroient. l|
pafte peur confiant i,: comme-nous le dirons:à d’ar-*
ticte Russ ie , que le lieutenant de ; police de* Pé4
tersboarg & des autres grandes ville», coudante
roit les coupables.à la peine du knout, & qu’ils
les faifoient expirer fous les fouets.
-La punition* doit, être prompte } analogue au crime
. & publique. *
Plus- la ïpemjsi fera .prompte!;&:• voifine-j.diii idéf
l i t , plus elle fera jufte & utile. Elle ferai plus
jafte-, parce quelle épargnera au criminel letoute
irieiit* cruel 8c fupesflu de Tincerritude de fon
fort., qui- croît en jaifop de la . force de foniraap
EJ
gination & du fentiment de fa.foibtefle. >, & parce
que la perte dp la liberté étant un k. peine ? elle
ne-peut être infligée avant la condamnation qu’ aur
tant que la néçeflité f exige. La prifon; n’etant que
le moyen dp s’affurer, de la perforine. d’uq çitqyeq
accuféi jufqu*4 ce qu’il foft donné pour çoupar
bl,e ■>. d.oit donp durer le moiijs.., &j. être- la plus
douce qu’il eft pomSle., La durée de la .priiou
doit être déterminée par le .teiqps. néceiïaife
à rinftruélion du procès, & par le droit de^
plus anciens prifonniers à être jugés, les premiers.
La rigueur de la .prifon ne peut être
que-celle, qui eft néceflaire pour empêcher k
fuite. de; Kaccufé x ou. pour découvrir 'les. preuves
du:idéli<J.,L.e prpçès meme doit; être fini dans le
moindre temps poffible» Quel,plus cruel contraire
que l’indolence- d’un juge & les angoifies .d’ un
accufé ; les plaiftrs & les commodités, dont, jouit
un raagiftr-at infenfible d’une part , & l’état horrible
d’un prisonnier. ! En général le poids de la
peine & les effets fâcheux d’un crime, doivent
•être, les plus efficaces, qu’il eft poffible pou-r tes
autres, & tes moins durs .pour, celui-,qui fouffre;
parce: que tesr hommes, en fe: réunijffant , n’ont
voulu s’afluj.ettir qu’aux plus petits maux pefli-
bles., & qu’il n’y a point de fociété légitime là où
ce principe neftpas regardé comme inconteftable.
II. eft.. donc de la plus grande importance de
rendre la peine voifine du crime, fi l’oi?. veut
que dans l’efprit greffier du yulgajre , la peinture
féduifante d’un crime avantageux réveille fur le-
champ l’idée de. h peine, qui le fuit. .Le-p^tardét
i n t de; k- punition ^rendra! l’union de ees deux
idées moins étroite. Quelque' impreffion que fafie
la punition , for les efprits > cite en fait.plus;alors
. comme fpeéfaçle,. quer comme châtiment- ; par.ee
qu’ elle ne fe préfente-aux fpe<ftatfi;Urs. que lorf-
- que. 1- horreur du crime,iqpi çpntribue) à .forrifi'er
le fentiment de. h peîne ± eft déjà affaiblie dans
jes.efprits. ; 1
•Un autre -moyen fervira;effi.caeement. à. rç$ex*çr
de.plus en plus, la liaifon qu’ il importe tant d’établir
entre; l’idée du crime. 8e celle do la peine ;
ce .moyen eft .que Ja peine . fq\t 9 autant, qu’il/fa
pe^t & ,analogue^ &, rel,ati ve à' k nature-. • du dié -
A ;;,çteftbà-d(irç.',i qu’il/fautl q u e ja -,pe\ne eorvdiftfe
l’efprit à un but contraire à celui vers lequej..(il
rétait'*;porté pat l’idée: féduifante de» avantages
qu-il fo promerçojt- ; -,c& qui'facilitera 3 metveilteufe-
• m'eut te; Gpnt-rafte dé j à réunion de ,la peine,avec
l’impulfion au ; crime? .
, Chez,, pîufieurs nations o n , punit1 les crimes
impifïs>cpnftdétabjes >, 1. ou^par. lar prifon , o,u par
.Itejçlavage dans.iUP pays éloigné; c ’eft-àjndire ,
dans ce dernier cas, qu’on.;envoie des..criminels
rporter- uni exempt: inutitei à' dosffociétùs «qu’ ils
. nfont pas0offenfées,-; & que -dans .l’un, ■ .&< dans
0 l’autre-, , l’exemple eftipef.dunpoftr la nation^ chiez
■ laquelle le-crime • a: été >commj8v Ges deux^ ufo^es
,font mauvais, parce. q u e j a . d e s grands' cri-
P E I
mes fett pén 't>oùt en détourner les. hdmmés qui;
ne fe déterminent ordinairement à les cdmmet-.
trê> qu'emportés par la,paffion1 du moment, t e '
plus gtand nombre h regarde comme étrangère;
& comme impoflible à encourir. Il faut donc
faire feryit à l'inlhuétion l i punition publique des
légers délits, q u i, plus roiline d’eu x , fera fur
leur ame line impreffion falutaire , & les ^lorgnera
très-fortement'des.grands criipeSj enles- détournant
de ceux qui le font moins.
Ld punition doit- être certaine & inévitables 5 • ' ;
Le meilleur frein du crime n’eft pas la féve-
rité de la peine , mais la cértitüdè-d’être puni.
De la , dans le magifirat, la néceffité de la vigi-
ïauce & de cétte ihexèrablê fèyéritéfpuu^/paBr
être une yertfü utile, doit- êtéèi accompagnée d -iyné*|
légifl ifion huiîîainé & dôùcet1’ La certitude d'ütt
châtiment modéré! ‘fera1 'toujours une1 plus' farte'*
imprkïfidrï-q'ue l'a crainte d>’uùe y eine .pluspfoyere
jointe à-l’ êfpérance de l’éviter. Les maux, quelque
légérs qu’ils foieiit-y lorfqu ils fontscertains ,
effrayent les h&mmês^aiï lieu que l'èfpe rance qui
leiir rterif' 'fauvélit Lieur:de-: tou t, '• *de--1'tfc
prit du fc.élérat j ’idéë dtS'îniaû»; les plus grandsi,
pour p.eu, qu’ elle fortifié^ , j eJ5,exemples
d’ impàjfitç, £ 0 ^ ^ ^ àccofdent
fauventvç., ' P c .]. *r Lia
(^çlqfiefôiséqntetebfttent dé punir uh jégér délit
lorfque l’ btfphré jé pardonne ; aéiè clé b.ien^ai-
fihc'e . ,Mm^is^ cqhtfaife ki^ .bjeh .pi^bfic. foar- ..
ticuiiçf pèùtfoien ne .pdàrëxiâèr la{. répà^atioq du,
tteihrha'gè qufaù; lui .q fi\x. i, màis, fo b?rdon quiL
accord’^ ,’ ne peut detrûihéi läh^qeSite dè l’qxem-
plè. Lé droit aucun citoÿën'en
'‘pàrtiçûliè’r , mais à tous & aü fouvérâin.
L ’offenfé peut rénoncéLà fa portion de cê droit,
mais non pas'öfter aux autrès: la leur.
Proportion ' entreilës peines les dé&ts'*
.E ’ ihcérêt co.m'muh dê§ h'ôHim’é-s éft hoh fèiilè-'.»
ment qu’dl fé cômmétte^peu de Crimes , 'mâis’>qiie
chaque efpèce; dd crime fait plûS' rare à ' propof- ■
tion du mal qu’ elle fait à la fociété. Les motifs
que la légiflâtioh établit - pour eir .dètoiiVhér lèi
hommes , doivent dOnc être plus farts pour chaque
efpêce de délit, à proportion qu’il eft plus
contrau'e'.' âû! bien public , & cn: vaifoiV dès motifs
qui' perivèrit porter à le ebrrimettrè. Il do't
donc iy avoir une; propörtiöh enti’dle1 c-rimé & les’
peines.
Le' pl'aifir & la douteur font les principes de
toute aéfion dans les êtres fenfibles. Parmi les
monte- qtfi dtfterminenn les- hommes- d ws-l-ordre-
meme Re ]a religion, le ■ fuprême légiflateur a
place tes pjjpv & fje.s récpiripejffes^, Si.-ffeiij primes
nuiianf ehâlèmenr à j a -fociête, rëçoi vè n t ~u né”
punition égale, les hommes ne trouvant pas un
P E I
: obftàclppÏIW 'gtàhd à c ômméttre i’âétioiv là pl us;
! orimlnèlte-j SfJ’! détferifiirwrbnr àliffi facilernéintqu i
; un trhTréJ'mofnd'té!j 8c là'difiriblrtvon'irtegale des
\p'èines jÿfadïiffa èêttë étrângê • contra'diélion peu'
; re’marqtféé j quoique très-frécfiiênte, qufe tes loix
auront à punir lés- crimes qu’elles auront fait
naîifife. _ . _ , t .
; . Si onféthbfit la même 'péinè pour cèîur qui nje
,utt eéi'f ou i-üft faifàri qiïé pour cetel qut thé un
-homme ; bü quifahffië^'un écrit' impofràh^ oti
‘ ne fera bfëntÿ plus aü'cuné différence entré cés
deafc déhts. C-êlbâinfi quon:détruit dans;te edeut
de l’homme tes fentimens .moraux ; ouvrage’ de
[beaucoup de frèctes, Uméiité par beaucoup de
*fang, établi fii lentement; 8c fi difficilement , 8t
teyon n’d- pas crû1 pOùvoir- élevér fans ïè fecours
jdhsPpfes foblimés mérite l ’appareil dés plus
[gtâbes farmafité^ ?i' : • ® w ;; . '
irtlpoffi'bVè d’ëHipéêbet èritiéreftiem les
dé'fôŸdreS'qàe peuvent-cidréé dans k fociété les
ipsffions' humainesl Gès défdrdrès augmentent en
raifon de la" population , & du choc & du croi-
fément cé'nïinuél deJ intcrSfs pdrtîculieis. L'hif-
toii'e nous*' les fait voit crolffint dans chaque e tit
avec rétendùé1 dë! fïdoiBm^SW.-'OHiné' pfeuf pas
diriger géométriquement a 1 utilité publique cette
:m-uiîittfIS1ffififtiSd?inééi‘êtti’pWtîéuliehv:cSnbiiié!?
en mille manières. A l'exaftitude mathématique ,
'OIT- eft forcé de fublîitafer- ; date I'amHrnetipfae
- politique, te cïleuV deS probabilités 8è dé fin'-
pie# approximations;. Gctte force qüî nous porte
fansi cetfe vers notre propi-ébién- ê tre, fèniblàble.
!à la pefanteur, ne s'arrête que pari-i’es ob'ftaHês'
qu'on itfi opi-ftfé : let! (•(?<.!s dé eeffe1 fëfanfeiir
morale! font- îétlté latférlè des aétiobS hubiaifiës.
Lés'j«i,'iW'fSnflleS ébftaclespSHtfqbêS quéda lé-
'giflation c.ppqfe à la tendance des a étions, de
chïqiié boninié : elles' fervent 'à- amortir lé ch ic
réciproque des-'intérêts; particuliers , & à empê-
cher les funeftes effets-/fans 'détruire dans l'honi-
trie là càufe dil rnouvèrdent Jqui eft la feiffibilité.
I.é:"!ég'Xluteur cil un-arnhirêéte habile , qui fait*
vaincre la force deftruétive dé'lâ pefanteiir , &
emplpéer toiifes 'cellêsl qui peuvent fervr au maintien
de, fôri editioé'
En fuppdfaîit la néceffité & les avantages de
la réuuion des hommes en fociété, en fuppofaht
dësucô'nvehtiôns emr'eux réfultantes de roppolî-
tion defs! intérêts particuliers-, on peut imaginer
une progreffion des crimes , dont1 le-plus grand
fêta -celui qui,.pend,à -,1a di f f pl ut i onà la def-
truéiion immédiate, de b. fociété s & ie plus lég
e r , la plus petite ôffêiif; que puiffe recevoir
itiS particulier : entre dest deux eXtrénièS'/ feront
comprifes toutes les a étions oppofées au bien
-publie-s~qui- font appellées criminelles , félon
une progreffion infenfible du premier terme au
. deTOe*..,, ; [ja
" St les calculs 'malhématiqu'èV étcùent applicables
aux combinaifons infimes. '& dbfqcres des