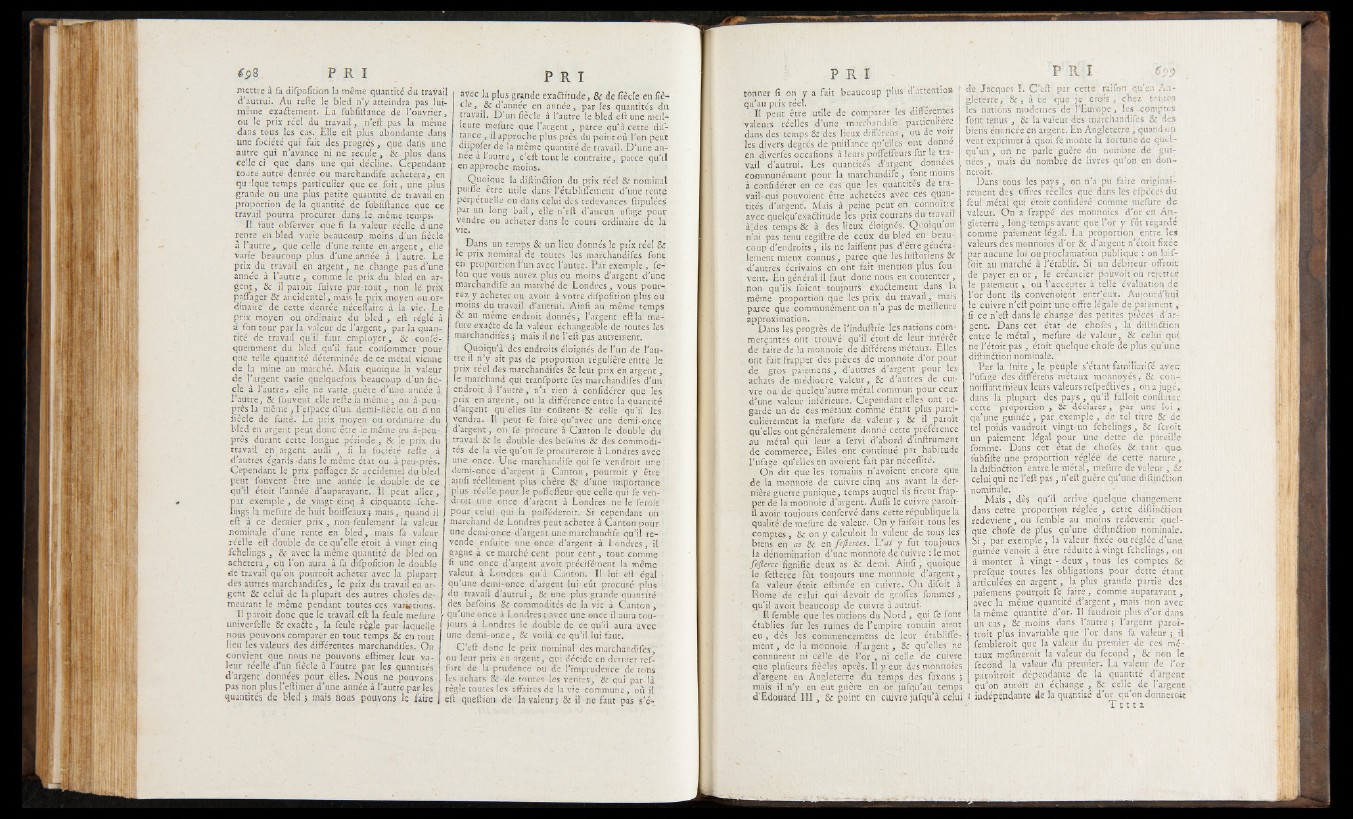
*j>8 P R I
mettre à fa difpofition la même quantité du travail
d'autrui. Au relie le bled n'y atteindra pas lui-
même exa&ement. La fubfiftance de l'ouvrier,
ou le prix réel du travail, n'eft pas la même
dans tous les cas. Elle elt plus abondante dans
une fociété qui fait des progrès , que dans une
autre qui n'avance ni ne recule, & plus dans
celle ci que dans une qui décline. Cependant
toute autre denrée ou marchandife achètera, en
quelque temps particulier que ce fo it , une plus
grande ou une plus petite quantité de travail en
proportion de la quantité de fubfiftance que ce
travail pourra procurer dans le. même temps.
Il faut obfer.ver que fi la valeur réelle d une
rente en bled varie beaucoup moins d'un fiècle
à l'autre, que celle d'une rente en argent, elle
Varie beaucoup plus d'une année a l'autre. Le
prix du travail en argent, ne change pas d'une
année à l'autre, comme le prix du bled en ar-
gent, & il paroît fuivre par tout , non lé prix
paflager & accidentel, mais le prix moyen ou ordinaire
de cette denrée nécefiaire à la vie. Le
prix moyen ou ordinaire du bled , eft réglé à
à foh tour par la valeur de l'argent, par la quantité
de travail qu'il faut employer, -& confé-
quenament du bled qu'il faut, confommer pour
que telle quantité déterminée de_ce métal vienne
de la mine au marché. Mais quoique la valeur
de l'argent varie quelquefois beaucoup d'un fiê-
cle à l'autre., elle ne varie guère d'une- année à
l'autre, & fo.uvent, elle refte la même, ou à-peu-
près la même , l'efpaçe d’un demi-fièele ou d’un
fiècle de fuite. Le prix moyen ou ordinaire du
bled en argent peut donc être, lé même ou à-peu-
près durant cette longue période , & le prix du
travail en argent au fil , fi la fociété refte à
d'autres égards «dans le même état ou à-peu-près.
Cependant le prix paffager & accidentel du bled
peut fouvent être une année le double de ce
qu’il étoit l'année d'auparavant. Il peut aller,
par exemple, de vingt-cinq à cinquante-fehe-
lihgs là mefure de huit boifleaux, mais, quand il
eft à ce dernier prix, non-feulement la valeur
nominale d'une rente en bled, mais fâ valeur
réelle eft double de ce qu'elle étoit à vingt cinq
fehelings , & avec la même quantité de bled on
achètera , ou l'on aura à fa difpofition le double
de travail qu'on pourroit acheter avec la plupart
des autres marchandifes, le prix du travail en ar- i
gent & celui dé la plupart des autres chofes demeurant
le même pendant toutes ces variations.
Il paroît donc que le travail eft la feule mefure
univerfelle & e x a& è , la feulé règle par laquelle
nous pouvons comparer en tout temps 8c en tout
lieu les valeurs des différentes marchandifes. On
convient que nous ne pouvons eftimer leur valeur
réelle d’un fiècle à l’autre par les quantités
d ’argent données pour elles. Nous ne pouvons
pas non plus l’eftimer d'une année à l'autre par les
quantités de bled j mais nous pouvons le faire J
p R i
avec la plus grande exactitude, & de fiècle en fièc
le , & d'année en année, par les quantités du
travail. D'un fiècle à l'autre le bled eft une meilleure
mefure que l'argent, parce qu'à cette distance
, il approche plus près du point où l'on peut
difpofer de la même quantité de travail. D'une année
a l’autre, c'eft tout le contraire, parce qu'il
en approche moins..
Quoique la diftinCtion du prix réel 8c nominal
puîné etre utile dans rétabhifemént d'une rente
perpétuelle ou dans celui des redevances Stipulées
par un long bail, elle n'eft d'aucun ufage pour
vendre ou acheter dans le cours ordinaire de la
vie.
Dans un temps & un lieu donnés Je prix réel &
le prix nominal de toutes les marchandifes font
en proportion l'un avec l'autre. Par exemple, félon
que vous aurez plus ou moins d'argent d'une
marchandife au marché de Londres, vous pourrez
y acheter ou avoir à votre difpofition plus ou
moins" du travail d'autrui. Ainfi au même temps
& au même endroit donnés, l’argent eft la mefure
exaéte de la valeur échangeable de toutes les
marchandifes J mais il ne l'eft pas autrement.
Quoiqu'à des endroits éloignés de l’ un de l'autre
il n'y ait pas de proportion régulière entre le
prix reel des marchandifes & leur prix eh argent,
le marchand qui tranfporte fes marchandifes d'un
endroit à l'autre , n'a rien à confidérer que les
prix en argent, ou la différence entre la quantité
d argent qu'elles lui coûtent & celle qu'il les
vendra. Il peut fe faire qu'avec une demi-once
d argent, on fe procure'à Canton le double du
travail & le double des befoins 8c des commodités
de la vie qu'on fe procurer©]t à Londres avec
une _once. Une •marehandife qui' fe ,vendroit une
demi-once d'argent à Canton, pourroit y être
ainfi réellement plus chère 8c d'une importance
plus réelle,pour le poffefleur que celle qui fie ven-
droit une once d'argent à Londres ne le feroît:
pour celui qui la pofféderoit. Si cependant un
marchand de Londres peut acheter à Canton pour
une demi-once d'argent une marchandife qu'il revende
enfuite une once d'argent à Londres, il
gagne à ce marché cent pourcent, tout eOmme
fi une once d'argent avoit précifément la même
valeur g Londres qu’à Canton. Il lui eft égal ■
qu'une demi-once d'argent lui eût procuré plus
du travail d'autrui, & une plus grande quantité
des befoins 8c commodités de la vie à Canton ,
- qu’une’once à Londrés pavée une once il aura toujours
à Londres le double de ce qu'il aura avec
une demi-once, 8c voilà ce qu'il lui faut.
C'eft donc le prix nominal des marchandifes,-
ou leur prix en argent, qui décide en dernier ref-
fort de la prudence ou de l'imprudence de toltis
les achats & de toutes les v en te s ,'& qui par- là
règle toutes les affaires de la vie commune, où il
eft queftion de la valeur i 8c il ne faut pas s’ép
R i
tonner fi on y a fait beaucoup plus d attention
qu’au prix réel. - ■ '
Il peut être utile de comparer les differentes
valeurs réelles d'une marchandife' particulière
dans des temps & des lieux différens, ou de voir
les divers degrés de puiffance qu'elles'ont donne
en diverfes occafions à leurs poffelfeurs fur le travail
d'autrui. Les quantités d’argent données
communément pour la marchandife, font moins
à confidérer en ce cas que les quantités de travail
qui pouvoient être achetées avec ces quantités
d'argent. Mais à peine peut on connoitre
avec quelqu'exaélitude les prix courans du travail
à'des temps & à des lieux éloignés. Quoiqu on
n'ai pas tenu rêgiftre de ceux du bled en beaucoup
d'endroits, ils ne laiffent pas d etre généralement
mieux connus, parce que Ieshlftoriens 8c
d'autres écrivains en ont tait mention plus fou
vent. En général il faut donc rious en contenter ,
non qu'ils foierit toujours exactement dans la
même proportion que les prix du travail, mais
parce que communément on n'a pas de meilleure
approximation.
Dans les progrès de l'induftrie les nations commerçantes
ont trouvé qu'il étoit de leur interet
de faire de la monnoie de différens métaux. Elles
ont fait frapper des pièces de monnoie d'or pour
de gros paiemens, d'autres d'argent pour les
achats de médiocre, valeur, 8c d'autres de cuivre
ou de quelqu'autre métal commun pour ceux
d'une valeur inférieure. Cependant elles ont regardé
un de ces métaux comme étant plus particuliérement
la mefure de valeur ; 8c il paroît
qu'elles- ont généralement donné cette préférence
au métal qui leur a fervi d’abord d’inftrument
de commerce, Elles ont continué par habitude
l'ufage quelles en avoient fait par néceflité.
~On dit que les romains n'avoient encore que
de la monnoie de cuivre cinq ans avant la dernière
guerre punique, temps auquel ils firent frapper
de la monnoie d'argent. Aufii le cuivre paroit-
tl avoir toujours confervé dans cette république la
qualité de mefure de valeur. On y-faifoit tous les
comptes, & on y çalculoit la valeur de tous les
biens en as & en fefierces. L’ as y fut toujours
la dénomination d'une monnoie de cuivre : le mot
fefierce fignifie deux as 8c demi. Ainfi , quoique
le fefterce fut toujours une monnoie d’argent,
fa valeur étoit eftimée en cuivre. On difoit à.
Rome de celui qui devoit dë groffes fommes,
cju'il avoit beaucoup de cuivre à autrui.
Il femble que les nations du Nord , qui fè font
établies fur les ruines de l’ empire'romain aient
e u , dès les commencemens de' leur étahliffe-
ment, de la monnoie d’argent, 8c qu'elles ne
•connurent ni celle de l 'o r , ni celle de cuivre’
que plufieurs fiècles après. Il y eut des monnoies
d’argent en Angleterre du temps des faxons
mais il n’y en eut guère en or jufqü’au temps
d’Edouard I I I , 8c point en cuivre jufqu'à celui
P R I 699
de Jacques I. C'eft par cette raifon qu'en Angleterre*
& , à ce que je crois , chez toutes
les nations modernes de l’Europe, les-comptes
font tenus, & la valeur des marchandifes & des
biens énoncée en argent. En Angleterre, quand on
veut exprimer à quoi fe monte la fortune de quelqu’un
, on ne parle guère du nombre de gui-
nées , mais du nombre de livres qu'on en don-
neroit.
Dans'tous.les pays, on n’a pu faire originairement
des offres réelles que dans les efpèces du
feul métal qui étoit confidéré comme mefure de-
valeur. On a frappé des monnoies d’or en Angleterre
, long-temps avant que l’or y fût regardé
comme paiement légal. La proportion entre les
valeurs des monnoies d’or & d’argent n’étoit fixée
par aucune loi ou proclamation publique : on laif-
foit au marché à l ’établir. Si un débiteur offroit
de payer en o r , le créancier pouvoit ou rejetter
le paiement > ou l’ accepter à telle évaluation de
l’or dont ils convenoient èntr’_eux. Aujourd’hui
le cuivre n’eft point une offre légale de paiement,
fi ce n’ eft dans le change dès petites pièces d’argent.
Dans cet état de chofés, la diftinétion
entre le métal, mefure de valeur, 8c celui qui
ne l'étoit pas , étoit quelque chofe de plus qu’une
diftinëtion nominale. '
Par la fuite , le peuple s’ étant familiarifé avec
l’ ufage des différens métaux monnoyés, 8c con-
noiffant mieux leurs valeurs refpeétives , on a jugé,
dans la plupart des pays , qu’ il falloit conftater
cette proportion , 8c déclarer, par une loi ,
qu’ üne guirïée, par exemple, de tel titre & de
tel poids vaudroit vingt-un fehelings, 8c feroit
un paiement le'gal pour une dette de pareille
fomme. Dans cet état de chofes & tant que
fubfifte une proportion réglée de cette nature,
ladiftinëtion entre.le métal, mefure de valeur, &
celui qui ne l’eft pas, n’ eft guère qu’une diftinétion
nominale.
M a is , dès qu’ il arrive quelque changement
dans cette proportion réglée , cette diftin&ion
redevient, du femble au moins redevenir quelque
chofe de plus qu’une diftinftion nominale.
S i , par exemple , là valeur fixée ou réglée d’une
guinée venoit à être réduite à Vingt fehelings, ou
à monter à vingt - deux, tous les comptes &
prefque toutes les obligations pour dette étant
articulées en argent, la plus grande partie des
paiemens pourroit fe faire, comme auparavant,
avec la même quantité d’argent, mais non avec
la même quantité d’or. Il faudroit plus d’or dans
un cas, 8c moins dans l’autre ; l’argent paroî-
tfoit plus invariable que Tor dans fa valeur 5 il
fembleroit que la valeur du premier de ces métaux
mefureroit la valeur du fécond , & non le
fécond la valeur du premier. La valeur de l’or
paroîtroit dépendante de la quantité d’argent
qu’on auroit en échange , & celle de l’argent
indépendante de la quantité d’or qu’on donneroit