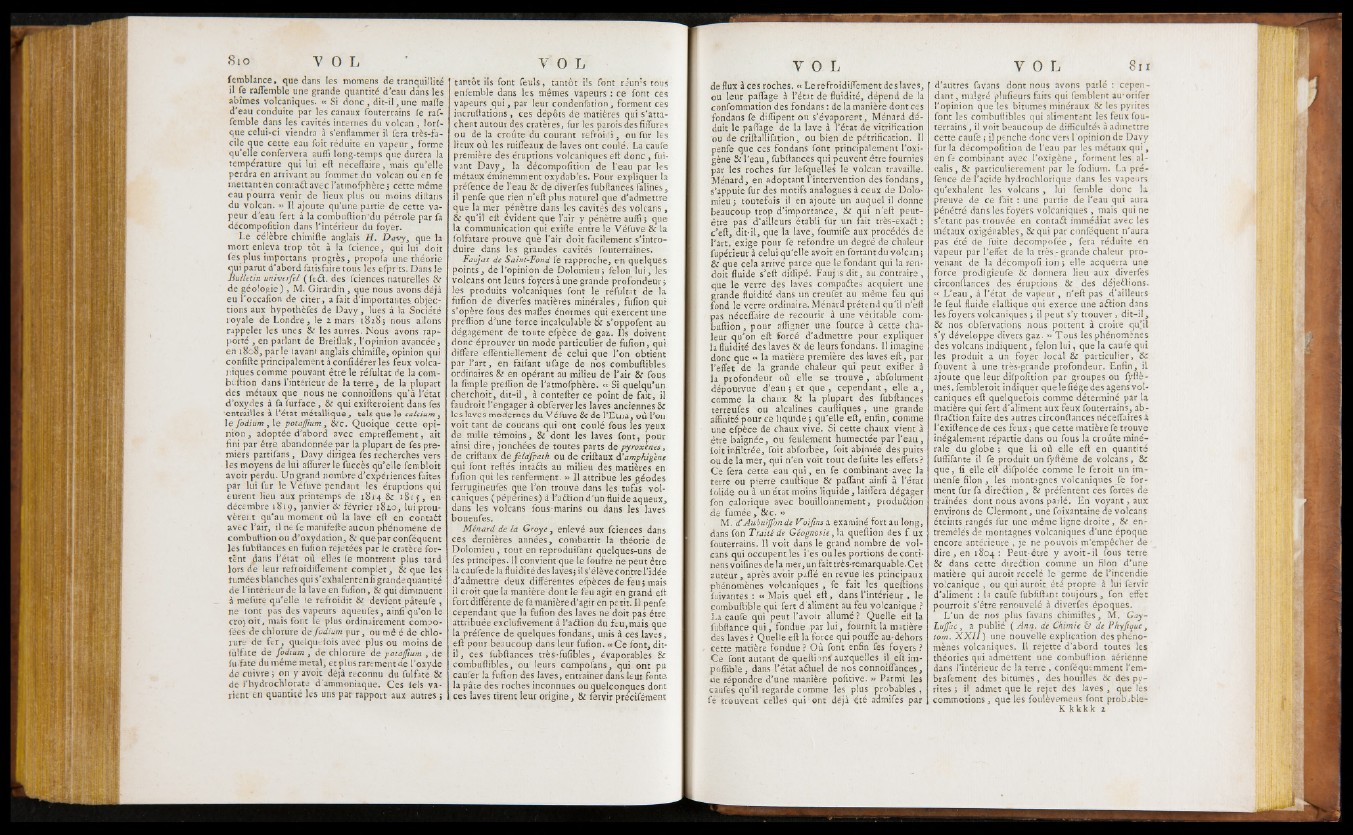
Bio "VOL
femblance, que dans les momens de tranquillité
il fe raffemble une grande quantité d'eau dans les
abîmes volcaniques. « Si donc, dit-il,une maffe
d'eau conduite par les canaux fouterrains Te raffemble
dans les cavités internes du volcan , lor(-
que celui-ci viendra à s’enflammer il fera très-facile
que cette eau foit réduite en vapeur, forme
qu’elle confervera aufli long-temps que durera la
température qui lui eft néceffaire, mais qu’elle
perdra en arrivant au fommet du volcan ou en fe
mettant en conradt avec l’atmofphère 5 cette même
eau pourra venir de lieux plus ou moins diltans
du volcan. » Il ajoute qu’une partie de cette vapeur
d'eau fert à la combuftion'du pétrole par fa
décompofition dans l’intérieur du foyer.
Le célèbre chimifte anglais H . D a v y , que la
mort enleva trop tôt à la fcience, qui lui doit
fes plus importans progrès, propofa une théorie
qui parut d’abord fatisfaire tous les efpfts. Dans le
B u l l e t in u n iv e r f e l ( fe 6t. des fciences naturelles &
de géologie) , M. Girardin, que nous avons déjà
eu l’occafion de citer, a fait d’importantes, objections
aux hypothèfes de Davy, lues à la Société
royale de Londre, le 2 mars 1828; nous allons ,
rappeler les unes & les autres. Nous avons rapporté
, en parlant de Breiflak, l’opinion avancée ,
en 1808, parle lavant anglais chimifte, opinion qui
conftfte principalement à confidérer les feux volcaniques
comme pouvant être le réfultat de la com-
bùftion dans l’intérieur de la terre, de la plupart
des métaux que nous ne corinoiflons qu’à l’état
d’oxydes à fa furface, & qui exifteroient dans fes
entrailles à l’état métallique, tels que le c a l c iu m ,
le f o d iu m y le potaJJium3 &c. Quoique cette opinion,
adoptée d'abord avec empreffement, ait
fini par être abandonnée par la plupart de fes premiers
partifans, Davy dirigea fes recherches vers
les moyens de lui affurer le fuccès qu’elle fembloit
avoir perdu. Un grand nombre d’expériences faites
par lui fur le Véfuve pendant les éruptions qui
eurent lieu aux printemps de 181-4 & 18 x y, en
décembre 1819, janvier & février 1820, lui prouvèrent
qu’au moment où la lave eft en contaèl
avec l’air, il ne fe manifefte aucun phénomène de
combuftion ou d’oxydation, & que par conféquent
les fubftances en fufion rejetées par le cratère for-
tênt jjans l’état où elles fe montrent plus tard
lors de leur refroidiffement complet, & que les
tumées blanches qui s’exhalenten lï gran de quanti té
de l’intérieur de la lave en fufion, & qui diminuent
à mefure qu’elle (e refroidit & devient pâteufe ,
ne lont pas des vapeurs aqueufes, ainfi qu’on le
c'ro)oit, mais font le plus ordinairement compo-
fées de chlorure d e f o d iu m pur, ou mê é de chlorure
de fer, quelquefois avec plus ou moins de
iulfate de f o d iu m , de chlorure de p o ia jftum , de
fu.fate du même métal, et plus rarement de l’oxyde
de cuivre } on y avoit déjà reconnu du fulfate &
de l’hydrochlorate d'ammoniaque. Ces fels varient
en quantité les uns par rapport aux autres }
V O L
tantôt ils font feuls, tantôt ils font réunis tous
enfemble dans l.es mêmes vapeurs : ce font ces
vapeurs qui, par leur condenfation, forment ces
incruftations, ces dépôts de matières qui s’attachent
autour des cratères, fur les parois des fiiTures
ou de la croûte du courant refroidi, ou fur les
lieux où les ruiffeaux de laves ont coulé. La caufe
première des éruptions volcaniques eft donc, fui-
vant Davy, la décompofition de l'eau par les
métaux éminemment oxydables. Pour expliquer la
j préfence de l’eau & de diverfes fubftances falines,
; il penfe que rien n’eft plus naturel que d’admettre
: que la mer pénètre dans les cavités des volcans ,
& qu’il eft évident que l’air y pénètre aufli j que
la communication qui exifte entre le Véfuve & la
folfatare prouve que l’air doit facilement s’introduire
dans les grandes cavités fouterrâines^
F a u ja s d e S a in t - F o n d fe rapproche, en quelques
points, de l’opinion de Dolomieu j félon lui, les
volcans ont leurs foyers à une grande profondeur >
les produits volcaniques font le réfultat de la
fufion de diverfes matières minérales, fufion qui
s’opère fous des mafles énormes qui exercent une
preffion d’une force incalculable & s’oppofent au
dégagement de toute efpèce de gaz. Ils doivent
donc éprouver un mode particulier de fufion, qui
diffère effentiellement de celui que l’on obtient
par l’art, en faifant ufage de nos combuftibles
ordinaires & en opérant au milieu de l’air & fous
la fimple preflïon de l’atmofphère. « Si quelqu’un
cherchoit, dit-il, à contefter ce point de fait, il
faudroit l’engager à obferverles laves anciennes &
les laves modernes du Véfuve & de l’Etna, où l’on
voit tant de courans qui ont coulé fous les yeux
de mille témoins, & dont les laves font, pour
ainsi dire , jonchées de toutes parts de p y r o x é n e s ,
de criftaux de f e ld f p a t h ou de criftaux d iam p h ig en e
qui font reftés intaéls au milieu des,matières en
fufion qui les renferment, »a II attribué les géodes
ferrugineufes que l’on trouve dans les tufas volcaniques
(pépérines) à l’a&ion d'un fluide aqueux,
dans les volcans fous-marins ou dans les laves
boueufés.
M é n a r d d e La G r o y e , enlevé aux fciences dans
ces dernières années, combattit la théorie de
Dolomieu, tout en reproduisant quelques-uns de
fes principes. 11 convient que le foufre ne peut être
la caufe de la fluidité des laves j il s’élève contre l’idée
d’admettre deux différentes efpèces de feu > mais
il croit que la manière dont le feii agit en grand eft
fort différente de fa manièred’agir en petit. Il penfe
cependant que la fufion des laves ne doit pas être
attribuée exclufivement à î’adion du feu, mais que
la préfence de quelques fondans, unis à ces laves,
eft pour beaucoup dans leur fufion. «Ce font, dit-
il, ces fubftances très-fufibles, évaporables &
combuftibles, ou leurs compofans, qui ont pu
caufer la fufion des laves, entraîner dans leur fonte
la pâte des roches inconnues ou quelconques dont
ces laves tirent leur origine , & fervir précifément
V O L V O L 8 1 1
de flux à ces roches. « Le refroidilïèment des laves,
ou leur paffage à l’état de fluidité, dépend de la
confommation des fondans : de la manière dont ces
fondans fe diflipent ou s’évaporent, Ménard déduit
le paffage de la lave à l’état de vitrification
ou de criftallifation, ou bien de pétrification. Il
penfe que ces fondans font principalement l’oxi-
gène & l’eau, fubftances qui peuvent être fournies
par les roches fur lefquelles le volcan travaille.
Ménard, en adoptant l'intervention des fondans,
s'appuie fur des motifs analogues à ceux de Dolomieu
5 toutefois il en ajoute un auquel il donne
beaucoup trop d’importance, & qui n'eft peut-
être pas d’ailleurs établi fur un fait très-exaèl :
c’eft, dit-il, que la lave, foumife aux procédés de
l’art, exige pour fe refondre un degré de chaleur
fupérieur à celui qu’elle avoit en fortant du volcan ;
& que cela arrive parce que le fondant qui la ren-
doit fluide s’eft diflipé. Fauj îs dit, au contraire ,
que le verre dçs laves compactes acquiert une
grande fluidité dans un creufet au même feu qui
fond le verre ordinaire. Ménard prétend qu'il n’eft
pas néceffaire de recourir à une véritable combuftion,
pour afligner une fource à cette chaleur
qu’on eft forcé d’admettre pour expliquer
la fluidité des laves & de leurs fondans. 11 imagine
donc que « la matière première des laves eft, par
l’effet de la grande chaleur qui peut exifter à
la profondeur où elle se trouve , abfolument
dépourvue d’eau j et que , cependant, elle a,
comme la chaux & la plupart des fubftances
terreufes ou alcalines cauftiques, une grande
affinité pour ce liquide î qu’elle eft, enfin, comme
une efpèce de chaux vive. Si cette chaux vient à
être baignée, ou feulement humectée par l’eau,
ioit infiltrée, foit abforbée, foit abîmée des puits
ou de la mer, qui n’en voit tout de fuite les effets ?
Ce fera cette eau qui, en fe combinant avec la
terre ou pierre cauftique & paffant ainfi à l’état
folide ou à un état moins liquide, laiffera dégager
fon calorique avec bouillonnement, production
de fumée, &c. »9
M. c C A u b u f f o n d e V o i j i n s u examiné fort au long,
dans fon T r a i t é d e G é o g n o s i e , la queftion des f. ux
fouterrains. Il voit dans le grand nombre de volcans
qui occupent les îes ouïes portions deconti-
nens voifînes de la mer, un fait très-remarquable.Cet
auteur, après avoir paffé en revue les principaux
phénomènes volcaniques , fe fait les queftions
fuivantes : « Mais quel eft, dans l’intérieur , le
çombuftible qui fert d 'aliment au feu volcanique ?
La caufe qui peut l’avoir allumé? Quelle eft .la
fubftance qui, fondue par lui, fournit la matière
des laves ? Quelle eft la force qui pouffe au-dehors
cette matière fondue ? Où font enfin fes foyers ?
Ce font autant de queftion^ auxquelles il eft im-
poflible, dans l’état aCtuel de nos connoiffances,
oe répondre d’une manière pofitive. » Parmi les
caufes qu’il regarde comme les plus probables,
fé trouvent celles qui ont déjà été admifes par
d’autres fa vans dont nous avons parlé : cependant,
malgré plufieurs faits qui femblent au-orifer
l’opinion que les bitumes minéraux & les pyrites
font les combuftibles qui alimentent les feux fouterrains
, il voit beaucoup de difficultés à admettre
cette caufe ; il penche donc vers l ’opinion de Davy
fur la décompofition de l’eau par les métaux qui,
en fe combinant avec l’oxigène, forment les alcalis,
& particulièrement par le fodium. La préfence
de l’acide hydrochlorique dans les vapeurs
qu’exhalent les volcans, lui femble donc la
preuve de ce fait : une partie de l’eau qui aura
pénétré dans les foyers volcaniques , mais qui ne
s’étant pas trouvée en contaél immédiat avec les
métaux oxigénables, &qui par conféquent n’aura
pas été de fuite décompofée, fera réduite en
vapeur par l’effet de la très-grande chaleur provenant
de la décompofi.ion 5 elle acquerra une
force prodigieufe & donnera lieu aux diverfes
circonuances des éruptions & des déjeèlions.
« L’eau, à l’état de vapeur, n’eft pas d’ailleurs
le feul fluide elaftique qui exerce une aétion dans
les foyers volcaniques > il peut s’y trouver, dit-il,
& nos obfervatîons nous portent à croire qu’il
s’y développe divers gaz. » Tous les phénomènes
des volcans indiquent, félon lui, que la caufe qui
les produit a un foyer local & particulier, &
fouvent à une très-grande profondeur. Enfin, il
ajoute que leur difpofition par groupes ou fyftè-
mes, fembleroit indiquer que le fiége des agens volcaniques
eft quelquefois comme déterminé par la
matière qui fert d’aliment aux feux fouterrains, ab-
ftra&ion faite des autres circonftances néceffaires à
l’exiftence de ces feux > que cette matière fe trouve
inégalement répartie dans ou fous la croûte minérale
du globe j que là où elle eft en quantité
fuffifante il fe produit un fyftëme de volcans, &
que, fi elle eft difpofée comme le feroit un im-
menfe filon , les montagnes volcaniques fe forment
fur fa direction, & préfentent ces fortes de
traînées dont nous avons parlé. En voyant, aux
environs de Clermont, une foixantaine de volcans
éteints rangés fur une même ligne droite, & entremêlés
de montagnes volcaniques d’une époque
encore antérieure , je ne pouvois m’empêcher de
dire, en 1804: Peut-être y avoit-il fous terre
& dans cette direction comme un filon d’une
matière qui auroit recelé le germe de l’incendie
volcanique , ou qui auroit été propre à lui fervir
d’aliment : la caufe fubfiftant toujours, fon effet
pourroit s’être renouvelé à diverfes époques.
L’un de nos plus favans chimiftes, M. G a y -
L u j f a c , a publié ( A n n . d e C h im ie & de P k y f iq u e ,
tom . X X I I ) une nouvelle explication des phénomènes
volcaniques. Il rejette d’abord toutes les
théories qui admettent une combuftion aérienne
dans l’intérieur de la terre , conféquemment l’em-
brafement des bitumes, des houilles & des pyrites
j il admet que le rejet des laves, que les
commotions, que les foulèveméus font probable-
K k k k k 2