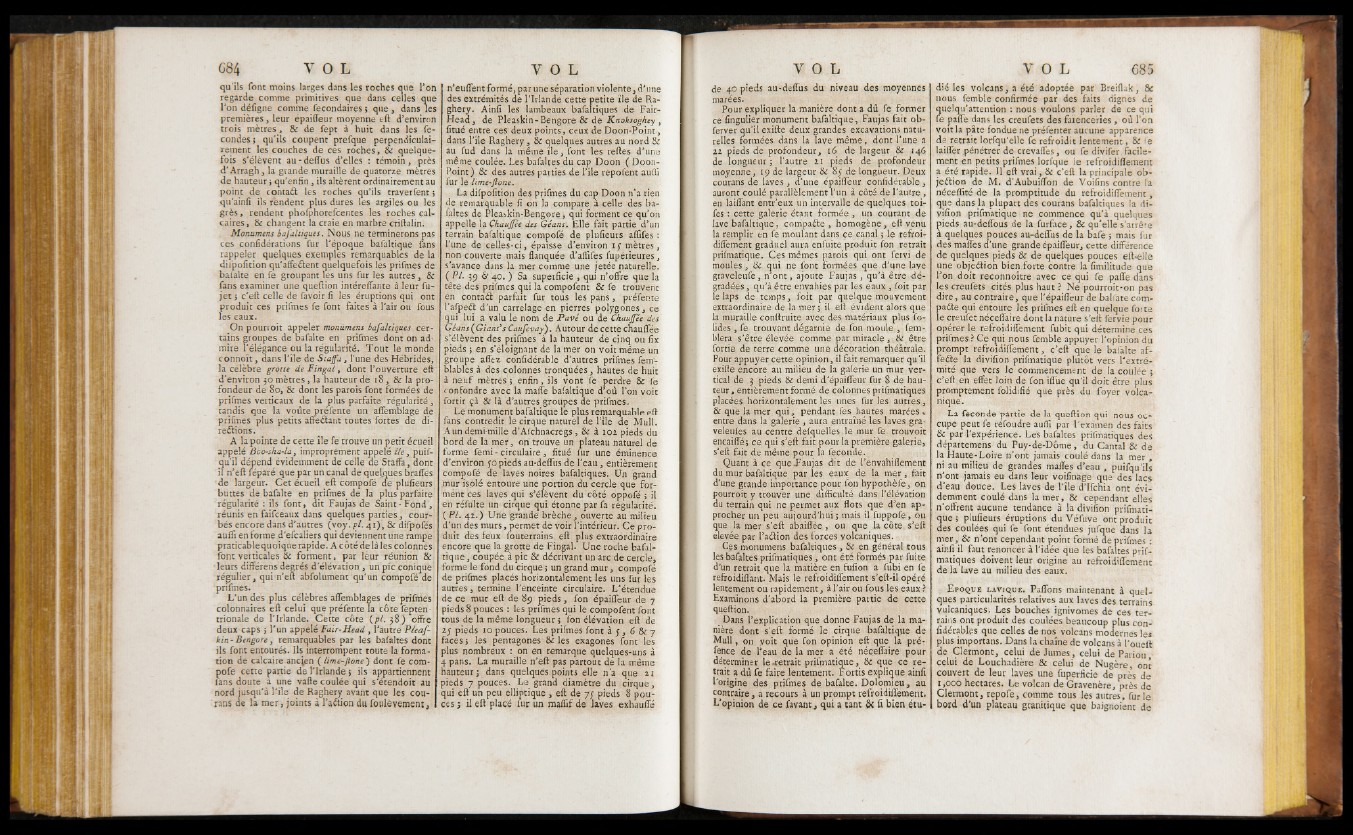
qu'ils font moins larges dans les roches que Ton
regarde comme primitives que dans celles que
Ton défigne comme fecondaires ; q ue , dans les
premières , leur épaiffeur moyenne eft d’environ
trois mètres, & de fept à huit dans les fécondés?
qu’ils coupent prefque perpendiculairement
les couches de ces roches, & quelquefois
s’élèvent au-deffus d’elles : témoin, près
d’Arragh, la grande muraille de quatorze mètres
de hauteur ? qu’enfin, ils altèrent ordinairement au
point de contaél les roches qu’ ils traverfent ?
qu’ainfi ils rendent plus dures les argiles ou les
grè s , rendent phofphorefcentes les roches calcaires
, & changent la craie en marbre criftalin.
Monumens bajaltiqu.es. Nous ne terminerons pas
ces çonfidérations fur l’ époque bafaltique fans
rappeler quelques exemples remarquables d e là
difpofition qu’affettent quelquefois les prifmes de
balalte en fe groupant les uns fur les autres , &
fans examiner une queftion intéreffante à leur fu-
je t ? c’eft celle de favoir lî les éruptions qui ont
produit ces prifmes fe font faites à l’air ou fous
les eaux.
On pourroit appeler monumens bafaltiques certains
groupes de bafalte en prifmes dont on admire
l ’élégance ou la régularité. Tout le monde
connoît, dans l’île de Staffa, l’une des Hébrides, ,
la célèbre grotte de Fingat, dont l’ouverture eft !
d’environ 30mètres, la hauteur de 18 , & la pro- I
fondeur de 80, & dont les parois font formées de
prifmes verticaux de la plus parfaite régularité,
tandis que la voûte préfente un affemblage de
prifmes plus petits affe&ant toutes fortes de directions.
A la pointe de cette île fe trouve un petit écueil
appelé Bbà-sha-la, improprement appelé île 3 puif-;
qu’il dépend évidemment de celle He Staffà, dont
il n’eft féparé que par un canal de quelques braffes
de largeur. C e t écueil eft compofé de plufieurs
buttes de bafalte en prifmes de la plus parfaite
régularité : ils font, ait Faujas de Saint-Fond,
réunis en faifceaux dans quelques parties, courbés
encore dans d’ autres (voy. pl. 41) , & difpofés
aufli en forme d’efcaliers qui deviennent une rampe:
praticablequoique rapide. A côté de là les colonnes
font verticales & forment, par leur réunion &
leurs différens degrés d’élévation , un pic conique
régulier, qui n’eft abfolument qu’un compofé de
prifmes.
L ’ un des plus célèbres affemblages de prifmes
colonnaires eft celui que préfente la côte fepten-
trionale de l’ Irlande. Cette côte ( pl. 38) offre
deux caps ? l’ un appelé Fair-Head, l’autre Pleaf-
kin-Bcngore, remarquables par les bafaltes dont
ils font entourés. Ils interrompent toute la formation
de calcaire ancien ( lime-ftone) dont fe com-
pofe cette partie de l’ Irlande 5 ils appartiennent
fans doute à une vafte coulée qui s’étendoit au
nord jusqu’ à l’île de Raghery avant que les courans
de la mer, joints à TaCtion du foulèvement,
n’euffent formé, par une séparation violente, d’ une
des extrémités de l ’Irlande cette petite île de Raghery.
Ainfi les lambeaux bafaltiques de Fair-
Head , de Pleaskin-Bengore & de Knoksoghey ,
lïtué entre ces deux points, ceux de Doon-Point,
dans l’île Raghery, & quelques autres au nord &
au fud dans la même î l e , font les reftes d’ une
même coulée. Les bafaltes du cap Doon ( Doon-
Point ) & des autres parties de l’île repoient auflï
fur le lime-ftone.
La difpofition des prifmes du cap Doon n’ a rien
de remarquable fi on la compare a celle des bafaltes
de Pleaskin-Bengore , qui forment ce qu’on
appelle la Chauffée des Géans. Elle fait partie d’un
terrain bafaltique compofé de plufieurs affifes :
■ l[une de celles-ci, épaisse d’environ iy mètres,
non couverte mais flanquée d’aflifes fupérieures,
s’avance dans la mer comme une jetée naturelle.
( Pl. 39 & 40. ) Sa superficie , qui n’ offre que la
tête des prifmes qui la compofent & fe trouvent
en contaél parfait fur tous les pans, préfente
l’afpeâ: d ’un carrelage en pierres polygones, ce
qui lui a valu le nom de Pavé ou de Chauffée des
Géans (Giant*s Caufevay) . Autour de cette chauffée
s’élèvent des prifmes à la hauteur de cinq ou fix
pieds ? en s’éloignant de la mer on voit même un
groupe affez confidérable d’autres prifmes fem-
blables à des colonnes tronquées , hautes de huit
à neuf mètres? enfin, ils vont fe perdre & fe
confondre avec la maffe bafaltique d’ où l’on voit
fortir ça & là d’autres groupes de prifmes.
Le monument bafaltique le plus remarquable eft
fans contredit le cirque naturel de l’île de Mull.
A un demi-miile d’Alchnacregs, & à 101 pieds du
bord de la mer, on trouve un plateau naturel de
forme femi- circulaire, fitué fur une éminence
d’environ yo pieds au-deffus de l’eau, entièrement
compofé de laves noires bafaltiques. Un grand
mur isolé entoure une portion du cercle que forment
ces laves qui s’élèvent du côté oppofé ? il
en réfûlte un cirque qui étonne par fa régularité.
( PL 42.) Une grande brèche, ouverte au milieu
d’un des murs, permet de voir l’ intérieur. C e produit
des feux fouterrains eft plus extraordinaire
encore que la grotte de Fingal. Une roche bafaltique,
coupée à pic & décrivant un arc de cercle,
forme le fond du cirque 3 un grand mur, compofé
de prifmes placés horizontalement les uns fur les
autres, termine l’enceinte circulaire. L’étendue
de ce mur eft de 89 p ied s , fon épaiffeur de 7
pieds 8 pouces : les prifmes qui le compofent font
tous de la même longueur ? fon élévation eft de
25 pieds 10 pouces. Les prifmes font à y , 6 & 7
faces? les pentagones & les exagones font les
plus nombreux : on en remarque quelques-uns à
4 pans. La muraille n’ eft pas partout de la même
hauteur 3 dans quelques points elle n’a que i l
pieds 7 pouces. Le grand diamètre du cirque,
qui eft un peu elliptique, eft de 75 pieds 8 pouces
3 il eft placé fur un maffif de laves exhauffé
de 40 pieds au-deffus du niveau des moyennes
marées.
Pour expliquer la manière dont a dû fe former
ce fingulier monument bafaltique,,Faujas fait ob-
ferver qu’ il ex.ifte deux grandes excavations naturelles
formées dans la lave même, dont l’une a
22 pieds de profondeur, 16 de largeur & 146
de longueur 3 l’autre 21 pieds de profondeur
moyenne, 19 de largeur & 8 y de longueur. Deux
courans de la v e s , d’une épaiffeur confidérable,
auront coulé parallèlement l’un à côté de l’auire,
en laiffant entr’eux un intervalle de quelques toi-
fes : cette galerie étant formée, un courant de
lave bafaltique, compacte, homogène, eft venu
la remplir en fe moulant dans ce canal ? le refroi-
diffement graduel aura enfuite produit fon retrait
prifmatique. Ces mêmes parois qui ont fervi de
moules, & qui ne font formées que d’une lave
graveleufe, n’ o n t, ajoute Faujas , qu’ à être dégradées
, qu’à être envahies par les eaux, foit par
le laps de temps, foit par quelque mouvement
extraordinaire de la mer 3 il eft évident alors que
la muraille conftruite avec des matériaux plus .foliées
, fe trouvant dégarnie de fon moule , Comblera
s’être élevée comme par miracle, & être
fortie de terre comme une décoration théâtrale.
Pour appuyer cette opinion, il fait remarquer qu’il
exifle encore au milieu de la galerie un mur vertical
de 3 pieds & demi d ’épaiffeur fur 8 de hauteur,
entièrement formé de colonnes prifmatiques
placées horizontalement les unes fur les autres.,
& que la mer q u i, pendant fes hautes marées,
entre dans la galerie, aura entraîné les laves gra-
veleules au centre defquelles,le mur fe. trouvoit
encaiffé? ce qui s’eft fait pour la première galerie,
s’eft fait de même pour la fécondé..
Quant à ce que .Faujas dit de l’envahiflement
du mur bafaltique. par les eaux de la mer, fait
d’une grande importance pour fon hypothèfe, on
pourroit y trouver une difficulté dans l’élévation
du terrain qui ne permet aux flots que d’en approcher
un peu aujourd'hui 3.mais il fuppofe, ou
que la mer s’eft abaiffée , ou que la côte s’eft
élevée par l’aétion des forces volcaniques.
Ces monumens bafaltiques , & en général tous
les bafaltes prifmatiques, ont été formés par fuite
d'un retrait que la matière en fufion a fubi en fe
refroidiffant. Mais le refroidiffement s’eft-il opéré
lentement ou rapidement, à l’ air ou fous les eaux ?
Examinons d’abord la première partie de cette
queftion.
Dans l’explication que donne Faujas de la manière
dont s’eft formé le cirque bafaltique de
Mull, on .voit que fon opinion eft que la pré-
fence de l’eau de la mer a été néceffaire pour
déterminer le .retrait prifmatique, & que ce retrait
a dû fe faire lentement. Fortis explique ainfi
l’origine des prifmes de bafalte. Dolomieu, au
contraire, a recours à un prompt refroidiffement.
L’opinion de ce f a v a n t, qui a ta n t & fi bien é tu -
dié les volcans, a été adoptée par Breiflak, &
nous femble confirmée par des faits dignes de
quelqu’ attention : nous voulons parler de ce qui
fe paffe dans les creufets des faïenceries, où l’on
voit la pâte fondue ne préfenter aucune apparence
de retrait lorfqu’elle fe refroidit lentement, & le
laiffer pénétrer de crevaffes, ou fe divifer facilement
en petits prifmes lorfque le refroidiffement
a été rapide. Il eft v ra i, & c ’eft la principale objection
de M. d’Aubuiffon de Voifins contre la
néceflîté de la promptitude du refroidiffement,
que dans la plupart des courans bafaltiques la di-
vifîon prifmatique ne commence qu’à quelques
pieds au-deffous de la furface, & qu’ elle s'arrête
à quelques pouces au-deffus de la bafe ? mais fur
des maffes d’une grande épaiffeur, cette différence
de quelques pieds & de quelques pouces eft-elle
une objeCtion bien forte contre la fimilitude que
l’on doit reconnoître avec ce qui fe paffe dans
les creufets cités plus haut ? Ne pourroit-on pas
dire, au contraire, que l’épaiffeur de balfate compacte
qui entoure les prifmes eft en quelque foi te
le creufet néceffaire dont la nature s’eft fervie pour
opérer le refroidiffement fubit qui détermine ces
prifmes? Ce qui nous femble appuyer l’opinion du
prompt refroidiffement, c’eft que le bafalte af-
feCte la divifîon prifmatique plutôt vers l’ extrémité
que vers le commencement de la coulée ?
c’ eft en effet loin de fon iffue qu’il doit être plus
promptement folidifié que près du foyer volcanique.
La fécondé partie de la queftion qui nous occupe
peut fe réfoudre auflï par l'examen des faits
& par l’expérience. Les bafaltes prifmatiques des
départemens du Puy-de-Dôme, du Cantal & de
la Haute-Loire n’ont jamais coulé dans la mer ,
ni au milieu de grandes maffes d’eau , puifqu'ils
n’ ont jamais eu dans leur voifinage que des lacs
d’eau douce. Les laves de l ’île d’Ifchia ont évidemment
coulé dans la mer, & cependant elles
n’offrent aucune tendance à la divifion prifmatique
? plufieurs éruptions du Véfuve ont produit
des coulées qui fe font étendues jufque dans la
nier, & n’ont cependant point formé de prifmes :
ainfi il faut renoncer à l’idée que les bafaltes prifmatiques
doivent leur origine au refroidiffement
de la lave au milieu des eaux.
Epoque lavique. Paffons maintenant à quelques
particularités relatives aux laves des terrains
vulcaniques. Les bouches ignivomes de ces terrains
ont produit des coulées beaucoup plus con-
fidérables que celles de nos volcans modernes les
plus importans. Dans la chaîne de volcans à l’oueft
de Clermont, celui de Jumes, celui de Pariou
celui de Louchadière & celui de Nugère, ont
couvert de leur laves une fuperficie de près de
1,000 hectares. Le volcan de Gravenère, près de
Clermont, repofe, comme tous les autres, furie
bord d’un plateau granitique que baignoient de