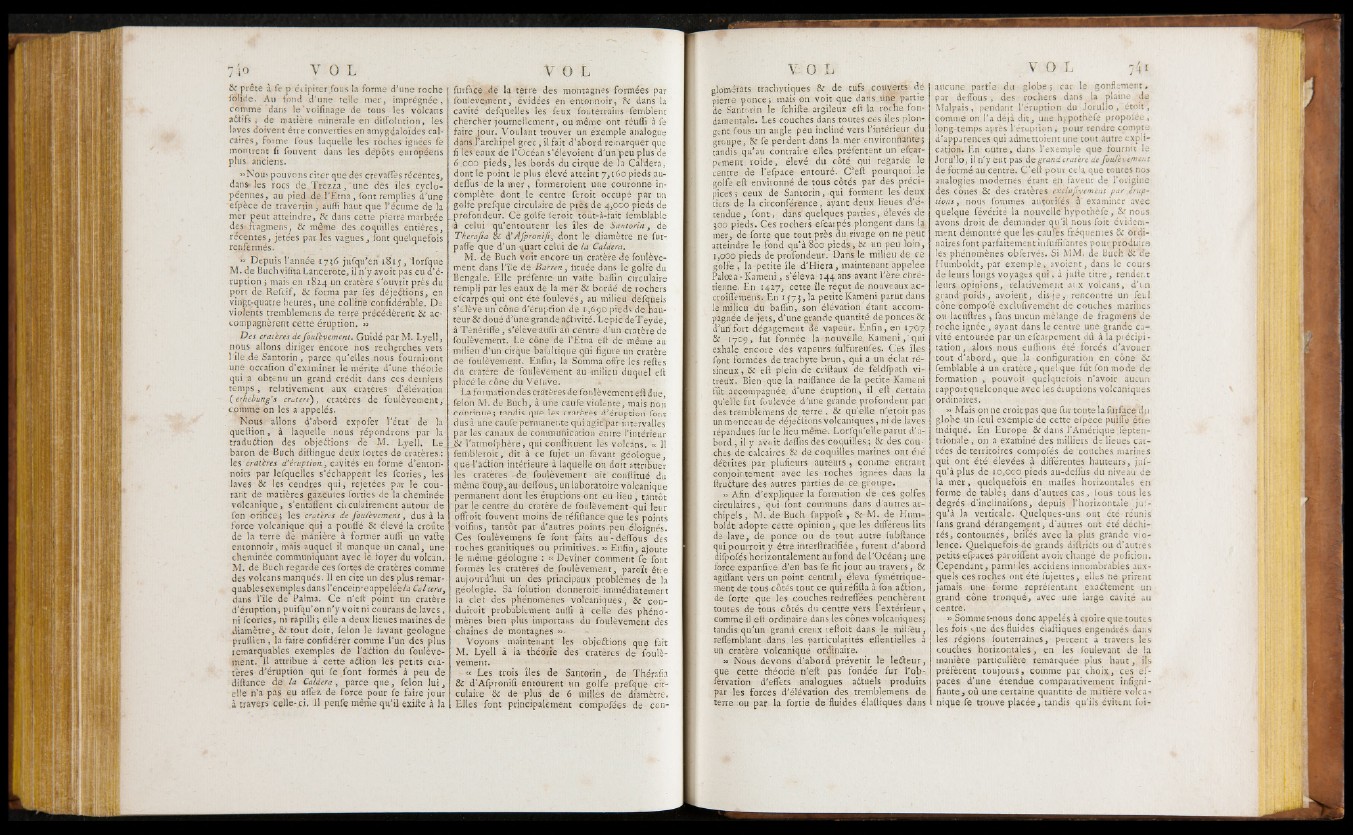
& prête à fe p é c ip i ter.fous la forme d’une roche
folide. Au fond d’une telle mer, imprégnée,
comme'dans le'voifinage de tous les volcans
aôtifs / de matière minérale en dilfolution, les
laves doivent être converties en amygffaloïdes calcaires,
foi me fous laquelle les roches ignées fe
montrent fi fouvent dans les dépôts européens
plus anciens.
»»Nous pouvons citer que des crevaffes récentes,
dans» les rocs d e . T re z za, " une des îles cyclo-
péennes, au pied de l ’Etna, font remplies d’une
efpèce de travertin, atiflî haut que l’écume de la
mer peut atteindre, & dans cette pierre marbrée
des rragmens, & même des coquilles entières,
rëcèntes, jetées par les vagues, font quelquefois ;
renfermés.
iy Depuis l’année 1756 jufqu’en 181 y , lorfque
M. de Buchvilita Lancerote, il 11’ya voit pas eu d’é - .
ruption ; mais en 1824 un cratère s’ouvrit près du
port de Refcif, & forma par fes .déje&ions, en
vinvgt;quatre heures, une colline confidérable. De
violents tremblemens de terre précédèrent & accompagnèrent
cette éruption.' »
Des cratères de foulèvement. Guidé par M. Lyell,
nous allons diriger encore nos recherches vers
l ile.de Santorin, parce qu’ elles nous fourniront
une occalion d’examiner le mérite d’une théorie
qui a obtenu un grand crédit dans ces derniers
temps, relativement aux cratères- d.'élévation:
( erhebung’s cratere), cratères de foulé veinent,*.,
cpmme on les a appelés.
Nous allons d’ abord expofer l’état de la
queftion, à laquelle .nous répondrons par la
traduction des objections de M. Lyell. jÉfjj
baron de Buch diftingue deux fortes de cratères.:
les cratères d‘éruption, cavités en forme d’énton-
noirs par lefquelles s’échappent lè's fcories, les ■
laves & les cendres qui, rejetées par le courant
de matières gazeules forties de la cheminée
volcanique, s’entaffent ciiculairement autour de
fon orifice j les cratères de foulevement, dus'à la
force volcanique qui a pouffé & élevé la croûte
de la terre de manière à former auffi un vafte
entonnoir, mais auquel il manque un canal, une-
cheminée communiquant avec le foyer du volcan.-
M. de Buch regarde ces fortes de cratères comme
des volcans manqués. Il en cite un des plus remarquables
exemples dans l’enceime appelée/a Cü/iera,
dans l’île de Palma. C e n’ eft point un cratère
d’éruption; puifqu’ on n’ y voit ni coutansde laves,
ni fcories, ni rapilli; elle a deux lieues marines de-
diamètre, & tout doit, félon le lavant géologue
pruflien, la faire confidérer comme l’un des plus
remarquables exemples de l ’aCtion du foulèvement.
Il attribue à cette a&ion les petits cia-
tères d’éruption qui fe font formés à peu de.
diftance de la Caldera, parce que, félon lu i,
elle n’a pas eu affez de force pour fe faire jour
à travers celle-ci. 11 penfe même qu’ il exifte à la
fur face ...de la terre des montagnes formées par
foulèvement, évadées en entonnoir , te dans la
cavité defquelîes les feux ' fouterrains femblenc
chercher journellement, ou même ont réufli à fe
faire jour. Voulant trouver un exemple analogue
dans l’ archipel grec, il fait d’abord remarquer que
fi lés eaux de l’Océan s’élevoient d’un peu plus de
6,006 pieds, les bords du cirque de la Caldera,
dont le point le plus élevé atteint 7,160 pieds au-
deffus de la m e r , formeroient une couronne in-
cômplète dont, le centre feroit occupé par un
golfe prefque circulaire dè près de 4,000 pieds de
.profondeur. Cè golfe feroit tout-à-fait femblable
à celui qu’ éntourenr les îles de Santorin, de
Therafea & à‘Afpronifi> dont le diamètre ne fur-
paffe que d’un quart celui de la Caldera.
M. de Buch voit encore un cratère de foulèvement
dans l’île de Barren i iituée dans le golfe du
Bengale.-Elle préfente un vafte baflîn circulaire
rempli par les eaux de la mer & bordé de rochers
efcarpés qui ont été foulevés, au milieu defque.ls
s’élève un cône d’éruption de £,690 pieds de^hau-
teur & doué d’une grande activité. Lepic deTeyde,
à Tenériffe, s’élève auflî au centre d’un cratère de
foulevement. Le cône de l’Etna e'ft de même au
milieu d’un cirque bafalciq.ue qïti figure un cratère
de foulèvement. Enfin', la Somma offre les reftes
du cratère de foulèvement au milieu duquel eft
placé le cône du Véfuve.
La foi mation des cratères de foulèvement eft due,
félon M. de Buch, à une caufe violente, mais non
continue j tandis que les cratères d’ éruption font
dus à une caufe permanente quiagitîpar intervalles
par les canaux de communication entre l’intérieur
Jk l’atmofphère, qui conftituent lés volcans. « Il
fembleroit, dit à ce fujet un favant géologue,
que l’aCtion intérieure à laquelle on doit attribuer
les cratères-de foulèvement ait conftitué du
même îfoup, au deffous, un laboratoire volcanique
permanent dont les éruptions ont eu -lieu 3 tantôt
par le centre du cratère de foulèvement qui leur
offroit fouvent moins de réfiftance que les points
voifins, tantôt par d’ autres points peu éloignés.
Ces foulèvemens fe font faits au-deffous des
roches granitiques ou primitives. » Enfin, ajoute
lè même géologue : « Deviner comment fe font
formés les cratères de^foulèvement, paroît êfre
aujourd’hui un des principaux problèmes de la
géologie. Sa lolütion donneroit immédiatement
la clef des phénomènes volcaniques, & conduiront
probablement auflî à celle des phénomènes
bien plus importans du foulèvement des
chaînes de montagnes ».
Voyons maintenant les obje&ions que fait
M. Lyell à la théorie des cratères de foulèvement.
-
« Les trois îles de Santorin, de Thérafia
& d’Afpronifi entourent un golfe prefque circulaire
& de plus de 6 milles de diamètre.
Elles font principalement compofées de .ccnglohiéràts
trachytiques &r de tufs couverts dè
pierre ponce;..mais ôn voit que daris.une partie
de Santorin le fehifte. argileux eft la roche fondamentale.
Les couches dans toutes ces îles plongent
fous-un angle peu incliné vers l’intérieur du
groupe, & fe perdent dans la mer environnante;
tandis qu’au contraire elles préfentent un efcar-
ponent roide, élevé du côte qui regarde le
centre de l’efpace entouré. C ’ eft pourquoi, le
golfe eft environné de tous côtés par des précipices;
ceux de Santorin,-qui forment les deux
tiers de la circonférence, ayant deux lieues d’é tendue,
fon t, dans quelques parties, élevés de
300 pieds. Ces rochers efcarpés plongent dans la
mer, de forte que tout près du rivage on ne peut
atteindre le fond qu’ à 800 pieds, te un peu loin,
1,000 pieds de profondeur. Dans le milieu de ee
golfe , la-petite île d’Hiera, maintenant appelée
Paloea-Kameni, s’éleva 144 ans avant l’èrechré-
tienne. En 1427, cette île reçut dè nouveaux ac-
croiffemens. En 15-73, la petite Kameni parut dans
le milieu du baflin, son élévation étant accompagnée
de jets, d’une grande quantité de ponces &
d’ un fort dégagement dé vapeur. Enfin, en 1707-^
& 1709, fut formée la nouvelle. Kameni, ' qui
exhale, encore des vapeurs lulfureufes. Cés îles
font formées dé trachyte brun, qui a un éclat résineux,.^
eft plein de criftaux de fêldfpath vitreux.
Bien que la naiffance de la petite Kameni
fût accompagnée, d’ une éruption., il eft certain
qu’elle fut fouievée d’une grande profondeur par
des tremblemens de terre, & quelle n’étoit pas
un monceau de déjeétions volcaniques, ni de laves
répandues fur le lieu même. Lorfqu’elle parut d’abord
, il y avoit deffus des coquilles.; 1k des couches
de calcaires & de coquilles marines ont été
décrites par plufieurs auteurs, comme entrant
conjointement avec les roches ignées dans la
ftruêture des autres parties de ce groupe.
« Afin d’expliquer la formation de ces golfes
circulaires, qui font communs dans d'autres archipels,
M. de Buch fuppofe , &-M. de Hum-
bojdt adopte cette opinion, que les différens lits
de dave, de ponce ou de tout autre fubftance
qui pourroit y être interftratifiée, furent d’abord
difpofés horizontalement au fond de l'Océan ; une
force expanfive d’en bas fe fit jour au travers, &
agiffant vers un point central, éleva fymétrique-
ment de tous côtés tout ce quiréfifta à fon adtion,
de forte que les couches redreflées penchèrent
toutes de tous côtés, du centre vers l’extérieur,
comme il eft ordinaire dans les cônes volcaniques;
tandis qu’un grand creux reftoit dans le milfeu,
reflemblant dans les particularités effentielles à
un cratère volcanique ordinaire.
» Nous devons d’abord prévenir le le&eur,
que cette théorie n’eft pas fondée fur l’ ob-
fervation d’effets analogues aétuels produits
par les forces d’élévation des tremblemens de
terre ;ou par la fortie de fluides élaftiques dans
aucune partie du globe ; car le gonflement,
par deffous , des rochers dans la plaine de
Malpais, pendant l'éruption du Jorullo , étoit,
comme on l’a déjà dit, une hypothèfe propolée,
long-temps après l'érupiion, pour rendre compte
d’apparences qui admettoient une tout autre explication.
En outre, dans l’exemple que fournit le
Joru'lo, il n’y eut pas de grand cratère de foulevement
de formé au Centre. G’eft pour cela, que toutes nos
analogies modernes étant en faveur de l’origine
dés cônes & des cratères exclujivemem par .éruptions
, nous fommes autorifés à examiner avec
quelque févérité la nouvelle hypothèfe, & nous
avons droit de demander qu’il nous foit évidemment
démontré que lqs caufès fréquentes & ordinaires
font parfaitement infuffifantes pour produire
les phénomènes obfervés. Si MM, de Buch & de
Humboldt, par exemple , avoient, dans le cours
de leurs longs voyages q u i, à jufte titre, rendent
leurs opinions, relativement aux volcans, d’un
grand poids, avoient, dis-je, rencontré un feul
cône compofé. exclufivemëht de couches marines
ou lacuftres , fans uncun mélange de fragmens de
roche ignée, ayant dans le centre une grande cavité
entourée par un efearpement dû à la précipitation,
.alors nous euftîons été forcés d’avouer
tout d’abord, que la configuration en cône &
femblable à un cratère, quel que fût fon mode de
formation , pouvoit quelquefois n’avoir aucun
rapport quelconque avec les éruptions volcaniques
ordinaires.
» Mais on ne croit pas que fur toute la furface du
globe un feul exemple de cette efpèce puiffe être
indiqué- .En Europe & dans l’Amérique fepten-
trionale, on a examiné des milliers de lieues carrées
de territoires compofés de couches marines
qui ont été élevées à différentes hauteurs, juf-
qu’ à plus de 10,000 pieds au-deffus du niveau de
la mer, quelquefois en maftes horizontales en
forme de table ; dans d’autres cas, (ous tous les
degrés d’inclinaifons, depuis l’horizontale .juî-
qu’à la verticale. Quelques-uns ont été réunis
'fans grand dérangement, d’autres ont été déchirés,
contournés, b ri tes avec la plus grande violen
ce . Quelquefois de grands diftrièis ou d’autres
petits efpaces paroiffent avoir changé de pofition.
Cependant, parmi les accidens innombrables auxquels
çes roches ont été fujettes, elles ne prirent
jamais une forme repré (entant exactement un
grand cône tronqué, avec une large cavité au
centre.
» Sommes-nous donc appelés à croire que toutes
les fois eue des fluides élaftiques engendrés dans
lès régions fouterraines, percent à travers les
couches horizontales, en les foulevant de la
manière particulière remarquée plus hau t, ils
préfèrent toujours, comme par choix, ces ef-
paces d’une étendue comparativement infîgni-
fiante, où une certaine quantité de matière volcanique
fe trouve placée, tandis qu’ils évitent foi