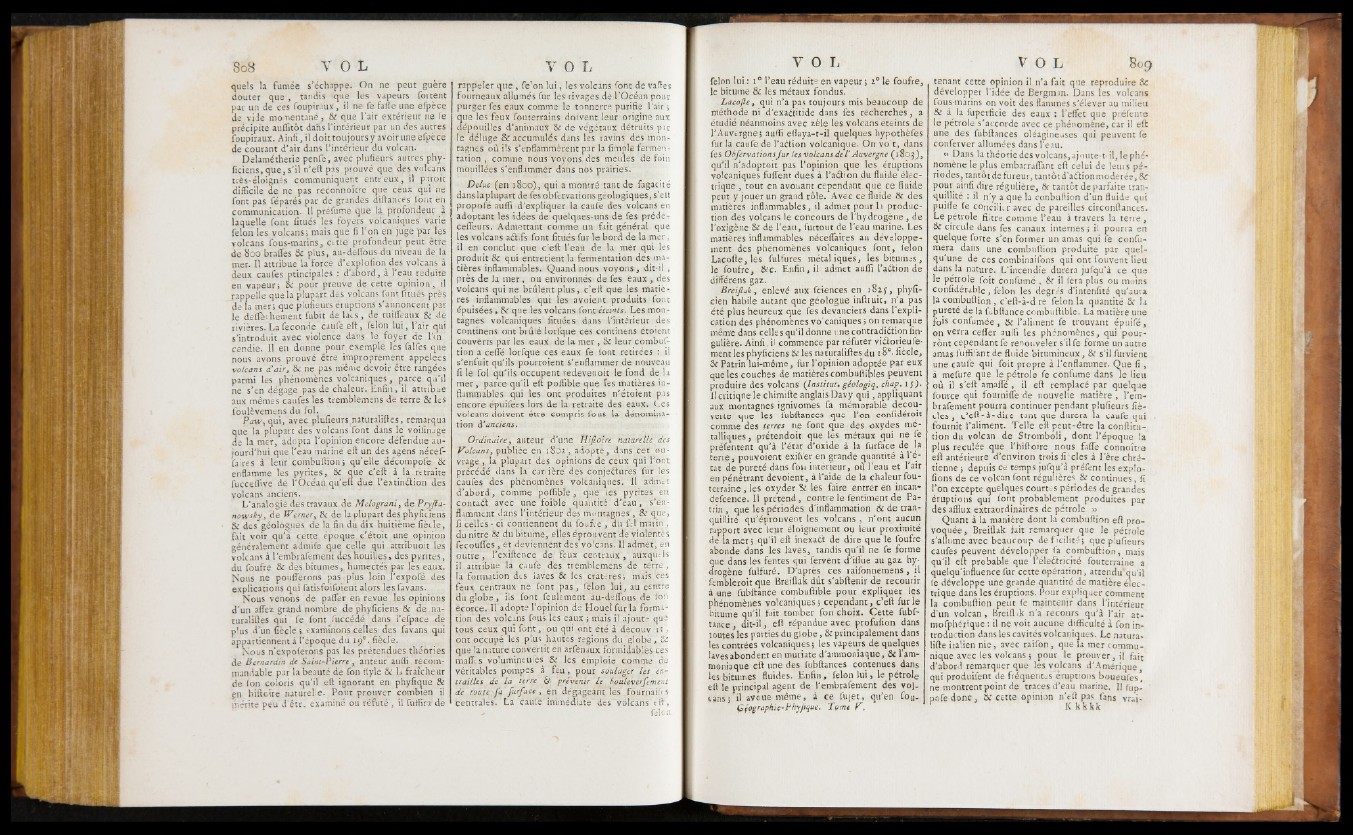
SoS V O L
quels la fumée s’échappe. On ne peut guère
douter que, tandis que les vapeurs fortent
par un de ces foupiraux, il ne fe fa lie une efpèce
de vide momentané, & que l'air extérieur ne fe
précipite auffitôt dans l'intérieur par un des autres
foupiraux. A inli, i 1 doit toujours y avoir une efpèce
de courant d’air dans l'intérieur du volcan.
Delamétherie penfe, avec plulieurs autres phy-
ficiens, que, s’il n'eft pas prouvé que des volcans
très-éloignés communiquent entr'eux, il paroît
difficile de ne pas reconnoître que ceux qui ne
font pas féparés par de grandes diftances font en
communication. Il préfume que la profondeui; t
laquelle font fitués les foyers volcaniques varie
félon les volcans; mais que fi l’on en juge par les
volcans fous-marins, cette profondeur peut être
de 800 braffes & plus, au-delTous du niveau de.la
mer. Il attribue la force d’explolion des volcans à
deux caufes ptincipales : d’abord, à l’eau réduite
en vapeur; & pour preuve de cette opinion, il
rappelle que la plupart des volcans font fitués près
de la mer; que plulieurs éruptions s’annoncent par
le deflechement fubit de lacs, de ruiffeaùx & de
rivières. La fécondé caufe elt, félon lui, l’air qui
s’introduit avec violence dans Je foyer de l'in
cendie. Il en donne pour exemple les falfes que
nous avons prouvé être improprement appelées
v o lc a n s d 'a i r , & ne pas même devoir être rangées
parmi les phénomènes volcaniques, parce qu’il
ne s’en dégage pas de chaleur. Enfin, il attribue
aux mêmes caufes les tremblemens de terre & les
foulèvemens du fol.
P<zw, qui, avec plulieurs,naturaliftes, remarqua
que la plupart des volcans font dans le voilinage
de la mer, adopta l’opinion encore défendue aujourd’hui
que l’eau mariné eft un des agens nëcef-
faires à leur combullion ; qu’elle décompofe &
enflamme les pyrites, & que c’eft à la. retraite
fucceffive de l’Océan qu’eft due l’extinèlion des
volcans anciens.
L’analogie des travaux de M e lo g r a n i , de P r y f ta -
n o w s k y , "He W e n t e r 3 & de la plupart des phyliciens
& des géologues de la fin du dix huitième liècle,
fait voir qu’à cette époque, e’étoit une opinion
généralement admife que celle qui attribuoit les
volcans à l'embrafemenc des houilles, des pyrites,
du foufre & des bitumes, humectés par les eaux.
Nous ne poufferons pas plus loin l’expofé des
explications qui fatisfoifoient alors les favans.
Nous venons de palfer en revue les opinions
d’un alfez grand nombre de phyliciens & de naturalises
qui fe font fuccéaé dans l’efpace-dé
plus d’un liècle ; examinons celles des favans qui
appartiennent à l’époque du 19e. liècle.
Nous n’e.xpoferons pas les prétendues théories
de B e r n a r d in d e S a in t - P ie r r e , auteur aufli recommandable
par la beauté de fon flyle & L fraîcheur
de Ion coloris qu’il eft ignorant en phylïque &
çn hifteire naturelle. Pour prouver combien il
mérite peu A etr» examine ou réfutéil fuffirade
V O L
rappeler que, feTon lui, les volcans font de va fie s
fourneaux allumés fur les rivages de l'Océan pour
purger fes eaux comme le tonnerre purifie l’air ;
que les feux fouterrains doivent leur origine aux
dépouilles d’animaux & de végétaux détruits par
le déluge & accumulés dans les ravins des montagnes
où ils s’enflammèrent par la {impie fermentation
, comme nous'vôÿons. des meules de foin
mouillées s’enflammer dans nos prairies.
D e lu e (en 1800), qui a montré tant de fagacité
dans laplupart de fes obfcrvationsgéologiques, s’ett
propofé aulfi d’expliquer la caufe des volcans en
adoptant les idées de quelques-uns de fes prédé-
celfeurs. Admettant comme un fait général que
les volcans aétifs font fitués fur le bord de la mer,
il en conclut que c’eft l’eau de la mer qui les
produit & qui entretient la fermentation des matières
inflammables. Quand nous voyons’, dit-il ,
près de la mer, ou environnés de fes eaux , des
volcans qui ne brûlent plus, c’eft que les matières
inflammables qui les a voient produits font
épuisées> & que les volcans font é t e in t s . Les montagnes
volcaniques fituées dans l’intérieur des
continens ont brûlédorfque ces continens étoient
couverts par les eaux de la mer, & leur combuf-
tion a celle lorfque ces eaux fe font retirées : il
s’enfuit qu’ils pourroient s’enflammer de nouveau
fi le fol qu’ils occupent redevenoit le fond de la
mer, parce^qu’il eft poffible que fes matières inflammables
qui les ont produites n’étoient pas
encore épuifées lors de la retraite des eaux. Ces
volcans doivent être compris fous la dénomination
d'a n c ie n s .
O r d in a i r e , auteur d’une H i j lo i r e n a tu r e lle des
V o l c a n s 3 publiée en 1802., adopté, dans cet ouvrage
,. la plupart des opinions de ceux qui l’ont
précédé dans la carrière dès conjectures fur les
caufes des phénomènes^ volcaniques. Il admet
d’abord, comme poffible, que les pyrites en
conta# avec une foible quantité d’eau, s’enflamment
dans l’intérieur dès montagnes , & que,
fi celles - ci contiennent du foufre , du Ici mat in,
du nitre & du bitume, étles éprouvent de violentes
fecoulfes, et deviennent des vo’cans. Il admet, èu
outre, rexiftence de; feux centraux, auxquels
il attribue la caufe dés tremblemens de terre,
la formation des laves & les cratères; mais ces
feux centraux ne font pas, félon lui, au centre
du globe, ils font feulement au-deffous de fon
écorce. Il adopte l’opinion dé Houel fur la formation
des volcans fous les eaux ; mais il ajoute que
tous ceux qui fon tou qui ont été à découv r t,
ont occupé les plus hautes régions du-globe,. &
que fa nature convertit en arfenaux formidables ces
malîls volumineufés & les emploie comme de
véritables pompes à feu, pour s o u la g e r l e s ent
r a i l le s d e la te rr e & p r é v e n ir Le b o u lev é r fem en t
d e to u t e s f a fu r fa c e , en dégageant les fouriiàifi s
centrales. La caulè' immédiate^ des'volcans* éft,
félon
félon lui : i° l’eau réduite en vapeur ; i° le foufre,
le bitume & les métaux fondus.
L a c o j t e , qui n’a pas toujours mis beaucoup de
méthode ni d’exaéiitide dans fes rècherches, a
étudié néanmoins avec zèle les volcans éteints de
l’Auvergne; auffi edaya—t-il quelques hypothèfes
fur la caufe de l’aétion volcanique. On vo’t, dans
fes O b f e r v a t io n s fu r le s v o lc a n s d e l ' A u v e r g n e (1803),
qu’il n’adoptoit pas l’opinion que les éruptions
volcaniques fuffent dues à l’aâion du fluide électrique
, tout en avouant cependant que ce fluide
peut y jouer un grand rôle. Avec ce fluide & des
matières inflammables, il admet pour la production
des volcans le concours de l’hydrogène, de
l’oxigène & de l’eau, furtout de l’eau marine. Les
matières inflammables nécelfaires au développement
des phénomènes volcaniques font, félon
Lacofte, les fulfures métal iques, les bitumes,
le foufre, &c. Enfin, il admet auffi l’adtion de
différens gaz.
B r e i f la k y enlevé aux fciences en i82y, phyfi-
cien habile autant que géologue inftruit, n’a pas
été plus heureux que fes devanciers dans l’explication
des phénomènes vo’caniques ; on remarque
même dans celles qu’il donne une contradiction fin-
gufière. Ainfi, il commence par réfuter viCtorieufe-
ment les phyliciens & les naturaliftes du 18e. fièele,
& Patrin lui-même, fur l’opinion adoptée par eux
que les couches de matières combuftifcles peuvent
produire des volcans' ( I n s t i t u t , g é o lo g iq . c h a p . 15).
Il critique le chimifte anglais Davy qui, appliquant
aux montagnes ignivomes fa mémorable decouverte
que les fubftances que l’on confidéroit
comme des te r r e s ne font que des oxydes métalliques,
prétendoit que les métaux qui ne fe
préfentent qu’à l’étar d’oxide à la furface de la
terie, pouvoient exifVer en grande quantité à l'état
de pureté dans fou intérieur, où l'eau et l’air
en pénétrant dévoient, à l’aide de la chaleur fou-
terraine, les oxyder Sé les faire entrer en incandescence.
11 prétend, contre le Sentiment de Patrin
, que les périodes d’inflammation & de tranquillité
qu’éprouvent les volcans , n’ont aucun :
rapport avec leur éloignement 014 leur proximité
de la mer ; qu'il eft inexaèt de dire que le foufre
abonde dans les laves, tandis qu’il ne fe forme
que dans les fentes qui fervent d'ilfue au gaz hydrogène
fulfuré. D’après ces raifonnemens, il
fembleroit que Breiflak dût s’abftenir de recourir
à-une fubftance combuftible pour expliquer l§s
phénomènes volcaniques ; cependant, ç’eft fur le
biiume qu’il fait tomber fon choix. Cette fubftance
, ditril, eft répandue avec profufion dans
toutes les parties du globe, & principalement dans
les contrées volcaniques ; les vapeurs de quelques
laves abondent en muriate d’ammoniaque, & l’ammoniaque
eft une des fubftances contenues dans
les bitumes fluides. Enfin, félon lui, le pétrole
eft le principal agent de l’embrafement des volc
a n s ; il avoue même, à ce fujet, qu’en fou-
G fO g r a p h ie -P h y J iq u e . T om e V .
tenant cette opinion il n’a fait que reproduire &
développer l’idée de Bergman. Dans les volcans
fous-marins on voit des flammes s'élever au milieu
& à la fuperficie des eaux : l’effet que préfenre
le pétrole s’accorde avec ce phénomène, car il eft
une des fubftances oléagineuses qui peuvent fe
conferver allumées dans l’eau.
« Dans la théorie des volcans, ajoute-t-il, le phénomène
le plus embarraflant eft celui de leurs périodes,
tantôt de fureur, tantôt d’aètion modérée, &
pour ainfi dire régulière, & tantôt de parfaite tranquillité
: il n'y a que la conbuflion d’un fluide qui
puilïe fe concilier avec de pareilles circonftances.
Le pétrole filtre comme l’eau à travers la terre,
& circule dans fes canaux internes ; il pourra en
quelque forte s’en former un amas qui fe confu-
mera dans une combullion produite par quelqu’une
de ces combinaifons qui ont fouvent lieu
dans la pâture. L’incendie durera jufqu’à ce que
le pétrole foit confumé , & il fera plus ou moins
confiderable, félon les degrés d’intenfité qu’aura
la combullion, c’eft-à-d re félon la quantité & U
pureté de la fubftance combuftible. La matière une
fois confumée, & l’aliment fe trouvant épuifé,
on verra celîer aufli les phénomènes, qui pourront
cependant fe renouveler s’il fe forme un autre
amas fuffifant de fluide bitumineux, & s’il furvient
une caufe qui foit propre à l’enflammer. Que fi ,
à mefure que le pétrole fe confume dans le lieu
où il s’eft amaffé, il eft remplacé par quelque
fource qui fourniffe de nouvelle matière, l’em-
brafement pourra continuer pendant plulieurs fiè-
cles, c’eft-à-dire tant que durera la caufe qui
fournit l’aliment. Telle eft peut-être la conftitu-
tion du volcan de Stromboli, dont l’époque la
plus reculée que l’hiftoire nous falfe connoître
eft antérieure d’environ trois fi clés à l'ère chrétienne
; depuis ce temps jufqu’à préfent les exploitons
de ce volcan font régulières & continues, fi
l’on excepte quelques courtes périodes de grandes
éruptions qui font probablement produites par
des afflux extraordinaires de pétrole »
Quant à la manière dont la combullion eft provoquée,
Breiflak fait remarquer que le pétrole
s’allume avec beaucoup de ficilité; que plulieurs
caufes peuvent développer fa combullion, mais
qu’il eft probable que l’éleétricité fouterraine a
quçlqu’influence fur cette opération, attendu'qu’il
le développe une grande quantité de matière électrique
dans les éruptions. Four expliquer comment
la combullion peut fe maintenir dans l’intérieur
d’un volcan, Breill «k n'a recours qu’à l’air at-
mofphérique : il ne voit aucune difficulté à fon introduction
dans les cavités volcaniques. Le natura-
lifte italien nie, avec raifon, que la mer communique
avec les volcans ; pour le prouver, il fait
d’abord remarquer que les volcans d’Amérique
qui produifent de fiéquentcis'eruptions boueufes,
ne montrent point de traces d’eau marine. II Aip-
pofe donc, & cette opinion n’eft pas fans vrai.
r K k k k k