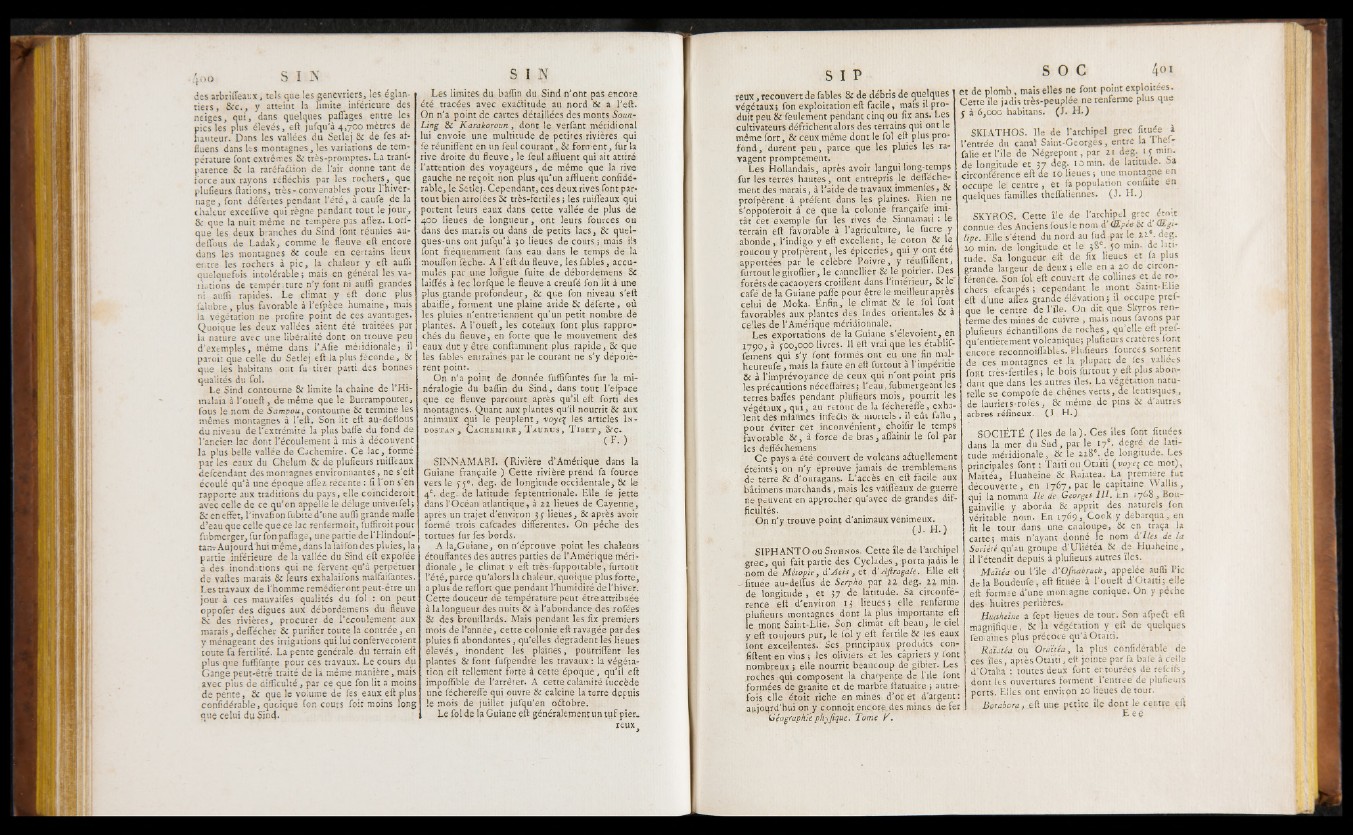
i o o S I N
des arbriffeaux, tels que les genévriers, les églantiers,
& c ., y atteint la limite inférieure des
neiges, qui, dans quelques paflages entre les
pics les plus élevés, eft jufqu’à 4,700 mètres de
hauteur. Dans les vallées du Setlej & de fes af-
fluens dans les montagnes, les variations de température
font extrêmes & très-promptes. La tranf-
parence & la raréfaction de l'air donne tant de
force aux rayons réfléchis par les rochers, que
plufieurs dations, très-convenables pour l'hivernage,
font défertes pendant l’été, à caufe de la
chaleur excelïïve qui règne pendant tout le jour,
& que la nuit même ne tempère pas aflez. Lorf-
que les deux branches du Sind font réunies au-
deflous de Ladak, comme le fleuve eft encore
dans les montagnes & coule en certains lieux
entre les rochers à pic, la chaleur y eft aufli
quelquefois intolérable > mais en général les variations
de tempér:ture n’y font ni aufli grandes
ni auffi rapides. Le climat y eft donc plus
falubre, plus favorable à l’efpèce humaine, mais
la végétation ne profite point de ces avantages.
Quoique les deux vallées aient été traitées par
la nature avec une libéralité dont on trouve peu
d’exemples, même dans l’Afïe méridionale, il
parole que celle du Setlej eft la plus féconde, &
que les habitans ont fu tirer parti des bonnes
qualités du fol.
Le Sind contourne & limite la chaîne de l’Hi-
malaïa à l'oueft, de même que le Burrampouter,
fous le nom de Sampou, contourne & termine les
mêmes montagnes à l ’eft. Son lit eft au-deflous
du niveau de l’extrémité la plus baffe du fond de
l ’ancien lac dont l’écoulement à mis à découvent
la plus belle vallée de Cachemire. Ce lac, formé
par les eaux du Chelum & de plufieurs ruifieaux
defeendant des momagnes environnantes, ne s’eft
écoulé qu’ à une époque aflez récente : fi l’on s’en
rapporte aux traditions du pays, elle coincideroit
avec celle de ce qu’ on appelle le déluge univet fel ;
8c en effet, l’invafion fubite d’une aufli grande maffe
d’eau que celle que ce lac renfermoit, Tuffiroit pour
fubmerger, fur fon paflage, une partie del’Hindouf-
tan~Aujourd'hui même, dans la faifon des pluies, la
partie inférieure de la vallée du Sind eft expofée
à des inondations qui ne fervent qu’à perpétuer
de vaftes marais & leurs exhalaifons malfaisantes.
Les travaux de l’homme remédieront peut-être un
jour à ces mauvaifes qualités du fol : on peut
oppofer des digues aux débordemens du fleuve
6c des rivières, procurer de l ’écoulement aux
marais, deffécher & purifier toute la contrée, en
y ménageant des irrigations qui lui conferveroient
toute fa fertilité. La pente générale du terrain eft
plus que fuffifante pour ces travaux. Le cours du
Gange peut-être traité de la même manière, mais
avec plus de difficulté, par ce que fon lit a moins
de pente, & que le volume de fes eaux eft plus
confidérable, quoique fon coûts foie moins long
que celui du Sind*
S I N
Les limites du baflin du Sind n’ont pas encore
été tracées avec exactitude au nord & a l’eft.
On n’a point de cartes détaillées des monts Soun-
Ling 8c Karakoroun, dont le verfant méridional
lui envoie une multitude de petires rivières qui
fe réunifient en un feul courant, 8c forment, fur la
rive droite du fleuve, le feul affluent qui ait attiré
l’attention des voyageurs, de même que la rive
gauche ne reçoit non plus qu’ un affluent confidérable,
le Setlej. Cependant, ces deux rives font partout
bien arrolées 8c très-fertiles5 les ruifieaux qui
portent leurs eaux dans cette vallée de plus de
400 lieues de longueur, ont leurs fources ou
dans des marais ou dans de petits lacs, 8c quelques
uns ont jufqu’à 30 lieues de cours j mais ih
font fréquemment fans eau dans le temps de la
mouflon fèche. A l’eft du fleuve, les fables, accumulés
par une longue fuite de débordemens Se
laiffés à (ec lorfque le fleuve a creufé fon lit à une
plus gtande profondeur, 8c que fon niveau s’eft
abaifié, forment une plaine aride 8c déferte, où
les pluies n’entretiennent qu’un petit nombre de
plantes. A l’oueft, les coteaux font plus rapprochés
du fleuve, en forte que le mouvement des
eaux dut y être conftamment plus rapide, 8c que
les fables entraînés par le courant ne s’y dépotèrent
point. ...
On n’a point de donnée fufflfantes fur la minéralogie
du baflin du Sind, dans tout l’efpace
que ce fleuve parcourt après qu’il eft forti des
montagnes. Quant aux plantes qu’il nourrit 8c aux
animaux qui le peuplent, voye^ les articles 1n-
dostan, C achemire, T aurus, T ib e t , 8cc.
( F . )
SINNAMARI. (Rivière d’Amérique dans la
Guiane françaife ) Cette rivière prend fa fource
vers le 55e. deg. de longitude occidentale, 8c le
4e. deg. de latitude feptentrionale. Elle fe jette
! dans l’Océan atlantique, à 22 lieues de Cayenne,
après un trajet d’environ 3y lieues, 8c après avoir
formé trois cafcades différentes. On pêche des
tortues fur fes bords,
A la^Guiane, on n’éprouve point les chaleurs
étouffantes des autres parties de l’Amérique méridionale,
le climat y eft très-fuppo»table, furtout
l’été, parce qu'alors la chaleur, quoique plus forte,
a plus de reflort que pendant l’humidité de l’ hiver.
Cette douceur de température peut être attribuée
à 1a longueur des nuits 8c à l’abondance des rofées
8c des brouillards. Mais pendant les fix premiers
mois de l’année, cette colonie eft ravagée par des
pluies fi abondantes, qu’elles dégradent les lieues
élevés, inondent les plaines, pourriflent les
plantes 8c font fufpendre les travaux : la végétation
eft tellement forte à cette époque, qu’ il eft
impoflible de l’arrêter. A cette calamité luccède
une féchereffe qui ouvre 8c calcine la terre depuis
le mois de juillet jufqu’en o&obre.
Le fol de la Guiane çft généralement un tuf pier,
s 1 P
reux, recouvert de fables 8c de débris de quelques '
végétaux} fon exploitation eft facile, mais il produit
peu 8c feulement pendant cinq ou fix ans. Les
cultivateurs défrichent alors des terrains qui ont le
même fort, 8c ceux même dont le fol eft plus profond,
durent peu, parce que les pluies les ravagent
promptement.
Les Hollandais, après avoir langui long-temps
fur les terres hautes, ont entrepris le defleche-
ment des marais, à l’aide de travaux immenfes, 8c
profpèrent à préfent dans les plaines. Rien ne
s’oppoferoit à ce que la colonie françaife imitât
cet exemple fur les rives de Sinnamari : le
terrain eft favorable à l’agriculture, le fucre y
abonde, l’indigo y eft excellent, le coton 8c le
roucou y profpèrent, les épiceries, qui y ont été
apportées par le célèbre Poivre, y réufliffent,
furtout le giroflier, le cannellier 8c le poirier. Des^
forêts de cacaoyers croiffent dans l’intérieur, 8c le
café de la Guiane pafle pour être le meilleur après
celui de Moka. Enfin, le climat 8^ le fol font
favorables aux plantes des Indes orientales 8c à
celles de l’Amérique méridionnale.
Les exportations de la Guiane s’élevoient, en
1790, à yoo,opo livres, il eft vrai que les établif-
fernens qui s’y font formés ont eu une fin mal-
heureufe, mais la faute en eft furtout à l’impéritie
8c à l’imprévoyance de ceux qui n’ont point pris
les précautions neceflaires; l’eau , fubmergeant les
terres baffes pendant plufieurs mois, pourrit les
végétaux, qui, au retour de la féchereffe, exhalent
des miafmes infeéts 8c mortels : i\ eût fallu,
pour éviter cet inconvénient, choifir le temps
favorable 8c, à force de bras, afîainir le fol par
les deflechemens
Ce pays a été couvert de volcans actuellement
éteints} on n’y éprouve jamais de tremblemens
de terre 8c d’ouragans. L'accès en eft-facile aux :
bâtimens marchands, mais les vaifleaux de guerre
rie peuvent en approcher qu’avec de grandes difficultés.
On n’v trouve point d’animaux venimeux.
■ ' (J. H.)
SIPHANTO ou Siphnos. Cette île de l’archipel
grec, qui fait partie des Cyclades, porta jadis le
•nom de Mltopie, A'Àtis ,• et à'Aftragale. Elle elt
-limée au-deffus de Sçrpho par 22 deg. 21min.
de longitude , et 37 de latitude. Sa circonférence
elt d'enyiron -13 lieues ; elle renferme
plufieurs montagnes dont la plus importante eft
le mont Saint-Elie, Son climat eft beau, le ciel
y eft toujours pur, le fol y eft fertile & les eaux
lont excellentes. Ses principaux produits con-
fiftent en vins ; les .ojiyiers et les câpriers y font
nombreux j elle nourrit beaucoup de gibier. Les
roches qui composent la charpente de l’ile lont
formées de granité et de marbre ftatuaire ; autrefois
elle étoit riche en mines d’or et d’argent:
aujourd’hui qn y connojt encore, des mines de fer
idéographie phyfique. Tome Y .
S O C
et de plomb, mais elles ne font point exploitées.
Cette île jadis très-peuplée ne renferme plus que
y à 6,000 habitans. (J. H.)
SKIATHOS. Ile de l'archipel grec fituée à
l’entrée du canal Saint-Georges, entre la Theî-
falie et l’ile de Négrepont, par 21 deg. 1 C min.
de longitude et 37 deg. 10 min. de latitude, oa
circonférénce eft de 10 lieues , une montagne en
occupe le centre , et fa population confifte en
quelques familles thefîabennes. (J. H.)
SKYROS. Cette île de l’archipel grec ■ étoit
connue des Anciens fous le nom d’ (Epée & d’ (Egi-
lipe. Elle s’étend du nord au fud.par le 22 . deg.
20 min. de longitude et le 38e. 50 min. de latitude.
Sa longueur eft de fix lieues et fa plus
grande largeur de deux j elle en a 20 de circonférence.
Son fol eft couvert de collines et de rochers
efearpés i cependant le mont Saint-Ehe
eft d’une aflez grande élévation ; il occupe pref-
que le centre de l’île. On dit que Skyros renferme
des mines de cuivre , mais nous favons par
plufieurs échantillons de roches, qu elle eft pref-
qu’entièrement volcanique; plufieurs cratères font
encore reconnoiflables. Plufieurs fources sortent
de çes montagnes et la plupart de fes vallées
font très-fertiles ; le bois furtout y eft plus abondant
que dans les autres îles. La végétation naturelle
se compofe de chênes verts, de lentisques,
de lauriers-rofes, & même de pins & d'autres
arbres réfineux. (J- H.)
SOCIÉTÉ (Iles de la). Ces îles font fituées
dans la mer du Sud, par le 17e. degré de latitude
méridionale, & le 228e. de longitude. Les
principales font : Taïti ou Otaïti (voyq ce mot),
Maïtéa, Huaheine & Raiatea, La première fut
découverte, en 1767, par le capitaine Wallis,
qui la nomma Ile de Georges 211. En 1768, Bougainville
y aborda & apprit des naturels fon
véritable nom. En 1769., Cook y débarqua, en
fit le tour dans une cnaloupe, & en traça la
carte; mais n’ayant donné, fe nom d lies de la
Société qu’au groupe d’Uliétéa & de Huaheine,
il l’étendit depuis à plufieurs autres îles.
Ma'itéa ou l'île i ’Ofnabruck, appelée auffi Pic
delà Boudeufe, eftfituée à l'oueft d’Otaïti; elle
eft formse d’une momagne conique. On y pêche
des huîtres.perlières.
Huaheine a fept lieues de tour. Son afpeft eft
magnifique, & la végétation y eft de quelques
Centaines plus précoce qu’à Otaïti.
Raïatêa, QU Ordïtéa, la plus confidérable de
ces îles, après Otaïti, elt jointe par fa baie à celle
U’Otaha : toutes deux font entourées de refeifs,
dont les ouvertures forment l’entrée de plufieurs
ports. Elles ont environ 20 lieues de tour.
Borahorti , eft une petite. île dont le centre eft
Ë ee