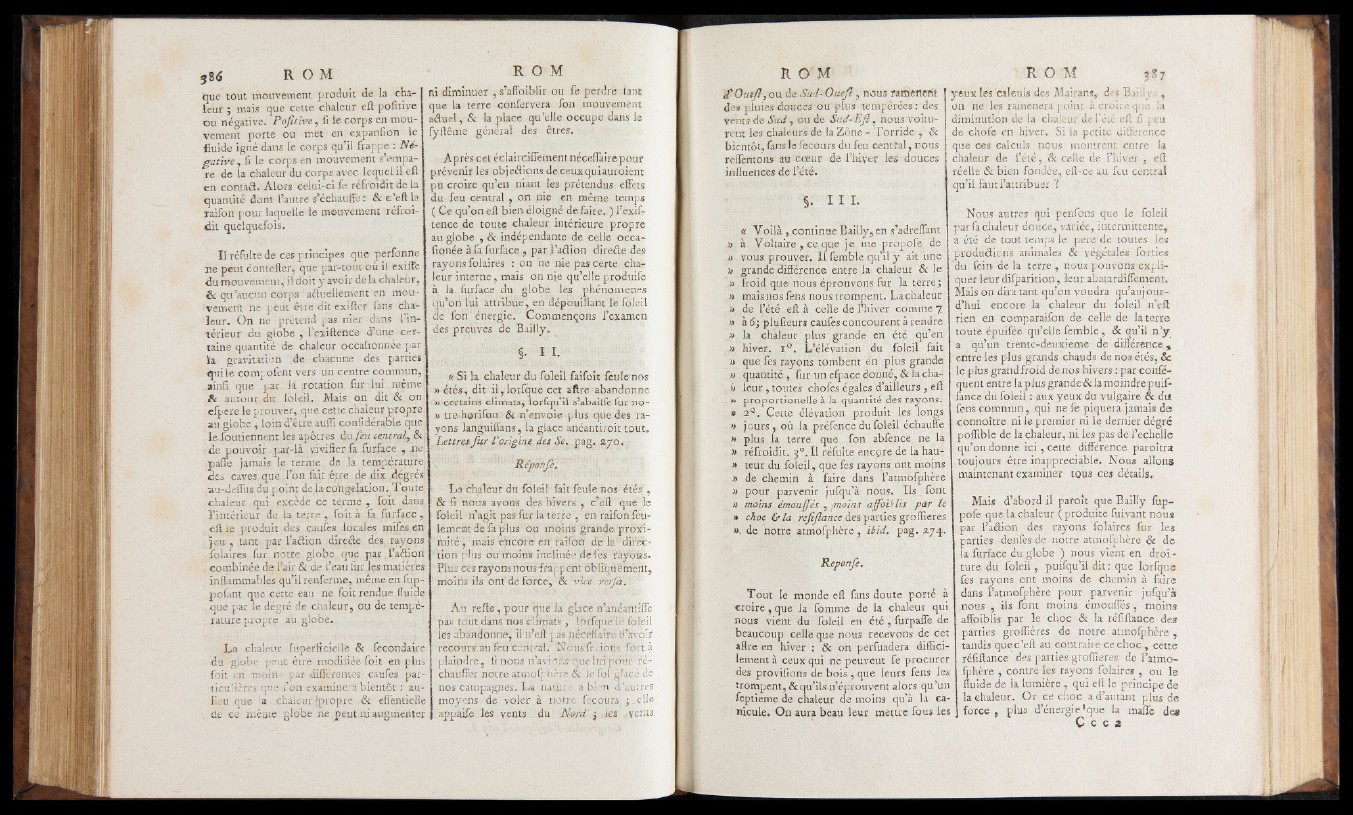
que tout mouvement produit de la chaleur
; mais que cette chaleur gft pofitive
ou négative. Pofitive, lï le corps en mouvement
porte ou met en eXpanfîon le
fluide igné dans le corps qu’il frappe : Négative
, fi le corps en mouvement s’empare
de la chaleur du corps avec lequel il eft
en contaâ. Alors celui-ci fe réfroidit de la
quantité dont l’autre s’échauffe : St e’eft la
raifon pour laquelle le mouvement réfroidit
quelquefois»
Il réfulte de ces principes que perfonne
ne peut contefter, que par-tout où il exifte
du mouvement, il doit y avoir delà, chaleur,
& qu’aucun corps aâuellement en mouvement
ne peut être dit extfter fans chaleur.
On ne prétend pas nier dans l’intérieur
du globe , Texiftence d’une certaine
quantîtende chaleur occaftonnée parJ
ni diminuer , s’affoiblir ou fe perdre faut
que la terre confervera fon mouvement
aâuel, & la place qu’elle occupe dans le
fyftême général des êtres..
Après cet éclairciffement néeeffairepour
prévenir les objeâions deceuxquiauroient
pu croire qu’en niant les prétendus effets
du feu central , on nie en même temps
( Ce qu’on eft bien éloigné de faire. ) i’exif-
tence de toute chaleur intérieure propre
au globe , & indépendante de celle occa-
fionée àfa furface , par l’aâion direâe des
rayons folaires : on ne nie pas certe chaleur
la gravitation de chacune des parties
quile compofent vers un centre commun,!
ainfi que par la rotation fur lui même;
& autour du foleîl. Mais on dit & on
efpere le prouver, que cette chaleur propre
au globe, loin d’être aüffi confidérable que
le foutiennent les apôtres du féu (entrai, St
de pouvoir par-là vivifier fa furface -, snej
paffe jamais le terme, de la températurej
des caves, que,,l’on fait .être de dix degrés
au-delfus du point delà congélation. Toute
chaleur qui excède ce terme , foit .dans.,
l’intérieur de la terre , . foit à là furface,
eft i.e produit des caufes locales mifesen
jeu , tant par l’aâion ; directe des rayons
folaires fur. notre globe, que par l’aâion
, combinée de l’air & de l’eau fur les matières
inflammables qu’il renferme, même en fup-
pofant que cette eau ne fort rendue fluide
que par le dégré de chaleur, ou de température
propre au globe.,
La chaleur fuperficielle & fecondaire
du globe peut être modifiée foit en plus
foit en moiri par-différentes caufes particulières
que l’on examinera bientôt : a.u-
lieu que 'a .chaleur jpropre .St effentielle
de ce même globe ne peut ni augmenter
interne, mais on nie qu’elle produife
à la. furface du globe, les phénomènes
i qu’on lui attribue^ en dépouillant le foleil
de fon1 énergie. Commençons l’examen
des preuves de Bailly.
§. I I .
«Si la chaleur du foleil faifoit feule nos
» étés, dit il,Iorfque cet aftre abandonne
» certains climats, lorfqu’il s’abailfe fur no-
» tre horifon. St n’envoie plus que des rayons
languiffans, la glace anéantiroit tout.
heures fur l'origine des Se. pag,. 2,70.
Répofifie.
K Là chalëur du foleil fait feule fios étés ,.
& fi nous ayons des hivers , c’eft que le
foleil n’agit pas fur la-terre , en raifon feulement
de fa plus ou moins grande proximité
, maïs encore en raifon de h direction
plus ou moins inclinée de fes rayons.
Plus ces rayonsnous frappent bblifjuëment,
moins ils ont de force, St vue v'erja.
Au relie, pour que la glace n’anéantiffe
- pas tout dans nos climats , [orfque le foleil
les abandonne, il n’eft pas nécelîàire d’avoir
recours’au feu central. Nous ferions fort à
plaindre, fi nous n’avioh's que lui pour réchauffer
notre atmofphère St le fol glacé de
nos campagnes. La nature a bien d’autres
moyens de voler à notre feçours ;Lelle
appaife les vents du Nord j les yents
d 'O u if î,ou de Sui-Ouefl , nous ramonent
des pluies douces ou plus tempérées: des
vents de Sud, ou de Sud-Efi, nous voitu-
rent les chaleurs de la Zone - Torride , &
bientôt, fans le fecours du feu centfal, nous
reffemons au coeur de l’hiver les douces
influences de l’été.
§. I I I.
« Voilà , continue Bailly, en s’adreffant
» à Voltaire , cemue je me propofe de
» vous prouver. Il femble qu’il y ait une
v grande différence entré la chaleur St le
froid que nous éprouvons fur la terre;
. » mais nos fens nous trompent. La chaleur
» de l’été eft à celle de l’hiver comme 7
» à 6; plufieurs caufes concourent à rendre
» la chaleur plus grande en été qu’en
» hiver. l &. L ’élévation du foleil fait
» que fes rayons tombent en plus grande
. « quantité , fur un efpace donné, &la cha-
» leur , toutes chofes égales d’ailleurs , eft
» proportionelle à là quantité des rayons.
» 2q. Cette élévation produit les longs
» j ours , où la préfence du foleil échauffe
» plus la terre que fon abfence ne la
» réfroidit. 30. Il réfulte encç.re de la hau-
» teur du foleil, que fes rayons ont moins
» de chemin à faire dans l’atmbfphère
» pour parvenir jufqu’à nous. I l s . font
. » moins émoujfés , /moins affbi'tlis par le
» choc & la refiftance des parties groffieres
». de notre atmofphère , ibid, pag. 274.
Reponfe.
yeux les calculs des Mairans, des Baillys ,
on ne les ramènera point à croire que la
diminution de la chaleur de l’été eft fi peu
de chofe en hiver. Si la petite différence
que ces calculs nous montrent entre la
chaleur de l’été, & celle de l’hiver , eft
réelle & bien fondée, eft-ce au feu central
qu’il fautFattribuer ?
Nous autres qui penfons que le foleil
par fa chaleur douce, variée, intermittente,
a été de tout temps le pere de toutes les
produdions animales & végétales forties
j du fein de la terre , nous pouvons expliquer
Tout le monde eft fans doute porté à
croire, que la fomme de la chaleur qui
nous vient du foleil en été , furpaffe de
beaucoup celle que nous recevons de cet
aftre en hiver : St on perfuadera difficilement
à ceux qui ne peuveut fe procurer
des provifions de b o is , que leurs fens les
trompent, & qu’ils n’éprouvent alors qu’un
feptieme de chaleur de moins qu’à la canicule.
On aura beau leur mettre fous les
leur difparition, leur abatardiffement.
Mais on dira tant qu’on voudra qu’auj our~
d’hui encore la chaleur du foleil n’eft
rien en comparaifon de celle, de la terre
toute épuifée qu’elle femble, St qu’il n’y
a qu’un trente-deuxieme de différence,
entre les plus grands chauds de nos étés, &
le plus grand froid de nos hivers : par confé-
quent entre la plus grande & la moindrepuif-
fance du foleil : aux yeux du vulgaire & du
fens commun, qui ne fe piquera jamais de
connoître ni le premier ni le dernier dégré
poffible de la chaleur, ni les pas de l’echelle
qu’on donne ici, cette différence paroîtra
toujours être inappréciable. Nous allons
maintenant examiner tous ces détails.
Mais d’abord il paroît que Bailly fùp-
pôfe que la chaleur (produite fuivant nous
par l’aclion des rayons folaires fur les
parties denfes de notre atmofphère. & de
la furface du globe ) nous vient en droiture
du foleil, puifqu’il dit: que lorfque
fes rayons ont moins de chemin à faire
dans l’atmofphère pour parvenir jufqu’à
nous , ils font moins émouffés , moins
affoiblis par le choc St la réfiftance des
parties groffières de notre atmofphère,
tandis quec’eft au contraire ce choc, cette
réfiftance des parties groffieres de l’atmofphère
, contre les rayons folaires , ou le
fluide de la lumière , qui eft le principe de
la chaleur. Or ce choc a d’amant plus de
force, plus d’énergie'que la maflè dos