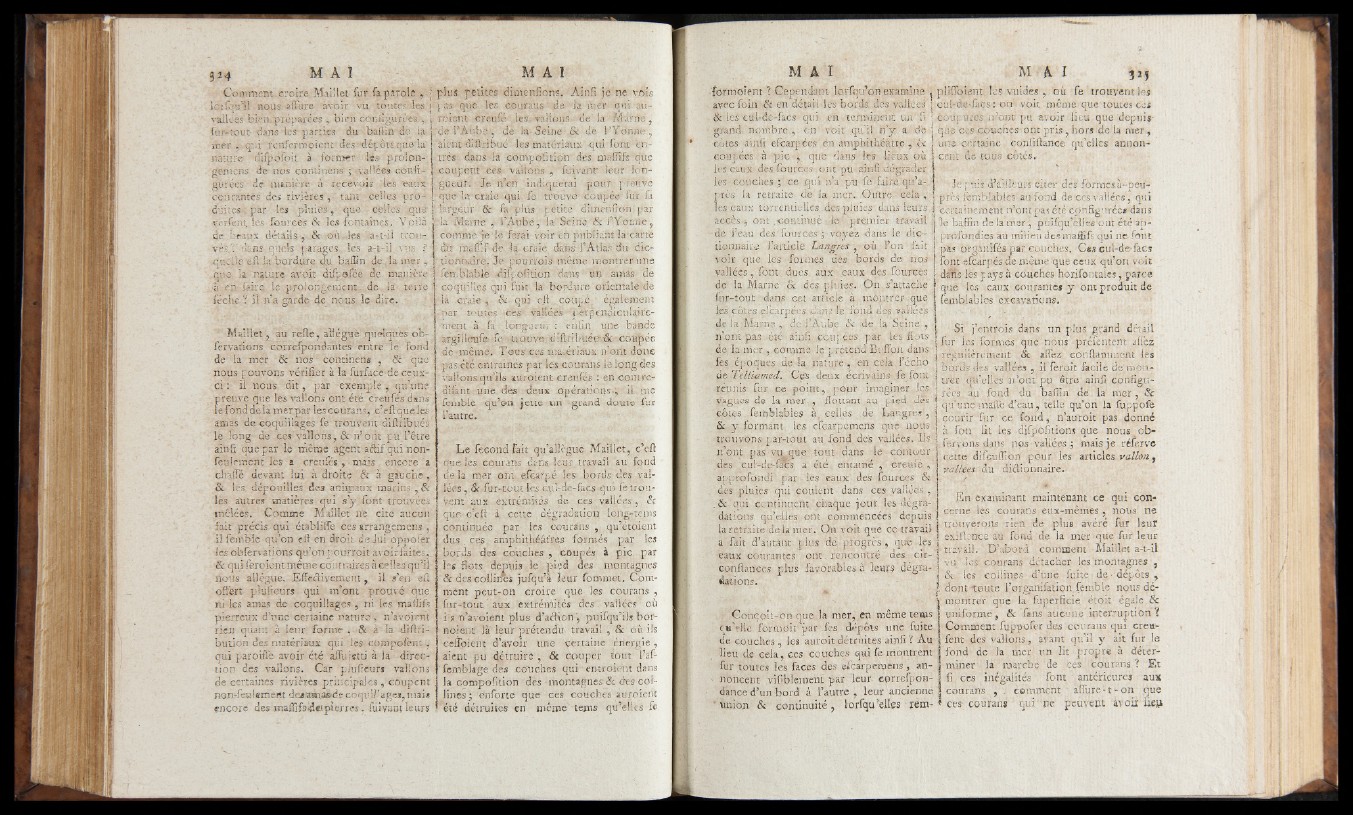
Comment croire Maillet fur fa parole
loifqull nous affine avoir vu toutes les
vailles bien.préparées, bien configurées.,
fur-tout dan-s les-parties du baffin dé la
Hier , qui renferm©ient'desï4dépôtsqüsla'
nature difpofoit à former les prolon-
gemens de nos continens' ; -vallées configurées
de minière à recevoir les eaux
courantes des rivières , tant celles prb-
duites, p'ar les pluies , que celles .que;.
verfent.les fources & les fontaines. Voilà
de beaux détails-,- & où , les Va-t-il .trou-é
•çésX dans quels parages , les a-t-il..vus ? 1
.quelle efl la bordure, du baffin de la m e r ,
que la 'nature avoit diipofée de manière ■:
•à en. iàirç fe .prolongement...de la terre 1
féclie ï il n’a garde de nous, le d ire ..
Maillet ,_aù refié, allégué quelques ob-
fervarions correfpondantés’ entre le fond
dé la mer & nos1 contiheris , 8c que ■
nous pouvons vérifier à la furfacé-dè ceux-
ci : il nous -d it, par exemple , qu’une
preuve que les valions ont été creufés dans
lefonddelamerpar iescouranj, c’eflqueles
amas de coquillages fe trouvent ■ diftribués
le long de ces vallons, & n’ ont pu l’être
ainfi que par lé même agent-aétif .qui non-
feulement les a creufés , • mais encore a
cliaffé devant lui à droite .& à gauche,
& lés dépouilles des anùji’âux marins , &
les autres matières qui s’y font trouvées
mêlées. Comme Maillet ne cité aucun
fait précis qui établiffe ces arrangemens ,
il femble qu’on efl en droit de lui oppofer
les obfervatidns qu’on jrourroit avoir faites,.
& quiferoientmêmecoimairesàcellesqu’il
nous allègue. Effeélivement, il s’en efl
offert plufîeurs qui m’ont prouvé que
ni les amas de coquillages-, ni les màflifs
pierreux d’une certaine nature1, n’àvorent
rien quant à leur forme , & à la diftri-
bution des matériaux qui les compofent |
qui paroifié avoir été aflujetti à la direction
des vallons. Car plufieurs vallons
de certaines riyièpes principales, coupent
non-feulement deaâfia.aside.coqüjfi âges, mais
encore des maffifsdeipierres. fùiÿapt leurs
plus petites dimenfions. Âinfi je pie vrfis
f 1 .t que les couraus 1 de la mer qui au-
roiont creufé les. vallons - de' la Marrie,
’de i’Aube,g de la Seine & de l ’Yonnfc:,
.'aient diftribué les matériaux qui font entrés
dans là conipofttion des malfifs -qiïe
coupent ces valions , fuivanr leur longueur.
Je n’eh indiquerai pouf prouve
que hv craie ■ qui fe trouve coupée fur,, fa
\largeur & fa plus petite dimenfibnlpar
:1a -Marné ,■ l’A u b e , la'Seinè. "& l’Yoniié,
comme je le ferai v o ir ’eii publiant Îa càrte
d'tr ràaffif de la crâiè. dans l’Atlas du dic-
rtiônnaire. Je pounois même montrer une
t fcîibkble dilpûfitibn- dans un amas de
coquilles qui fuit la bordure orientale 'de
la craie , & qui efl . coupe, également
• par toutes ces. Vallées perpendiculairement
à fa .longueur : enfin Une bande
-argi 11 euf* fe feouve -ciiflribuée-, •&-coupée
de -même. Tous -.ces .matériaux- niorit donc
■ pas été entraînés par iescouransde long des
valions qn iis auraient creufés : en coutre-
difent une. des deux opérations., il. jfee
femble qu’on jette un grand doute1 fur
. l’autre.
Le fécond fait qu’allègue Maillet, c’ell
1 que les couraus dans leur travail au fond
; de la mer ont. efearpé les bords dès vallées,
& fur-tout fes GUlide-facs-quâ fe trouvent
aux extrémités, de ces vallées1:,". &
que c’cft à," cette . dégradation long-tenis
continuée par les couraus , qu’étoient
dus ces amphithéâtres formés par les
bords des couches , .coupés à pic .par
les flots depuis le pied des montagnes
& des codifies jufqu’à ïéur fommet. Comment
peut-on croire que les cou rails ,
fur-tout aux extrémités des . vallées * où
i s n’avoient plus d’aéfion1, püifqu’ils bor-
noient là leur prétendu travail , 8c où ils
ceffoient d’avoir une certaine énergie ,
aient pu détruire , & couper tout l’af-
" femblage des couches qui emroieht dans
la compofition des montagnes & des collines;
e-nforte que ces couches auroient
1 été détruites en meme teins qu’elles fe
. pliffoient les vuides , où fe trouvent les
J cul-de-facs: oh- voit même que" toutes ces
■ coupures-,Infant1 pu avoir lieu que depuisuns
fdrmorent ? Cependant lorfqu’on examine
avec foin & en détail-lés bords: des vallées
& les cul-de-facs qui en terminent un1 fi
■ grand- nombre , %ï voit qu’il n’y â d'ê
côtes ainfi efearpées ! èn amphithéâtre , .&
coupées à pic -, que dans-’ les lieux où
les eaux .des -fources. ont pu ainfi dégrader
les - couches ; ce qui n’a pu fe faire qu’a-,
près la retraite de la mer. Outré, cela ,
les eaux torrentielles .des pluies dans leurs
accès R ont .continué Ç le premier, travail
de l’eau des fources ; voyez dans; le dictionnaire
l’article Langres , où l’on fait
voir que. les" formes dés bords de nos
vallées, font dues aux .eaux des fource-s
de la Marne & des pluies. On s’attache
fur-tbut dans- cet article à montrer que
les cotes e'earpees dans le fpnd des vailées
de la Marne.,. deJ’Aube & de . la Seine ,
n’ont pas ..été- - ainfi .coupées, par les flots
. de la mer., comme le prétend Buffon dans
fes .époques de la nature ,'.en cela l’écho
de TeUiamed. Ces deux écrivains fedont ;
réunis fur ce. point, pour imaginer les 1
vagues de la mer,., flottant au pied dès -
côtes ifeihblables a celles de Langres , :
& y formant les efearpemens que nous
trouvons-, par-tout au fond des vallées. I ls -
n ’ont (tas v aq u e tout dans le-contour
..des :cü!-dedaes a été entamé , c reu fé ,j
approfondi'par les eaux des fources &
des pluies qui coulent dans ces vallées ,
. qui continuent chaque jour les dégradations
qu’elles, ont commencées depuis
la retraite delà mer. On voit que ce travail
a fait d’autant plus de, progrès , que les
eaux courantes ont . rencontré des cir-
confiances plus favorables a leurs dégradations.
- Conçoit-on que la mer, en même tems
cu’ elie formait par .fes dépôts une fuite
dé couches , les auroit détruites ainfi f Au
lieu de cela, ces couches qui fe montrent
fur toutes les faces des efearpemens, an-
. noncent vifiblemenf par leur eorrefpon-
dànce d’un bord à l’autre , leur ancienne
"union & continuité, lorfqu’elles rèm-
certaine confiflance qu’elles annoncent
de tous côtés.
' Jê puis d’ailleurs citer des formes à-peu-
près fèmblabieséau fond de ces vallées, qui
certainement1 n’ont pas été configurées dans
le baffin de la m er, puifqu’éljes ont été ap-
, profcndies au milieu des math fs qui ne font
pas organifés par couches. Ces cul-de-facs
font efearpés de même que ceux qu’on voit
- dinsrles pays à couchés horjfontales, parce
que les-;e.aux .courantes y Ont produit de
femblables excavations.
Si j’entrois dans un plus grand détail
fur les,formés que nous préfentent allez
régulièrement & affez conftamment les
bô.i’îis des vallées , ifTer,oit facile de montrer
quelles n ’ont^ pu être ainfi-configurées
au fond dû baffin de la mer, &
qu’une tnàlfe d’eau, telle qu’on la fuppofe
courir fur ce fond, n’auroit pas donné
à. fort . lit les .difpôfitions que nous ob-
; fervons"d.ans . nos vallées ; mais je réferve
cette difeuffion pour les articles vallon,
vallées du diélionnaire.
En examinant maintenant ce qui concerne
les courans eux-mêmes , nous ne
trouverons rien de plus avéré fur leur
èxiflerice au fond, de la mer que fur leur
travail. D’abord comment Maillet a-t-il
vu les courans détacher les montagnes ,
&, les çoilines d’une fuite de • dépôts ,
:, dont -toute ljprganifatioii femble nous démontrer
que la fuperfîcie étok égale &
; uniforme, & fans aucune interruption ?
Comment, fuppofer des ccurans qui crea-
fent fies vallons, avant qu’il y ait fur le
fond de la mer un lit propre à déterminer
la marché de ces courans ? Et
fi ces inégalités font antérieures aux
courans , . comment allure - 1 - on que
ces courans qui ire peuvent Avoir lien