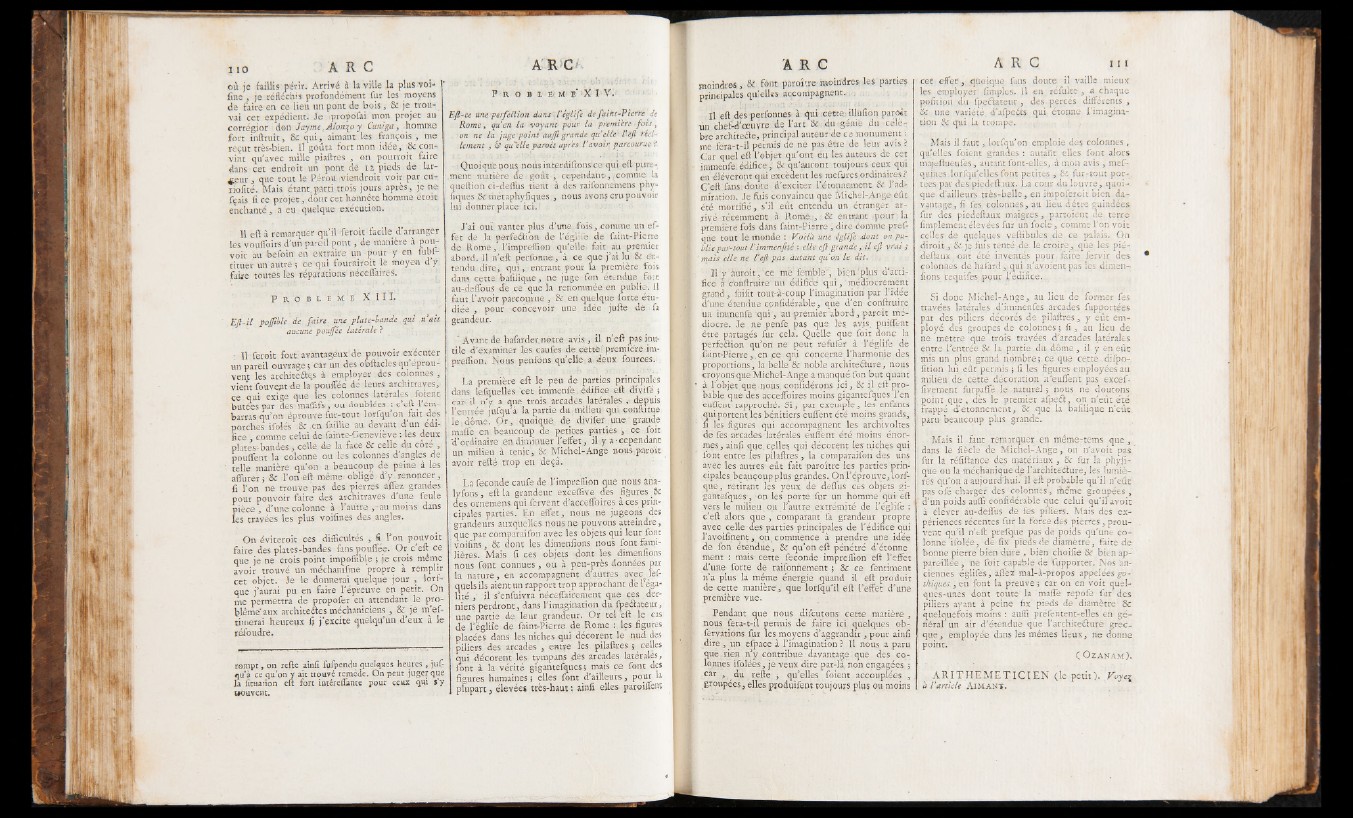
où je faillis périr. Arrivé à la ville la plus voi-
fine j je réfléchis profondément fur les moyens
de faire en ce lieu un pont de b ois , & je trou-
vai cet expédient. Je .propofai mon projet au
corrégior don Jaytnc, y Cunigu3 homme
fort inftruit, & q ui, aimant les françois , me
reçut très-bien. Il goûta fort mon idée, & con-.
vint qu'avec mille piaftres , on pourrait faire !
dans cet endroit un pont dé i a pieds de lar- !
£ e u r , que tout le Pérou viendrait voir par cu-
riofité. Mais étant,parti trois jours après, je ne
frais fi ce projet,.dont cet honnête homme etoit
enchanté, a eu quelque exécution.
Il eft à remarquer qu'il feroit facile d’arranger
les vouffoirs d’un pareil pont, de manière à pouvoir
au befoin en extraire un pour y en fubf-
tituer un autre-; ce qui fournirait le moyen d'y.
faite toutes l’es réparations néceflaires.
P R O B L E ÎVÏ E X I I I.
Efi-il pojphle de .faire, une plaie-hande qui n'ait
aucune poujfée latérale ?
: Il feroit fort avantageux’' de pouvoir exécuter
un pareil ouvrage j car un des obftacles qu éprouvent
les architectes à employer .des colonnes ,
vient Couvent de la pouffée de leurs architraves,;
çe qui exige que les colonnes latérales foient
butees par des mafîlfs, ou doublées,^:c eft -1 embarras
qu’ on éprouve fur-tout lorfqu on fait des
porches ifolés 8 c .en faillie au devant d’un édifice
, comme celui de fainte-Geneviè've : les deux
plates-bandes ij, celle, de la face 8 c celle du côté ,«
pouffent la colonne ou les colonnes d’angles .de
‘ telle manière qu’on a beaucoup de peine à les
affurer ; ■ & l’on -eft même obligé d’y j renoncer ,
fi l’on ne trouve pas des pierres -allez grandes
pour pouvoir faire des architraves d’une feule
p iè c e , d’ une colonne à l’autre y au moins dans
les travées les plus voifines des . angles.
On éviteroit ces difficultés , fi l’ on pouvoir
faire des plates-bandes fans pouffée. Or c’ eft ce
que je ne crois point impofiVble ; je crois même
avoir trouvé un méchanifme propre à remplir
cet objet. Je le donnerai quelque jour , lorf-
que j’aurai pu en faire l’épreuve en petit. On
me permettra de propofer en attendant le problème
aux architectes méchaniciens, & je m’ef-
timerai heureux fi j’excite quelqu’un d’eux à le
téfoudre.
rompt, on rcfte ainfi fufpendu quelques heures , juf-
qu’à ce qu’on y ait trouvé remède. On peut juger que
la fituarion eft fort intéreffante pour ceux qui s’y
wouvent.
P R O B L Ef M R X I V .1
Eft-ce une perfection dans-Véglife de faitit-Vterre <lt
Rome, qu en la \voyant pour la prentiére ‘fo ls ,
on ne la juge'point üujjigrande qu elle' llefe réellement
,• & qu'elle paroît après. V avoir parcourue '?
: Quoique qous nous interdifions'-ce qui eft pure-
.ment matière degoût j cependant),/comme la
queftion ci-deffus tient à des raifonnemens phy-
uques métaphyfiques,, nous avons cru pouvoir
lui donner place ici. ■'
J’ai ouï vanter plus d’une fois ,.comme un effet
de la perfection de l’églife de faint-Pierre
de Rome, . l’impreffion qu’elle» fait au premier
abord. Il n’ eft perfonne j à ce que j’ai lu 8 c Entendu
dire, q u i, entrant pour la première fois
dans, cette bafilique, ne juge fon étendue fort
au-deffous de .ee que la renommée en publie. Il
faut .l’avoir parcourue , & en quelque forte étudiée
, pour concevoir une idée jufte de fa
grandeur.
; " Avant de hafarder.notre avis-, il n’eft pas inutile
d’ examiner les caufes de. çettèf première im-
; preffion. Nous penfôns qu elle . à deux fources.
• La première eft le peu de parties principales
1 dans lesquelles cet immenfe ; édifice eft divifé »
' car il n’y a. que trois- arcades latérales depuis
l’entrée jufqu à la partie du »milieu qui conftitiie
le; dôme. Or , quoique, de d ivifer,une, grande
maffe en beaucoup de petites parties 4 ce foit
'd’ordinaire en diminuer l’effet, il y a - cependant
un milieu à tenir , & Michel-Ange nous.parok
; avoir refté trop en deçà.
La fécondé caufe de l’imprelfion que nous ana-
lyfons, eft la grandeur exceffive des figures
des ornemens qui fervent d’acceffoires aces principales
parties. En effet, nous me jugeons des
grandeurs auxquelles nous ne pouvons atteindre,
que par comparaifon avec les objets qui leur font
j voifins, & dont les dimenfions nous font fami-
lières. Mais fi ces objets dont les dimenfions
nous font connues, ou à peu-près données par
la nature, en accompagnent d’autres avec_ lesquels
ils aient un rapport trop approchant de l’égalité
, il s’ enfuivra néceffairement que ces derniers
perdront, dans l’imagination du fpedateur,
une partie de leur grandeur. Or tel eft le cas
de l’égliîe de faint-Pierre de Rome : les figures
placées dans les niches qui décorent le nud des
piliers des arcades', entre les pilaftres}, celles
qui décorent les tympans fies arcades latérales,
font à la vérité gigantefques } mais ce font des
figures humaines } elles font d'ailleurs, pour la
plupart | élevées très-haut ; ainfi elles paroiffent
moindres * & font, paraître moindres; .les parties
principales qu’elles accompagnent., >
Il eft des perfonnes à qui feette) illufion paroît
un chef-d’oeuvre de^ l’art 8c ; »du •. génie du célèbre
architecte, principal auteur de ce monument :
me féra-t-il permis de ne pas être de leur avis ?
Car quel eft l’objet qu’ont éu les auteurs de cet
immenfe; édifice, &: qu’auront toujours ceux qui
en .éléverbnt qui excèdent les raefures'ordinaires?
C’eft fans, douté d’exciter l’étonnement & l’admiration.
Je fuis convaincu que Michel-Ange-eût
été mortifié , s’il eut entendu un étranger ar- !
rivé récemment. à Rome.:, r & èntrant po.ur -, la
première fols dans faint-Pièrre, dire comme pref-
qde tout lé monde : Voila, une êglife dont on publie
par-tout l ’immenfe té ■ elle eft grande 9 il efi vrai ;
1 mais elle ne t efi pas autant quon le dit.
■ l l i r à û r d i t / c e tue féififcle', bien’plus d’ artifice
a ‘cbhftruire un édifice q u i, 'médiocrement
grand, faillît tout-à-coup l’imagination par l’rdée
d’une étendue cpnfidérable, que d’ en conftruire
un immenfe q u i, au premier abord, paroît médiocre.
J e . ne penfe pas que, l,es. avis, puiffent
être partagés fur cela. Quelle que foit donc la
perfection qu’on ne’ peut refufer à l’eglife de
faint-Pierreen ce qni concerner harmonie des
proportions, la belle & noble architecture, nous
croyons que Michel-Ange a manqué fon but quant
à, l’objet que nous, cpnfidéron.s ic i, & il eft probable
que des acceffoires moins gigantefques l’en
euffent rapproché: S i , par exemple, les enfants
qui portent les bénitier.s euffent été moins grands,
fi les figures qui accompagnent les archivoltes
de fes arcades latérales euffent été moins énormes,
ainfi que. celles qui décorent les niches qui
font entre les pilaftres, la comparaifon des uns
avec les autres’ eût fait paroître les parties principales,
beaucoup plus grandes. On l’éprouve,lorf-
que, retirant les yeux de deffus ces objets gigantefques,
on les porte fur un homme qui eft
vers le milieu, ou .l’autre extrémité de l’églife :
c’eft alors q u e , comparant fa grandeur propre
avec celle des parties principales de l’édifice qui
l’avoifinent, on .commence à prendre une idée
de fon étendué, & qu’on eft pénétré d’étonne
ment : mais cette fécondé impreffion eft l’effet
d’une forte de raifpnriement j & ce fentiment
n’ a plus la même énergie quand il eft produit
de cette manière, que lorfqu’il eft l’effet d’ une
première vue.
Pendant que nous difeutons cette matière ,
nous fera-t-il permis de faire ici quelques ob-
fervations fur les moyens d’ aggrandir , pour ainfi
dire, un efpace à l’imagination ? Il nous a paru
que rien n’y contribue davantage que des colonnes
ifoléës, je veux dire par-là, non engagées 5
câr du refte j qu’elles foient accouplées ,
groupées, elles produifeot toujours plus ou moins
cet e ffe t, quoique fans doute il vaille mieux
les employer’ fimples. Il en réfulte, à chaque
pofitipil du fpeélateur, des percés différents ,
& une variété d’afpeéts qui étonne l'imagination
.|| qui la trompe. •
Mais il fau t, lorfqu’ on emploie des colonnes ,
qu’elles foient grandes : autant elles font alors
majeftueufes, autant font-elles, à mon avis, mef-
qiijnes.lorfqu’eiles font petites , & fur-tout por-,
tées par desipiedeftaux. La cour du louvre, quoique
d’ailleurs très-belle, en impoferoit bien davantage,
fi fes colonnes, au lieu d être guindées
fur des piedeftaux maigres, partoient de terre
fimplement élevées fur un focle, comme l’on voit
celles de quelques vefti.bules de ce palais. On
diroit., 8 c je fuis tenté de. le croire, que les pié-
deftaux. ont été inventés pour faire fervir des
colonnes de hafard, qui n’avoient pas les diraen-
fions requifes pçur l’édifice.
Si donc M ich e l-A n g e au lieu de former fes
travées latérales d’immenfes arcades fupportées
par des piliers décorés de pilaftres, y eût employé
des groupes de colonnes 5 f i , au lieu de
ne mettre que trois travées d’arcades latérales
entre l’entrée & la.partie du dôme, il y en eût
mis un plus grand nombre j. ce que cette difpo-
fition lui eût permis 5 fi les figures employées au
milieu de cette décoration n’euffent pas excef-
fiv.eraent furpaffé -le naturel ; nous ne doutons
point que, dès le premier afpeét, on n’eût été
frappé ffétonnement, & que la bafiiique n’eût,
paru beaucoup plus grande.
Mais il faut remarquer en même-tems q ue ,
dans le fiècîe de Michel-Ange, on 11’avoit pas
fur la réfiftance des matériaux, & fur la physique
ou la méçhanique de l’architeélure, les lumiè-
rés qu’on a aujourd’hui. 11 eft probable qu’il n’eût
pas ofé charger des colonnes, meme groupées ,
• d’un poids auffi cônfîdérable que celui qu’il avoit
; à élever au-deffus de fes piliers. Mais des expériences
récentes fur la force des pierres, prou-
: vent qu’il n’eft prefque pas de poids qu’une colonne
ifolée, de fix pieds de diamètre, faite de
bonne pierre bien dure , bien choifîe & bien appareillée
, ne foit capable de uipporter. Nos an-
; ciennes églifés, àffez- mal-à-propos appelées gothiques.
^ en {ont la preuve } car on en voit quelques
unes dont toute la maffe repofe fur'des
piliers ayant à peine fix pieds de diamètre &
quelquefois moins : auffi préfentent-elles en général
un air d’ étendue que l’architeéhirè grecque,
employée dans les mêmes lieux, ne donne
| point.
| O z a n a m ).
A R I T H E M E T I C I E N (le petit ), Voye^
a l ’article A im a n t .