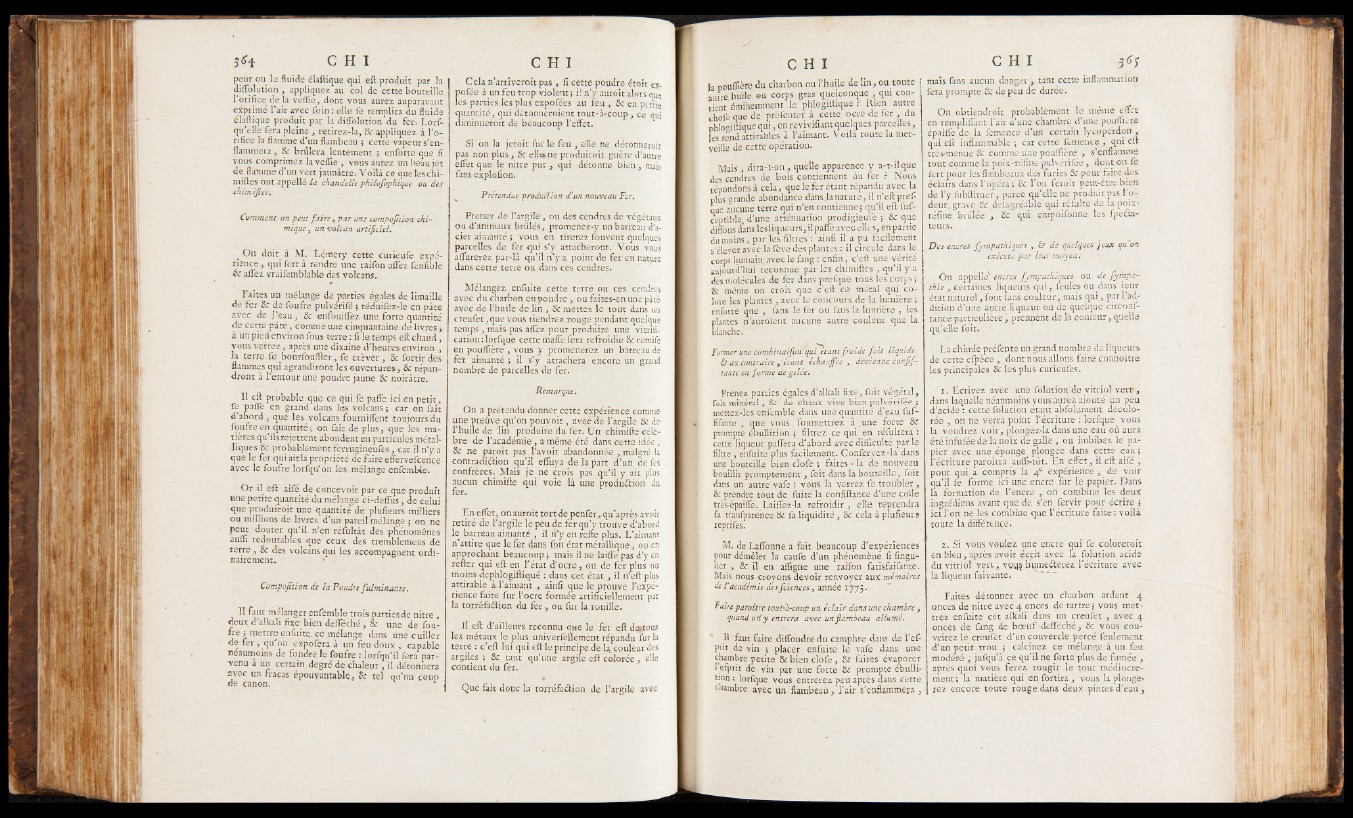
3 * 4 C H I
peur ou le fluide élaftique qui eft produit par la
diflolution , appliquez au col de cette bouteille
l’orifice delà veflie, dont vous aurez auparavant
exprimé l’air avec foin : elle fe remplira du fluide
élaftique produit par la diflolution du fer. Lorf-
qu’elle fera pleine , retirez-la, & appliquez à l’orifice
la flamme d’ un flambeau j cette vapeur s’enflammera
3 & brûlera lentement 5 enforte que fi
vous comprimez la veflie y vous aurez un beauiet
de flamme d’ un vert jaunâtre. Voilà ce queleschi-
miftes ont appellé la chandelle pkilofophique ou des
chimiftes.
Comment on peut faire, par une compofttion chimique
, un volcan artificiel.
. On doit à M. Lémery cette curieufe expérience
j quiVert à rendre une raifon allez fenfible
& aflez vraifemblable des volcans.
Faites un mélange de jparties égales de limaille
de fer & de foufre pulvérifié 5 réduifiez-le en pâte
avec de J’eau, & enfoulfl'ez une forte quantité
de cette pâte, comme une cinquantaine de livres,
a un pied environ fous terre : fi le témps éft chaud ,
vous verrez , après une dixaine d’heures environ ,
la terre fe bourfouffler, fie crèver , & fiortir des
flammes qui agrandiront les ouvertures, & répandront
à l’entour line poudre jaune & noirâtre.
Il eft probable que ce qui fie pafle ici en petit *
fe pafle en grand dans les volcans.} car on fiait
d’abord, que les volcans fourniflent toujours du
fpufre en quantité-, on fiait de plus^ que les matières
qu’ ils rejettent abondent en particules métalliques
& probablement ferrugineufes, car il n’y a
que le fer qui ait la propriété de faire efferveficence
avec le foufre lorfqu’on les mélange enfiemble.
Or il eft aifié de concevoir par ce que produit
une petite quantité du mélange ci-deflus, de celui :
que produiroit une quantité de plufîeurs milliers
ou millions de livres d’ un pareil mélange 5 on rie
peut douter qu il n’en- réfultât des phénomènes
aufli redoutables que ceux des tremblemens de
terre 3 & des volcans qui les accompagnent ordinairement.
’ .
Compojttion de la Poudre fulminante.
Il faut mélanger enfiemble trois parties de nitre,
deux d’ alkali fixe bien defleché , & une de foufre
5 mettre enfuite^ ce mélange dans une cuiller
de fe r , qu’ on expofera à un feu doux , capable
néanmoins de fondre le foufre : lorfqu’il fiera parvenu
a un certain degré de chaleur , il détonnera
avec un fracas épouvantable, & tel qu’nn coup
de canon.
C H I
Cela n’arriveroit pas , fi cette poudre étoit ex-
pofiée à un feu trop violent,} il n’y auroit alors que
les parties les plus expofees au fe u , & en petite
uantité, qui détonneroient tout-à-coup, ce qui
iminueroit de beaucoup l’effet.
Si on la jetoit fur le fe u , elle ne détonneroit
pas non plus, & elle»ne produiroit guère d’autre
effet que le nitre pur , qui détonne bien, mais
fans explofion.
Prétendue production d’un nouveau Fer.
Prenez de l’argile, ou des cendres de végétaux
ou d’animaux brûlés, promenez-y un barreau d’acier
aimanté} vous en tirerez fouvent quelques
parcelles de fer qui s’y attacheront. Vous voiis
aflurerez par-là qu’il n’y a, point de fer en nature
dans cette terre ou dans ces cendres.
Mélangez enfuite cette terre ou ces cendres
avec du charbon en poudre , ou faites-en une pâte
avec de l’huile de lin , & mettez le tout dans un
creufet, que vous tiendrez rouge pendant quelque
temps, mais pas aflez pour produire une vitrification
rlorfique cette mafle fiera refroidie & remife
en pouflière , vous y promènerez un barreau de
fer aimanté} il s’y attachera encore un grand
nombre de parcelles de fer.
Remarque.
On a prétendu donner cette expérience comme
une preuve qu’on pouvait, avec de l’argile & de
l’huile de lin produire du fer. Un chimifte célèbre
de l’académie, a même été dans cette idée,
& ne paroît pas l ’avoir abandonnée ,. malgré la
contradièlion qu’il efîuya de la part d’un de fies
confrères. Mais je ne crois pas qu’il y ait plus
aucun chimifte qui voie là une production du
fer.
En effet, on auroit tort de penfier, qu’après avoir
retiré de l’argile le peu de fer qu’y trouve d’abord
le barreau aimanté , il n’y en refte plus. L’aimant
n’attire que le fer dans fon état métallique, ou en
approchant beaucoup} mais il ne laifle pas d’y en
refter qui eft en l’état d’ocre, ou de fer plus ou
moins dephlogiftiqué : dans cet état , il n’eft plus
attirable à. l’aimant , ainfi que le prouve l’expérience
faite fur l’ocre formée artificiellement par
la torréfaction du fer , ou fur la rouille.
Il eft d’ailleurs reconnu que le fer eft de^tous
les métaux le plus univerfellement répandu fur la
terre : c’eft lui qui eft le principe de la_ couleur des
argiles } & tant qu’une argile eft colorée, elle
contient du fer.
Que fait donc la torréfaction de l’argile avec
C H I
Ja pouflîère du charbon ou l’huile de lin, ou toute
autre, huile ou corps gras quelconque , qui contient
éminemment le phlogiftique ? Rien autre
chofie que de préfenter à cette ocre de f e r , du
phlopiftiquequi, en revivifiant quelques parcelles,
[es rend attirables a 1 aimant. Voila toute la merveille
de cette opération.
Mais, dira-t-on, quelle apparence y a-t-il que
des cendres de bois contiennent du fer ?. Nous
répondons à cela, que le fèr étant répandu avec la
plus grande abondance dans Ja nature, il n’eft prefi-
que aucune terre qui n’en contienne'} qu’il eft fiufi-
ceptible^ d’une atténuation prodigieufe } & que
dirions dans les liqueurs, il pafle avec elles, en partie
du moins, par les filtres : ainfi il a pu facilement
s’élever avec,la fève des plantes : il circule dans le
corps humain, avec le fang : enfin, c’eft une vérité
aujourd’hui reconnue par les chimiftes , qu’il y a
des molécules de fer dans prefque tous les corps}
& même on croit que. c’eft ce métal qui colore
les plantes, avec le concours de la lumière >
enforte que , fans le fer ou fans la lumière , les
plantes n’auroient aucune autre couleur que la
blanche.
Former une c om b in a ifo n q u i é ta n t f r o id e f o i t liq u id e
& ad contraire 3-étant échauffée , devienne confif-
• tante en fgrme de gelee.
Prenez parties égales d’alkali fixe, foit végétal,
■ foit minéral, & de chaux vive bien pulvérifée }
mettezdes enfiemble dans une quantité d’eau fiuf-
fifante , que vous fioumettrez à „une forte &
prompte ébullition } filtrez ce qui en réfultera :
cette liqueur pafiera d’abord avec difficulté par le
filtre, enfuite plus facilement. Confervez-la dans
une bouteille bien clofie } faites-la de nouveau
bouillir promptement , foit dans la bouteille, foit
dans un autre vafe : vous la verrez fie troubler ,
& prendre tout de fuite la confiftance d’une colle
très-épaiffe. Laiflez-la refroidir , elle reprendra
fa tranfparence & fa liquidité, & cela à plufîeurs
reprifies. ;
M. de Laflonne a fait beaucoup d’expériences
pour démêler la caufe d’un phénomène fifingu-
lier , & il en afligne une raifon fatisfaifante.
Mais nous croyons devoir renvoyer aux mémoires
de V 'académie des fciencest année 1773.
Faire paraître tout-a-coup un éclair dans une chambre ,
quand otiy entrera avec unfiambeau allumé
H faut faire diffoudre du camphre dans de l’efi-
prit de ^vin } placer enfuite le vafe dans une
chambre petite & bien clofie, 8r faites évaporer
1 efprit de vin par une forte & prompte ébullition
; lorfque vous entrerez peu après dans cette
cnambre avec un flambeau, l’ air s’enflammera,
c h i m t
mais fans aucun danger, tant cette inflammation
fiera prompte & de peu de durée.
On obtiendroit probablement le même effet
en rempliffant l’air a’une chambre d’ une pouflicre
épaiffe de la femence d’un certain lycoperdon ,
qui eft inflammable 3 car cette femence , qui eft
très-menue & comme une pouflière , s’enflamme
tout comme la poix-réfine pulvérifée, dont on fie
fiert pour les flambeaux des furies & pour faire des
éclairs dans l’opéra; & l’on feroit peut-être bien
de l ’y fubftituer, parce qu’elle ne produit pas l'odeur,
grave. & défagréable qui rélulte de la poix*
réfine brûlée , & qui empoifonne les fipéclateurs.
Des encres fympathiqu.es , & de quelques jeux qu on
exécute pdr leur moyen.
On appelle*- encres, fyinpathiqifes ou de fympa-
thie , certaines' liqueurs q u i, feules ou dans" leur
état naturel, font fans couleur, mais qui., par l’addition
d’une autre liqueur ou de quelque circonfi-
tance particulière, prennent de la couleur, quelle
qu’elle fo i t .. '
La chimie pré fiente un grand nombre de liqueurs
de cette efipèce , dont nous allons faire connoïtre
les principales & les plus curieufies.
1. Ecrivez avec une folution'de vitriol vert*,
dans laquelle néanmoins vous aurez ajouté un peu
d’acide : cette folution étant abfolument décolp-
réè , on ne verra point l’écriture : lorfque vous
I la voudrez v oir , plongez-la dans une eau où aura
été infufée de la noix de galle, ou imbibez le papier
avec une éponge plongée dans cette eau}
l’écriture paroîtra aufli-tôt. En effet, il eft aifié ,
pour qui.a compris la 4e expérience, de voir
qu’il fe forme ici une encre fur le papier. Dans
la formation de l’ encre , on combine les deux
ingrédiens avant que de s’en fervir pour écrire }
ici l’on ne les combine que l’écriture faite : voilà
toute la différence.
2. Si vous voulez une encre qui fie coloreroit
en bleu, après avoir écçit avec la folution acide
du vitriol v e r t, vou§ hjimeèterez l’écriture avec
la liqueur fiuivante.
Faites détonner avec un charbon ardent 4
onces de nitre avec 4 onces de tartre} vous met *
trez enfuite cet alkali dans un creufet , avec 4
onces de fang de boeuf defleché, & vous couvrirez
le creufet d’ un couvercle percé feulement
d’un petit trou } calcinez ce mélange à un feu
modéré ,' jufqu’ à ce qu’ il ne forte plus de fumée ,
après quoi vous ferez rougir le tout médiocrement
; la matière qui ën fortira , vous la plongerez
encore toute rouge dans deux pintes d’eau,