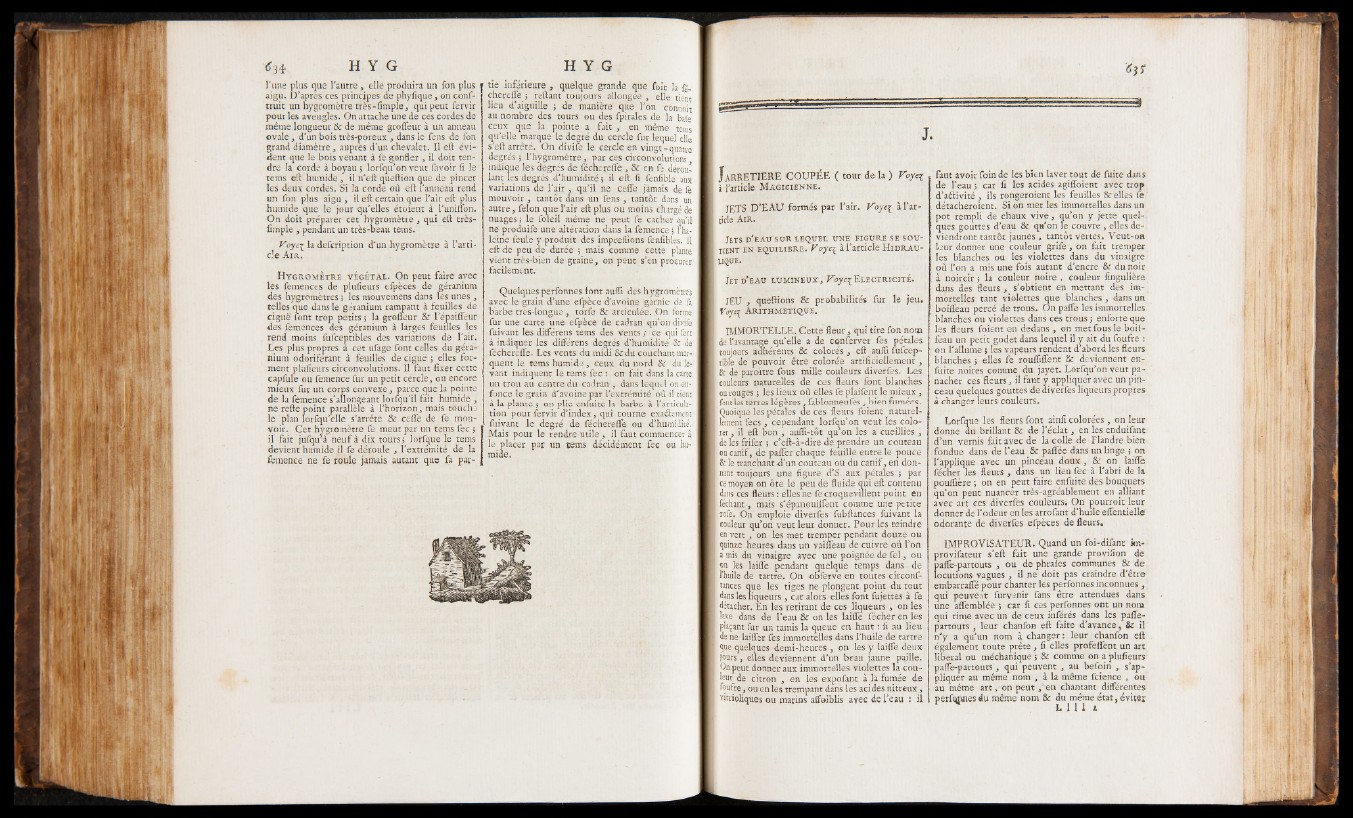
*34 H Y G
Tune plus que l’autre, elle produira un Ton plus
aigu. D’après ces principes de phyfique , on conf-
truit un hygromètre très-fimple3 qui peut fervir
pour les aveugles. On attache une de ces cordes de
même longueur & de même groffeur à un anneau
ovale 3 d’un bois très-poreux , dans le fens de Ton
grand diamètre 3 auprès d’un chevalet. Il eft évident
que le bois venant à fe gonfler , il doit tendre
la corde à boyau 5 lorfqu’ on veut favoir fi le
tems eft humide 3 il n’eft queftion que de pincer
les deux cordes. Si la corde où eft l’anneau rend
un fon plus a igu , il eft certain que l’air eft plus
humide que le jour qu’elles étoient à l’uniffon.
On doit préparer cet hygromètre , qui eft très-
fimple, pendant un très-beau tems.
Voyei la defcription d’ un hygromètre à l’article
Air,
H y g r o m è t r e v é g é t a l . On peut faire avec
les femences de plufieurs efpèces de géranium
des hygromètres 5 les mouvemens dans les unes ,
telles que dans le géranium rampant à feuilles de
ciguë font trop petits 5 la groffeur & l’épaiffeur
des femences des géranium à larges feuilles les
rend moins fufceptibles des variations de l ’air.
Les plus propres a cet ufage font celles du géra'-»*
nium odoriférant à feuilles de ciguë j elles forment
plufieurs circonvolutions. Il faut fixer cette
capfule ou femerice fur un petit cercle, ou encore
mieux fur un corps convexe., parce que la pointe
de la femence s’ allongeant lorfqu’il fait humide 3
ne reftepoint parallèle à l’horizon, mais touche
le plan lorfqu’elle s’arrête & ceffe de fe mouvoir.
Cet hygromètre fe meut par un tems fec ;
il fait jufqu’à neuf à dix tours j lorfque le tems
devient humide il fe déroule , l’extrémité de la
femence ne fe roule jamais autant que fa par-
H Y G
tie inférieure , quelque grande que foit la fé-
chereffe ; reftant toujours allpngee, elle tient
lieu d’aiguille j de manière que l’on connoît
au nombre des tours ou des fpirales de la bafe
ceux que la pointe a fait , en, même tems
qu’elle marque le degré du cercle fur lequel elle
s'eft arrêté. On divife le cercle en vingt-quatre
degrés 5 l’hygromètre, par ces circonvolutions
indique les degrés de féchereffe , & en fe déroulant
les degrés d’humidité j il eft fi fenfible aux
variations de l ’air , qu’il ne ceffe jamais de fe
mouvoir, tantôt dans un fens , tantôt dans un
autre, félon que l’air eft plus ou moins chargé de
nuages 5 le foleil même ne peut fe cacher qu’il
ne produife une altération dans la femence ; lJha-
leine feule y produit des impreflîons fenfibles. Il
eft de peu de durée > mais comme cette plante
vient très-bien de graine, on peut s’en procurer
facilement.
Quelques perfonnes font aufïi des hygromètres
avec le grain d’une efpèce d’avoine garnie de fa
barbe trè s -lo n gu e to r fe & articulée. On forme
fur une carte une efpèce de cadran qu’on divife
fuivant les différens tems des vents; ce qui fert
à indiquer les différens degrés d’humidité & de
,-féchereffe. Les vents du midi & du couchant marquent
le tems humide, ceux du nord & du levant
indiquent le tems fec : on fait dans la carte
un trou au centre du cadran , dans lequel on enfonce
le grain d’avoine par l’extrémité où il tient
à la plante 5 on plie enfuite la barbe à l’articulation
pour fervir d’index , qui tourne exactement
fuivant le degré de féchereffe ou d’humidité.
Mais pour le rendre utile, il faut commencer à
le placer par un tems décidément fec ou humide.
J.
J a r r e t i è r e c o u p é e ( tour de la ) M g «
à l’article M a g ic ie n n e .
JETS D’EAU formés par l ’air. Voye^ à l’article
Air.
Jets d’ e a u su r l e q u e l u n e f ig u r e se so u tient
en Eq u il ib r e . Voye[ à l ’artic le H id r a u -
LIQUE.-
Jet d ’ e a u l u m i n e u x 1 M B ? E l e c t r i c i t é .
JEU , queftions & probabilités fur le jeu. Voyei ARITHMETIQUE.
IMMORTELLE. Cette fleur, qui tire fon nom
de l’avantage qu’elle a de conferver fes pétales
toujours adhérents & colorés , eft auffi fufcep-
tible de pouvoir être colorée artificiellement,
& de paroître fous mille couleurs di ver fes. Les
couleurs naturelles de ces fleurs font blanches
j ou rouges j les lieux où elles fe plaifent le m ieux,
! font les terres légères, fablonneufes, bien fumées.
r Quoique les pétales de ces fleurs foient naturèl-
j leinent fecs , cependant lorfqu’on veut les colo-
: rer, il eft bon , auffi-tôt qu’on les a cueillies ,
; de les frifer 5 c’ eft-à-dire de prendre un couteau
i ou canif, de paffer chaque feuille entre le pouce
& le tranchant-d’un couteau ou du canif, en don-
i nant toujours une figure d’S aux pétales j par
ce moyen on ôte le peu de fluide qui eft contenu
dans ces fleurs : elles ne fe croquevillent point en
féchant, mais s’épanouiffent comme une petite
riofe. On emploie diverfes fubftances fuivant la
couleur qu’on veut leur donner. Pour les teindre
! en vert, on les met tremper pendant douze ou
! quinze heures dans un vaiffeau de cuivre où l’on I a mis du vinaigre avec une poignée de fe l, ou
on les laiffe pendant quelque temps dans de
[ l’huile de tartre. On obferve en toutes circonf-
| tances que les tiges ne plongent point du tout
dans les liqueurs, car alors elles font fujettes à fe
détacher. En les retirant de ces liqueurs , on les
lave dans de l’eau & on les laiffe fécher en les
plaçant fur un tamis la queue en haut : fi au lieu
de ne laiffer fes immortelles dans l’huile de tartre
■ que quelques demi-heures , on les y laiffe deux
! jours, elles deviennent d’un beau jaune paille.
On peut donner aux immortelles violettes la couleur
de citron , en les expofant à la fumée de
foufre, ou en les trempant dans les acides nitreux,
vitrioliques ou marins affoiblis avec de Peau : il
faut avoir foin de les bien laver tout de fuite dans
de l’eau j car fi les acides agiffoient avec trop
d’aélivité , ils rongeroient les feuilles & elles fe
détacheroient. Si on met les immortelles dans un
pot rempli de chaux v iv e , qu’on y jette quelques
gouttes d’eau & qu’on le couvre, elles deviendront
tantôt jaunes , tantôt vertes. Veut-on
k u r donner une couleur grife, on fait tremper
les blanches ou les violettes dans du vinaigre
où l’on a mis une fois autant d’encre & du noir
à noircir j la couleur noire , couleur fingulière
dans des fleurs , s’obtient en mettant des immortelles
tant violettes que blanches, dans un
boiffeau percé de trous. On paffe les immortelles
blanches ou violettes dans ces trous ; enforte que
les fleurs foient en dedans , on met fous le boi(-
feau un petit godet dans lequel il y ait du foufre :
on l’allume ; les vapeurs rendent d’abord les fleurs
blanches ; elles fe rouffiffent & deviennent en-
fuite noires comme du jayet. Lorfqu’on veut panacher
ces fleurs, il faut y appliquer avec un pinceau
quelques gouttes de diverfes liqueurs propres
à changer leurs couleurs.
Lorfque les fleurs font ainfi colorées , on leur
donne au brillant & de l’é c la t, en les enduifanc
d’un vernis fait avec de la colle de Flandre bien
fondue dans de l’eau & paffée dans un linge ï on
l’applique avec un pinceau d ou x , & on laiffe
fécher les fleurs , dans un lieu fec à l’abri de la
pouffière î on en peut faire enfuite des bouquets
qu’ on peut nuancer très-agréablement en alliant
avec art ces diverfes couleurs. On pourroit leur
donner de l’odeur en les' arrofant d’huile effentielltf
odorante de diverfes efpèces de fleurs.
IMPROVISATEUR. Quand un foi-difant im-
prôvifateur s’eft fait une grande provision de
paffe-partouts , ou de phrafes communes & de
locutions vagues , il ne doit pas craindre d’être
embarraffé pour chanter les perfonnes inconnues ,
qui peuvent furvenir fans être attendues dans
une affemblée 3 car fi ces perfonnes ont un nom
qui rime avec un de ceux inférés dans les paffe-
partouts , leur chanfon eft faite d’avance, & il
n’y a qu’un nom à, changer: leur chanfon eft
également toute prête, fi elles profeffent un art
liberal ou méchanique j & comme on a plufieurs
paffe-partouts , qui peuvent , au befoin , s’appliquer
au même nom , à la même fcience , ou
au même art ,'on peut en chantant différentes
perfonnes du même nom & du même état, éviter
^ L 1 1 I 1