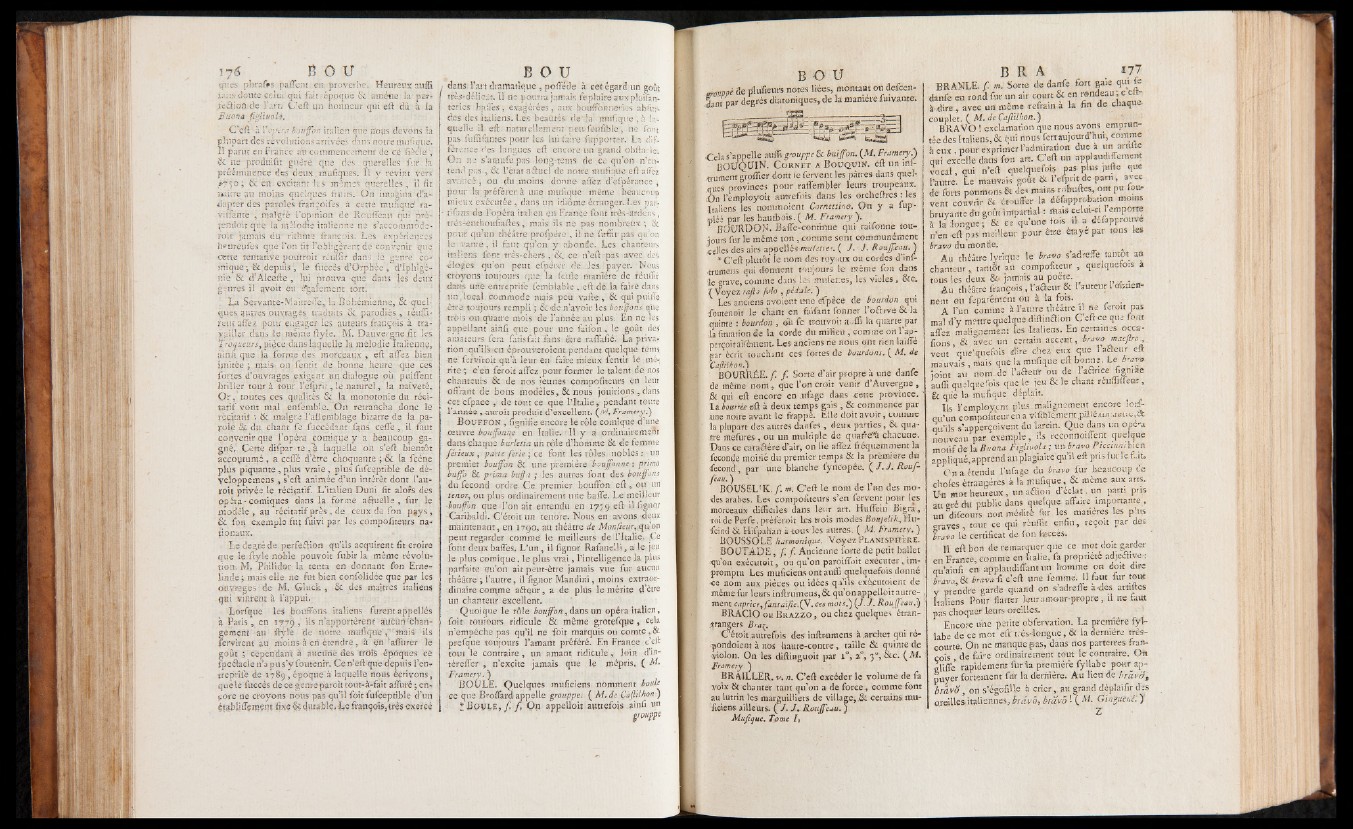
t 7 6 B O U
ques phraf#s paftent en. proverbe. Heureux auffi
i;tns-doute celui qui fait époque Se amène lap e r -
/eclioft de Fart, C ’eft un honneur qui eft dû à la
'M’.tona f i g l i u o l i .
C ’eft -à Y-opéra b o u ffo n italien: que ;iïous devons la
pinpart des ré vol vufions arrivées dans notre nïuficfué.
II parut en France au ci)mmenc ement de ce fiée le1',
ne produifit giièrè que d<:s . q\lereîles fur -, la
prééminence des cleux.mufiques. Î1 y revint Vers-'
; Ôè en excttahr 1es mènV2S q1uçrelles , il fit
m icre au moins qiiielqi;les- finirs. Oiî iinakinà' d’aprer
des paroles fran çoifes à; cette miifique’ ratfante
, malgré l’opinion de Rcu Beau qui préfêndoit
qüe la ifiêl odis italienn e ne s^accommoderoir
jamais du' rit:hme franc ois. Le:s expériences
h^ureufes que l’on fit FôbîigèÉèn? dé convenir que
cette tentative pourrait réuffir dans le genre cô- !
mique ; & depuis j le fuccès d’Orphée j d’Iplugér ■
nie & d’Alcefte , lui prouva-que dans les deux'
genres il qvoit eu également tort!
. La Sêryante-MaîtreiTe, la Bohémienne, & quel- ;j
ques autres ouvrages traduits & parodiés , réufTi-
fent affez pour engager les auteurs françois à travailler
dans Je même ftyle. M. Dauvergne fit les
Tr'oqueurs, pi|ee dansl^quelle la mélodie Italienne,
a in fi que la forme des. morceaux , eft allez bien .
imitée ; mais on fenrit de bonne heure que ces !
fortes d’ouvrages exigent un dialogue où puiflent
briller tour à tour l’efprù, le naturel, la naïveté.
O r , toutes ces qualités & la monotonie du réei-
tafif vont mal enfemble. On retrancha donc le
récitatif *, 8ç malgré l’afiçmblage bizarre de la parole
% du chant fe faccédant fans celle , il faut
convenir que l’opéra comique y a beaucoup ga-,
gné, Cette difpar-te , a laquelle on s’eft bientôt
accoutumé , a çelTé d’être choquante ; & la fcène
plus piquante, plus vraie , plus fufcqptible de dé-
veloppemëns,, s’eft animée d’un intérêt dont l’au-
roit privée le récitatif. L ’italien Duni fit alors des
ppéra - comiques dans là forme aéfuelle , fur le
modèle , aq récitatif près , de. ceux de fon pays|
$ c fon exemple fut fiiiyi par les çompofiteurs nationaux.
Le degré de, perfeéKon qu’ils acquirent fit croire
que le .ftyle noble pouvoir fubir la même révolu-?
tion. M. Philidor la tenta en donnant fon Erne-
tinde.; mais elle ne fut bien confolidée que par les
ouvrages de M. G lu ck , & des maîtres italiens
qui vinrent à l’appui.
Lorfque les bouffons italiens furent appellés
à Paris , en 1779 , ils n’apportèrent âiièûfi'chan-
gément au ftyle- de notre mufiqueY'mais ils
fervirent au moins â en étendre, à bn affurer le
goût ; cependant a aucü'rié des trôîs époques ce
fpeéfacle n’a pu s’y foutenrr. Ce n-’eft que depuis l’en?
treprïfe de 178.9, époque à laquelle nous écrivons,
que lé fuccès de ce genre paroît tout-à-fait affuré ; en? •
çore ne croyons nous pas qu’il foit fufceptible d’un
çf^blùTfmçnt hxç §ç durable, Le frapçois, très oxéiçé
b o u
I dans l’art dramatique , poftede à cet égard un goût
très-délicàt, Il ns pourra jamais feplnire auxplaifan-
teries baffes, exagérées, aux bouffonneries abfur-
d.es des italiens. Les beautés- c-!e'-ia mufique , à laquelle
il eft: naturellement peivfenftble, ne font
pas fufnfantes pour les lui taire fiipporter. La différence
H es langues eft encore un grand obftarle.
On ne s’amufepas long-tetns de ce qu’on-n’en-
ténd pas , & l’état aftuel de notre mufique eft aflèz
avancé, ou du moins donne afiez d’efpérance ,
pour la préférer, à une mufique même beaucoup
mieux exécutée , dans un idiome étranger.-Le's par-
- tifnns deTopéra italien en. France font rrès-àrdens,
très-enthoufiaftes, mais: ils ne pas nombreux y &
peuri qu’un théâtre profpére , il ne fiiffirpas qu’on
le vante, il faut qu’on y abonde. Les chanteurs
-italiens font très-chers ^ ce n’eft: pas avec des
éloges qu’on peut efpèrer de:.des. payer. Nous
croyons toujours que là feule manière de féuflir
dans une entreprife l’emblable , eft.de la faire dans
unrlocal commode niais peu vafte , & qui puilTq
.être toujours rempli & de n’ayoir les bouffons que
trois ou quatre mois de l’année au plus. En ne; les
appellant ainft que pour une faifon, le goût des)
amateurs fera fatisfait jfans être rafTafié, La privai
tion qù’ils-en éprouveraient pendant quelque tërns
ne ferviroit qua leur en faire mieux fentir le mé-<
rite ; c’en feroit aflez pour former le talent;de-nos
chanteurs & de nos jeunes çompofiteurs § n leur
offrant de bons modèles ,& nous jouirions, dans
-eet efpace de tout ce que l’ Italie ,- pendant toute
l ’année, aurait produit d’excellent. (M, F ram e r y f)
Bouffon , fignifie encore le rôle comique d’une
oeuvre bouffonne e n Italie, r II y a ordinaire m sut
dans chaque hurletta un rôle d’homme & de femme
fé r ie u x , p a rte fe r le ; ce font les rôles, nobles t - un
premier bouffon & une- première bouffonne : primo
buffo&L p 'im a buffa ; les autres font des bouffons
du fécond ordre, Ce. premier bouffon eft , oui un
ténor, ou plus ordinairement uiie baffe. Le meilleur
-bouffon que l’on ait entendu en 1779 eft’ H ft§nQr
Caribaldi. C ’étoit un tendre. Nous en avons -deux
maintenant, en 1790, au théâtre de Mo n fieü r^q ffo v
peut regarder comme' le meilleurs de l’Italie. Ce
font deux baffes. L ’un , il fignor Rafanelli, a le. jeu
le plus comique, le plus v ra i, l’intelligence la | l#
parfaite qu’on ait peut-être jamais vue fur aucun
théâtre ; l’autre, il fignor Mandini, moins extraordinaire
comme aâqur, a de plus le mérite d’être
un chanteur excellent.
Quoique le rôle b o u ffo n , dans un opéra italien,
foit touiours ridicule & même grotefqite , cela
n’empêche pas qu’il ne foit marquis ou comte, &
prefque toujours l’amant préféré. En France c’eft
tout le contraire, un amant ridicule, loin d’in**
téreffer , n’exçite jamais que le mépris, ( M*
F ramer y . ) ■'
BOULE. Quelques mufieiens nomment boule
c e que Brofîârd appelle grouppe; ( M . de Çàjlilhon )
J Bou l e , f ƒ, Ou appelloit autrefois ainfi un
jrouppe
B O U
miippi 3e # ■ * * * notes lîées’ montaBt m <lercen-
5ant par degrés diatoniques, de la manière iuiv.anie;
___ ; __ fl_,
Cela s’appelle zwtfv grouppe St buiffon. (M. Framery.)
BO U Q U IN . C ornet a Bou q uin , eft un inf-
truitient grofïier dont fe fervent les pâtres dans quelques
provinces poiir raffembler leurs troupeaux.
lOn Femployoit aius-efois dans les orcheftres : les
Italiens les nommoient CorAettino. On y a fup-
-pléé par les hautbois. ( M. Framery).
' BOURDON. Baffe-continue qui raifonne toujours
fur le même ton, comme sont communément
.celles des airs appeftbs mufette r. ( J. J. R ouffeau. )
* C’eft plutôt lé nom des tuyaux ou cordes d’infi-
ttrumens qtii donnent toujours le Esêmë fon dans
le grave, comme dans les mufenes, les vicies > Sic.
ƒ Voyez raflo foîo , pédale. ) .
Les anciens avolent une dfpèce de bourdon qui
foutenoir le chant en faifant fonner l ’oâa'Ve & la
quinte : bourdon , où fe trou voir a.iffi la quarte^ par
la fituarion de la corde du miheu , comme on l’ap-
perçoirailement. Les anciens ne nous qirt rien laiffé
par écrit touchsnt ces fortes de bourdons, ( M. de
Cafflhon.')
BOURRÉE, f . f . Sorte d’air propre à une danfe
de même nom, que l’on croit venir d’Auvergne,
.& qui eft encore en .ufage dans .cette province. '
La bourrée && à detix temps gais , & commence par
une noire avant le frappé. Elle doit avoir, comme
la plupart des autres danfes , deux, parties, & quatre
mefures , ou un multiple de quatre^ chacune.
Dans ce caractère d’air-, on lie a fiez fréquemment la
fécondé moitié du premier temps & la prêmiare du
>fecorîd , par une blanche lyrtcopée. J. J. Rouf-
feau. )
BOUS EL? K. ƒ. m. C ’êft le nom de l’un des modes
arabes. Les çompofiteurs s’en fervent pour les
morceaux difficiles dans lecr art. Huffeiu Bigra, |
•roidePerfe, préfèrok les trois modes Boujdik^Hn-
feind & Hifpahan à tous les autres. ( M. Framery. )
BOUSSOLE harmonique. V O y e z PLANISPHERE.
BOUTADE, /. ƒ. Ancienne forte de petit ballet
•qu’on exécutoit , ou qu’on paroiffoit exécuter, impromptu
Les mufieiens ont auffi quelquefois donné
■ ce nom aux pièces ou idées qu’ils exècutoient de
même fur leurs inftrumens,& qu’on appelloit autre- 5
ment caprice, fantaijie.(V. ces motsf) (J. J. Rouffeau.j) |
BRACIO ou Br a z zo ^ ou chez quelques étran-
^rangers Bra^.
C ’étoit .autrefois des inftmmens à.archet qui ré-
pondoient à nos haute-contre, taille & quinte de
violon. On les dtftinguoit par i° , 2°, 3“, &e. ( M.
Framery. )
BRAILLER, v. n. C ’eft excéder le volume de fa
voix & chanter tant qu’on a de force, comme font
au lutrin les marguiliiers de viliage,.& certains nm-
ficiens ailleurs. ( J. J . Rouffeau. )
Mufique. Tome TJ
B R A 177
BRANLE, f . m . Sorte de dante fort gaie q“ ' "
danfe en rond far un air court & eu rondeau ; c ett-
à .dire., avec un même refrainà 1a fin de chaque
couplet. ( M . de CaJHVion.’)
BRAVO ! exclamation que nous avons empruntée
des Italiens, & qui nous fertaujourd’hui, comme
à eux , pour exprimer l’admiration due à un amlte
ont excelle dans fon art. C’eft un applaudtffemet*
vocal, qui n’eft quelquefois pas: plus jufte que
l’autre. Le mauvais goôt & l’ rfpnt de p aru, avec
de forts poumons & des mains robuftes, ont ptt tou-
vent couvrir & étouffer la dé&pprobanon moins
bruyante dtr goût impartial : mais celui-ci 1 emporte
à la longue-; & ce qu’une fois >1 a defapproirve
n’en-eft pas meilleur pour être étaye par tous les
bra v a riumonde.
Au théâtre lyrique le b ra v o s’adre-ffe tantôt an
chanteur J tantôt an compofiteur , quelquefois a
tous les deux Sfj jamais au poète. •
Au théâtre .fr'anÇois , l’aaeur & 1 auteur 1 oBaen-
nent Ou fèpar'êntent Ou a la fois.
A l’un comme à l ’antre théâtre il ne feroit pas
mal d ’v mettre quelque diftinflion C’ eft ce que font
a{fez malignement les Italiens. En certaines occa-
fions, & avec un certain accent, -bravo mac jlro
vent quelquefois dire chez eux que 1 afleur eft
mauvais , mais que la mufique eft bonne. L e » «
joint au nom. de ÆjétetCr ou de 1 aflnce Jjgniâe
auffi quelquefois qne le jeu & le chant réuffiffent,
& que ta mufique déplait.
Ils l'employant plus malignement encore lorf-
ou’ un compofiteuren a
ou’ils s’apperçoiveat du larcin. Que dans un ope-a
nouveau par exemple, ils recontroiffent quelque
motif de \ î B u a . i a F i g lw o h ; un b ra v o P r c c in m bien
appliqué, apprend au plagiaire qu’il eft pris furie fut.
On a. étendu l’ufag.e du b ra vo iur beaucoup ce
chofes étrangères à ta mufique, & même aux arts.
Ufl mot heureux, un aCiioni d’éclat. un parti pris
an gré du public dans quelque affaire importante ,
un ’ difcours non médité fur les matières les plus
graves, tout ce qui réuffit enfin, reçoit par des
b ra vo le certificat de fon fuccès.
Il eft bon de remarquer que ce mot doit garder
en France, comme en Italie, fa propriété adjeélivei
nu’ainfi en ap'plaudiffant un homme on dott dire
brava. & b ra v a ■& e’eft une femme. 11 faut fur tout
y prendre garde quand on s’adreffe à-dos artiftes
Italiens Pour flavter leur amour-propre, il ne faut
pas choquer .leurs oreilles.
Encore une petite obfervation. La première fyt-
labe de ce mot eft très-longue, & la dernière très-
courte. On ne manqueras, dans nos parterres fran-
cois , de fai' e ordinairement tout le contraire. Oh
gliffe' rapidement fur ia première fyllabe pour ajjpuyer
fortement fur la dernière. Au lien de b r â v i f ,
b r a v o , on s'egofiRe à crier, au grand déplâifir des
oreillesitaliehnes, b r a v o , b r a v o ! ( AL G in g u c o é . )
Z