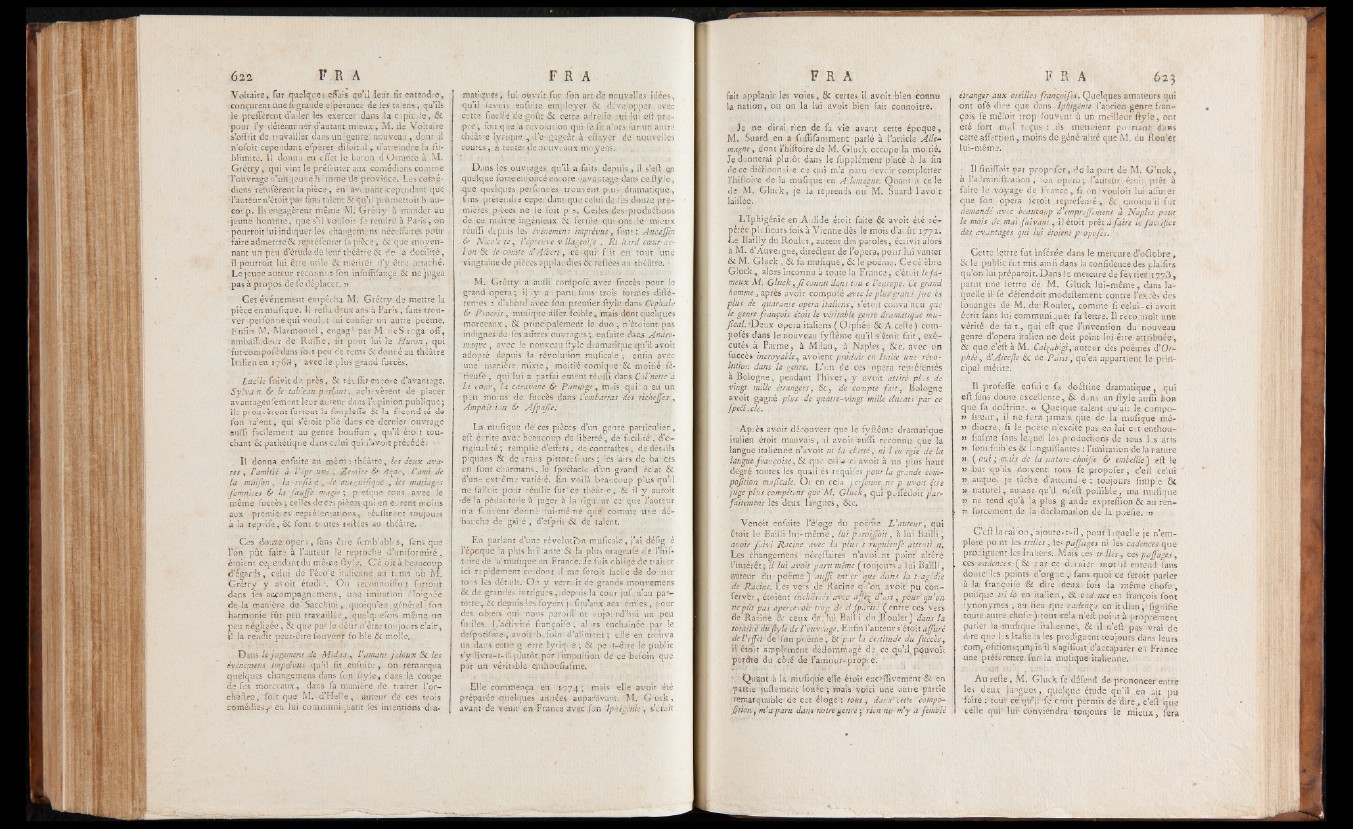
Voltaire, fur quelques eflais qu’il leur fit entendre,
conçurent une fi-grande espérance de iès talens, qu’ils 1
le prelièrent d’a.Yer' les exercer ;dans -la o pi elle, &
pour l’)r.déterminer d’autant mieuxvM. de Voltaire j
s’offrit dei travailler dans un : genre:' nouveau , dont il \
n’ofoit cependant e'pérer difoit.il., d’atteindre la -fu-
blimité. Ï1 donna en effet le baron d Ocrante a M. .
Grétry, qui vint le préfenter aux comédiens comme |
l’ouvrage rf uhijeune h mmë 'dè province. Les corné- j
diens rétufërent la pièce , èn avouant^cependant qiiq {
Tautëur n’étoit pas fans talent St 'qu’iJ prdméttoit b au-
côi p. Ils engagèreiir même M. Grétry' à -mander au ;
jeune homme , que s’il vouloir fé rendre à Pans, oh
pourroit luiindiquer les chàngemens rtéceffairës pofir
faire admettre^ repréfentër fa pièce -, & que moyennant
un peu d’étude de leur'théâtre & de a docilité,
il pourroit lui être .utile & mériter d’y être attaché.
Le jé.uné auteur reconnut- fon i'nfufEfànçe & ne jugea
pas à propos defe déplacer. »
Get événement empêcha M. Grétry de mettre la '
pièce en mufique. 11 refia deux ans à Paris , fans trouver
per forme qui voulut ;ui confier un autre poème.
'Enfin M. Marmontel, engagé par M. de S rogaeoff,
ambâffadeiir de Ruffiej- fit pour lui le Huron, qui
fut'cëmpofé’dans fort peu'dé rems &donr.é au théâtre
Italien en 1768 , avec le plus' grand fuccès.
Ludls fui vit de près, & réuffif encore d’avantage.
Sylvain & le tableau parlant^: achevèrent de placer
avantageufement leur aureur dans l’opinion publique;
ils prouvèrent furtout la foupleffe & la. fécondité de
fori talent, qui s’étoit plié dans ce dernier ouvrage :
suffi facilement au genre bouffon , qu’il étoit touchant'&
pathétique dans celui qui 1 a voit précédé. -v
11 donna en fuite au mèm; théâtre,. /« deux avares
, Vamitié à lépr.uvs., Zernire £?‘ 4 ~or, l’ami, de i
la mïïifon , la ■ ?oJifrfyAeéiru*gnifîque..}, les mariages ;
famnues & la faujfe mape ;. prefque1 toits.. ajvec le '
même fuccès ; celles deëes pièces qui en eurent moins .
aux premières repré.lematiçns*.. réu(firen.t toujours ;
à la r.eprife,& font t< utes reftées au théâtre.-.
Ces douze opéra , (ans être femb'abbs, fans que '
l’on: pût faire à l’auteur le .reproche d'uniformité,
étaient cependant du même ftyîe.. C ’é.oit à beaucoup !
d égards, celui de l’éco'e. italienne , au nms. où M. •
Grétry y aVôit étudié. ' On récbhhbiffo'7t furtout
dans fes accompagne mens, une imitation élo’gneé j
de, la' manière de*' Sâcchini. quoiqu’en ; général ; fon •
harmonie fût- peu travaillée., quelquefois même un
peu négligée, & que par le défir cfçtce toujours clair,
il la rendît peut-être fou vent fo’ble & molle.
Daps h jugement de Midas , L’amant .jaloux & les
cvénernens imprévus qu’il .fit enfuite , on.remarqua
quelques changemens dans fon■fiyjte, .dans la coupe
dé fes morceaux, dans fa manière de traiter l’or-
cheflre, fôit que Ml-d’Helle, auteur de ces trois
comédies^ en lui communiquant fes intentions dramatiq.
ues, lui ouvrît, fur fon art de nouvelles idées-,
qu’il (avois, enfui.te employer & développer. avec
cette fmeffë )de goût & cette- ad.relTe ;ui .l-ùi .eft pro-
-prë’, fo.itqfte la révolution qui fofit.a-'oxs fur un autre
-théâtre lyrique ,vrengageât à effayer de nouvelles
routes, à tenter.de nouveaux moyens.. ,
Dans les .ouvrages, qu’il affaits. depuis ,..il s’e.ft .gp
quelque forte enfoncé encore Javajjtage-dans ceftÿle,
que quelques perfonnes. trouvent pi,u> dramatique.,
fans prétendre cependant^que celui de fes douze premières
p-ècés ne Je (oit p s. Celles -desTproduélions
de.içe maître ingénieux 8c. fertile, qui ont le mieux
réuffi depuis les événetnens imprévus, font: Aucaffm
& Nicole:te, l’épreuve vdlageoife , Ri.hard caitr-de-
l:on & le . corrite dé Albert, • ce iquh flit eh fout une
vingtaine de pièces applaudies & refiées an théâtre. >
Mi Grétry a'aufii conipoféavec fuccès pour le
grand opéra ; il y an paru; fous trois formes differentes
: d’abord avec fön premier fiyle dans Géphale
& Procris y : mufique àfièz îfoiblë.; ânais^ctent quelques
morceaux, & principalement le. duo , n’étoient. pas
-indignes de fes autres ouvrages:;.-enfoite-dans Andro-
maque , avec le nouveau fiyle dramatique qu’il a voit
adopté depuis la révolution muficalë ; enfin ay,eç
une manière- mixte, moitié' comique & moitié fé-
rieufe , qui lui a parfai emént réulff dans Col.nette’à
la cour, là caravane 6* Paniérge, nuis qui a eu un
peu rrioiiis' de fuccès dans lembarras des rïcheJJ'es ,
Amphif. ion & Afpaße.1
La mufique de'ces pièces- d’un genre particulier,
eft. écrite avec beaucoup de liberté , de facilité", d’o -
riginrdité; remplie d’effets, de eontraftës , de détails
piquans & de îrai-.s pittorefques; 'es airs de babets
en font charmans, lé fpëéfâcle d’un grand éclat &
d’une extrême variété. En voila beaucoup plus qu’il
ne falloir pour réufiir fiir‘ ce: t-îieacré, & il y auroit
*dëîa. pédanterie, 'à juger à'la 'rigueur ce: que l’aqtçur
m a f..uvént';'donné ' Iui-mê-tje qu^ comme une -débauché
'de "'gaîté, d’elprit & de talent.
En parlant d’une révolution muficalë, j’ai défig é
l ’époque la plus bril ante & la plus orageufe .de l’hif-
toiré dé 'a mufique en France: Je fuis .obligé-'de traker
ici rapidement cetdbnt vl me ferojt facile de do'-iner
to-ts les détails. O n.y verroit de grands mouvemens
& de -grandes.intrigues,i.depuis1a cour jufqu’au parterre,.^
depuis les.foyers jùfqu’aux académiespour
des ob;efs qui nous paroiff nt aujo*. r.d’hui un peu
fin il es. L’aéliviré françoife . alors enchaînée parle
defpotfi^é', avoir b.foin d’aliment ; elle en trouva
un dans dette g- erre lyrique ; & peut-être le publie
s’y-livra-t-ibplütôt .par fiïïipiiHion de -ce -befoin que
par un véritable ejUhoufiafmè.
Elle commença' eh'- 1-7-74 ; mais elle -avoir été
préparée quelques années aupâ^àVaht. 'M. G'u ck,
avant de Venir en‘France avet fon ‘Iphigénie,- s’et-bit
fait applanir les voies, & certes il avoit bien connu
la nation, ou on la lui avoit bien fait connoître.
Je ne dirai rien de fa vie avant cette époque,
M. Suard en a fuiîifamment parlé à l’article Aile-
magne, dont fhifioire de M. Gluck occupe la moitié.
Je donnerai plutôt dans le. fupplément placé à la fin
de ce diéKonnaire ce -c{ui m’a paru devoir completter
rhifioire de la mufique-en Allemagne. Quant’à ce'le
de M. Gluck, je la reprends ou M. Suard lavolt
laiffée.
L ’Iphigénie en Aulide eto.it faite & 'avoit été répétée
piu fieurs fois à Vienne dès le mois d’août.' 1772. .
Le Bailly du Rôu.let , auteur des paroles, écrivit alors
à M. d’Auvergne, direéfeur de l’opéra, pour lui vanter
& M. Gluck, & fa mufique, & le poème. Ce célèbre
Gluck,. alors inconnu à toute la France, c’étoit le fa-,
meux M. Gluck , f i connu dans tou e l ’europe. Ce grand
homme, après avoir compofé avec le plus"grand juc.ès
plus de quarante opéra italiens, s’étoit conva ncu que
le genre frdnçois éioit le véritable genre dramatique mu-
Jîcal. ’Deux opéra italiens ( Orphée & Aicefte ) coth-
pofés dans le nouveau fÿftême qu’il s’étoit fait , exécutés
à Parme, à Milan, à Naples, &c. avec un
fuccès incroyable, avoient produit en Italie une révolution
dans le genre. L’un de ces opéra repiéfentes
à Bologne, pendant l’hiver, y avoit attiré pi,s de
vingt mille étrangers, de compte fait, Bologne
avoit gagné .plus de quatre-vingt mille ducats par ce
fpeétjcle. .
Après avoir découvert que le fyfiême dramatique
italien étoit mauvais, Il avoit aufii reconnu que la
langue italienne n’avoit ni la clarté, ni l'èn r'gie de la
langue francoise, & que ce) ;v-ci avoit à iin plus haut
degré toutes les quali .és requifes pour la grande cùm-
pojition muficalë. Or en cela gerjonne.ne pouvoit être
juge plus compétent que M. Gluck , qui pyffédoit parfaitement
les deux langues, &c. ’
Vènoit enfuite l’é'oge du p.oqme!. L ’auteur, qui
étoit le Bailli lui-même , lui paroiffoit, à lui Bailli,
avoir fuivi Racine avec la plus s:rupuleitfe attentu ri.
Les changemens riéceffaires n’avohnt point altéré
l’intérêt; il lui avoit paru même (;toujours à lui Bailli^
auteur du • pdëme ) aujjî ent er 'que dans là tragedie
de Racine. Les vers de Racine cjù’on. àybit'pu çon-
fervër, étoient ilichâs'sès avef ajjeç d’aft, pour’ qu’on
ne pût pas apercevoir trop de d fparitJ ( entre ces vérs
de Racine & ceiix deb.hji Bai 11 ,du ,R.oulèt ) dans la
iàthliie du'(fyïé dè Iouvragé. Enfin fauteur s’étoit affuré
de l ’effet ‘de ’ fon/p'oëuVe , ôf par la certitude du fuccès ,
il étoit ' ampMmént d'édonirnagé de ce pâuVoit
perdra du côté de l’atiîour-propre'. f
Quant-4 la."-mufique elle étoit ëxcéfiivetriënt & en
partie qufieftien-t:louée'; mais voici Uhe autre partie
remarquable- de cet -élqgè'Y' tout j dàris^'cet'fe ’éoMpo-
f tion, m’a paru dans notre genrê y rien 'nç-m’y a fèinblé
étranger aux oreilles françoifes. Quelques amateurs qui
ont ofé- dire que dans Iphigénie l’ancien genre fiançais
fe mêloit trop fouvent à un meilleur fiy le , ont
été fort, mal reçus : ils mettoient peinant; dans
cette affertion, moins de géné alité que M. du Rouler
lui-même.
Il finiffoitpar propofër., de la part de M. G'uck,
a l’à,dminiftr.atipn» (on opéra; l’aijtetir étoit. prêt à
faire l e ; .voyage de France , fi on'vquloit lui: affurer
que fon opéra foçoit. repréfe-méy. & quoiqull-fut
■ demandé avqc beaucoup d’emprefatient à Naples pour
le mois de, maifuivani ,11'étoit prêta faire le faebifice
des. avantages qui lui étoient propofés. ■
Cette lettre fut inférée dans le mercure, d’oélpbre ,
& le public fut mis -ainfi dans la confidence des pla.fu s
: qu’on lui préparoit. -Daps le meçcure de février 7
parut une lettre de M. Gluck lui-même, dans laquelle
iF fe défendait modeftemeht contre l’excès des
louanges .de M. du' Roulet, comme fi celui-ci avoir
écrit fans lui communiquer fa lettre. Il rccohnoît une
vérité de fait, qui efi que l’invention du nouveau
, genre d’opera italien në» doit point--lui être attribnée ,
& que c’eft à M. Cal^abi'gi, auteur des poèmes d’Or-
phée, àéAlcefle & de. Pans, qu’en appartient le principal
mérite.
Il profeffe en fui : e fa doéirine dramatique , .qui
eft fans doute excellente, & dans un fiyle aufii bon
que fa dpétrine. « Quelque talent qu’ai: le compot-
» firent, il ne fera jamais, que de la mufique mér
” dioçre, fi le poète n’excite pas en lui c;t enthou-
” fiafme fans lequel les produéfions de, tous les arts
», fom foib'es & languifiantes : l’imitation de la rature
». {oui ; piais de la nature choifie & embellie) eft le
» but qu’ils ,ôpivent tous fe propofër; c’en celui
».auquel je ; tâche- d'atteindre : toujours fimp’e ÔC
» naturel, amant qu’il m’eft pofiible, ma mufique
» ne tend qu’a la plùs g. andë expreffion & au ren-
r » forcement de la déçliamation delà poëfie. »
C ’eft laraifon,‘ajoute-t-il, pour laquelle je n’emploie
po nt les trilles, les paffages ni les cadences que
prodiguent les I'alier.suMais ces trdles, ces paffages,
, ces cadences. rar ce dernier mot 11 entend fans
doute1 lies points d’orgue ,» fans quoi ce feroit parler
à la françoife ék dire-:deux; fois la même chofe,
puifque tri là en italien',, tkl.cïdence en françoîs font
lynonymes , au lieu c\iM'cadenfj en italien, fianifie
toute autre chofiy);tout :cela n’efi poi '«t à- proprement
parler la mufique-italienne?, & il n’efi pas vrai de
dre que ‘les Italiens les prodiguent toujours dans leurs
comt-ofition»;; jmBis> il s’agllloit d’accaparer e i France
une préférenee,fùr-.la mqfique. italienne.
Aurefte, M. Gluck fë défend de-prononcer entre
les deux langues, quelque étude qu’il en .ait pu
faire i toüh cé qtfil Ye crôit permis de 'dire , c’e'fi que
I celle qui' lui- cbnViëndVà toujours le mieux, fera