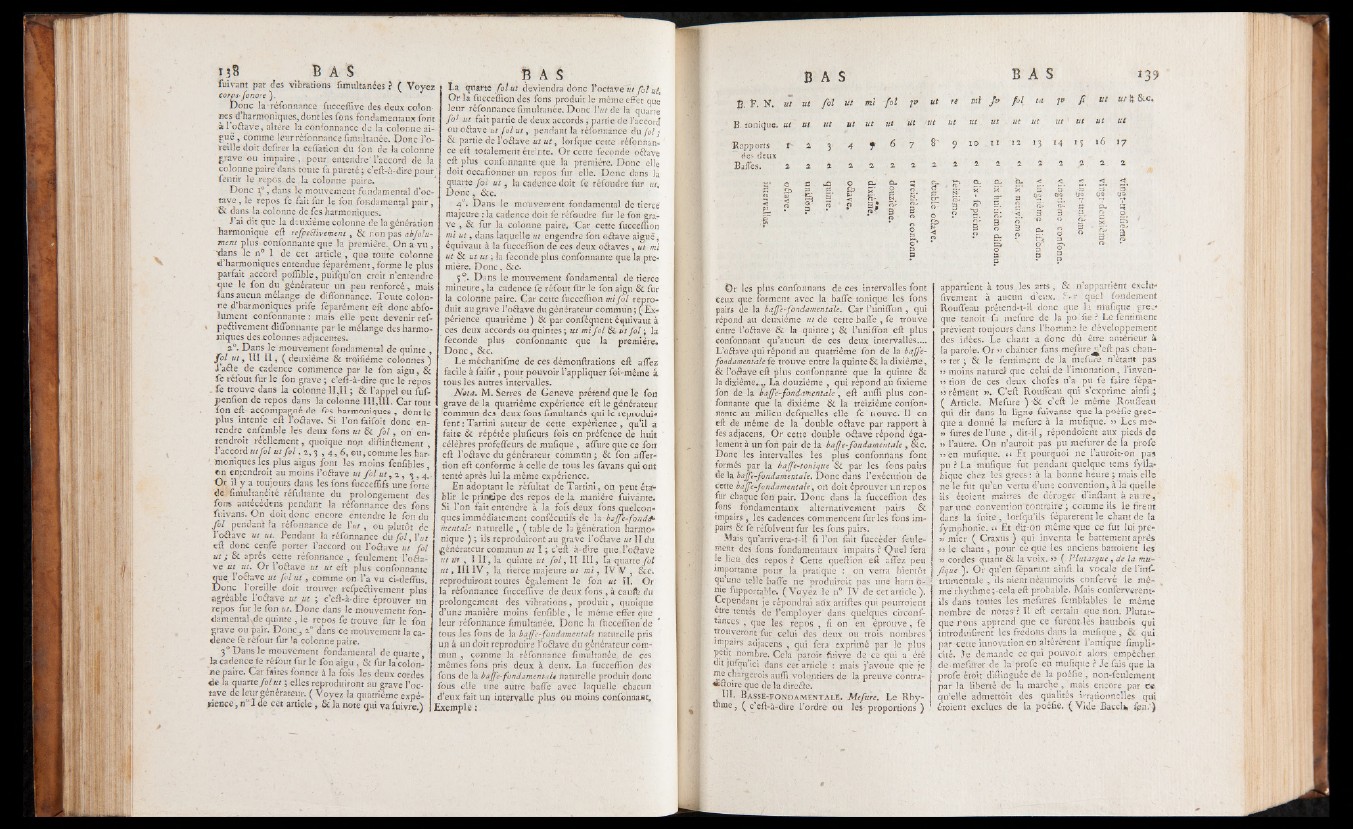
n 8 b a s
fuivam par des vibrations funultanêes ? ( Voyez
corps■ fonorc ).
Donc la-rèfonnance fucceffive des deux colonnes
d’harmoniques, dont lès fons fondamentaux font
à l’oftave, altère la confonnance de la colonne aiguë
, comme leur rèfonnance fmiultanée. Donc l’oreille
doit defirer la ceffation du ion de la colonne
grave ou impaire , -pour entendre'l’accord de la
colonne paire dans toute fa pureté ; c’elï-à-dire pour
fentir le repos- d e . la colonne paire.
Donc , dans le mouvement fondamental d’octave
, le repos fe fait fur le fon fondamental pair ,
& dans la colonne de fes harmoniques. '
J’ai dit que la deuxième colonne de la génération
harmonique eil refpeElïvcment , & non pas absolument
plus- confonnante que la première. On a vu ,
■ dans le n° 1 de cet article , que toute colonne
d harmoniques entendue féparément, forme le plus
parfait .accord poilible, puifqu’on croit n’entendre
que le fon du générateur un peu renforcé, mais
Jans aucun mélangé de diifonnance. Toute colonne
d’harmoniques prife féparément eft donc abfo-
lument confonnante : mais elle peut devenir ref-
i peflivement diflorinante par le mélange des harmoniques
des .colonnes adjacentes.
a°. Dans le mouvement fondamental de quinte ,
f o l u t, III I I , ( deuxième & troiiième colonnes )
J’aéle_ de cadence commence par le fon aigu, &
Te réfout fur le fon grave ; c’eft-à-dire que le repos
. fe trouve dans la colonne H,II ; & l ’appel ou fuf-
penfion de repos dans la colonne 111,111. Car tout
fon eil- accompagné de fes harmoniques, dont le
plus intenfe eil l’oâave. Si l’on fàifoit donc entendre
enfemble lés deux fons ut & f i l , on entendrait
réellement, quoique nop diflinélement ,
l ’accord ut fol ut f i l , i , 3 , 4 , 6, e u , comme les harmoniques
les plus aigus font les moins fenfibles,
©n enjendroit au moins l’oâave ut f i l ut, a , 3 , / .
O r il y a toujours dans les fons fucceflifs une forte ,
dé fimultanèité réfultante du prolongement des
fons antécédens pendant la rèfonnance des fons
fuivans. On doit donc encore entendre le fon du
f i l pendant la rèfonnance de lier , ou plutôt de
l ’oâave ut ut. Pendant la rèfonnance du f i l , Ÿut
eil donc cenfé porter l’accord ou l’oâave ut f i l
ut j & après cette rèfonnance , feulement l’oâav
e ut ut. Or l’oâav.e ut ut eil plus confonnante
que l’oâave ut f i l ut , comme on l’a vu ci-deffus.
Donc l’oreille doit trouver refpeâivement plus
agréable loélave ut ut ; c’eft-à-dire éprouver un
repos fur le fon ut. Donc dans le mouvemeht fon-
damentalyde quinte , le repos fe trouve fur le fon
grave ou pair. D o n c , 20 dans ce mouvement la cadence
fe .réfout fur la colonne paire.
3° Dans le mouvement Fondamental de quarte,
la cadence fe rèfout fur le fon aigu , & fur la colonne
paire. Car faites fonner à la fois les deux cordes
de la quarte f i l ut ; elles reproduiront au grave l’octave
de leur générateur. ( Voyez la quatrième expérience
, ti a de cet article, & la note qui ya fuivre.)
b a s
La quarte f i l ut deviendra donc l’octave ut f i l ut,
Or la fucceflïon des fons produit le même effet que
leur rèfonnance iimultanée. Donc l!//z de la quarte
f i l ut fait partie de deux accords , partie de l’accord
ou oâave ut f i l u t, pendant la rèfonnance du fol ;
& partie de l ’oâave ut u t, lorfque cette -réfonnan-
ce eil .totalement éteinte. Or cette fécondé oâave
eil plus confonnante que la première. Donc elle
doit occafionner un repos fur elle. Donc dans la
quarte fo l u t , la cadence doit fe réfoudre fur ut,
Donc , &c.
4°. Dans le mouvement fondamental de tiercé
majeure : la Cadence doit fe refondre fur le fon grave
, & fur la colonne paire* 'Car cette fucceflïon
mi u t , dans laquelle ut engendre fon oéfave aiguë,
équivaut à la fucceflïon de ces deux oâaves , ut mi
ut & ut ut ; la fécondé plus confonnante que la première.
Donc , & C-
5®. Dans le mouvement fondamental de tierce
mineure, la cadence fe refont fur le fon aigu & fur
la colonne paire. Car cette fucceflïon mi fo l reproduit
au grave Foélave du générateur commun ; ('Expérience
quatrième ) & par conféquent équivaut à
ces deux accords ou quintes ; ut mi fo l & ut fo l ; la
fécondé plus confonnante que la première.
D o n c , &c.
Le méchanifme de ces démonflrations eft affez
facile à faifir , pour pouvoir l’appliquer foi-même à
tous les autres intervalles.
Nota. M. Serres de GeneVe prétend que le fon
grave de la quatrième expérience efl le générateur
commun des deux fons fimultanés qui le reprodui-
fentrTartini auteur de cette expérience, qu’il à
faite & répétée plufieurs fois en préfence de huit
célèbres prorefleiirs de mufique, aflure que ce fort
eft l’o&ave du générateur commun ; & fon affer-
tioii eft conforme à celle de tous les favans qui ont
tenté après lui la même expérience.
En adoptant le réfultat de Tartinî, ôh peut étav
blir le principe des repos de -la manière fuivàme*
Si l’on fait entendre à la fois deux fons quelconques
immédiatement confécutifs de \a.'baffe-fondd*
mentait naturelle , ( table de la génération harmonique
) ; ils reproduiront au grave l ’o&ave ut II du
générateur commun ut I ; c’eft- à-dire que To&ave
ut ut , I I I , la quinte ut f o l , II I I I , la quarte fol
ut t I I I IV , la tierce majeure ut mi, IV V , &c*
reproduiront toutes également le fon ut II. Or
la rèfonnance fucceflive de deux fons , à caufo du
prolongement des vibrations, produit, quoique
d’une manière moins fenfîble, le même effet que
leur rèfonnance fimulfanée. Donc la fucceflïon de
tous les fons de la baffe-fondamentale naturelle pris
un à un doit reproduire l’oâave du générateur commun
, comme la rèfonnance iimultanée, de ces
mêmes fons pris deux à deux. La fucceflïon des
fons de la baffe-fondamentale naturelle produit donc
fous elle une autre baffe avec laquelle chacun
d’eux fait un intervalle plus ou moins cOnfonnaat,
Exemple i
B A S B A S * 3 9
fi. F. N.
B. tonique.
Rapports
des deux
Baffes.
»7 ut f i l ut mi f i l JV ut re mi f i f i l ta 7* f i ut ut R &c.
ut ut ut ut ut ut Ut 1ut U( ut ut ut ut ut * ut ut ut
X à. y 4 f 6 7 8" 9 10 I I 12 13 14 15 16 >7
2 2 a a 2 a 2 2 a 2 2 , 2 2 2 2, 2. 2
Or lés plus confonnans de ces intervalles font
Ceux que forment avec la baffe tonique les fons
pairs de la baffe-fondamentale. Car l’uniffon , qui
répond au deuxième ut de cette baffe , fe trouve
entre l’oâave & la quinte ; & l’uniffon eft plus
confonnant qu’aucun de ces deux intervalles....
L’oftave qui répond au quatrième fon de la baffe-
fondamentale fe trouve entre la quinte & la dixième,
& l’oélave eft plus confonnante que la quinte &
la dixième*,v. La douzième , qui répond au fixieme
fon de la baffe-fondamentale , eft auflï plus confonnante
que la dixième & là treizième confonnante
au milieu defquelles elle fe trouve. 11 en
eft de même de là double oélave par rapport à
fes adjacens. Or cette double oftave répond également
à un fon pair de la baffe-fondamentale , oie.
Donc les intervalles les plus confonnans font
formés par la baffe-tonique & par les fons pairs
de la baffe-fondamentale. Donc dans l’exécution de
cette baffe-fondamentale, on doit éprouver i:n repos
fur chaque fon pair. Donc dans la fucceflïon des
fons fondamentaux alternativement pairs &
tmpairs , les cadences commencent fur les fons impairs
& fe réfolvent fur les fons pairs.
Mais qu’arrivera-t-il fi l’on fait fuccèder feulement
des fons fondamentaux impairs ? Quel fera
le .lieu des repos ? Cette queftion eft affez peu
importante pour la pratique : on verra bientôt
quune telle baffe ne produircit pas une harn 0-.
nie fupportable. ( Voyez le n° IV de cet article ).
Cependant je répondrai atfx artiftes qui pourroient
ctre tentes de l’employer'dans quelques circonf-
tances , que les repos , fi on en éprouve, fe
trouveront fur celui des deux ou trois nombres ’
impairs adjacens , qui fera exprimé par le plus
petit nombre. Cela paroit ftiivre de ce qui a été
dit jufqu’ici dans cet article : mais j’avoue que je
me clia:rgerois auflï volontiers de la preuve contradictoire
que de la direéle»
L L Basse-fondamentale. Mefure. Le Rhy-
9 C c’eft-à-dire l’ordre ou les- proportions )
appartient à tous.les arts, & n’appartiént exclu-
flvement à aucun d’eux. S r quel fondement
Rouffeau prétend-t-il donc que la mufique grec*
que tenoit - fa mefure de la po. fie ? Le lentiment
prévient toujours dans l’homme le développement
des idées. Le chant a donc dû être antérieur à
la parole. Or ” chanter fans mejure^n’eft pas chan-
jî ter ; & le fentiment de la mefure n’étant pas
55 moins naturel que celui de l’intonation , l’inven-
55 tion de ces deux chofes n’a pu fe faire fépa-
>5 rément v. C ’eft Rouffeau qui s’exprime ainfïj
( Article. Mefure ) •& c’eft le même Rouffeau
qui dit dans la ligne fuivante que la poéfle grecque
a donné la mefure à la mufique. 55 Les me-
» fures de l’une , dit-il, répondoient aux pieds de
»> l’autre. On n’auroit pas pu mefurer de la profé
55 en mufique. a Et pourquoi ne l’auroit-on pas
pu ? La mufique fut pendant quelque tems fyila-
bique chez les grecs : à la bonne heure ; mais elle
ne le fut qu’en vertu d’une convention , à la quelle
ils étoient maîtres de déroger d’inftant àaurre, '
par une convention "Contraire ; comme ils le firent
dans la fuite, lorfqu’ils féparerent le chant de la
fymphonie. « Et dif-on même fque ce fut lui pre»
j) mier ( Craxus ) qui inventa le battement après
51 le chant, pour ce que les anciens battoient les
u cordes quant & la voix. 55 ( Plutarque b de la mu-
fique'). Or qu’en féparant ainfl la vocale de l ’inf-
trumentale , ils aient néanmoins conferve le même
rhythme;-cela eft probable. Mais conferverent-
ils dans toutes lès mefures femblables le même
nombre de notes ? 11 eft certain que non. Plutarque
rous apprend que ce furent-les hautbois qui
introduïfirent les fredoiis dans la mufique , & qui
par cette innovation en altérèrent l’antique fimpli-
cïté. Je demande ce qui pouvolt alors empêcher
de-mefurer, de la profe en mufique ? Je fais que la
profe ètqit diftinguée de la poéfle , non-feulement
par la liberté de la marche , mais encore par ce
qu’elle admettôit des qualités irrationnelles qui
étoient exclues de la poéfle. (V id e Bacch, fen.')