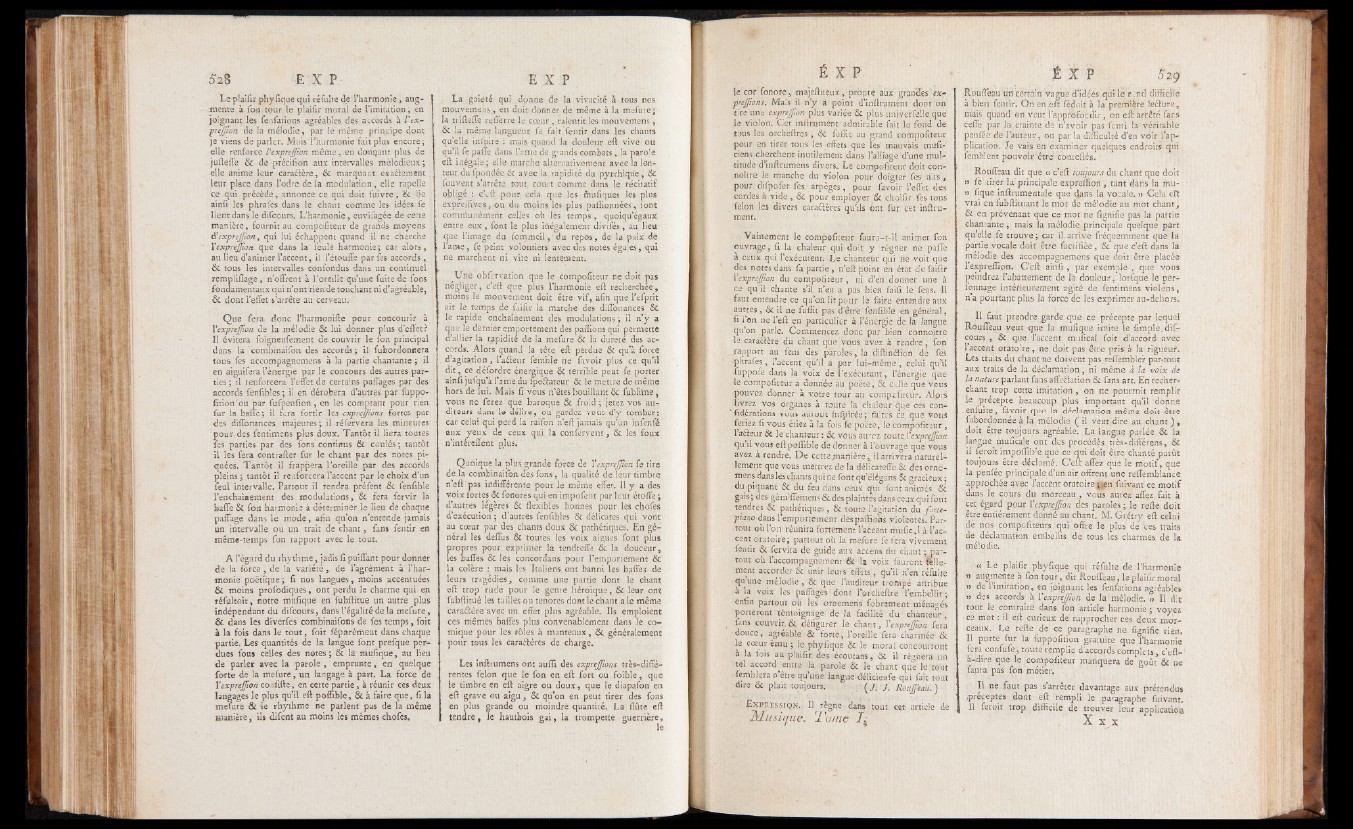
528 E X P
Le plaifir phyfique qui réfulte de l’harmonie, augmente
à fon tour, le plaifir moral de l’imitation, en
joignant les fenfations agréables des accords à l*ex-
prejfion de la mélodie, par le même principe dont
je viens de parler. Mais l'harmonie fait plus encore ;
elle renforce Vexprefon même, .en donnant plus de
jufteffe & de précifion aux intervalles mélodieux ;
elle anime leur caraâère, & marquant exactement
leur place dans l’odre de la modulation , elle rapelle
ce qui précède, annonce ce qui doit fu iv re , & lie
ainfi les phrafes dans le chant comme les idées fe
lient dans le difcours. L ’harmonie, euvifagée de cette
manière, fournit au compofiteur de grands moyens
à’exprejjîon, qui lui échappent quand il ne cherche
XexpreJJion que dans la feule harmonie; car a lors ,
au lieu d’animer l’accent, il l’étouffe par fes accords ,
& tous les intervalles confondus dans un continuel
rempliflage, n’offrent à l’oreille qu’une fuite de fons
fondamentaux qui n’cnrriende touchant ni d’agréable,
& dont l’effet s’arrête au cerveau.
Q u e fera donc l’harmonifte pour concourir à
Yexprejjion de la mélodie & lui donner plus d’effet?
Il évitera foigneufement de couvrir le fon principal
dans la combinaifon des accords; il-fubordonnera
tous fes accompagnemens à la partie chantante ; il
en aiguifera l’énergie par le concours des autres parties
; il renforcera l’effet de certains paffages par des
accords fenfibles ; il en dérobera d’autres par fuppo-
fition'ou par fufpenfion, en les comptant pour rien
fur la baffe; il fera fortir le s expierions fortes par
des diffonances majeures; il réfervera les mineures
pour des fentimens plus doux. Tantôt il liera'toutes
fes parties par des fons-continus & coulés; tantôt
il les fera contrafter fur le chant par des notes piquées.
Tan tô t il frappera l ’oreille par des. accords
pleins ; tantôt il renforcera l’accent par le choix d’un
feul intervalle. Partout il rendra préfent & fenfible
l'enchaînement des modulations, & fera fervir la
baffe & fou harmonie à déterminer le lieu de chaque
paflage dans le mod e, afin qu’on n’entende jamais
un intervalle ou un trait de ch an t, fans fentir en
même-temps fon rapport avec le tout.
A l’égard du rhythme, jadis fi pUiffant pour donner
de la force, de la variété, de l’agrément à l’harmonie
poëtfque; fi nos langues, moins accentuées
& moins profodiques, ont perdu le charme qui en
réfultoit, notre mufique en fubftitue un autre plus
indépendant du difcours, dans l’égalité de la mefure,
& dans les diverfes combinaifons de fes temps, foit
à la fois dans le tout, foit féparémeut dans chaque
partie. Les quantités de la langue font prefque perdues
fous celles des notes; & la mufique, au lieu
de parler avec la parole, emprunte, en quelque
forte de la mefure, un langage à part. L a force de
XexpreJJion confifte, en cette partie, à réunir ces deux
langages le plus qu’il eft poffible, & à faire que, fi la
mefure & le rhythme ne parlent pas de la même
manière, ils difeot au moins les mêmes chofes.
E X P
La gaieté qui .dpnne de la vivacité à tous nos
mouvemens, en doit donner de même à la mefure;
la trifteffe reflerre 1- coeur , ralentit les mouvemens,
& la même langueur fe fait fentir dans les chants
qu’elle infpire : mais quand i a douleur eft vive ou
qu’il fe paffe dans Famé de grands combats, la parole
eft inégale ; elle marche alternativement avec la lenteur
du fpondée & avec la rapidité du pyrrhique, &
fouvent s’arrête tout, court comme dans le récitatif
obligé : c’eft pour cela que les mufiques les plus
expreflïves, ou du moins lés plus.paffionnées, font
communément celles oh lès temps , quoiqu’égaux
entre eu x , font le plus inégalement divifés, au lieu
que l’image du fommeil, du repos , de la paix de
l’am e , fe peint volontiers avec des notes égales, qui
ne marchent ni vite ni lentement.
U n e obfervation que le compofiteur ne doit pas
négliger, c’eft que plus l’harmonie eft recherchée,
moins le mouvement doit être v if , afin queTefprit
ait le temps dé faifir la marche des diffonances &
le rapide enchaînement des modulations ; il n’y a
que le dernier emportement des pallions qui permette
d’allier la rapidité de la mefure & la dureté des accords.
Alors quand la tête eft perdue & qu’à force
d’agitation, l’aéteur fe'mble ne favoir plus ce qu’il
d it , ce défordre énergique & terrible peut fe porter
ainfi jufqu’à l’ ame du fpe&ateur & le mettre de même
hors dè lui. Mais fi vous n’êtes bouillant & fublitne,
vous ne ferez que baroque & froid ; jetez vos aur
diteurs dans le délire, ou gardez-vous d’y tomber:
car celui qui perd la raifon n’eft jamais qu’un infenfé
aux yeux de ceux qui la confervent, & les foux
n’intéreffent plus.
Quoique la plus grande force de XexpreJJion fe tire
de la combinaifon des fons, la qualité de leur timbre
n’eft pas indifférente pour le même effet. Il y a des
vo ix fortes & fonores qui en impofent par leur étoffe ;
d’autres légères & flexibles bonnes pour les chofes
d’exécution ; d ’autres fenfibles & délicates qui vont
au coeur par des chants doux & pathétiques. En général
les deffus & "toutes les voix aigues font plus
propres pour.exprimer la tendreffe & la douceur,
les baffes & les concordans pour l’emportement &
I la colère : mais les Italiens ont banni les baffes de
leurs tragédies, comme une partie dont le ç-hant
eft trop 'ru de pour le genre héroïque, & leur ont
fubftitué les tailles ou tenores dont le chant a le même
cara&êre~avec u'n effet plus agréable. Ils emploient
ces mêmes baffes plus convenablement dans le comique
pour les rôles à manteaux, & généralement
■ pour tous les caractères de charge.
Les inftrumens ont suffi des exprejjions très-différentes
félon que le fon en eft fort ou fo ib le , que
le timbre en eft aigre ou dou x, que le diapafon en
eft grave ou a igu , & qu’on en peut tirer des fons
en plus grande ou moindre quantité. La flûte eft
ten d re , le hautbois g a i , la trompette guerrière,
É X P
le cor fonore, majeftueux, propre aux grandes'ex-,
prejjions. Mais il n’y a point d’inftrument dont on
tire une exprejjionplus variée &. plus finiverfèlle.que
le violon. Ce t inftrument admirable fait le fond de
tous les orcheftres , §e fuffit au grand compofiteur
pour en tirer tous les effets que les mauvais mufi-
ciens cherchent inutilement dans ralliage ’d’une multitude
d’inftrumens divers. Le compofiteur doit con-
noitre le manche du violon pour doigter fes airs,
pour difpofer fes arpèges, pour favoir l’effet des
cordes à v id e , & pour employer & choifir. Tes tons
félon les divers caractères qu'ils ônt fur cet inftrument.
Vainement le compofiteur faura-t-il animer fon
ouvrage, fi la chaleur qui doit y régner ne paffe
a ceux qui l’exécutent. L e chanteur qui ne -voit que
-des notes dans, fa partie , n’eft point en état de faifir
XexpreJJion du compofiteur, ni d’en donner une à
ce qu’il chante s’il n’en a pas bien faifi le fens. Il
faut entendre ce qu’on lit pour le faire entendre aux
autres, & il ne fuffit pas detre fenfible en général,
fi l’on ne 1 eft en particulier à l’énergie de la langue
qu’on parle. Commencez donc par bien connoïtre
le caraftère du chant que vous avez à rendre, fon
rapport au fens des paroles, la diftimftion de Tes
phrafes, l’accent qu’il a par lui-même, celui qu’il
fuppofe dans la voix de l ’exécutant, l’énergie que
le compofiteur a donnée au poète, & Ccdle,que vous
pouvez donner à votre tour au compofiteur. Alprs
livrez vos organes à toute la chaleur que cès considérations
vous auront infpirée; faites ce que vous
feriez fi vous étiez à la fois fe poète, le compofiteur,
1 aéteur & le chanteur : 8c vous aurez toute XexpreJJion
qu il vous eft poffible de donner à l’ouvrage que vous
avez a rendre. D e cette .m a n iè r e i l arrivera naturellement
que vous mettrez de la délicateffe & des ornè-
mens dans les chants qui ne font qu’êlégans 5c gracieux ;
du piquant & du feu dans ceux qui font animés &
gais ; des gém-ffemens 8c des plaintes dans ceux qui font
tendres 8c pathétiques, 8c toute l’agitation du JJorte-
piano dans l’emportement despaffîons violentes. Partout
©Mon réunira fortement l’accent mufic^là l’accent
oratoire; partout où la mefure fe fera vivement
fentir 8c fervira de guide aux àccèns du chant ; partout
ou l’accompagnement & la Voix fauront V ile ment
accorder 8c unir leurs effets, qu’il n’en réfulte
qu une mélodie , 8c que l’auditeur trompé attribue
a la voix les paffages dont l’orcheftre l’embellir;
enfin partout où les ornemens fobremerit: ménagés
porteront témoignage de la facilité du chanteur,
fans couvrir.ÔC défigurer le ch an t, XexpreJJion fera
-douce, agréable 8c forte, l’oreille fera charmée'8c
le coeur ému ; le phyfique 8c le moral concourront
a la fois au plaifir des écôutàns ; & il régnera un
tel accord^ entre la parole- 8c le chant que le tout
femblera n etre qu’une langue" déiieieufe qui fait tout
dire 8c plaît toujours. (J . J. R o u f eau. )
E x pr e s s iq n . Il règne dans tout cet article de
Musique. Tome / .
É X P 5 29
Rou fléau un certain vague d’idées qui le r :nd difficile
à bien fentir. On en .eft Téduit à la première leéiure,
mais quand on veut l'approfondir, on eft arrêté fars
ceffe par la crainte de n’avoir pas fenti la véritable
penfée de l’auteur , ou par la difficulté d’en voir l’application.
Je vais en examiner quelques endroits qui
femblent pouvoir être- conteftés.
Rouffeau dit que.« c’eft toujours du chant que doit
» fe tirer la principale expreiïion, tant dans la mu-
» fique inftrumentale que dans la vocale. » Gela eft
vrai en fubftituant le mot de mélodie au mot chant,
8c en prévenant que ce mot ne fignifie pas la partie
chamante, mais la mélodie principale quelque part
qu’elle fe trou ve; car il.arrive fréquemment que la
partie vocale doit être facrifiée, 8c que c’eft dans la
mélodie; des accompagnemens que doit être placée
l’expreflîon. C ’eft ainfi , par exemple , que vous
peindrez l’abattement de la douleur , lorfque le per-
fonnage intérieurement agité de. fentimens vio len s,
n’a pourtant plus la force de les exprimer au-dehors.
Il faut prendre garde que ce précepte par lequel
Rôuffeau veut que la mufique imite le fimple. difcours
, & que. l’accent mufical foit d’accord -avec
l’accent oratoire, ne.doit pas être pris à la rigueur.
Les traits du chant ne doivent pas reffembler par-tout
aux traits de la déclamation, ni même à la voix de
la nature parlant fans affectation 8c fans art. En recherchant
trop cette imitation, on ne pourroit remplir
le précepte beaucoup plus important qu’il donne
enfuite, fàvoir que la déclamation même doit être
fubordonnée à la mélodie ( il veut dire au chant ) ,
doit être toujours agréable. La langue parlée 8c ia
langue rnufîcale ont des procédés,très-difféfens, 8c
il feroit impoffi^e que ce qui doit être chanté parût
toujours etre déclamé. C ’eft aflez que le m o tif, que
la penfée principale d’un air offrent une reffemblance
approchée avec l’accent oratoire $en fuivant ce motif
dans le cours du morceau, vous aurez affez fait à
cet égard pour Xexpreffion des paroles ; le refte doit
être entièrement donné au chant. M. G ré try eft celui
cle nos compofiteurs qui offre le plus de "ces traits
de déclamation embellis de tous les charmes de la.
mélodie.
« Le plaifir phyfique qui réfulte de l’harmonie
» augmente à fon tour, dit Rouffeau, le plaifir moral
” de l'imitation, en joignant les fenfations agréables
” Aes accords à l ’exprejjion de la mélodie. >? Il dit
tout le contraire dans ifon article harmonie $ voyez
ce mot : il eft curieux de'rapprocher ces deux morceaux.
Le refte de ce paragraphe ne fignifie rien«
Il porte fur la fuppofition gratuite que l’harmonie
fera confufe, toute remplie d ’accords complets, c’eft-
a-.dire que le compofiteur manquera de goût & ne
Taura pas fon métier.
I l ne faut pas s’arrêter davantage aux prétendus
.préceptes dont eft rempli le paragraphe fuivant.
Il feroit trop difficile de trouver leur application
X x x