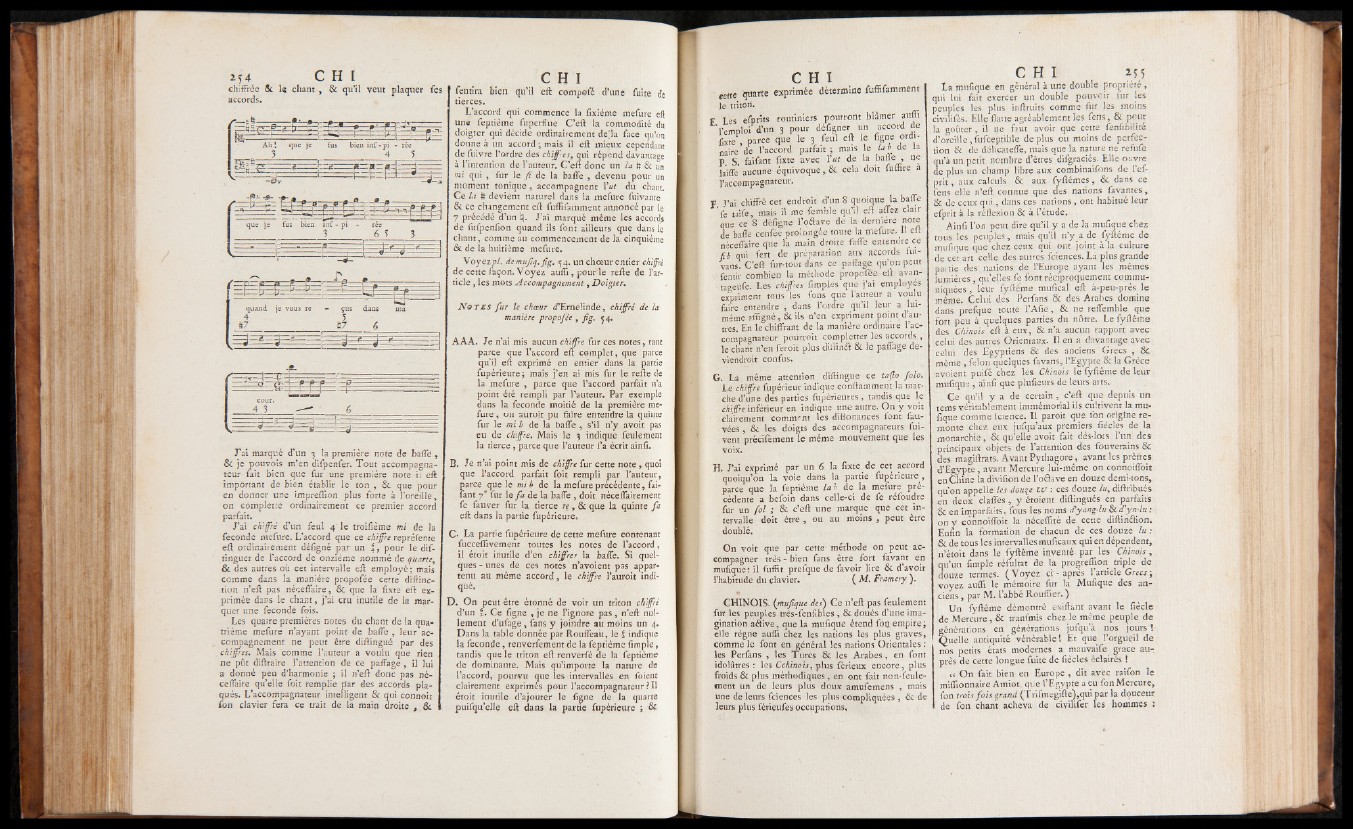
254 C H I
chiffrée & le chant, & qu’il veut plaquer fes
accords.
Ah 1 que je fus bieninf-pi - rée
3___________________ 4 î.
dErgr r— iB=a=a=£=
= * :
=ZLZg^Z^=i=Z-=j=Z 1 «
que je fus bien- inf - pi
. A 1 _ J _
î F 3 ^ - j - g =
quand je vous re - çus dans ma
4 5
J 7__ . __ t\7 6__ ^
cour.
" jE 4 3 ' v ------ 6_______________
E=— j— . = = = = =
J’ai marqué d’un 3 la première note de baffe ,
& je pouvois m’en difpenfer. Tout accompagnateur
fait bien que fur une première note il eft
important de bien établir le ton , & que pour
en donner une impreffion plus forte à l’oreille,
on complette ordinairement ce premier accord
parfait.
J’ai chiffré d’un feul 4 le troifième mi de la
fécondé mefure. L’accord que ce chiffre repréfente
efl ordinairement défigné par un 1 , pour le dif-
tînguer de l’accord de onzième nommé de quarte
& des autres où cet intervalle efl employé; mais
comme dans la manière propofée cette diflinc-
tion n’efl pas néceffaire, & que la fixte efl exprimée
dans le chant, j’ai cru inutile de la marquer
une fécondé fois.
Les quatre premières notes du chant de la quatrième
mefure n’ayant point de baffe , leur accompagnement
ne peut être diffingué par des
chiffres. Mais comme l’auteur a voulu que rien
ne pût diflraire l’attention de ce paffage , il lui
a donné peu d’harmonie ; il n’efl donc pas néceffaire
qu’elle foit remplie par des accords plaqués.
L’accompagnateur intelligent & qui connoit
fon clavier fera ce trait de la main droite , &
c H 1
Ifentîra bien qu’il efl compofé d’une fuite de
tierces.
L’accord qui commence la fixième mefure çft
une feptième fuperdue C ’efl la commodité du
doigter qui décide ordinairement de’ la face qu’on
donne à un accord ; mais il efl mieux cependant
de fuivre l’ordre des chiffres, qui répond davantage
à l’intention de l’auteur. C ’efl donc un la # & un
mi qui , fur le f i de la baffe , devenu pour un
moment tonique, accompagnent Y ut du chant.
Ce la # devient naturel dans la mefure fuivante
& ce changement efl fufHfamment annoncé par le
7 précédé d’un fc|. J’ai marqué même les accordj
de fufpenfion quand ils font ailleurs que dans le
chant, comme au commencement de la cinquième
& de la huitième mefure.
Vo y e zpl. demufiq.fig. 54. un choeur entier chiffré
de cette façon. Vo yez auffi, pour le refie de l’article
, les mots Accompagnement, Doigter.
N o t e s f u r le choeur tfErnelinde, chiffré de la
manière propofée , fig . 54.
A A A. Je n’ai mis aucun chiffre fur ces notes, tant
parce que l’accord efl complet, que parce
qu’il efl exprimé en entier dans la partie
fupérieure; mais j’en ai mis fur le relie de
la mefure , parce que l’accord parfait n’a
point été rempli par l’auteur. Par exemple
dans la fécondé moitié de la première mefure
, on auroit pu foire entendre la quinte
fur le m i h de la baffe , s’il n’y avoit pas
eu de chiffre. Mais le 3 indique feulement
la tierce, parce que l’auteur l’a écrit ainfi.
B. Je n’ai point mis de chiffre fur cette note , quoi
que L’accord parfait foit rempli par l ’auteur,
parce que le mi h de la mefure précédente, faisant
7e fur le fa de la baffe , doit néceffairement
fe fauver fur la tierce r e , & que la quinte fa
efl dans la partie fupérieure.
C- La partie fupérieure de cette mefure contenant
fucceflivement toutes les notes de l’accord,
il étoit inutile d’en chiffrer la baffe. Si quelques
- unes de ces notes n’avoient pas appar*
tenu au même accord, le chiffre l’auroit indiqué.
D . On peut être étonné de voir un triton chiffré
d’un i . Ce ligne | je ne l’ignore pas, n’efl nullement
d’u foge, fans y joindre au moins un 4.
Dans la table donnée par Ronffeaù, le I indique
la fécondé, renversement de la feptième fimple,
tandis que le triton efl renverfé de la Septième
de dominante. Mais qu’importe la nature de
l’accord, pourvu que les intervalles en foient
clairement exprimes pour l’accompagnateur ? Il
étoit inutile d’ajouter le ligne de la quarte
puifqu’elle efl dans la partie fupérieure ; &
c h 1
tette quarte exprimée détermine fuffifamment
Je triton.
F Les efprits routiniers pourront blâmer auffi
l’emploi d’un 3 pour défigner un accord de
fixte , parce que le 3 feul efl le figue ordinaire
de l’accord parfait ; mais le la b de la
P. S. faifant fixte avec Y ut de la baffe; , ne
laiffe aucune équivoque, & cela doit Suffire a
l’accompagnateur.
F J’ai chiffré cet endroit d’un 8 quoique la baffe
’ fe taife, mais il me Semble qu’il efl affez clair
que ce 8 défigne l’oéhve de la dernière note
de bafïe cenfée prolongée toute la mefure. Il eft
néceffaire que la main droite foffe entendre ce
fi h qui Sert de préparation aux accords fui-
vans. C ’efl fur-tout dans ce paffage qu’on peut
v fentir combien la méthode propofée, efl avan-
tageùfe. Les chiffes Simples que j’ai employés
expriment tous les fons que l’auteur a voulu
foire entendre , dans l’ordre qu’il leur a lui-
même affigné, & ils n’en expriment point d’autres.
En le chiffrant de la manière ordinaire l’accompagnateur
poürroit completter les accords ,
le chant n’en feroit plus diflinél & le paffage de-
viendroit confus.
G. La même attention diflingue ce tafio folo.
Le chiffre fupérieur indique conflamment la marche
d’une des parties fupérieures , tandis que le
chiffre inférieur en indique une autre. On y voit
clairement comment les diffonances font fou-
vées , & les doigts des accompagnateurs fui-
vent précifément le même mouvement que les
voix.
H. J’ai exprimé par un 6 la fixte de cet accord
quoiqu’on la voie dans la partie fupérieure,
parce que la feptième la h de la mefure précédente
a befoin dans celle-ci de fe réfoudre
fur un fol ; & c’efl une marque que cet intervalle
doit être, ou au moins , peut être
doublé.
On voit que par cette méthode on peut accompagner
très - bien fons être fort favant en
mufique: il fuffit prefque de fa voir lire & d’avoir
l’habitude du clavier. ( M. Framery ).
CHINOIS. (mufique des) Ce n’efl pas feulement
fur les peuples trés-fenfibles , & doués d’une imagination
aftive, que la mufique étend fou empire ;
elle règne auffi chez les nations les plus graves,
comme le font en général les nations Orientales :
les Perfans , les Turcs & les Arabes , en font
idolâtres : les Cchinois, plus férieux encore, plus
froids & plus méthodiques, en ont foit non-feulement
un de leurs plus doux àmufemens , mais
une de leurs fciences les plus compliquées , & de
leurs plus fériçufes occupations.
C H I *55
La mufique en général à une double propriété ,
qui lui fait exercer un double pouvoir fur les
peuples les plus inft.ruits comme fur les moins
civilifés. Elle flatte agréablement les fens, & pour
la goûter , il ne faut avoir que cette fenfibilité
d’oreille, ftifceptible déplus ou moins de perfection
& de délicateffe, mais que la nature ne refufe
qu’à un petit nombre d’êtres difgraciés. Elle ouvre
de plus un champ libre aux combinaifons de l’ef-
p r it, aux calculs & aux fyftêmes, & dans ce
fens elle n’efl connue que des nations favantes,
& de ceux q u i, dans ces nations , ont habitué leur
efprit à la réflexion & à l’étude,
Ainfi l’on peut dire qu’il y a de la mufique chez
tous les peuples, mais qu’il n’y a de fyftéme de
mufique que chez ceux qui ont joint à la culture
de cet art celle des autres fciences. La plus grande
partie des . nations de l’Europe ayant les mêmes
lumières, qu’elles fe font réciproquement communiquées,
leur fyftéme mufical efl à-peu-près le
même. Celui des Perfans & des Arabes domine
dans prefque toute l’Afte , & ne reffemble que
fort peu à quelques parties du nôtre. Le fyftéme
des Chinois efl à eux, & n’a aucun rapport avec
celui des autres Orientaux. Il en a davantage qvec
celui des Egyptiens & des anciens Grecs , &
même , félon quelques favans, l’Egypte & la Grèce
avoient puifé chez les Chinois le fyftéme de leur
mufique , ainfi que plufieurs de leurs arts.
Ce qu’il y a de certain, c’efl que depuis un
tems véritablement Immémorial ils cultivent la mufique
comme fcience. Il paroît que fou origine remonte
chez eux jufqu’aux premiers fiècles de la
monarchie, & qu’elle avoit fait dès-lots l’un des
principaux objets de l’attention des fouverains &
des magiflrats. Avant Pythagore , avant les prêtres
d’Egypte, avant Mercure lui-même on connoiffoit
en Chine la divifion de l’oélave en douze demi-tons,
qu'on appelle lesdou^e i v : ces douze lu, diftribués
en deux claffes , y étoient dillingués en parfaits
& .en imparfaits, fous les noms tTyang-lu SicTyn-lu:
on y cônnoifloit la néceffité de cette diftinélion.
Enfin la formation de chacun de ces douze lu:
& de tous les intervalles muficaux qui en dépendent,
n’étoit dans le fyftéme inventé- par les Chinois ,
qu’un fimple réfultat de la pro^reffion triple de .
douze termes. (V o y e z ci-apres l’article Grecs;
voyez auffi le mémoire fur la Mufique des anciens
, par M. l’abbé Rouffier. )
Un fyftéme démontré exiflsnt avant le fiècle
de Mercure, & tranfmis chez le même peuple de
générations en générations jufqu’à nos jours 1
Quelle antiquité vénérable! Et que l’orgueil de
nos petits états modernes a mauvaife grâce au-,
près de cette longue fuite de fiècles éclaires !
c< On fait bien en Europe , dit avec raifon le
miffionnaire Amiot, que l’Egypte a eu fon Mercure,
fon trois fois grand (Trifmegifle),qui par la douceur
de fon chant acheva de civimer les hommes :