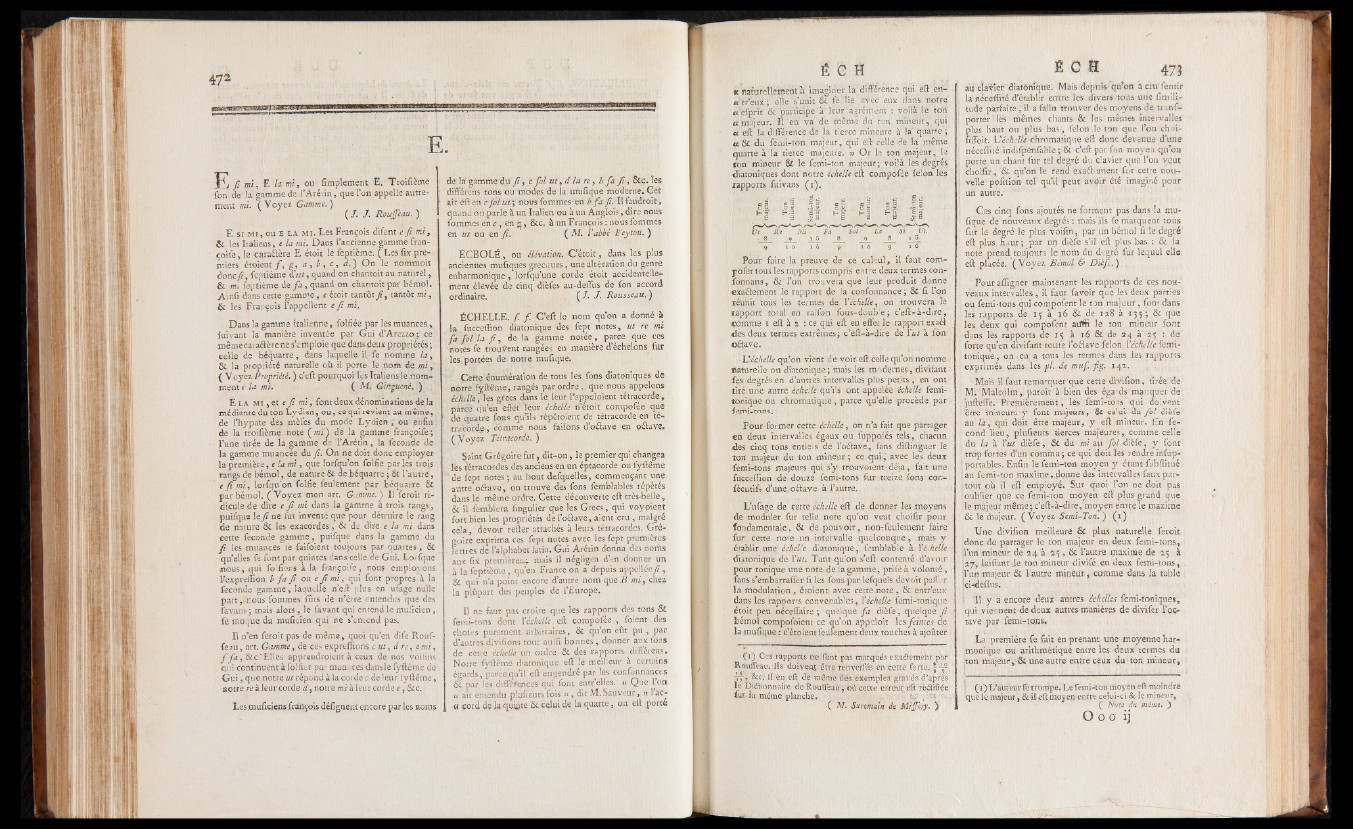
E.
/ m\3 E la mi, ou Amplement E. Troifième
fön de la.gamme de.l’Arétin, que l’on appelle autrement
mi. (V o y e z Gamme. )
( J. J. Roujfeau. )
E si Mi, ou E la m i . Les François difent e f i mi ,
& les Italiens, e la mi. Dans l’ancienne gamme françoife
, le caraâère E étoit le feptième. ( Les fix premiers
étoient f , g , a , b , c , d. ) On le nommoit
donc/, feptième a ut, quand on chantoit au naturel,
& mi feptième de f à , quand on.chantoit par bémol.
Ainfi dans cette gamme, e étoit tantôt ƒ , tantôt mi,
& les François l’appellent e f i mi.
Dans la gamme italienne, folfiée par les muances,
luivant la manière inventée par Gui d’Arezzos ce.-
même caractère ne s’emploie que dans deux propriétés;
celle de béquarre, dans laquelle il fe nomme la ,
& la propriété naturelle ou il porte le nom de mi,
( Voyez Propriété. ) c’eft pourquoi les Italiens le nomment
e la mi. ( M. G'mguené. )
E la M i, et e f i mi, font deux dénominations de la
médiante du ton Lydien, ou, ce qui revient au mettre,
de l’hypate des mèfes du mode Lydien, ou' enfin !
de la troifième note ( mi ) de la gamme françoife;
l’une tirée de la gamme de l’Arétin, la fécondé de
la gamme muancée du fi. On ne doit donc employer-
la première, e la mi, que lorfqu’on folfie par les trois
rangs de bémol, de nature & de béquarre ; & l’autre',
e f i mi, lorfqu’on folfie feulement par béquarre ôc
par bémol. ( Voyez mon art, Gamme.) Il feroit ridicule
de dire e f i mi dans la gamme à trois rangs,
puifque l e / ne fut inventé que pour détruire le rang
de nature & les exacordes, & de dire e la mi dans
cette fécondé gamme, puifque dans la gamme du
f i les muances le faifoient toujours par quartes , &
qu’elles fe font par quintes dans celle de Gui. Lorfque
-nous, qui fo;fions à la françoife, nous employons
l’expreffion b fa f i ou e f i mi, qui font propres à la
fécondé gamme, laquelle n’eft plus en ufage nulle
part,-nous fommes furs de n’être entendus que des
favansj mais alors, le favant qui entend le muficien,
fe moque du muficien qui ne s’entend pas.
Il n’en feroit pas de même, quoi qu’en dife Rouf-
feau, art. Gamme, de ce« expreffions e u t, d re, emi,
ƒ fia, &c.~Elles apprendroient à ceux de nos voifins
qui continuent à folfier par muances dans le fyftême de
Gui , que notre ut répond à la corde c de leur fyftême,
notre re à leur corde d , notre mi à leur corde e , &c.
Les tnuficiens françois défignent encore par les noms
de là gammedu / , c fol ut, d la re, b fa f i , &c. tes
dïfférèns tons ou triodes de la ntufique moderne. Get
air éft eh c'fol ut ; nous femmes en b fa fi. Il faudroit,
quand on parle à un Italien ou à un Anglois, dire nous
fommes en c , en ^ , &c, à un François : nous fommes
en ut ou en fi. ( M. Vabbé Feytou. )
ECBOLÉ, ou élévation. C’étoit, dans les plus
anciennes mufiques grecques, une altération du genre
enharmonique, lorlqu’une corde étoit accidentellement
élevée de cinq dièfes au-deflus de fon accord
ordinaire. (/. /. Rousseau.)
ÉCHELLE, fi. f. C ’eft le nom qu’on a donné a
la. fucceffion diatonique des fept notes, ut re mi
fa fol'la f i , de la gamme notée, parce que ces
rotes fe trouvent rangées en manière d’échelons fur
les, portées de notre mufique.
Cette énumération de tous les fons diatoniques de
notre fyftême, rangés par ordre, que nous appelons
échelle i les grecs dans le leur l’appeloient tétracorde ,
parce qu’én effet leur échelle netoit compofée que
dé quatre fons qu’ils répétoient de tétracorde en tétracorde*,
comme nous faifons d’o&ave en o&ave*
( Voyez Tétracorde. )
Saint Grégoire fut, dit-on, le premier qui changea
lés tétracordes des anciens en un éptacorde ou fyftême
" de fept notes; au bout defquelles, commençant une
autre oâave, on trouve des fons femblables répétés
dans le même ordre. Cette découverte eft très-belle ,
& il femblera fingulier que les Grecs, qui voyoient
fort bien les propriétés de i’o&ave, aient cru , malgré
cela, devoir refter attachés à leurs tétracordes. Grégoire
exprima ces fept notes avec les fept premières
.. lettres de l’alphabet latin. Gui Arétin donna des noms
aux fix premières.^ mais il négligea d’en donner un
.à la feptième, qu’en France on a depuis appellée/,
& qui n’a point encore d’autre nom que R mi, chez
la plupart des peuples de l’Europe.
Il ne faut pas croire que les rapports des tons &
fenii-tons dont 1 "échelle eft compofée , foient des
chofes purement, arbitraires, & qu’on eut pu , par
d’autres divifions tout aufli bonnes , donner aux fons
de cette échelle un ordre & des rapports differens.
Notre fyftême diatonique eft le meilleur a certains
égards, parce qu’il eft engendré par les confonnances
& par les différences qui font entr’élles. « Que Yoa
« ait.entendu plufieurs fois « , dit M.Sauveur, » l’ac-
u £ord de la quitte cejui de la quarte, on eft porté
« naturellement à imaginer,la différence qui eft ert-
«'tr’eux; elle s’unit & fe lie avec eux dans notre
«t efprit & participe à leur ; agrément ; voilà le ton
u majeur. Il en va de même du ton mineur, qui
<t eft la différence de la tierce mineure à la' quarte ;
<c & du fe mi-ton majeur, qui eft- celle de là même
quarte à la tierce majeure. » Or le ton majeur, le
tb n 'mineur & le femi-ton majeur; voilà les degres
diatoniques dont notre échelle eft compofée félon les
rapports fui vans ( i ).
- J L 9 i 5 8 9 8 1 5,
9 i o • i 6 9 i,o 9 v 6 •
Pour faire la preuve de ce calcul, il faut com-
pofer tous les rapports compris entre deux termes con-
fdnnans, & l’on trouvera que leur produit donne
exactement le rapport de la confonnancè ; fi l’on
réunit tous lès termes de Y échelle, on trouvera le
rapport total en raifon fous-doub’e; c’eft-à-dire,
comme i eft à 2 : ce qui eft en effet le rapport exa6t
dès deux termes extrêmes; c’eft-à-dire de Yut à fon
oétave.
• I l échelle qu’on vient de voir eft celle qu’on nomme >
naturelle ou diatonique ; mais les modernes, divifant
fes degrés en d’autres intervalles plus petits , en ont
tiré une autre échelle qu’ils ont appelée échelle femi-
tonique ou chromatique, parce qu’elle procède par •
lemi-tons.
Pour former cette échelle, on n’a fait que partager
en deux intervalles égaux ou fuppofés tels, chacun
des cinq tons entieïs de l’oétave, fans diftinguer le
ton majeur du ton mineur; ce qui, avec les deux
femi-tons majeurs qui s’y trouvoient déjà, fait une
fucceffion de; douze femi-tons fur :treize fons con-
fécutifs d’une oélave à l’autre..
L’ufage de cette échelle eft de donner les moyens
de moduler fur telle note qu’on veut choifir pour
fondamentale, & de pouvoir, non-feulement faire
fur cette note un intervalle quelconque , mais y
établir une échelle diatonique, femblable à Y échelle
diatonique de Yut. Tant qu’on s’eft contenté d’avoir
pour tonique une note de la gamme, prifë à volonté,
fans s’embarraffer fi les fons par lefquels devoit paff.-r
la modulation, étoientj avec cette .note, & entr’eux
dans les rapports convenables, Y échelle femi-tonique
étoit peu néceffaire ; quelque fa dièfe, quelque /
bémol compofoient ce qu’on appeîoit les feintes de
la mufique : c’étoient feulement deux touches à ajoûter
CO Ces rapports ne font pas marqués exactement par
Rôuffeau. Ils doïveàjt être rènvèrfés en cette forte.,| — ,
TT3 Il èn éft de mêmë dés exemples gravés d’après
le Dictionnaire de RoufteaU , où cette erreuÇ eft -rèdrfiée
la même planche. \ - . ,y w
( M. Suremain de Mijfery. )
au cïa-fief diatonîque. Mais depuis qu’on àcru fentir
la;nécèffité d’établir entre les divers tons uiie fimili-
; tude parfaite, il a fallu trouver des moyens de tranf-
■ porter les mêmes chants & lies'mêmes intervalles
plus haut ou 'plus bas, félon\le ton que l’on choi-
fiffoit. L'échelle chromatique eft donc devenue d’une
: néceflité indifpénfable ; & c’eft par fon moyen qu’on
; porte.un chant fur tel degré du clavier que l’on veut
■: choifir., & qu’on le rend exaCltïment fur cetre non-
j velle pofition tel qu’il peut avoir été imaginé pour
! un autre/ ‘
Ces cinq fons ajoutés ne forment pas dans la mufique
de nouveaux degrés : mais ils fe marquent tous
fur le degré le plus voifin, par un bémol fi le degré
eft plus haut ; par un dièfe s’il eft plus bas : & la
note prend, toujours le nom du degré fur lequel elle
eft placée. (V oy e z Bémol & Dièfe.) ,
Pour àffigner maintenant les rapports de ces nouveaux
intervalles, il faut favoir que les deux parties
ou femi-tons qui compofent le ton majeur, font dans
les rapports de 15. à 16 & de 128 à 135 ; & que
les deux qui compofent aifffi le ton mineur font
dans les rapports de 1^ à i 6 & d e 2 4 a 2 5 : d e
forte qu’en divifant toute l’oClave félon Y échelle femi-
tonique; on en a tous les termes dans les rapports
exprimés dans les pl. de muf. fig. 142.
Mais il faut remarquer que cette divifion, tirée de
M: Malcolm ,, paroît à bien dès égards manquer de
juftéffef Prernïèrement, les femi-tons qui doivent
être mineurs y font majeurs, & celui du /»/'dièfe'
au la, qui doit être majeur, y eft mineur. En fécond
lieu, plufieurs tierces majeures, comme celle
du la à Yut dièfe, & du mi au fol dièfe, y font
trop fortes d’un comtna ; ce qui doit les rendre irifup-
i portables. Enfin le femi-ton moyen y étant fübftitué
ï au femi-ton maxime ».donne des intervalles faux par-
stout ou il eft employé. Sur quoi l’on ne doit pas
: oublier que ce femi-ton moyen eft plus grand que
le majeur même;c’eft-à-dire, moyen enrrele maxime
& le majeur. ( Voyez Semi-Ton.) (1 )
Une divifion meilleure & plus naturelle feroit
donc de partager le ton majeur en deux femi-tons,
d’un mineur de 24 à: a f , & l’autre maxime de 25 à
•27, laiffant Je ton mineur divifé en deux femi-tons,
;l’un majeur & l’autre mineur, comme dans la table
’ci-deffus.
> 11 y a encore deux autres échelles femi-toniques,
qui viennent de deux autres manières de divifer l’octave
par femi-tons.
La première fe fait en prenant une moyenne harmonique
ou arithmétique entre les deux termes du
Ston majeur j & une autre entre ceux du ton mineur,
! ( ï ) L’auteur fè'trttrripe. Le femi-ton moyen eft moindre
que le majeur, &îl eft moyen entre celui-ci & le mineur,
( Note du même. )
O o 0 ij