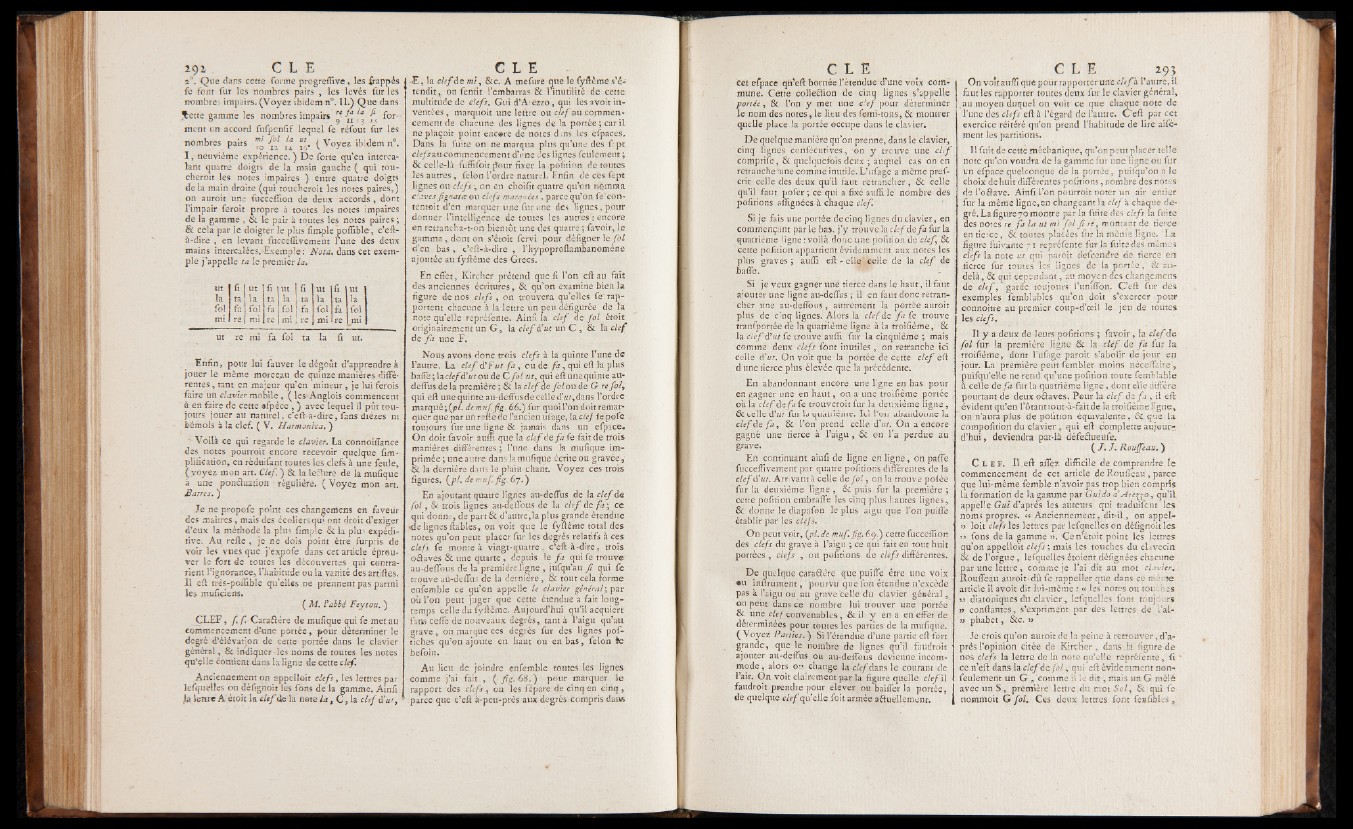
292. C L E
a°. Que dans cette forme progreflive, les frappés
fe font fur les nombres pairs , les levés fur les
nombres impairs. (Voyez ibidem n°. 11.) Que dans
%ette gamme les nombres impairs " '* k f . forment
un accord fufpenfif lequel fe réfout fur les
nombres pairs ^ .ƒ* ( Voyez ibidem n°.
In e u v ièm e expérience.) De forte qu’en intercalant
quatre doigts de la main gauche ( qui tou-
cheroit les notes impaires ) entre quatre doigts
de la main droite (qui toucheroit les notes paires,)
on auroit une fucceflion de deux accords, dont
l’impair feroit propre à toutes les notes impaires
de la gamme , & le pair à toutes les notes paires ;
& cela par le doigter le plus fimple ppflible, c’eft-
à-dire , en levant fucceflivement l’une des deux
mains intercalées.-Exemple: Nota, dans cet exemple
j ’appelle ta le premier la,
ut c ut c fl ut fi ut
la ta la ta la ta la ta la
fol fa fol fa fol fa fol fa fol
mi « nu re mi re mi re ^mi
ut Te mi fa fol ta la a ut.
Enfin, pour lui fauver le dégoût d’apprendre à
jouer le même morceau de quinze manières différentes
, tant en majeur qu’en mineur, je lui ferois
faire un clavier mobile, ( les Anglois commencent
à en faire de cette ofpèce , ) avec lequel il pût toujours
jouer au naturel, c’eft-à-dire, fans dièzes ni
bémols à la clef. ( V. Harmonica. )
' Voilà ce qui regarde le clavier. La connoiffance
des notes pourroit encore recevoir quelque fim-
plifkation, en réduifant toutes les clefs à une feule,
(y o y e z mon art. Clef. ) & la leâure de k mufique
à une pon&uarion régulière. ( Voyez mon art.
Barres. )
Je ne propofe point ces changenlens en faveur
des maîtres, mais des écoliers qui ont droit d’exiger
d’eux la méthode la plus fimp.le & la plu - expéditive.
Au refie , je ne dois point être furpris de
voir les vues que j’expofe dans cet article éprouver
le fort de tomes les découvertes qui contrarient
l’ignorance, l’habitude ou la vanité des artifles.
Il efl très-poflible qu’elles ne prennent pas parmi
les muficiens.
( M. F abbé Feytou. ) .
^ L E F , f. f. Caraâère de mufique qui fe met au
commencement c£une portée, pour déterminer le
degré d’élévation de cette portée dans le clavier
général, & indiquer -les noms de toutes les notés
qu’çlle contient dans la ligne de cette clef.
Anciennement on appelloit clefs, les lettres par
lesquelles on défignoit les fons de la gamme. Ainfi
k lettre A étoit la cle f de la note la , C , la clef (Tut,
C L E
•-E, la clef de mi, &c. A mefure que le fyftême s’étendit,
on fentit l’embarras & Vinutilité de cette
multitude de clefs. Gui d’At ezzo, qui les avoit inventées
, marquoit une lettre ou clef au commencement
de chacune des lignes de la portée; car il
ne plaçoit point encore de notes dms les efpaces.
Dans la fuite on ne marqua plus qu’une des f:pt
clefs au commencement d’une des lignes feulement ;
& celle-là fuffifoit pour fixer la pofition de toutes
les autres, félon l’ordre naturel. Enfin de c'es fept
lignes ou clefs ; on en choifit quatre qu’on nèmrna
c laves fignates ou clefsmarqnées , parce qu’on fe'conte
ntoit d’en marquer une fur une des lignes, pour
donner l’intelligence de toutes les autres : encore
en retrancha-t-on bientôt une clés quatre.; favoir, le
gamma , dont on s’étoit fervi pour défigner le fo l
d’en bas , c’eft-à-dire , l’hypoproflambanomène
ajoutée au fyftême des Grecs.
En effet, Kircher prétend que fi l’on efl au fait
des anciennes écritures, & qu’on examine bien la
figure de nos clefs , on trouvera qu’elles fe* rapportent
chacune à la lettre un peu défigurée de la
note qu’elle repréfente. Ainfi la clef de fol étoit
originairement un G , la clef dyut un C , & la clef
de fa une F.
Nous avons donc trois clefs à la quinte Fnne de
l’autre. La cle f d9 F ut fa , ou de fa , qui eft la plus
baffe;lac/^dVtoude C fo l ut, qui eft ùne quinte au-
deffus de la première ; & la clef de fo l ou de G re fol,
qui eft une quinte au-deflusde celle d'ut, dans l’ordre
marqué; (p/. de muf fis. 66.) fur quoi l’on doit remarquer
que par un refte de l’ancien ufage, la clef fe pofe
toujours fur une ligne & jamais dans un efpace.
On doit favoir âum que la clef de fa fe fait de trois
manières différentes!; l’une dans la mufique imprimée
; une autre dans la mufique écrite ou gravée,
& la dernière dans le plain-chant. Voyez ces trois
figures. ( j i i de mif.fig. 67.)
En ajoutant quatre lignes au-defiiis de la clef de
J o l , 8e trois lignes au-defioiis de la clef de fa ; ce
qui donne, de part& d’autre,la plus grande étendue
«de lignes fiables, on voit que le fyftême total des
notes qu’on peut placer fur les degrés relatifs à ces
clefs fe monte à vingt-quatre, c’eft à-dire, trois
o&aves & une quarte , depuis - le fa qui fe trouve
au-deflous de la première ligne , jufqu’au f i qui fe
trouve aü-deffus de la dernière, & tout cela forme
enfemble ce qu’on appelle le clavier général', par
où l’on peut juger que cette étendue a fait longtemps
celle du fyftême. Aujourd’hui qu’il acquiert
fans ceffe de nouveaux degrés, tant à l’aigu qu’au
grave, on marque ces degrés fur des lignes pof-
tiches qu’on ajoute en haut ou en bas, félon fe
befoin.
Ati lieu de joindre enfemble toutes les lignes
comme j’ai fait , ( fig,68.) pour marquer le
rapport des clefs , on les fépare de cinq en cinq ,
parce que c’eft à-peu-près aux degrés Compris dans
C L E
cet efpace qü’eft bornée retendue d’une voix com- j
mune. Cette colleélion de cinq lignes s’appelle 1
portée, & l’on y met une c le f pour déterminer j
le nom des notes, le lieu des femi-tons, & montrer
quelle place la portée occupe dans le clavier.
De quelque manière qu’on prenne, dans le clavier,
cinq lignes confécutives, -on y trouve une clef
comprife, & quelquefois deux ; auquel cas on en
retranche une comme inutile. L ’ufage a même pref-
crit celle des deux qu’il faut retrancher , & celle
qu’il faut pofer ; ce qui a fixé aufli le nombre des
polirions aftignées à chaque clef. '
Si je fais une portée dècinq lignes du clavier, en
commençant parle bas, j’y trouve la clef de/ùfurla
quatrième ligne: voilà donc une pofition.de clef, &
cette pofition appartient évidemment aux notes les
plüs graves ; aufli efl: - elle % celle de la clef de
baffe.
Si je veux gagner une tierce dans le haut, il faut
ajouter une ligne au-deffus ; il en faut donc retrancher
une au-deflous , autrement la portée auroit
plus de cinq lignes. Alors la clef de fa fe trouve
tranfportée de la quatrième ligne à la troifième, &
la cle f à1 ut fe trouve, aufli fur la cinquième ; mais
comme deux clefs font inutiles, on retranche ici
celle cl’ur. On voit que la portée de cette c le f eft
d une tierce plus élevée que la précédente.
En abandonnant encore une ligne en bas pour
en gagner une en haut, on a une troifième portée .
où la clef de fa fe trouveroit fur la deuxième ligne ,
& celle d'ut fur la quatrième. Ici l’on abandonne la
clef de f a , & l’on prend celle d'ut. On a encore
gagné une tierce à l’aigu , & on l’a perdue au
grave.
En continuant ainfi de ligne en ligne, on pafle
fucceflîvement par quatre pofitions différentes de la
c le f déut. Arrivant à celle de f o l , on la trouve pofée
fur la deuxième ligne , & puis fur la première ;
cette pofition embraffe les cinq plus hautes lignes,
& donne le diapafon le plus aigu que l’on puiffe
établir par les clefs.
On peut voir, {pl. de muf. fig. 69.) cette fucceflion
des clefs du grave à l’aigu ; ce qui fait en tout huit
portées , clefs , ou pofitions de clefs différentes.
De quelque caractère que puiffe être une voix
•u infiniment, pourvu que foin étendue n’excède
pas à l’aigu ou au grave celle du clavier général^
on peut dans ce nombre lui trouver une portée
& une clef convenables, & i l y en a en effet de
déterminées pour toutes les parties de la mufique.
(V o y e z P arties. ) Si l’étendue d’une partie efl fort
grande, que le nombre de lignes qu’il faudroit 1
ajouter au-deflùs ou au-deflous devienne incommode
, alors on change la clef dans le courant de
l’air. On voit clairement par la figure quelle clefW
faudroit prendre pour élever ou baiffer la portée,
de quelque c le f qu’elle foit armée a&uellemenc-.
C L E 293
On voit aufli que pour rapporter un‘e c le f à l’autre, il
faut les rapporter toutes deux fur le clavier général,
.au moyen duquel on voit ce que chaque note de
l’une des clefs eft à l’égard de l’autre. C ’eft par cet
exercice réitéré qu’on prend l’habitude de lire aifé-
ment les partitions.
Il fuit de cette méchanique, qu’on peut placer telle
note qu’on voudra delà gamme fur une ligne ou fur
un efpace quelconque de la portée, puifqu’on a le
choix de huit différentes pofitions, nombre des notes
de l’oâave. Ainfi l ’on pourroit noter un air entier
fur la même ligne,en changeant la clef 2, chaque degré.
La figure 70 montre par la fuite des clefs la fuite
des notes re fa la ut mi fol f i rê, montant de tierce
en tiefee, & toutes placées fur la même ligne. La
figure fuivarite 71 repréfente fur la fuite des mêmes
clefs la note ut qui paroît defeendre de tierce en
tierce fur toutes les lignes de la portée, & au-
delà , & qui cependant, au moyen des changemens
de c le f, garde toujours l’uniffon. C ’eft fur des
exemples femblables qu’on doit s’exercer pour
connoître au premier coup-d’oeil le jeu de toutes
les clefs.
Il y a deux de leurs pofitions ; favoir, la c le f de
fol fur la première ligne & la c le f de fa fur la
troifième, dont 1 ufage paroît s’abolir de jour en
jour. La première peut fembler moins néceffaire ,
puifqu’elle ne rend qu’une pofition toute femblable
à celle de fa fur la quatrième ligne, dont elle diffère
pourtant de deux o&aves. Peur la clef dé f a , il eft:
évident qu’en l’ôtant tout-à-fait de la troifième ligne.,
on n’aura plus de pofition équivalente , & que- la
compofition du clavier , qui eft complette aujourd’hui
, deviendra par-là défeéfueüfe.
( J. J. Rouffeau. )
C l e f . Il eft aflez difficile de comprendre le
commencement de cet article de Rouffeau, parce
que lui-même femble n’avoir pas trop bien compris
la formation de la gamme par Guido <£Are^~o, qu’il
appelle Gui d’après les auteurs qui traduifent les
noms propres, « Anciennement, dit-il 0 on appel-
n loit clefs les lettres par lefquelles on défignoit les
3î fons de là gamme ». Ce n’étoit point les lettres
qu’on appelloit clefs ; mais les touches du clavecin
& de l ’orgue, lefquelles étoient défignées chacune
par une lettre, comme je l’ai dit au mot clavier.
Rouffeau auroit dû fe rappelier que dans ce m.êine
article il avoit dit lui-même : « les notes ou touches
33 diatoniques du clavier, lefquelles font toujours
n confiantes, s’expriment par des lettres de i’al-
» phabet, &c. »
Je crois qu’on auroit de la peine à retrouver, d’ar
près l’opinion citée de Kircher , dans la figure de
nos clefs la lettre de la note qu’elle repréfente, fi
ce n’eft dans la c le f de fo l , qui eft évidemment non-
feulement un G , comme il le d it, mais un G mêlé
avec un S., première lettre du mot Sol, & qui fe
nommoit G fol. Ces deux lettres font fesfibles 9