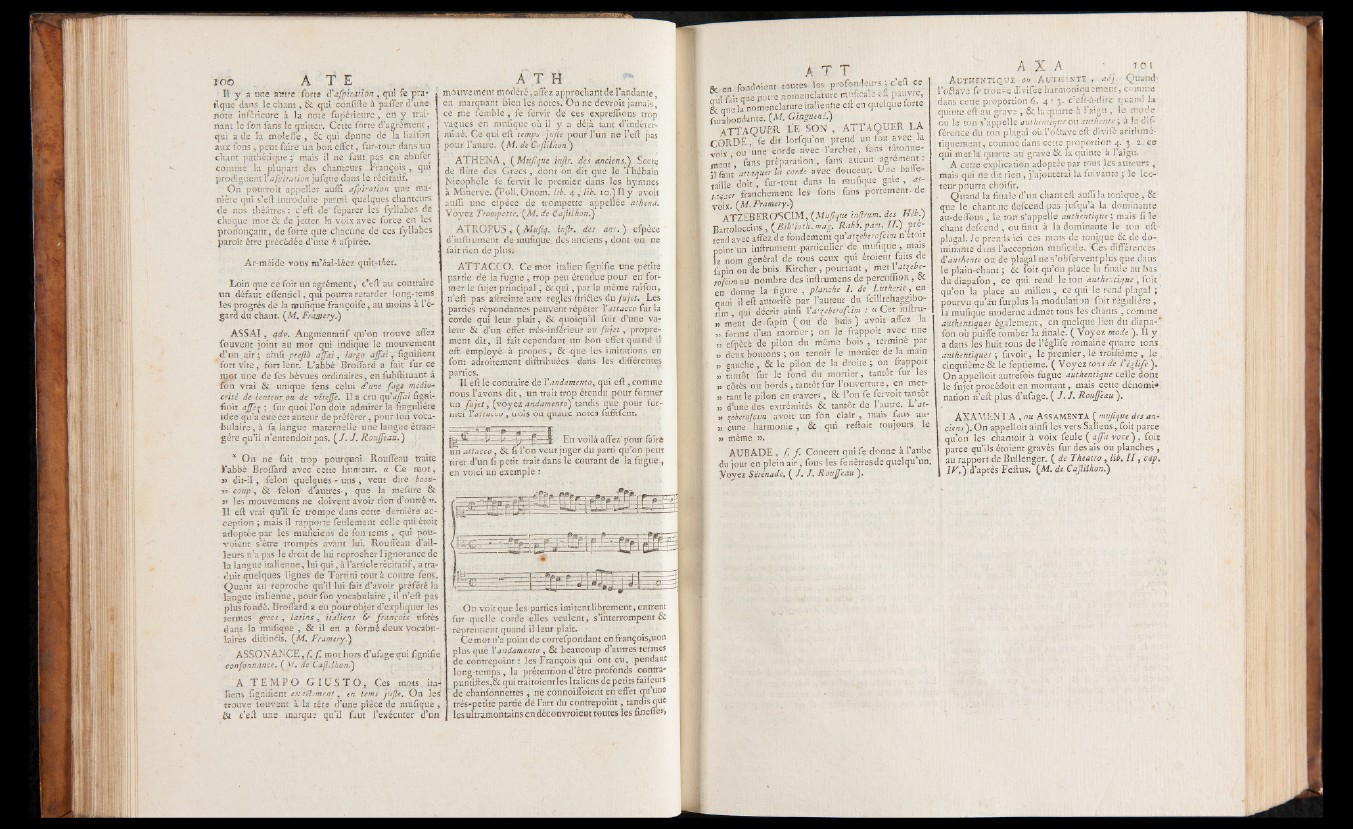
j'oè. A T E
Il y a une autre forte d'afpiràtidn , qui fe pratique
dans le chant, & qui cdnfifte à palier d une-
riots inférieure à la note fupérieure, en y traînant
le fon fans lé quitter. Cette forte d’agrément,
qui a de la moleffe , & qui donné de la liaifon
aux Ions , peut faire un bon éffet, fur-tout dans un
chant pathétique ; mais il ne faut pas en abufer
comme la plupart des chanteurs François, qui
prodiguent Y aspiration jüfqiie- dans le récitatif.
On pourroit appeller auffî afpira tio n une manière
qui s’eft introduite parmi quelques chanteurs
de nos théâtres : c’eft de' fépàrer les fyllabes dé •
chaque mot & de jetter la voix avec force en les
prononçant, de forte que chacune de ces fyllabes
paroît être précédée d’une h afpîrée.
Ar-méide vous m’éal-ÎAez quÎNtéer.
Loin que ce foit-un agrément , c’eft au contraire
un défaut effentiel, qui pourra retarder long-tems
les progrès de la naufique françoife, au moins à l’égard
du chant. (Af. F ramer y?)
ASS A I , adv. Augmentatif qu’on trouve allez
•fouvent joint au mot qui indique lé mouvement
d’un air ; ainfi prejlb ajfai, largo ajpïi y lignifient
fort v ite , fort lent. L’abbé Broffard a fait fur ce
mot une de fes bévues ordinaires, en fubftituant à
fon vrai & unique fens celui d'une fige média-
crité de lenteur,ou de vîtejfe. l i a cru qu'ajjai figni-
fioit ajfe^ ; fur quoi l’on doit admirer la finguliêre
idée qu’a eue cet auteur de préférer, pour fon vocabulaire,
à fa langue maternelle une langue étrangère
qu’il n’entendoit pas. ( /. J. Roujfea.ii. )
* Ôn ne fait trop pourquoi Rouffeaii traite
l ’abbé Brollard avec cette humeur. « Ce m o t,
j) dit-il, félon quelques - uns , veut dire beau-
33 c o u p , & félon d’autres , que la mefüre &
3? les mouvemens ne doivent avoir rien d’outré w.
11 eft vrai qu’il fe trompe dans cette dernière ac- ■
ception ; mais il rapporte feulement célle qui étoit
adoptée par les muficiens de fon tems , qui pou-
voient s’êtré trompés avant lui. Rouffeaii d’ail- .■
leurs n’a pas le droit de lui reprocher 1 ignorance de
la langue italienne, lui qui, à l’article récitatif, a traduit
quelques lignes de Tartini tout à contre fens.
Quant au reproche qu’il lui fait d’avoir préféré la
langue italienne, pour fon vocabulaire , il ri’eft pas
plus fondé. Brollard a eu pour objet d’expliquer les
termes grecs , la t in s ., italiens & f r a n c ois- U fîtes
dans la mufique , & il en a formé deux vocabulaires
diftinéls. (Af. F ram e r y j
ASSON A N C E , ƒ. f . mot hors d’ufage qui fignifie
conformance. ( V/. de Cajlilhon.)
A T E M P O G I U S T O , Ces mots ita-j
liens lignifient exà&sment, en tems ju fle .. On Tes
trouve louvent à la‘ tête d’une pièce de mufique ,
& .c’eft une marque qu’il faut l’exécuter d’un
A T H
mouvement modéré, affez approchant de l’andante
en marquant bien les notes. On ne devroit jamais,
ce me femble, fe férvif de ces expreflions trop
vagues en mufique où il y a déjà tant d’indéter-
niiné. Ce qui eft temps jtijlé pour l’un ne l?eft pas
pour l’autre. (A/, de Caftilhotf)
A TH ÉN A , ( Mufique injlr. . des anciens?) Sorte
de flûte des Grecs , dont on dit que le Thébain
Nicophèle fe lervit le premier dans les hymnes
à Minerve. (Poil. Onoiru lib. 4 , lib. io.) Il y avoit
auffi une elpèce de trompette appellée athend.
Voyez Trompette. (Af. de Cajîilhon.'j
ATROPUS , ( M u fiq . injlr. des anc. ) efpèce
d’inftrument de mufique des anciens, dont on ne
fait rien de plusi
A T T A C C O . Ce mot italien fignifie une petite
partie de la fugue , trop peu étendue pour en former
le fujet p r in c ip a l6c q u i, par la même ràifon,
n’eft pas aftreinte aux réglés ftri&es du fu je t. Les
parties répondantes peuvent répéter 1 'attacco fur la
corde qui leur plaît, & quoiqu’il foit d’une valeur
& d’un effet très-inférieur ali f u j e t , proprement
dit , il fait cependant un bon effet quand il
eft employé à propos, & -que les imitations en
font adroitement diftribuées dans les différentes
parties.
Il eft le contraire de l’andamento^ qui e ft, comme
nous Pavons d it, un trait trop étendu pour former
un f u j e t , (voyez andamento) tandis que pour former
Y attacco trois ou quatre notes fuffifent.
•.— —!■ En voilà affez' pour faire
un attacco , & fi l’on veut juger du parti qu’on peut
tirer d’un fi petit trait dans le courant de la fugue.,
en voici un exemple :
w
On voit que les parties imitentlibrement, entrent
fur quelle corde elles veulent, s’interrompent &
reprennent quand il leur plaît.
Ce mot n’a point dé: correfpondant en françois,uon
plus que Y andamento , & beaucoup d’autres termes
de contrepoint : les François qui ont eu, pendant
long-temps , la prétention d’être profonds contra-
puntiftes,& qui traitoientles Italiens de petits faifçurs
de chanfonnettes , ne connoiffoierit en effet qu’une
très-petite partie.dé l’art du contrepoint, tandis auè
les ultramontains en déconyroieiat toutes les fineffes*
A T T
& en {ondoient toutes les profondeurs ; c’eft ce
nui fait que notre nomenclature muficale eft pauvre,
â: que la nomenclature italienne eft en quelque forte
furabondante. (Af. Ginguenc.)
A T T A Q U E R LE SON , A T T A Q U E R LA
T O R D E fe dit lorfqu’on prend un fon,avec la
voix bii 'une corde avec l’archet, fans tâtonnement’,
fans préparation , .fans aucun agrément :
il faut attaquer la corde avec douceur. Une baffe-
taille doit fur-tout dans la mufique gaie , attaquer
franchement les ■ fons fans portement.de
voi x .(M .P r am e r y .)
ATZEBEROSCIM, (Mufique inllrum. des Heb.)
Bartoloccius , ( B ib lïo th . mag. Rabb. p a rt. I I . ) prétend
avec affez de fondement q u ’atqebcrojcim n etoit
; point un inftrument -particulier de mufique , mats
le nom général de tous ceux qui étoient faits de
fapin ou de buis. Kircher , pourtant , m e t Yatqebe-
rofdm au nombre des inftrumens de percuffion, K
en donne la figure , p lanche 1. de l u th e r i e , en
quoi il eft autorifé par l’auteur du fcilltehaggibo-
rim, qui décrit ainfi l'a'qeberofcim : « Cet iiiftru-
» ment deffapin ( o u de b u is) avoit affez la
t „ forme d’tui mortier ; on le' frappoit avec une
I, 53 efpècè de pilon du même bois , terminé par
| li deux boutons ; on tenoit le mortier de la main
: j, gauche, & le pilon de la droite ; on frappoit
33 tantôt fur le fond du mortier, tantôt fur les
33 côtés ou bords, tantôt fur l’ouverture, en met-
| 33 tant le pilon en travers , & l’on fe fervoit tantôt
! si d’une des extrémités & tantôt de l’autre. L a t-
33 reberofcïm :avoit un: fon clair , mais fans au-
33 çune harmonie , & qui reftoit toujours, le
I 33 même ».
AUBADE , f i f . Concert qui fe donne à l’aube
du jour en plein air, fous les fenêtresde quelqu’un,
y oyez Sérénade. ( / . / . Ro u jfea u ) .
A X A ; ioi
A üTHESTÏQVI ou A uti-IlNTïï , ad). Quand
l’oélâve fe trouve dlvifée liarnioniquement, comme
dans cette proportion 6. 4 : 3. c’eft~à-dire quand la
quinte eft au grave , & la quarte à l’aigu , le mode
où le ton s’appelle authentique ou aulhente 5 a la différence
du ton plagal o u i’délave eft divifé arithmétiquement
, comme dans cette proportion 4. 3.2. ce
qui met la' quarte au grave & la quinte à l’aigu.
A cette explication adoptée par tous les auteurs ,
mais qui ne dit rien , j’ajouterai la fui van te ; le lecteur
pourra choifir.
Quand la finale d’un chant eft auffi la tonique , &
que le chant ne defeend pas jufqu’à la dominante
au-deffous , le ton s’appelle authentique ; mais fi le
citant defeend , ou finit à la dominante le ton eft-
plagal. Se prends ici ces mots de tonique & de dominante
dtns l’acception muficale. Ces différences
à’ aurhente 011 de plagal ne s’obferventplus que dans
le plain-chant ; & foit qu’on place la finale au bas
dudiapafon, ce qui rend le ton authentique:, foit '
qu’on la place au milieu, ce qui le rend plagal ; '
pourvu qu’au furplus la modulation foit régulière ,
la mufique moderne admet tous les chants , comme
authentiques également, en quelque lieu du diapa-
, fon où puiffe tomber la finale. ( V oyez mode ). Il y
a dans les huit tons de l’églife romaine quatre tons
authentiques ; favoir, le premier, le troifiëme , l e .
cinquième & le feptiême. ( Voyez tons de l'é g life ).
On appelloit autrefois fugue a u th en tiq u e celle dont
le fujet procédoit en montant, mais cette dénomr*
nadon n’ell plus d’ufage. ( J . J . Roujjeau ).
AXAMENTA , ou Assamenta ( mufique des an-,
cierrs). On appelloit ainfi les vers Saiiens, foit parce
qu’on les chantait à voix feule ( a fin voce ) , foit
parce qu’ils étoient gravés fur des ais ou planches ,
au rapport de Bullenger. ( de T h e a tro , lib, I I , cap,
iy . ) d’après Feftus. {M. de Cajlilhon.)