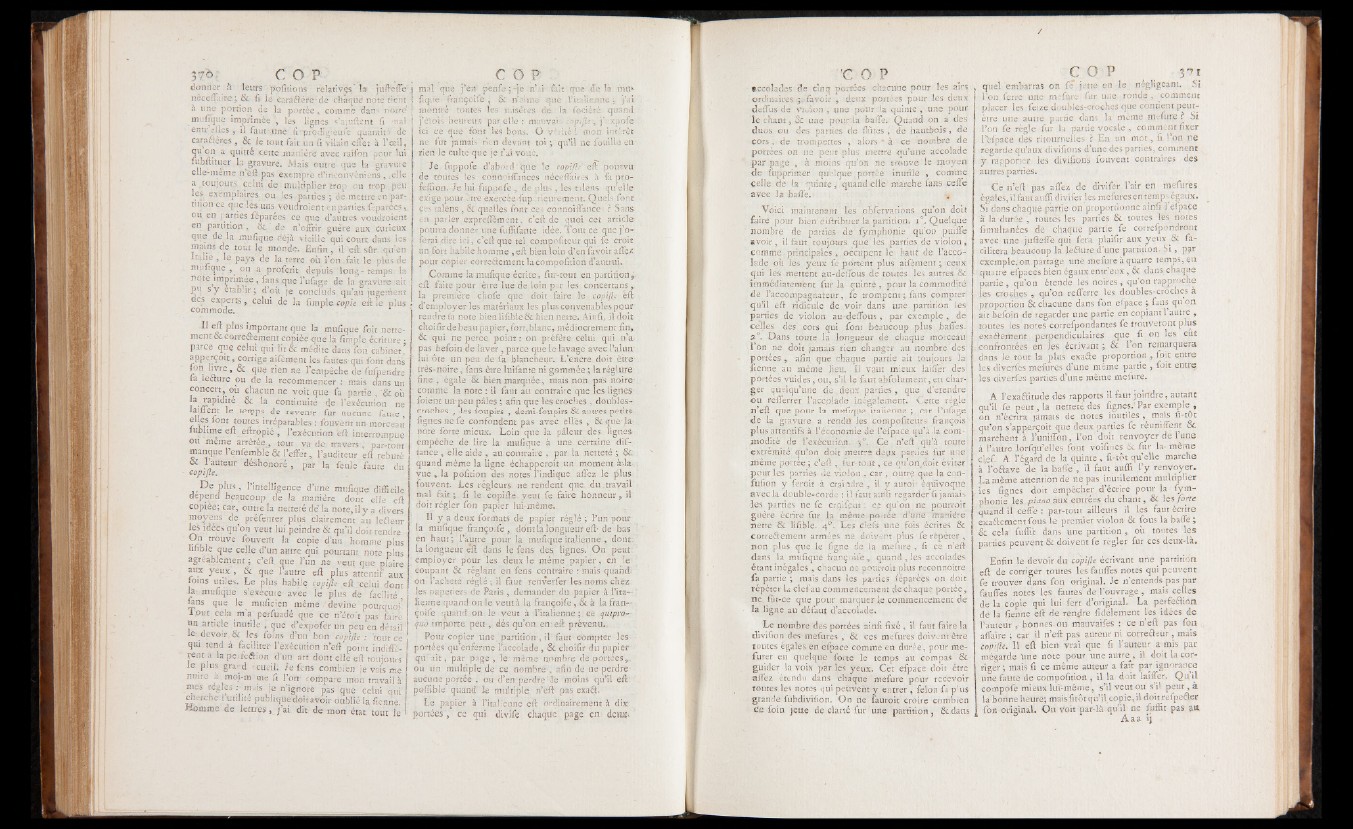
3 7 ô ' C O P
donner à leurs profitions relatives, la- juffeffe
nécefiaire.; & fi: le caraCteredé chaque note tient
à une portion de la portée, comme dan- notre
mufique imprimée', les lignes s 'a liten t fi mal ■
entr elles , il faut une fi : prodïgteiue quantité de
caraClères , & le tout fait un fi vilain effet à l’oeil ,
qu on a quitté cette manière avec raifon pour lui
fubftituer la gravure. Mais outre que la gravure
elle-même n’èft pas exempte d’inconvéniens , -.elle
a ,toujours celui de multiplier trop ou trop peu
les exemplaires, ou les parties ; de mettre en par-
titjon ce que lès uns voudroient en parties féparées >.
ou en parties féparées ce que d’autres voudroient
en parution , & de n’offrir guère aux curieux
que de la mufique déjà vieille qui court dans les
mains de tout Iç monde. Enfin, il eft. sûr ,qu?en
Italie , le pays de la terre où l’on fait le plus de
mufique, on a profçrit depuis long-temps la
note imprimée , fans que l’ufage de la gravure :ait
pu s y etab'ir ; d’où je concluds qu’au jugenfient
;s experts, celui de la fimple copie eft le plus
commode,.
C O P
mal que j’eif penfe;-je n’ .fi fait que d e là mil*
fi que- françoife 6 8c n’aime que l’italienne ; j’ai
montré toutes les misères de la fociétê quand
j’étois heureux par elle : manvai cop.jle , j’cx.pofe
ici ce que font les bons. O v V u é î mon intérêt
ne fut jamais rien devant toi ; qu’il ne fouille en
rien le culte que je t’ai voué.
Je fuppofe d’abord que le copi (h' eft pourvu
de tôutes les connoiffances néceffaites à fa pro-
fefiion. Je lui fuppofe , de plus , les talens qu’elle
exige pour être exercée fup rieurement. Quels font
ces talens , & quelles font ce-, connoifiance- ? Sans
en parler expreffément. c’eft de quoi cet article
pourra donner une fuffifante idée. Tout cé que j’o-
ferai dire ici, c’eft que tel compofiteur qui fie croit
un fort habile homme , eft bien loin d’en fiavoir afféz
pour copier correctement la compofition d’autrui.
Comme la mufique écrite, fiur-tout en partition,',
eft faite pour être lue de loin par les concerta ns ,
la première chofe que doit faire le copifle èû.
d’employer les matériaux les plus convenables pour
rendre fa note bien lifible & bien nette. Ainfi, il doit
11 eit puis important que la mufique foit nette
ment & correctement copiée que la fimplë écriture
parce que celui qui lit & médite dans fon cabinet
apperçoit, corrige aifénjent ies fautes qui font dan:
Ion hvre, & que rien ne l’empêche de fufpendr<
ta lecture ou de la recommencer : mais dans ur
concert, ou chacun ne voit que fa partie, '& oi
j a._IaPldlté & la continuité de l’exécution n<
lajffent le temps de revenir fur aucune faute
elles font toutes irréparables : fou vent un morceai
lubhme eft eftropié , l’exécution eft interrompu«
ou meme arrêtée, tout va de travers par-toùi
manque l’enfemble & l’effet, l’auditeur eft rebuté
& 1 auteur déshonoré, par la feule faute di:
copifle.
D e plu s, l’intelligence d’une mufique difficile
dépend beaucoup de la manière, dont elle efi
copiée; car, outre la netteté de' la note, il y a divers
mo7 eus de préfenter^ plus clairement au- leéîeui
les idées qu’on veut lui peindre & qu’il doit rendre
On trouve fouvent la copie d’un homme plus
lifible que celle d’un autre qui pourtant note pim
agréablement; c’eft que l’un ne veut que plaire
aux y e u x , & que l’autre eft plus attentif.aux
foins utiles. Le plus habile copifle' eft -celui dont
.lat, mufique s’exécute' avec le plus de facilité ,
lans que le • muficien même f devine pourquoi
Tout cela m’a perfuadé que ce n’éto't pas faire
un article inutile , que d’expofer un peu en détail
te-devoir, & les foins d’un bon copifte ; tout ce
qui tend à faciliter 1’èxécution n’eft point indifférent
a la peifeftion d'un art dont elle eft toujours
le plus grard -cueil. Je fens combien je vais me
nuire à moi-m me fi l’on compare mon travail à
mes régies : m.fis je n’ignore pas que celui qui
cherche 1 utilité publique doit a voir oublié la fienne.
Jjbmme de lettres, j ai dit de mon état tout le
choifir de beau papier, fort,blanc, médiocrement fin,
& qui ne perce point : on préfère celui qui n’a
pas befoin de laver , parce que le lavage avec l’alun-
lui ôte un peu de fa blancheur. L ’encre, doit être
très-noire, fans être luifante ni gommée.; laréglure
fine , égale & bien marquée., mais non pas noire-
comme la note : il faut au contraire que les lignes-
foient un-peu pâles ; afin que les croches , doubles-
croches , les foupirs , demi foupirs & autres petits-
lignes ne fë confondent pas avec elles , 8c que Ja-
note forte mieux. Loin que la pâleur des lignes-
empêche de lire là mufique à line certaine distance
, elle aide , au contraire , par la netteté &
quand même la ligne échapperoit un moment à-la-
vue , la pofition des notes l’indique affez le plus
fouvent. Les régleurs ne rendent que. du travail
mal fait; fi j e copifte. veut fe faire honneur, il
doit régler fon papier lui-même.
Il y a deux formats de papier réglé ; Pun pour
la mufique françoife , doht la longueur eft- de bas
en haut; l’autre pour la mufique italienne , dont,
la longueur eft dans le fens des, lignes. On peut:
; employer pour les deux le même papier, en le-
coupant & réglant en fens contraire : mais quancL
on l’acheté réglé ; il faut renverfer les noms chez
les papetiers de Paris , demander du papier à Tita— '
lienne quand on le veut à la françoife, oc à la fran—
çoife quand on le veut à l’italienne; ce quipro-r
quo importe peu , dès qu’on, en: eft prévenu..
Pour copier une partition-, il faut compter les
portées qu’enferme l’accolade , 8c choifir du papier
qü: a it , par page , le même nombre de portées,,
ou iin multiple.de ce nombre-, afin dé ne perdre-
aucune portée , ou d’en perdre le moins qu’il eft:
pofiible quand le multiple n’ëft pas exaCb
Le papier à l’italienne eft ordinairement à dix:
portées', ce qui diyife chaque page enj deus^
c o P
«ccolades Se cinq portées chacune pour les airs
ordinaires j.Tavoir , deux portées pour les deux
deffus dé Vision, une pour la quinte, une pour
le chant, & une pour-la baffe. Quand on a des
duos ou des parties de flûtes j de hautbois, de
cors , de trompettes , alors - à ce nombre de
portées on ne peut plus mettre qu’une accolade
par page , à moins qu’on né trouve le moyen
de fnpprimer quelque ; portée inutile , comme
celle de la quinte ,• quand elle marche fans ceffe
avec la baffe. ; ,
Voici maintenant les obfervatiôns qu’on doit
faire pour bien ciftribuer la partition, i°. Quelque
nombre de parties de fymphonie qu’on puiffe
avoir, il faut toujours que les parties de violon,
comme principales , occupent le haut de l’accolade
où les yeux fe portent plus aifément ; ceux
qui les mettent au-deffous de toutes les autres 8c
immédiatement fur la quinte, pour la commodité
de l’accompagnateur, fe trompent ; fans compter
qu’il eft ridicule de voir dans une partition Jes-
parties de violon au-deffous , par exemple , de
celles des cors qui font bèaucoup plus „baffes.
2°. Dans toute la longueur de chaque morceau
l ’on ne doit jamais rien changer au nombre des ,
portées , afin que chaque partie ait toujours la
lienne au même lieu. Il vaut mieux laiffèr des'
portées vuides, ou, s’il le faut abfolumént, en charger
quelqu’une de . deux parties , que d’étendre
©u refferrer l ’accolade inégalement. Cette règle
« ’eft que pour la mafiqpe italienne ; car l’ufage
de la gravure a rendu les compofiteurs françois
plus attentifs à l’économie de l’efpace qu’à la commodité
de l’exécuticn. 30. Ce n’eft qu’à toute
extrémité qu’on doit mettre deyx parties fur une
même portée ; c’eft , fur-tout, ce qu’on^doit éviter ■
pour les parties de violon , car , outrç que la con- j
fufion y feroit à craindre , il y auroir équivoque ■
avec la double-corde : il faut aufti regarder fi jamais
les parties ne fe crqifent : ce qu’on ne pourroit
guère écrire fur la même portée d’une manière :
nette 8c lifible. 40. Les clefs une fois écrites & j
correctement armées ne doivent plus fe répéter , ;
non plus que le figne de la mefure , fi ce n’eft
dans la mufique françoife , quand , les accolades
étant inégales , chacun no pourroit plus reconnaître ,
fa partie ; mais dans les parties féparées on doit
répéter U c le f au commencement de chaque portée,
ne fut-ce que pour marquer le commencement de
la ligne au défaut d’accolade.
Le nombre des portées ainfi fixé , il faut faire la
divifion des mefures , 8c ces mefures doivent être
toutes égales en efpace comme en durée, pour me-
furer en quelque forte le temps au compas &
guider la voix par les yeux. Cet efpace doit être
affez étendu dans chaque mefure pour recevoir
toutes les notes qui peùvent y entrer , félon fa p'us
grande fubdivifion. On ne fauroit croire combien
ce foin jette de clarté fur une partition, & dans
C O P 3 7 ï
quel embarras on -fe;jette en le négligeant. Si
l ’on ferre une rnafûre fur une ronde , comment
placer les feize doubles-croches que contient peut-
être une autre partie dans la même nu-fure ? Si
l’on fe règle fur la partie vocale , comment fixer
l’bfpace des ritournelles ? En un mot, fi l’on ne
regarde qu’aux divifions d’une des parties, comment
y rapporter les divifions fouvent contraires des
autres parties.
Ce n’eft pas affez de divifer l’air en mefures
égales,il faut aufti divifer les mefures en temps égaux.
Si dans chaque partie on proportionne ainfi i elpace
à la durée , toutes les parties 8c toutes les notes
fimultanées dé chaque partie fe correfpondront
avec une jufteffe qui fera, plaifir aux yeux & facilitera
beaucoup la leâure d’une partition. S i , p^r
exemple, on partage une mefure à quatre temps, eu
quatre efpaces bien égaux entr’eux, & dans chaque
partie , qu’on étende les noires , qu’on rapproche
les croches , qu’on refferre les doubles-croches a
proportion & chacune dans fon efpace ; fans qu on
ait befoin de regarder une partie en copiant l’autre ,
toutes les notes correfpondantes fe trouveront plus
exactement perpendiculaires que fi on les eut
confrontées en les écrivant; & l’on remarquera
dans le tout la plus exaéte proportion , foit entre
les diverfes mefures d’une même partie , foit entre
les diverfes parties d’une même mefure.
A l’exaéritude des rapports il faut joindre, autant
qu’il fe peut, la netteté des fignes.!Par exemple^,
on n’éçrira jamais de notes inutiles , mais fi-tot
qu’on s’apperçoit que deux parties fe reuniffent 8c
marchent à l’uniffon, l’on doit renvoyer de l’une
à l’autre lorfqu’elles font voifines 8c fur la- même
ctef. A l’égard de la quinte , fi-tôt qu’elle marche
à l’oCtave de la baffe , il faut ^ufli l’y renvoyer.
La même attention de ne pas inutilement multiplier
tes fignes doit empêcher d’écrire pour la fymphonie
les pia.no aux entrées du chant, 8c les forte
quand il ceffe : par-tout ailleurs il les faut écrire
exactement fous le premier violon & fous la baffe ;
8c cela fuffit dans une partition , où toutes les
parties peuvent 8c doivent fe régler fur ces deux-là.
Enfin le devoir du copifle écrivant une partition
eft de corriger toutes les fauffes notes qui peuvent
fe trouver dans fon original. Je n’entends pas par
fauffes notes les fautes de l’ouvrage , mais celles
de la copie qui lui fert d’original. La perfeClion
de la fienne eft de rendre fidèlement les idées de
l’auteur bonnes ou mauvaifes : ce n’eft pas fon
affaire ; car il n’eft pas auteur ni correCteur, mais
copifle. 11 eft bien vrai que fi l’auteur a mis par
mégarde Une note pour une autre^, il doit la corriger
; mais fi ce même auteur a fait par ignorance
une faute de compofition , il la doit latffer. Q u ’il
j compofe mieux lui-même, s’il veut ou s’il peut, à
la bonne heure; mais fitôt qu’il copie, il doit refpeCter
fon original. On voit par-là qu’il ne fuffit pas «u*
A a a ij