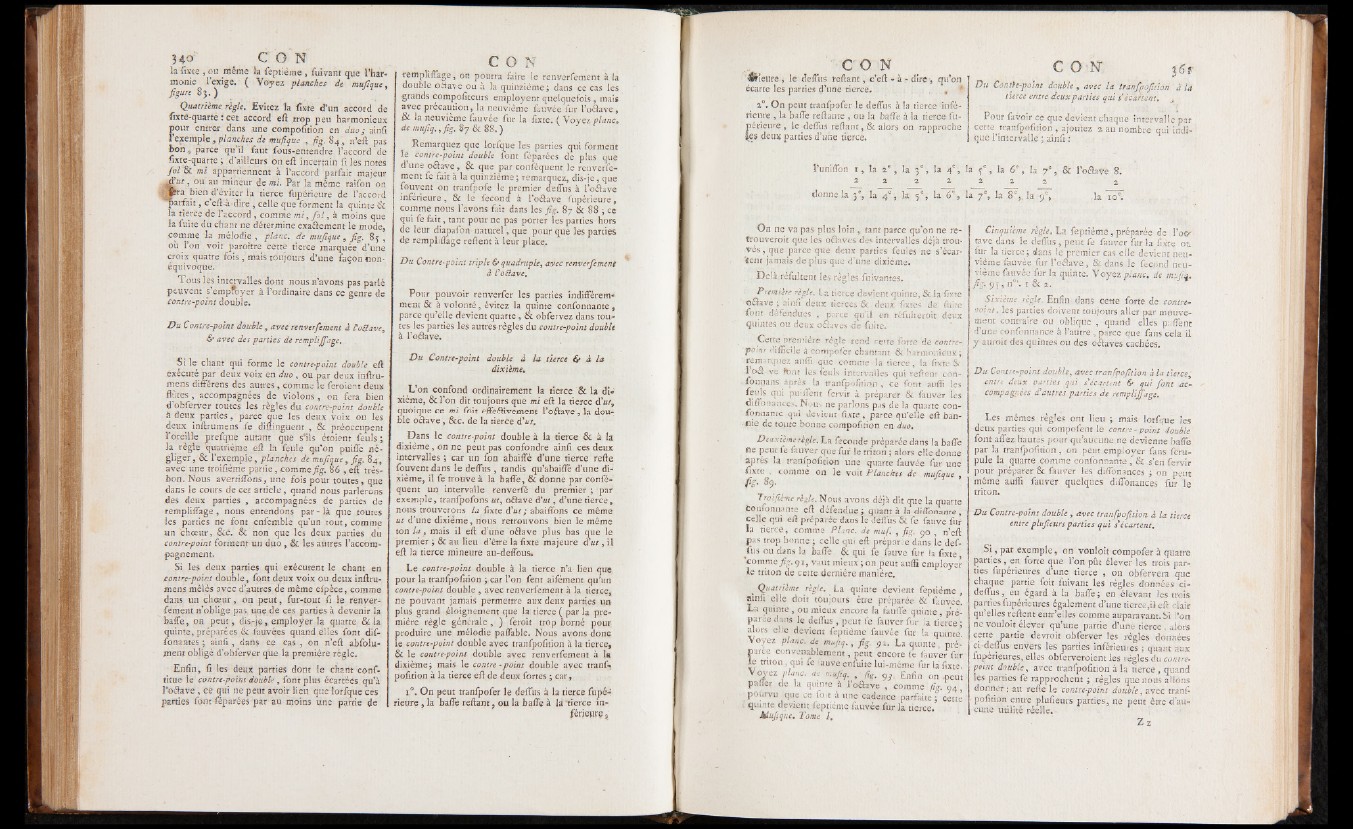
340 C O N
la fixte , ou meme la feptième , fuivant que l’harmonie
l ’exige. ( Voyez planches de mufique,
figure 83. )
Quatrième règle. Evitez la fixte d’un accord de
fixte-quarté : cet accord eft trop peu harmonieux
j)0ur entrer, dans une compofition en duo ; ainfi
1 exemple , planches de mu fi que , fîg. 84., n’eft pas
bon ., parce qu il faut fbus-entendre l’accord de
fixte-quarte ; d ailleurs on eft incertain fi les notes
fo l & mi appartiennent à l’accord parfait majeur
ijrfLut » 9U au ;mineur de mi. Par la même raifon on
fjjgra bien d’eviter la tierce fupérieure de l’accord
parrait, c’eft-à-dire , celle que forment la quinte &
la tierce de l’accord, comme mi, f o l , à moins que
la fuite dû chant ne détermine exa&ement le mode,
.comme la mélodie , plane, de mufique, fig, 83 ,
où l’on voit paroitre cette tierce marquée d’une
croix quatre fois , mais toujours d’une façon non-
équivoque.
Tous les intervalles dont nous n’avons pas parlé
peuvent s'employer à l’ordinaire dans ce genre de
contre-point double.
Du Contre-point double, avec renverfement d FoQave9
& avec des parties de rempîiffage..
S i le chant qui forme le contrepoint double eft
exécuté par deux voix en duo , ou par deux inftru-
mens différens des autres, comme le feroient deux
flûtes , accompagnées de violons , on fera bien
d’obferver toutes les règles du contre-point double
à deux parties, parce que les deux voix ou les
deux inftrumens fe diftinguent , & préoccupent
l’oreille prefque autant que s’ils étoient feuls ;
la régie quatrième eft là feule qu’on puiffe négliger
, & l’exemple, planches de mufique, fig. 84',
avec une troiiîème partie, comme ƒ g. 86 , eft très-
bon. Nous avertirons, une fois pour toutes, que
dans le cours de cef article, quand nous parlerons
des deux parties , accompagnées de parties de
rempîiffage, nous entendons par - là que toutes
les parties ne font enfemble qu’un tout, comme
un choeur, &c. & non que les deux parties du
contrepoint forment un duo , & les autres l’accom-
pagnement.
Si les deux parties qui exécutent le chant en
contre-point double, font deux voix ou deux inftrumens
mêlés avec d’autres de même efpèce, comme
dans un choeur, on peut, fur-tout fi le renversement
n’oblige pas, une de ces parties à devenir la
baffe, on peut, dis-je,, employer la quarte & la
quinte, préparées & fauvées quand elles font dif-
fonantes ; ainfi, dans ce cas , on n’eft abfol.u-
ment obligé d’obferver que la première régie.
Enfin, fi les deux parties dont le chant conf-
titue le contrepoint double, font plus écartées, qu’à
l’oélave , ce qui ne peut avoir lieu que lorfque ces
parties font féparées par au moins une partie de
c o N
rempîiffage, on pourra faire le renverfement à la
double odave ou à la quinzième ; dans ce cas les
grands compofiteurs employent quelquefois , mais
avec précaution, la neuvième fauvée fur l’oélave,
& la neuvième fauvée fur la fixte. ( Voyez plane»
de rnufiq., fig. 87 & 88. )
Remarquez que lorfque les parties qui forment
le contrepoint double font féparées de plus que
d’une o&ave, & que par conséquent le renverfement
fe fait à la quinzième; remarquez, dis-je, que
fouvent on tranfpofe le premier deffus à l’-oâave
inférieure, 8c le fécond à l’oétave fupérieure,
comme nous l’avons fait dans les fig. 87 & 88 ; ce
qui fe fait, tant pour ne pas porter les parties hors
de leur diapafon naturel, que pour que les parties
de rempîiffage relient à leur place.
Du Contrepoint triple & quadruple, avec renverfement *
à l'oÜave.
Pour pouvoir renverfer les parties indifféremment
& à volonté, évitez la quinte confonnante ,
parce qu’elle devient quarte, & obfervez dans toutes
les parties les autres règles du contrepoint double
à l’oélave.
Du Contre-point double à la tierce & A la
dixième,
L ’on confond ordinairement la tierce & la dixième,
& l’on dit toujours que mi efl la tierce d'ut9
quoique ce mi foit effeéUvement l’oftave, la dour
ble o&ave, &c. de la tierce d'ut,
Dans le contrepoint double à la tierce & à la
dixième,on ne peut pas confondre ainfi ces deux
intervalles ; car un fou abaiffé d’une tierce refte
fouvent dans le deffus , tandis qu’abaiffé d’une dixième,
il fe trouve à la baffe, & donne par confé-
quent un intervalle renverfé du premier ; par
exemple, tranfpofons ut, oélave d’ut, d’une tierce,
nous trouverons la fixte.à!ut; abaiffons ce même
ut d’une dixième, nous retrouvons bien le même
ton la , mais il eft d’une oéfave plus bas que le
premier ; & au lieu d’être la fixte majeure d'ut, il
eft la tierce mineure au-deffous»
Le contre-point double à la tierce n’a lieu que
pour la tranfpofition ; car l’on fent aifément qu'un
contrepoint double , avec renverfement à la tierce,
ne pouvant jamais permettre aux deux parties un
plus grand éloignement que la tierce ( par la première
règle générale, ) feroit trop borné pour
produire une mélodie paffable. Nous avons donc
le contre-point double avec tranfpofition à la tierce,
& le contrepoint double avec renverfement à la
dixième ; mais le contre - point double avec tranfpofition
à la tierce eft de deux fortes ; car,
i° . On peut tranfpofer le deffus à la tierce fupé-;
rieure , la baffe reftant , ou la baffe à la ‘tierce inférieur?
g.
C O N
■ Sfîeure, le deffus reftant, c’eft - à - dire -, qu’on
écarte les parties d’une tierce. , fl|
20. On peut tranfpofer le deffus à la tierce inférieure
, la baffe reliante , on la baffe à la tierce fupérieure
, le deffus refiant, & alors on rapproche
les deux parties d’une tierce.
c o N î(îF
Du Contfepoint double, avec la tranfpofition à là
tierce entre deux parties qui s’écartent. ^
Pour favoir ce que devient chaque intervalle par
cette tranfpofition, ajoutez 2 au nombre qui indique
l’intervalle ; ainfi :
l’unifTon 1 , la 2e , là 3 e , la 4e ; la ?e , la 6e , la 7 * , & l’oâave 8.
2 2 2 2 2 2 2 2
donne la 3% la 4e , la 5 e., la 6e , la
pos
[00 rt
1 ^
.la 10e.
On ne va pas plus loin , tant parce qu’on ne re-
frouveroit que les oélaves des intervalles déjà trouvés
, que parce que deux parties feules ne s’écartent
jamais de plus que d une dixième.
Delà,réfultent les règles fuivantes.
Première règle. La tierce devient quinte, & la fixte
oélave ; ainfi deux tiefçes 8c deux fixtes de fuite
font défendues , parce qu il en réfulteroit deux
quintes ou deux oélaves de fuite.
Cette première règle rend reite forte de contrepoint
difficile à cornpofer chantant 8c harmonieux;
remarquez auffi que comme la tierce, la fixte &
.1 oâ^ve font les feuls intervalles qui reftenr con-
fonnans après la tranfpofition , ce font aufii les
feuls qui pin fient fervir à préparer & fauver les
diffonances. Nous ne parlons pas de la quarte con-
ionnanre qui devient fixte, parce qu’elle eft bannie
de toute bonne compofition en duo.
Deuxième réglé, La fécondé préparée dans la baffe
ne peut fe fauver que fur le triton ; alors elle donne
après la tranfpofition une quarte fauvée fur une
fixte , comme on le voit Planches de mufique ,
fig' %•
Troisième règle. Nous avons déjà dit que la quarte
Confonnante eft défendue; quanta la diffonanre,
celle qui eft préparée dans le deffus & fe fauve fur
la tierce, comme Plane, de muf , fig. 90 , n’eft
pas trop bonne ; celle qui eft préparée dans le def-
’*"us ou dans la baffe & qui fe fauve fur la fixte
’comme fig. 91, vaut mieux ; on peut auffi employer
le triton de cette dernière manière.
, Quatrième règle. La quinte devient feptième ,
ainfi elle doit toujours être préparée & fauvée.
La quinte , ou mieux encore la fauffe quinte, préparée
dans le deffus , peut le fauver fur la tierce ;
alors elle devient feptième fauvée fur la quinte.
Voyez plane, de rnufiq., fig. 92. La quinte, préparée
convenablement, peut encore fe fauver fur
le triton, qui fe auve enfuite lui-même fur la fixte.
\ o y e z plane, de rnufiq. , /%. q j . Enfin on .peut
palier de la quinte à l’oéteve , comme fîg. 9 4 ,
poùrvii que ce foit à une cadence parfaite ; cette
• qmnte devient feptième fauvée fur la tierce.
Mufique, Tome l.
Cinquième règle, La feptième, préparée de l’oc^
tave dans le deffus, peut fe fauver fur la fixte ou
fur la tierce ; dans Je premier cas elle devient neuvième
fauvée fur l’oélave, & dans le fécond neuvième
fauvée fur la quinte. V o y e z plane, de mu fia.
fig. 95 , n°5. 1 8c 2.
Sixième règle. Enfin dans cette forte de contrepoint,
les parties doivent toujours aller par mouvement
contraire ou oblique , quand elles paffent
d’une confonnance à l’autre , parce que fans cela il
y auroit des quintes ou des oétaves cachées.
Du Contrepoint double, avec tranfpofition à la tierce '
entre deux parties qui s'écartent & qui font accompagnées
d'autres parties de rempîiffage.
Les memes règles ont lieu ; mais lorfque les
deux parties qui compofent le contre - point double
font affez hautes pour qu’aucune ne devienne baffe
par la tranfpofition, 011 peut employer fans feru-
pule la quarte comme confonnante, & s’en fervit
pour préparer & fauver les diffonances ; on peut
même auffi fauver quelques diffonances fur le
triton.
Du Contre-point double, avec tranfpofition à la tierce
entre plufieurs parties qui s écartent.
S i , par exemple, on vouloit compofer à quatre
parties, en. forte que l’on pût élever les trois parties
fuperieures d’une tierce , on obfervera que
chaque partie foit fuivant les règles données ci-
deffus, eu égard à la baffe ; en élevant les trois
parties fupérieures également d’une tierce,il eft clair
qu’elles reftent entr’eiles comme auparavant. Si l’on
ne vouloit élever qu’une partie d’une tierce . alors
cette partie devroit obferver les règles données
ci-deffus' envers les parties inférieures ; quant aux
fupérieures, elles obferveroient les règles du contrepoint
double, avec tranfpofition à la tierce , quand
les parties fe rapprochent ; règles que nous allons
donner : au refte le contrepoint double, avec tranfpofition
entre plufieurs parties, ne peut être d’aucune
utilité réelle.'
Z z