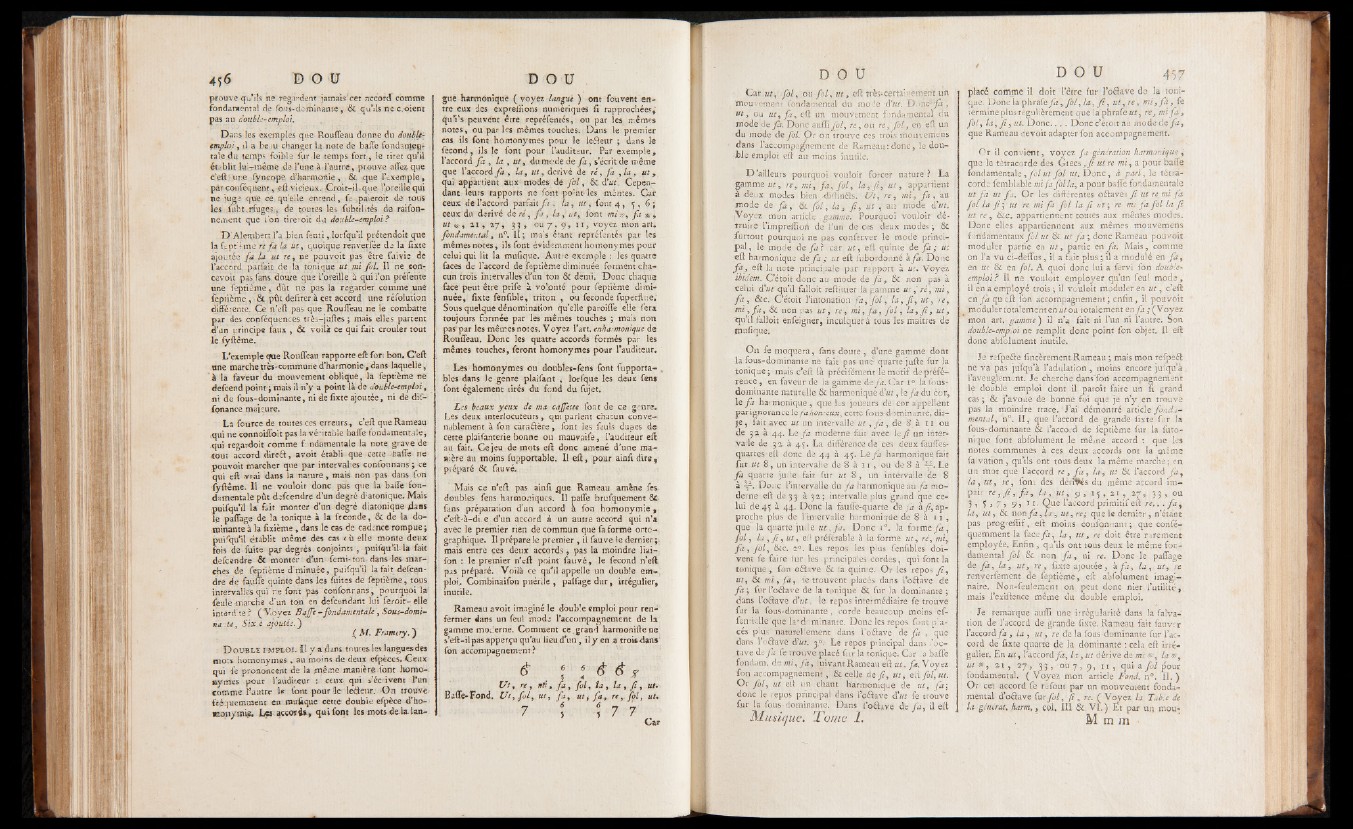
prouve qu’ils ne regardent jamais’ cet accord comme
fondamental de fous-dolhinante , & qu’ils ne c.oient
pas au doubler emploi.
Dans les exemples que Roufleau donne du doubler
emploi, il a beau changer la note de baffe fondanjÊgT
taie du temps foibls fur.le temps fort* le tiret qu’Ù
établit luiTinême de l’une à l’autre, prouve allez que
c’eft une fynçope, d’harmonie, & ique l’exemple,
par conféquent, eft viçieux. Croit-iLque l’oreille qui
ne juge que ce quelle entend, fe ;,paieroit de tous
les fobt.rfuge$,, de toutes les fubtiUtés de raifon-
nement que ion tirer oit du double-emploi?
D'Al.embert l’a -bien fentî ,.lorfqu’il prétendoit que
la fopt ème re fa la ut, quoique repverfée de la fixte
ajoutée fa la ut re, ne pouvoit pas être fuivie de
l’accord parfait rie la tonique ut mi fol. Il ne concevoir
pas fans doute que l’oreille,à qui l’on préfente
une feptième * dût ne pas la regarder comme une
feptième , & pût defxrer à cet accord une réfolution
différente. Çe n’eft pas que Roufleau ne le combatte
par des conféquences très-juftes ; mais elles partent
d’un principe faux , & voilà ce qui fait crouler tout
le fyftême.
L’exemple que Roufleau rapporte eft fori bon, C’eft
une marche très-commune d’harmonie , dans laquelle,
à la faveur du mouvement oblique, la feptième ne
defeend point ; mais il n’y a point là de double-emploi,
ni de fous-dominante, ni de fixte ajoutée, ni de dif-
fonance majeure.
La fource de toutes ces erreurs, c’eft que Rameau
.qui ne connoiffoit pas la véritable baffe fondamentale,
qui regardoit comme f. ndamentale la note grave de
»tout accord direâ, avoit établi que cette baffe ne
pouvo.it marcher que par intervalles confonnans ; ce
qui eft vrai dans la naiure, mais non pas dans fon
fyftême. Il ne vouloir donc pas que la baffe fondamentale
put defeendre d’un degré d:atonique. Mais
puifqu’il la fait monter d’un deg-é diatonique dans
le paflage de la tonique à la fcconde, & de la dominante
à la fixième , dans le cas de cadince rompue ;
puisqu’il établit même des cas cii elle monte deux
fois de fuite par degrés conjoints , puifquril-la fait
de (cendre & monter ■ cfun femi-ton- dans les marches
de feptième d'minuée., puilqu’il la fait defeendre
de fauffe quinte dans les fuites de feptième, tous
intervalles qui re font pas corifonrans., pourquoi la
feule »marche d’un ton en defeendant lui feroit-elle
interdite ? (Voyez Bajfit -fondamentale, Sous-domi-
na:te_, Six.e ajoutée.j
.( M. Framtry. )
D ouble fmfloi. ï i y a .dans toutes les langues des
mots homonymes , au moins de deux efpèces. Ceux
qui le prononcent de la même manière font homonymes
pour l’audireur : ceux qui »’écrivent l’un
comme l’autre 1» font pour île- le&eur. -On trouve-
fréquemment en muffque cette double efpèce d’ho-
Ktonymi^. Les accords , qui font les mots de-la. langue
harmonique ( voyez langue ) ont fou vent entre
eux des expreilions numériques fl rapprochées;
qu-i’s peuvent être repréfentés, ou par les mêmes
notes, ou par les mêmes touches., Dans le premier
cas. ils font homonymes pour le leéleur ; dans le
fécond, ils le font pour l’auditeur. Par exemple,
l’accord fa , la , ut, du mode de fa , s’écrit de même
que l’accord fa , la, ut, dérivé de ré, fa , la, ut,
qui appartient aux modes- dé fo l, & d?ut. Cependant
leurs rapports ne font-po’ht-les mentes. Car
Ceux dé l’accord parfait f t , la, ut, font 4, 5, 6;
ceux du dérivé de ré, fa , la, ut, font mi%, f i
ut 1 1 , 27, 33, 007 , 9, 1 1 , voyez mon art,
fondamental, n°, II; ma s étant repréfentés par les
mêmes notes, ils font évidemment homonymes pour
celui qui lit la mufique. Autre exemple : les quatre
faces de l’açcord de feptième diminuée forment chacun
trois intervalles d’un ton & demi» Donc chaque
face peut être prife à volonté pour feptième diminuée,
fixte fenflble, triton , ou fécondé fuperflue.
Sous quelque dénomination quelle paroifle elle fera
toujours formée par les mêmes touches ; mais non
pas* par les mêmes notes. Voyez l’art, enharmonique de
Roufleau. Donc les quatre accords formés par les
mêmes touches, feront homonymes pour l’auditeur.
Les homonymes ou doubîes-fens font fupporta- ,
blés dans Je genre plaifant , lorfque les deux fans
font également tirés du fond du fujet.
Les beaux yeux de ma cajfette font de ce genre.
Les deux interlocuteurs, qui parlent chacun convenablement
à fon caraéfère, font les feuls dupes de
cette plaifanterie bonne ou mauvaife, l’auditeur eft
au fait. Ce jeu de mots eft donc amené d’une manière
au moins fupportable. Il eft, pour ainfi dire f
préparé & fauve.
Mais ce n’eft pas ainfi ^ue Rameau amène fes;
doubles fens harmoniques. Il paffe brufquement ÔC
fans préparation d'un accord a fon homonymie 9
c*eft-à-di.e d’un accord à un autre accord qui n’a
avec le premier rien de commun que fa forme ortc-
graphique. Il prépare le premier, il fauve le dernier
mais entre çes deux accords , pas la moindre liai—
fon : le premier n’eft point fauve, le fécond n’eft
pas préparé. Voilà ce qu’il appelle un double em-,
ploi, Combinaifon puérile , paifage dur, irrégulier,
inutile.
Rameau avoit imaginé le double emploi pour renfermer
dans un feul mode l’accompagnement de la
gamme moderne. Comment ce.grand harraonifle ne
s’eft-ilpas apperçu qu’au lieu d’un, il y en .a troisdan*'
fon accompagnement ?
d i : d â r
U t , re, nti, f a , fo l, ta, la , f i , ut.
Baffe-Fond. U t , fo l, ut, fa , ut} fa , re,. fo l, ut*
S
Car
Car ut, fo l, ou fo lg u t, eft très-certainement un
ïnouvemeht fondamental du mode dyut. Doncï'fa ,
u t, ou ut, fa , eft un mouvement fondamental du
mode de fa. Donc aufli fo l, re, ou re, fo l, en eft un
du mode de fol. Or on trouve ces trois mouvemens
dans l’accompagnement de Rameau : donc, le double
emploi eft au moins inutile.
D ’ailleurs pourquoi vouloir forcer nature ? La
gamme ut, re, mi, fa , fo l, la, f i , u t, appartient
à deux modes bien diftinéfs. Ut, re, mi, f a , au
mode de fa , & fo l, la , f i , ut , au mode d’ut.
Voyez mon article gamme. Pourquoi vouloir détruire
l’impreffioh de l’un de ces deux modes ; &
Surtout pourquoi ne pas confetver le mode principal
, le mode de fa } car ut, eft qüinte de fd ; ut
eft harmonique de fa ; ut eft fubordonné a fa. Donc
f a , eft la note principale^ par rapport à ut. Voyez
ibidem. C ’étoit donc au mode de f a , & non pas à
celui d’ut qu’il falloit reftituer la gamme u t ré, mi,
f a , &c. C ’étoit l’intonation fa , f o l , lu, f i , ut, 1e,
mi, fa , & non pas ut, re, mi, fa , f o l , la, f i , ut,
’qu’il falloit enfeigner, inculquera tous les maîtres de
tnufique.
On fe moquera, fans doute, d’une gamme dont
la fous-dominante ne fait pas une quarte jufte fur la
tonique ; mais c’eft là précifément le motif de préférence
, en faveur de la gamme de fa. Car i° la fous-
dominante naturelle & harmonique d'ut, le fa du cor,
le fa harmonique, que les joueurs de cor appellent
par ignorance 1 efahoweux, cette fous-dominante, dis-
je , fait avec ut un intervalle u t , f a , de 8. à 11 ou
de 32 à 44. Le fa moderne fait avec \efi un intervalle
de 32 à 45. La différence de ces deux fauffes-
quartes-eft donc de 44 à 43. Le fa harmonique fait
fur ut 8, un intervalle de 8 à 1 1 , ou de 8 à Le
fa quarte jurie fait fur ut 8 , un intervalle de 8
à y ’. Donc l’intervalle du fa harmonique au fa moderne
eft de 33 à 32; intervalle plus grand que celui
de 45 à 44. Donc la fauffe-quarte de fa à fi, approche
plus de l’intervalle harmonique de 8 à 1 1 ,
que la quarte jufte ut, fa. Donc t°. la forme fa ,
f o l , la , f i , ut, eft préférable à la forme ut, ré, mi,
f a , fo l, &c. 20. Les repos les plus fenfibles doivent
fe faire fur les principales cordes, qui font la
tonique, fon o&ave & ia quinte. Or les repos f i ,
ut, & mi, fa, le trouvent placés dans l’oétave de
fa ; fur l’oétave de la tonique & fur la dominante ;
dans l’oélave d*ut, le repos intermédiaire fe trouve
fur la fous-dominante, corde beaucoup moins ef-
fenrielle que la'dominante. Donc les repos font placés
pius naturellement dans l’oélave de fa , que
dans l’oiftavè d'ut. 3.0. Le repos principal dans i’octave
de fa fe trouve placé fur la tonique. Car a baffe
fondam. de mi, fa , luivant Rameau eft ut, fa. Y oyez
fon accompagnement, & celle de f i , ut, eft fol, ut.
Or fo l, ut eft un chant harmonique de ut, f a ;
donc le repos principal dans l’o&ave d*»t fe trouve
for la fous-dominante. Dans Toélave de fa , il eft
Musique. Tome 1.
placé comme il doit l’être for l’oétave de la tonique.
Donc la phrafe f a , fo l, la, f i , u t , re, mi, f à , fe
termine plus régulièrement que la' phrafe#*, rc, mi fa y
fo l, la, f i y ut. Donc.. . . Donc c’étoit au mode de f a ,
que Rameau devoit adapter fon accompagnement.
Or il convient, voyez fa-génération harmonique ,
que le tètracorde des Giecs,fi utre mi, a pour baffe
fondamentale, fol ut fo l ut. Donc, à pari, le tétra-
corde femblabl e mi fa folia, a pour baffe fondamentale
ut fa ut fa. Or les différentes oélaves f i ut re nu fa
fo l la fi', ut re. mi fa fo l la f i ut ; re mi fa fo l la f i
ut re, &c. appartiennent toutes aux mêmes modes.
Donc elles appartiennent aux mêmes mouvemens
fondamentaux fol ut & ut fa', donc Rameau pouvoit
moduler partie en ut, partie en fa. Mais, comme
on l’a vu ci-deffus, il a fait plus; il a modulé en fa ,
en ut & en fol. A quoi donc lui a fervi fon double-
emploi? Il ne vouloit employer qu’un feul mode,
il en a employé trois ; il vouloit moduler en u t, c’eft:
en fa qu eft fon accompagnement ; enfin, il pouvoit
moduler totalement eh ut 6 u totalement en fa ; (Voyez
mon art. gamme') il n’a fait ni l’un ni l’autre. Son
double-emploi ne remplit donc point fon objet. Il eft
donc abfolument inutile.
Je refpeéle ftncèrement Rameau ; mais mon réfpeél
ne va pas juïqu’à l’adulation , moins encore jufqu’à
l’aveuglement. Je cherche dansTori accompagnement
le double emploi dont il paroît faire un n grand
cas ; & j’avoue de bonne foi que je n’y en trouve
pas la moindre trace. J’ai démontré article fondamental,
n°. II,'que l’accord de grande fixte for la
fous-dominante & l’accord de feptième for la futo-
nique font abfolument Je même accord : que les
notes communes à ces deux accords ont la ijaeme
faivation, qu’ils ont tous deux la même marche; en
un mot que l’accord re, f a , la, ui & l’accord fa.,
la , ut, re, font des dérivés du même accord impair
re , f i ,< fa , la , ut , ' 9 , 1 5 , 2 1 , 27, 3 3 , ou
3 , 5 , 7 , 9, 11. Que l’accord primiti feft r e .. . fa ,
la, ut, & nonfa , la; ut, re; que le dernier, n’étant
pas prog-eflif, eft moins confonnant; que confé-
quemment la face fa , la, u t, re doit être rarement
employée. Enfin, qu’ils ont tous deux le même fondamental
fo l & non f a , ni re. Donc le paffage
de fa , la , ut, re , fixte ajoutée, à fa , la , ut, re
renverfement de feptième, eft abfolument imaginaire.
Non-feulement on peut donc nier l’utilité,
mais l’exiftence même du double emploi.
Je remarque àufti une irrégularité dans la faivation
de l’accord de grande fixte. Rameau fait fauve r
l’accord fa , la , u t, re de la fous-dominante fur l’accord
de fixte quarte de la dominante : cela eft irrégulier.
En ut, l’accord fa , la , ut dérive de mi *•, la
ut 2 1 , 27>, 33 , ou 7 , 9 , 11 , qui a /ô/ pour
fondamental. ( Voyez mon article Fond. n°. IL )
Or cet accord fe réfout par un mouvement fondamental
d’o&ave for fo l, f i , re. ( Voyez la Table de
la générât, harm, , col. III & V I .) Et par un mou-
M m m