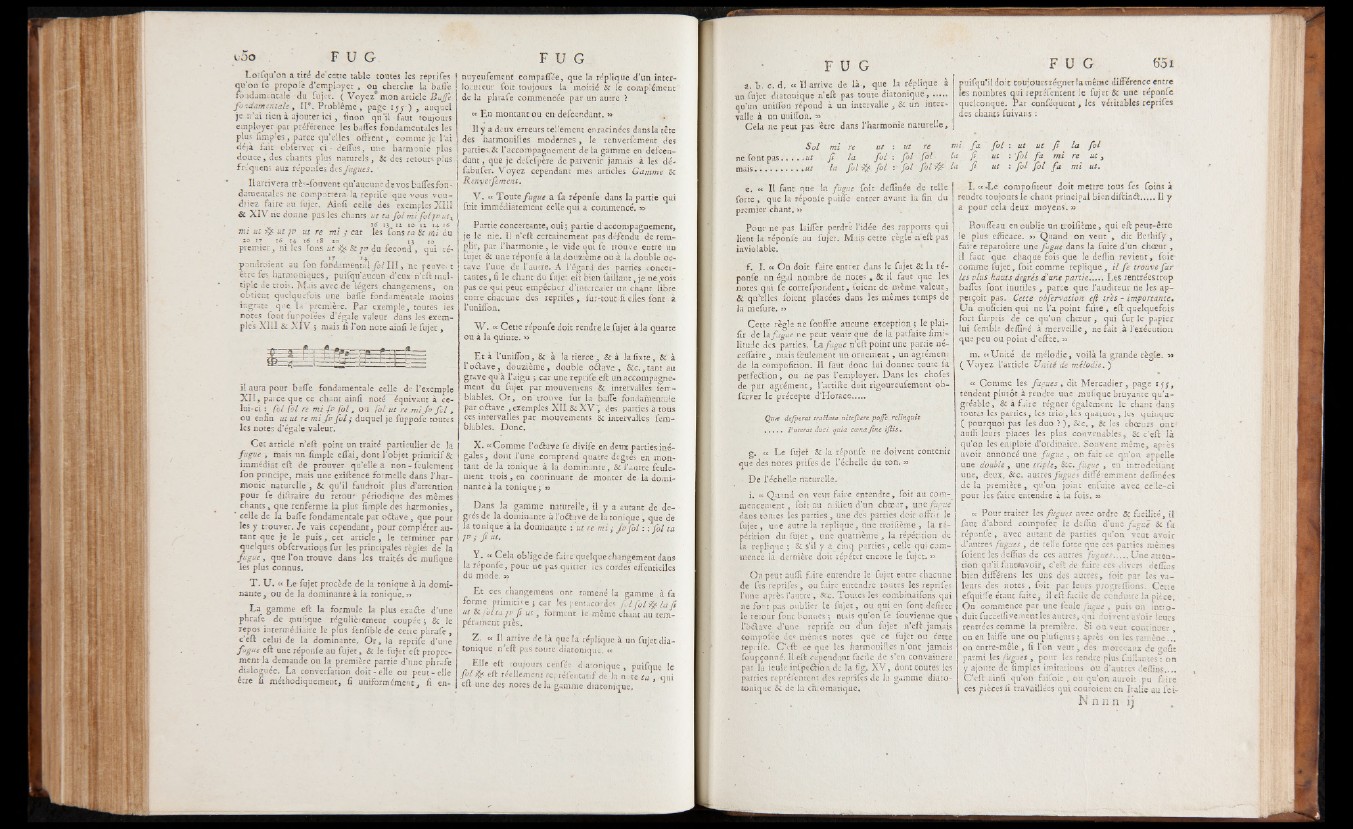
u o o F U G
Lorfqu’on a tiré de*cette table toutes les reptiles f
Qü'on le propofe d’employer , on cherche la balle !
fondamentale du fujet. ( Voyez*mon article Baffe
foidamcxta.lt, IIe. Problème, page i y y ) , auquel
je n’ai rien à ajouter i c i , (mon qu’il-faut toujours
employer par préférence les baffes fondamentales les
plus f in ie s , parce qu’elles offrent, comme je’l ‘ai
déjà fait oblerver ci - deffus, une harmonie plus
douce, des chants plus naturels, & des retours plus
fréquens aux répondes dc-s fugues. '
Il arrivera très-fouvent qu’aucune de vos baffes fondamentales
ne comportera, la reprife que vous voudriez
faire au lujec. Ainfi celle des exemples XIII
& XIV ne donne pas les chants ut ta fo l mi fo ljv utx
. l3_ 12- io i i 14 16
mi ut rg ut jv ut re mi y car les fons ta & mi du
•20 17 16 14 t6 18 zo ij 10
premier , ni les fons ut & j v du fécond , qui répondroient
au fon fondamental f a i l l i , ne peu vert
être fes harmoniques, puifqu aucun d’eux n’eft multiple
de trois. Mais avec de légers changemens, on
obtient quelquefois une baffe fondamentale moins
ingrate que la première. Par exemple, toutes les
notes font fuppolées d’égale valeur dans les exemples
XIII & X IV 5 mais fi l’on note ainfi le fujet ,
il aura pour baffe fondamentale celle de l’exemple
X I I , parce que ce chant ainfi noté équivaut à celui
ci : fo l fo l re mi fv f o l , ou fo l ut rc,mi Jv fo l ,
ou enfin ut ut re mi fv fo l ; duquel je fuppofe toutes
les notes d’égale valeur.
Cet article n’eft point un traité particulier de la
fugue > mais un fimple eflai, dont l’objet primitif &
immédiat eft de prouver qu’elle a non - feulement
fon principe, mais une exiftence formelle dans l’harmonie
naturelle , & qu’il faudroit plus d’attention
pour fe diftraire du retour périodique des mêmes
chants, que renferme la plus fimple des harmonies,
' celle de la baffe fondamentale par o&ave, que pour
les y trouver. Je vais cependant, pour compléter autant
que je le puis,. cet article , le terminer par
quelques obfervations fur les principales règles de la
fugue, que l’on trouve dans les traités de mufîque
les plus connus.
T . U . « Le fujet procède de la tonique à la dominante
, ou de la dominante à la tonique. »
La gamme eft la formule la plus exaéte d’une
phrafe de tnufique régulièrement coupée ; & le
repos intermédiaire le plus fenfible de cette phrafe ,
c’eft celui de la dominante. O r , la reprife d’une
fugue eft une réponfe au fujet, & le fujet eft proprement
la demande ou la première partie d’une phrafe
dialoguée. La converfation doit-elle ou peut-elle
être fi méthodiquement, fi uniformément, fi en-
F U G
nuyeufement cornpaffée, que la réplique d’un interlocuteur
foit toujours la moitié & le complément
de la phrafe commencée par un autre î
ce En montant ou en defcer.dant. » ,
11 y a doux erreurs tellement enracinées dans la tête
des harmoniftes modernes, le renverfement des
parties^ l’accompagnement de la gamme en descendant
, qùe je défefpère de parvenir jamais à les dé-
fabufer. Voyez cependant mes articles Gamme &
Renyerfement.
V . « Toute fugue a fa réponfe dans la partie qui
fuit immédiatement celle qui a commencé. x>
Partie concertante, oui5 partie d’accompagnement,
je le nie. Il n’eft certainement pas défendu de remplir,
par l’harmonie, le vide qui fe trouve entre un
Sujet & une réponfe à la douzième ou à la double octave
l’une de l’autre. À l’égard des parties concertantes,
fi le chant du fujet eit bien Caillant, je ne .vois
pas ce qui peut empêcher d’intercaler un chant libre
entre chacune des reprifes, fur-tout fi elles font à
Tuniffon.
W . « Cette re'ponfe doit rendre le fujet à la quarte
ou à la quinte. »
Et à l’uniflbn, & à la tierce , & à la fixte, & à
l’ octave, douzième, double oétave , & c .?tant au
grave qu'à l’aigu ; car une reprife eft un accompagnement
du fujet par mouvemens & intervalles feir-
blables. O r , on trouve fur la baffe fondamentale
par oétave , exemples XII & X V ' des parties à tous
ces intervalles par mouvements & intervalles fem-
blables. Donc.
X. ce Comme l’oétave fe divife en deux parties inégales,
dont l’une comprend quatre degrés en montant
de la tonique à la dominante, & l’autre feulement
trois , en continuant de monter de la dominante
à la tonique; %>
Dans la gamme naturelle, il y a autant de degrés
de la dominante àl'oéhve de la tonique, que de
la tonique à la dominante : ut re mi ; fv fo l : ; fo l ta
Éj§ f i Uty
Y . et Cela oblige de faire quelque changement dans
la réponfe, pour ne pas quitter les cordes effentielles
du mode. *>
Et ces changemens ont ramené la gamme à fa
forme primitive ; car les pentucordes f o l f o l la f i
ut 8c f o l ta jv fi, ut , forment le même chant au tempérament
près.
Z. et II arrive de là que la réplique à un fujet diatonique
n’eft pas route diatonique. «
Elle eft toujours cenfée diatonique , puifque le
fo l eft réellement reprélentarif de la note ta , -qui
eft une des notes de la gamme diatonique,
l
F U G
a. b. c. d. ce II arrive de là-, que la réplique à
un fujet -diatonique n’eft pas toute diatonique.........
qu’un uniffon répond à un intervalle, & un intervalle
à un uniffon. 3»
Cela ne peut pas être dans l’harmonie naturelle.
Sol mi re ut : ut re
ne font pas.........ut , f i la fo l : fo l fol
mais...................ut la fo l fo l r fo l f o l
e. c< Il faut que la fugue foie deffinée de telle
forte , que la réponfe puiffe entrer avant la fin du
premier chant. 33
Pour ne pas laiffer perdre l’idée des rapports qui
lient la réponfe au fujet. Mais cette règle n’eft pas
inviolable.
f. I. ce Ôn doit faire entrer dans le fujet & la réponfe
un égal nombre de notes, & il faut que les
notes qui fe correfpondent, l’oient de même valeur,
& qu’elles foient placées dans les mêmes temps de
la mefurè. »3
Cette règle ne fouffre aucune exception > le plai-
fir de la fugue ne peut venir que de la parfaite fimi-
litude des parties. La fugue n’eft point une partië né-
ceffaire , mais feulement un ornement, un agrément
de la compofîtion. Il faut donc lui donner toute fa
perfection, ou ne pas l’employer. Dans les chofes
de pur agrément, l’artifte doit rigoureufement ob-
ferver le précepte d’Horace.....
Quoe dejperat trattata nitefeere pojje. relinquit
. . . . . Voterai duci quia ccsna fine ifiis.
g. ce Le fujet & la réponfe ne doivent contenir
que dés notes prifes de l’échelle du ton. 33
De l’échelle naturelle.
i. cc Quand on veut faire entendre, foie au commencement
, foit au milieu d’un choeur, une fugue
dans toutes les parties , une des parties doit offrir le
fujet, une autre la répliqué, une troifïème , la répétition
du fujet,. une quatrième , la répétition de
la répliqué ; & s’il y a cinq parties, celle qui commence
la dernière doit répéter encore le lujet. 33
On peut suffi faire entendre le fujet entre chacune
de fes reprifes, ou faire entendre toutes les reprifes
l’une après l’autre , &.c. Toutes lès combinaifons qui
ne fort pas oublier le fujet, ou qui en font defirer
le retour font bonnes ; mais qu’on fe fouvienne que
l’bétave d’une reprife ou d’un fujet n’eft jamais
compofée des mêmes notes que ce fujet ou cette
reprife. C ’eft ce que les harmoniftes n’ont jamais
foupçonné. Il eft cependant facile de s’en convaincre
par la feule infpe&ion de la fig. X V , dont toutes les
parties représentent des reprifes de la gamme diaco-
touique & de la chromatique.
F U G 651
puifqu’ildoit toujours régner la même différence entre
les nombres qui reprefentent le fujet & une réponfe
quelconque. Far conféquent, les véritables reprifes
des chants fuivans :
m i fa . ' f o l : u t u t f i la f o l
la f i u t : f o l f a m i re u t ,
la f i u t x f o l f o l f a m i u t.
l. c« .Le compofîteur doit mettre tous fes foins à
rendre toujours le chant principal biendiftinét......Il y
a pour cela deux moyens. >3
. Rouffeau en oublie un troifïème, qui eft peut-être
le plus efficace. 33 Quand on veut , dit Bethify ,
faire reparoître une fu g u e dans la fuite d’un choeur ,
il faut que chaque fois que le deflln revient, foie
comme fujet, foit comme répliqué, i l f e trouve f u r
les plus h auts degrés d'une p a r tie ..... Les rentrées trop
baffes font inutiles , parce que l’auditeur ne les ap-
perçoit pas. Cette obfervation efl très - imp o rta n te .
Un muficien qui ne l’a point faite , eft quelquefois
fort furpris de ce qu’un choeur , qui fur le papier
lui fembie deffiné à merveille , ne fait .à l’exécution
que peu ou point d’effet. 33
m. ce Unité de mélodie, voilà la grande règle. 33
(V o y e z l’article U n ité de mé lodie .')
cc Comme les fu g u e s , dit Mercadier, page iy y ,
tendent plutôt à rendre une mufîque bruyance qu’agréable
, & à faire régner également le chant dans
toutes les parties, les trio , les quatuor, les quinque
( pourquoi pas les duo ? ) , & c ,, & les choeurs ont
auffi leurs places les plus convenables, & c’eft là
qu’on les emploie d’ordinaire. Souvent même, après
avoir annoncé une fu g u e , on fait te qu’on appelle
une double , une triple, Sic. fu g u e , en introduilant
une, deux, Sic. autres fu g u e s différemment deffinées
de la première , qu’on joint enfuite avec celle-ci
pour les faire entendre à la fois. 33
ce Pour traiter les fu g u e s avec ordre & facilité, il
faut d’abord compofer le deffin d’une fu g u é Sc fa
réponfe , avec autant de parties qu’on veut avoir
d’autres fugues , de relie forte que ces parties mêmes
foient les deffins de ces autres fu g u e s ......Une attention
qu’il faut#avoir, c’eft de faire ces divers deffins
bien difféïens les uns des autres, foit par les valeurs
des notes , foit par leurs progreffions. Cette
efqui'îe étant faite, il eft facile de conduire la pièce.
On commence par une feule fugue , puis on introduit
fuccelfivernent les autres, qui doivent avoir leurs
j rentrées comme la première. Si on v.euc continuer ,
on en Laiffe une ou plufieurs; après on les ramène...
on encre-mêle , fi l’on veut, des morceaux de o-out
parmi les fugues , pour les rendre plus {aillantes : on
y ajoute de fi m pies imitations ou d’autres deffins....
C ’eft ainfi qu’on faifoic , ou qu’on auroit pu faire
ces pièces fi travaillées qui couroient en Italie au fei-
N n n n ij