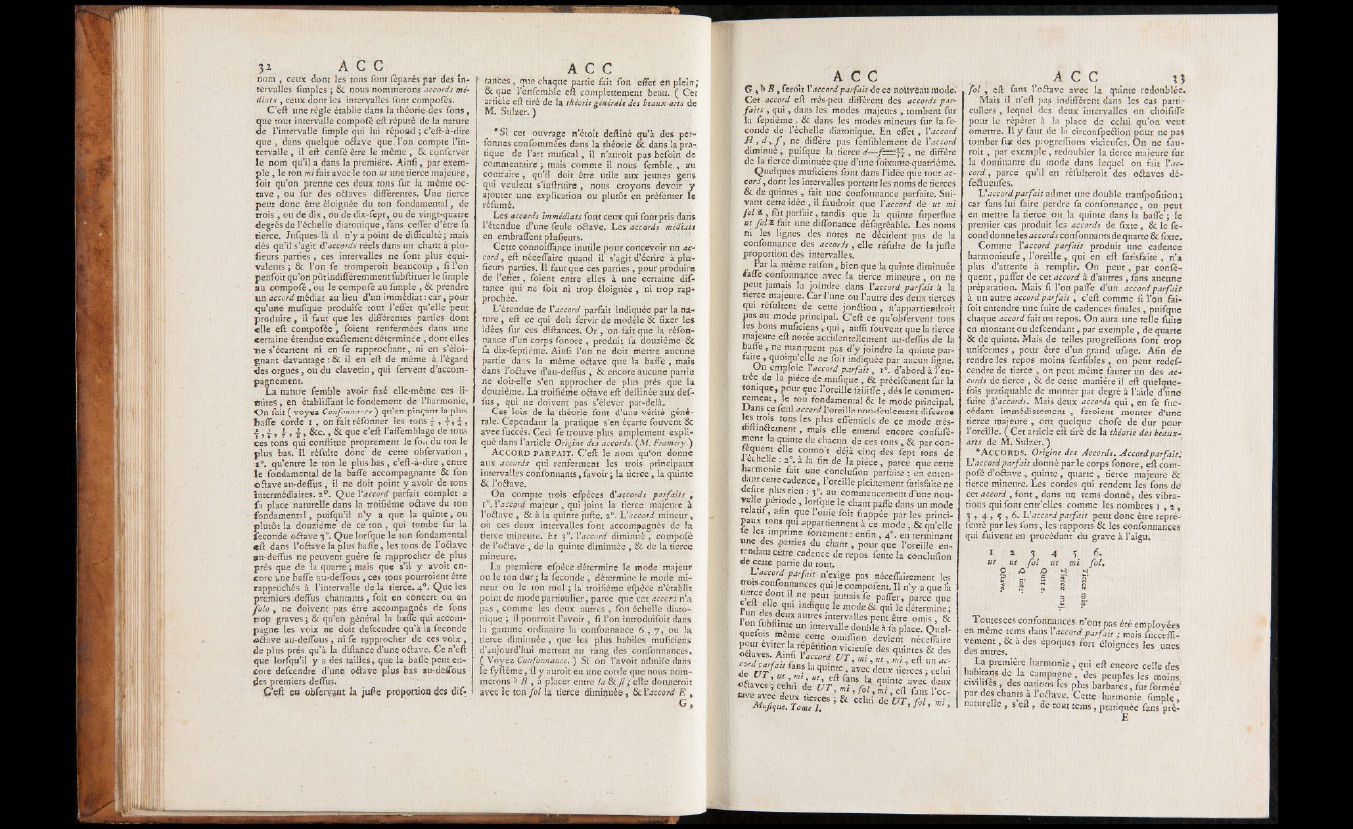
32 A C C
nom , ceux dont les tons font féparés par des intervalles
(impies ; & nous nommerons accords médiats
, ceux dont les intervalles {'ont compofés.
C ’eft une règle établie dans la théorie- des Tons,
que tout intervalle compofé eft réputé de la nature
de l’intervalle fimple qui lui répond ; c’eft-à-dire
q u e , dans quelque oâave que_ l’on compte l’intervalle
, il eft cenfé être le même , & cçmforver
le nom qu’il a dans la première. Ainfi, par exemple
, le ton mi fait avec le ton ut une tierce majeur?,
loit qu’on prenne ces deux tons fur la même octave
, ou fur des oétaves différentes. Une tierce
peut donc être éloignée du ton fondamental ? de
trois , ou de dix, ou de dîx-fept, ou de vingt-quatre
degrés de l’échelle diatonique, fans ceffer d’être fa
tierce. Jufques-là il n’y a point de difficulté ; mais
dès qu’il s’agit d'accords réels dans un chant à plu-
fieurs parties , ces intervalles ne font plus équivalents
; & l’on fe tromperoit beaucoup , fi l’on
penfoit qu’on pût indifféremment fubftituer le fimple
jau compofé, ou le compofé au fimple , & prendre
un accord médiat au lieu d’un immédiat : car , pour
qu’une mufique produife tout l’effet qu’elle peut
produire , il faut que les différentes parties dont
elle eft compofée , foient renfermées dans une
certaine étendue exaélement déterminée, dont elles
n e s’écartent ni en fe rapprochant, ni en s’éloignant
davantage : & il en eft de même à l’égard
des orgues, ou du clavecin, qui fervent d’accompagnement.
L a nature femble avoir fixé elle-même ces limites
, en établiffant le fondement de l’harmonie.
O n fait ( voyez Conformance ) qu’en pinçant la plus
baffe corde i , on fait réfonner les tons ~ \ ,
JL y £ y f , j , Sec. , & que c’eft l’affemblage de tous
ces tons qui conftitue proprement le fou du ton le
plus bas. 11 réfulte donc de cette obfervation ,
i° . qu’entre le ton le plus bas , c’eft-à-dire , entre
le fondamental de la baffe accompagnante & fon
oâ av e au-deffus , il ne doit point y avoir de tons
intermédiaires. 2,^. Que l'accord parfait complet a
la place naturelle dans la troifième oâave du ton
fondamental, puifqu’il n’y a que la quinte, ou
plutôt la douzième de ce to n , qui tombe fur la
fécondé oâave 30. Que lorfque le ton fondamental
eft dans l’oâave la plus baffe, les tons de l’oâave
»u-deffus ne peuvent guère fe rapprocher de plus
près que de la quarte; mais que s’il y avoit encore
ime baffe au-déffous , ces tons pourroient être
rapprochés à l ’intervalle de la tierce. 4°* Que les
premiers deffus chantants, fait en concert ou en
folo , ne doivent pas être accompagnés de fons
trop graves ; 8c qu’en général la baffe qui accompagne
les voix ne doit defeendre qu’à la fécondé
oéfave au-dé flous , ni fe rapprocher de ces voix ,
de plus près qu’à la diftance d’une oâave. Ce n’eft
que lorlqu’il y a des tailles, que la bafl’e peut encore
defeendre d’une oâave plus bas au-deffous
îles premiers deffus.
C ’eft en obferv^at la jufte proportion des dif-.
A C C
tantes, que chaque partie fait fon effet en plein ;
& que l’enfemble eft complettement beau. ( Cet
article eft tiré de la théorie générale des beaux-arts de
M. Sulzer. )
*Si cet ouvrage n’étoit deftiné qu’à des per-
fonnes confommées dans la théorie & dans la pratique
de i’art mufical, il n’auroit pas befoin de
commentaire j mais comme il nous femble , au
contraire, qu’il doit être utile aux jeunes gens
qui veulent s’inftmire , nous croyons devoir y
ajopter une explication ou plutôt en préfenter le
réfumé.
Les accords immédiats font ceux qui font pris dans
l’étendue d’une feule oâave. Les accords médiats
en embraffent plufiçurs.
Ceçte çonnoiflapçe inutile pour concevoir un accord
, eft néceffaire quand il s’agit d’écrire à plu-
fieurs parties. Il faut que ces parties , pour produire
de l’effet, foient entre elles à une certaine dif—
tance qui ne foit m trop éloignée , ni trop rapprochée.
L ’éçendue de Vaccord parfait indiquée par la nature
, eft ce qui doit fervir de modèle & fixer les
idées fur ces diftances. Or , 'on fait que la réfon-
nance d’un corps fonore , produit fa douzième &
fa dix-feptième. Ainfi l’on ne doit mettre aucune
partie dans la même oâave que la baffe , mais
dans l’oâave d’au-deffus , & encore aucune partie
ne doit-elle s’en approcher de plus prés que la
douzième. La troifième oâave eft deftinée aux deffus
, qui ne doivent pas s’élever par-delà.
Ces loix de la théorie font d’une vérité générale.
Cependant la pratique s’en écarte foitvent &
avec fuccès. Ceci fe trouve plus amplement expliqué
dans l’article Origine des accords. (M. Framery.)
A ccord parfait. C ’eft le nom qu’on donne
aux accords qui renferment les trois- principaux
intervalles confonnants, favoir ; la tierce, la quinte
& l’oâave.
On compte trois cfpèces d'accords parfaits ;
i°. Y accord majeur , qui joint la tierce majeure à
l’oâave , & à la quinte jùfte. a°. h'accord mineur,
où ces deux intervalles font accompagnés de la
tierce mineure. Et 30. Y accord diminué , composé
de l’oâave , de la quinte diminuée , & de la tierce
mineure.
La première efoèce détermine le mode majeur
ou le ton dur ; la fécondé , détermine le mode mineur
ou le ton mol ; la troifième efpêce n’établit
point de mode particulier, parce que cet accord n’a
pas , comme les deux autres , fon échelle diatonique
; 11 pourroit l’avoir , fi l’on introduifoit dans
la gamme ordinaire la confonnance 6 , 7 , ou la
tierce diminuée , que les plus habiles muficiens
d’aujourd’hui mettent au rang des^confonnances,
(V o y e z Confonnance.} Si on l’avoit admîfè dans
le fyftême, il y auroit eu une corde que nous nommerons
i> B , à placer entre laSefi ; elle dôuneroit
avec le ton fo l la tierce diminuéef & X:accord E t
G ,
© > h S , feroit Vaccord parfait de ce nouveau mode.'
Cet accord eft très-peu différent des accords par-
[. faits y qui, dans les modes .majeurs -, tombent fur
| là feptième , & dans les modes mineurs fur la fécondé
de l’échelle diatonique. En effet, Y accord
H , d y, f y TtQ diffère pas fenfiblement de Y accord
diminué, puifque la tierce d—f==z~z , ne diffère
de la tierce diminuée que d’une foixante-quatrième.
Quelques muficiens font dans ridée que tout accord
y dont les intervalles portent les noms de tierces
& de quintes , fait une confonnance parfaite. Suivant
cette idee , il faudroit que Y accord de ut mi
fol S , fût parfait, tandis que la quinte fiiperfhie
ot fo l 8 fait une diffonance délagréable. Les npms
ni les lignes des notes ne décident pas de la
; confonnance des accords, elle réfuite de la jufte
proportion des intervalles.
/r*11 W ■n^eme ra^on 9 bien .que la quinte diminuée
cafte confonnance avec la tierce mineure , on ne
peut jamais la joindre dans Y accord parfait à la
tierce majeure. C a r i’une ou l’autre des deux tierces
qui refultent de cette jonâion , n’appartiesdroit
pas.au mode principal. C ’eft ce qu’oblervent tous
les bons muficiens, qui, auffi fouvent que la tierce
majeure eft notee accidentellement au-deffus de la '
bafle , ne manquent pas d’y joindre la quinte par-
iaite , quoiqu’elle 11e foit indiquée par aucun figne. :
On emploie l’accord parfait, i". d’abord à rentrée
de la pièce de mufique , & précifémept fur la
tonique, pour que l’oreille faififfe, dès le commencement,
le ton fondamental & le mode principal.
JJans ce feul accord l’oreille non-feulement difoerne
nS tGns fe l P*us effen«els cc mode três-
diiiinctement, mais elle entend encore -confofé-
ment la quinte de chacun de ces tons , & par con-
emient elle conno't déjà cinq des fept tons de i
i-ecnelle : i®. a la fin-de la pièce, parce que cette
harmonie fait une conclufion parfaite'; en entendant
cette cadence, l’oreille pleinement fatisfaite ne
tieiire plus rien : 30. au commencement d’une non-
Telle période , lorfque le chant pa/Te dans un mode
relanf, afin que 1 mue foit frappée par les principaux
tons qui appartiennent à ce mode, & quelle
le les imprime fortement: enfin , 40. en terminant
«me des parles du chant, pour que l’oreille en-
tendanteetre cadence de repos fente la conclufion
de cette partie du tout.
L accord parfait n’exige pas néceflàirement les
trois conformances qui le corapofent. Il n’y a que ik
r 1? 6 nom 1 . ” e Peut jamais fe pafier, parce que
T,™ « M W lndullle le & qui le détermine ;
l’in r u - autfes miervalles peut être omis , &
un mtervalle double à fa place. Quel-
néceffaire
des q«mt« & des
c ^ Z r 'A r T 0ri- MM I . M , B i , eff un uci
f v r l &n? îa q" T ; ayec <leilx ««ces ; celui
o f i. v. c \ i f 1.1 ^ans ^a. quinte avec deux s s a B de UT> t snote, en fans gu
M r ' ? Ker.CêS ’ & cdui Mujiqiu, Tome 1, de V T ,’ Jf o l’, mi’,
A C C 33
fo l y eft fans l’oâave avec la quinte redoublée.
Mais il n’eft pap indifférent dans les cas particuliers
, lequel des deux intervalles on choififfe
pour le répéter à la place de celui qu’on veut
omettre. Il y faut de la circonfpeâion pour ne pas
tomber fur des progreffions vicîeufes. On ne fau-
ro it, par exemple, redoubler la tierce majeure fur
la dominante du mode dans lequel on fait Yac-
cord, parce qu’il e_n réfulteroît des oâaves dé-
feâueufes,
accord parfait admet une double tranlpofition ;
car fans lui faire perdre fa confonnance, on peut
en mettre la tierce ou la quinte dans la baffe ; le
premier cas produit les accords de fixte , & le fécond
donne les accords confonnants de quarte & fixte.
Comme Y accord parfait produit une cadence
harmonieufe , l’oreille , qui en eft fatisfaite , n’a
plus d’attente à remplir. On p eu t, par confé-
quent, paffer de cet accord à d’autres , fijns aucune
préparation. Mais fi l’on paffe d’un accord parfait
à un autre accord parfait , c’eft comme fi l ’on fài-
foit entendre une fuite de cadences finales , puifque
chaque accord fait un repos. On aura une telle fuite
en montant ou defeendant, par exemple, de quarte
& de quinte. Mais de telles progreffions font trop
uniformes, pour être d’un grand ufage. Afin de
rendre les repos moins fenfibles, on peut redef*
cendre de tierce , on peut même fauter un des accords
de tierce , & de cette manière il eft quelquefois
pratiquabie dé monter par degré à l'aide d’une
fuite Raccords. Mais deux accords qui , en fé fuc-
cédant immédiatement , feroient monter d’une
tierce majeure , ont quelque chofe de dur pour
l’oreille. ( Cet article eft tiré de la théorie des beaux-
arts de m. Sulzer.")
* Accords. Origine des Accords. Accord parfait J
\J accord parfait donné par le corps fonore, eft compofé
d’o â a v e , quinte, quarte , tierce majeure &
tierce mineure. Les cordes qui rendent les fons dé
cet accord, fo n t, dans un tems donné, des vibrations
qui font entr elles comme les nombres i , a ,
3 9 4 > 5 9 6. L'accord parfait peut donc être repré-
femé par les fons, les rapports & les confonnançes
qui fuivent en procédant du grave à l’aigu.
î a 3 4 5 6.
ut ut fo l ut mi fol, 0 /5 O H H
ît» - £ H‘ o’
en meme tems dans 1 accord parfait ; mais fucceffi-
vement, & a des époques fort éloignées les unes
ces autres.
La première harmonie, qui eft encore celte (tes
habuans de la campagne , des peuples les moins
civihfes S des nations les plus barbares, fut formée''
par des chants a lo flave. Cette harmonie fimple,
naturelle, s e ft, de tout tems, pratiquée fans pri-
E