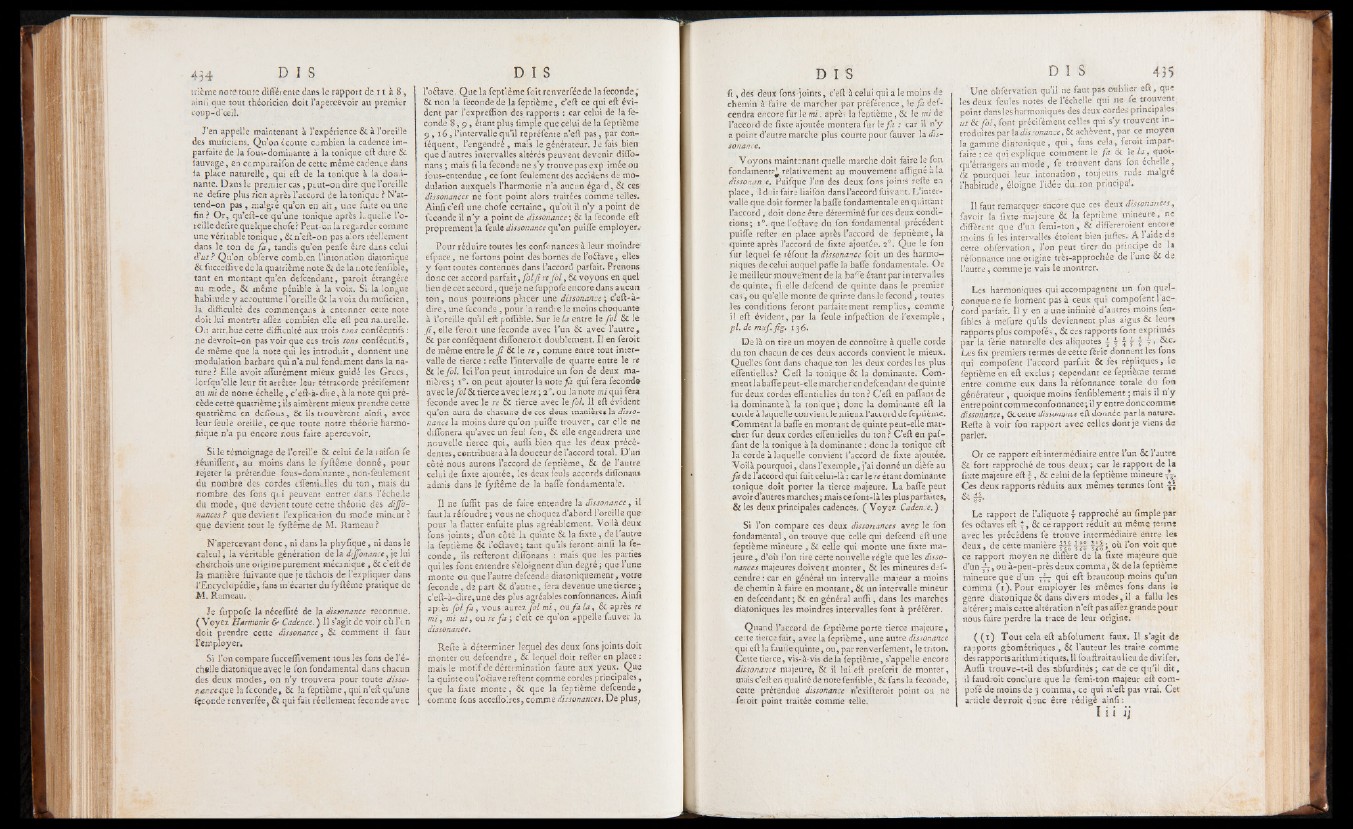
même note toute différente dans le rapport de 11 à 8 -,
ainli que tout théoricien doit l’apercevoir au premier
coup-d'oeil.
J’en appelle maintenant à l’expérience & à l’oreille
des muficiens. Qu’on écoute combien la cadence imparfaite
de la fous-dominante a la tonique eft dure &
lauvage, en ccmparaifon de cette même cadence dans
la place naturelle, qui eft de la tonique à la dominante.
Dans le premier cas, peut-on dire que l’oreille
ne defire plus rien après l’accord de la tonique ? N’attend
on pas , malgré qu’on en ait, une fuite ou une
fin? Or, qu’eft-ce qu’une tonique après L quelle l’oreille
defire quelque chcfe ? Peut-on la regarder comme
une véritable tonique, & n’eft-on pas alors réellement
dans le ton de f a , tandis qu’on penfe être dans celui
dW ? Qu’on obferve comb.en l’intonation diatonique
& fucceffive de la quatrième note & de la note fenfible,
tant en montant qu’en defeendant, paroît étrangère
au mode, & même pénible à la voix. Si la longue
habitude y accoutume l’oreille & la voix du muficien,
la. difficulté des commençans à entonner cette note
doit lui montrer allez combien elle eft peu naturelle.
On attribue cette difficulté aux trois tons consécutifs :
ne devroit-on pas voir que ces trois tons consécutifs,
de même que la note qui les introduit, donnent une
modulation barbare qui n’a nul fondement dans la nature?
Elle avoit affurément mieux guidé les Grecs,
lorfqu’elle leur fit arrêter leur tétracorde précifement
au mi de notre échelle, c’eft-à- dit e , à la note qui précède
cette quatrième ; ils aimèrent mieux prendre cette
quatrième en defious, & ils trouvèrent ainfi, avec
leur feule oreille, ce que toute notre théorie harmonique
n’a pu encore nous faire apercevoir.
Si le témoignage de l’oreille & celui cela laifon fe
iéuniffent, au moins dans le fyftême donné, pour
rejeter la prétendue fous-dominante, non-feulement
du nombre des cordes tffentislles du ton, mais du
nombre des fons qui peuvent entrer dans Pêcherie
du mode, que devient toute cette théorie des dijfo-
naness ? que devient l’explication du mode mineur?
que devient tout le fyftême de M. Rameau ?
N’apercevant donc, ni dans la phyfique, ni dans le
calcul, la véritable génération de la dijfonance, je lui
ehërchois une origine purement mécanique, & c’eft de
la manière fui vante que je tâehois de l’expliquer dans
l’Encyclopédie, fans m'écarter du fyftême pratique de
M. Rameau. f
Je fuppofe la néceffité de la dissonance reconnue.
(V oy e z Harmonie & Cadence. ) Il s’agit de voir cù l’cn
doit prendre cette dissonance, & comment il faut
l’employer.
Si l’on compare fucceffivement tous les fons de l’échelle
diatonique avec le fon fondamental dans chacun
des deux modes, on n’y trouvera pour toute dissor.
ance-qice la fécondé, & la feptième, qui n’eft qu’une
fçconde renverfée, & qui fait réellement fécondé avec
l’oélave. Que la feptième foit renverféede lafeconde^
& non la fécondé de la feptième, c’eft ce qui eft évident
par i’expreffion des. rapports : car celui de la fécondé
8 ,9 , étant plus fimple que celui de la feptième
9 , 1 6 , l’intervalle qu’il repréfente n’eft pas, par Con-
iéquent, l’engendré, mais le générateur. 3e fais bien
que d'autres intervalles altérés peuvent devenir diffo-
nans ; mais fi la fécondé ne s’y trouve pas exp imée ou
fous-entendue, ce font feulement des accidens de modulation
auxquels l’harmonie n’a aucun éga: d , & ces'
dissonances ne font point alors traitées comme telles.
Ainfi c’eft une chofe certaine, qu’où il n’y a point de
fcconde il n’y a point de dissonance ; & la fécondé eft
proprement la feule dissonance qu’on puiffe employer.’
Pour réduire toutes les contenances à leur moindre-
efpace, ne fortons point des bornes de l’oâfave, elles
y font toutes contenues dans l’accord parfait. Prenons
donc cet accord parfait, foljire fo l , & voyons en quel
lieu de cet accord, que je ne fuppofe encore dans aucun
ton, nous pourrions placer une dissonance \ c’eft-a-
dire, une fécondé , pour !a rendre le moins choquante
à l’oreille qu’il eft poffible. Sur le la entre le fo l & le
ƒ , elle feroit une fécondé avec l’un & avec l’autre,
& par conféquent diffonerolt doublement. Il en feroit
de même entre le f i & le re, comme entre tout intervalle
de tierce : refte l’intervalle de quarte entre le re
& le fol. Ici l’on peut introduire un fon de deux manières
; i°. on peut ajouter la note fa qui fera fécond»
avec le/o/& tierce avec 1ère; 2°. ou la note mi qui fera
fécondé avec le re & tierce avec le fol. 11 eft évident
qu’on aura de chacune de ces deux manières la dissonance
\a moins dure qu’on puiffe trouver, car elle ne
diffonera qu’avec un feu! fon, & elle engendrera une
nouvelle tierce qui, auffi bien que les deux précédentes,
contribuer a à la douceur de l’accord total. D ’un
côté nous aurons l’accord de feptième, & de l’autre
celui de fixte ajoutée, les deuxfeuls accords diffonans
admis dans le fyftême de la baffe fondamentale.
Il ne fuffit pas de faire entendre la dissonance, il
faut la réfoudre ; vous ne choquez d’abord l’oreille que
pour la flatter enfuite plus agréablement. Voilà deux
fons joints; d’un côté la quinte &. la fixte, de l’autre
la feptième & i’oélave ; tant qu’ils feront ainfi la fécondé,
ils relieront diffonans : mais que les parties
qui les font entendre s’éloignent d’un degré; que l’une
monte ou que l’autre defeende diatoniquement, votre
fécondé, de part & d’autre, fera devenue une tierce ;
c’eft-à-dire,une des plus agréables confonnances. Ainfi
ap tè s fol fa , vous aurez fo l mi, ou fa la, & après re
mi, mi ut, ou re fa', c’eft ce qu’on appelle fauver la
dissonance.
Refte à déterminer lequel des deux fôns joints doit
monter ou defeendre, & lequel doit refter en place :
mais le motif de détermination faute aux yeux. Que
la quinte ou l’oétave relient comme cordes principales,
que la fixte monte, & que la feptième defeende,
comme fons acceffoires, comme dissonances. De plus^
fi , des deux fons joints, c’eft à celui qui a le moins de
chemin à faire de marcher par préférence, le fa descendra
encore fur le mi . après la Septième, & le mi de
l’accord de fixte ajoutée montera fur le fa : car il n’y
a point d’autre marche plus courte pour fauver la dissonance.
Voyons maintenant quelle marche doit faire le fon
fondamental relativement au mouvement aflignéàla
dissonan e. Puifque l’un des deux fons joints refte en
place, il doit faire liaifon dans l’accord fuivant. L’intervalle
que doit former la baffe fondamentale en quittant
l’accord, doit donc être déterminé fur ces deux conditions;
i°. que Poêla ve du fon fondamental précédent
puiffe refter en place après l’accord de feptième, la
quinte après l’accord de fixte ajoutée. 2°. Que le fon
fur lequel fe réfout la dissonance foit un des harmoniques
de celui auquel paffe la baffe fondamentale. Or
le meilleur mouveïnent de la ba'fo étant par intervalles
de quinte, fi elle defeend de quinte dans le premier
cas, ou qu’elle monte de quinte dansie fécond, toutes
les conditions feront parfaitement remplies, comme
il eft évident, par la feule infpeélion de l'exemple,
f l . de muf. fig. 13 6.
De là on tire un moyen de connoître à quelle corde
du ton chacun de ces deux accords convient le mieux.
Quelles font dans chaque ton les deux cordes les plus
effentielks? C ’eft la tonique & la dominante. Comment
la baffe peut-elle marcher en defeendant de quinte
fur deux cordes effentielles du ton ? C’eft en paffant de
la dominante à la tonique ; donc la dominante eft la
corde à laquelle convient le mieux l’accord de feptième.
Comment la baffe en montant de quinte peut-elle marcher
fur deux cordes effeniielles du ton ? C ’eft en paf-
sfant de la tonique à la dominante : donc la tonique eft
la corde à laquelle convient l’accord de fixte ajoutée.
Voilà pourquoi, dans l’exemple, j’ai donné un dièfe au
fa de l’accord qui fuit celui-là : car le re étant dominante
tonique doit porter la tierce majeure. La baffe peut
avoir d’autres marches; mais ce font-là les plus parfaites,
& les deux principales cadences. ( Voyez Cadence.)
Si l’on compare ces deux dissonances avec le fon
fondamental, on trouve que celle qui defeend eft une
feptième mineure, & celle qui monte une fixte majeure
, d’où l’on tire cette nouvelle règle que les dissonances
majeures doivent monter, & les mineures defeendre
: car en général un intervalle majeur a moins
de chemin à faire en montant, & un intervalle mineur
en defeendant ; & en général aufli, dans les marches
diatoniques les moindres intervalles font à préférer.
Quand l’accord de feptième porte tierce majeure,
cette tierce fait, avec la feptième, une autre dissonance
qui eft la faufte quinte, ou, par renverfement, le triton.
Cette tierce, vis-à-vis delà feptième, s’appelle encore
dissonance majeure, & il lui eft preferit de monter,
piais c’eft en qualité de note fenfible, & fans la fécondé,
cette prétendue dissonance n’exifteroit point ou . ne
feroit point traitée comme telle.
Une obfervation qu’il ne faut pas oublier eft, que
les deux feules notes de l’échelle qui ne fe trouvent
point dans les harmoniques des deux cordes principa .es
ut & fo l, font précifément celles qui s’y trouvent introduites
par la dissonance, & achèvent, par ce moyen
la gamme diatonique, qui, fans cela, feroit imparfaite
: ce qui explique comment le fa &. le la, quoi-
qu’étrangers au mode , fe trouvent dans fon echelle,
& pourquoi leur intonation, toujours rude maigre
l’habitude, éloigne l’idée du-ion principal.
Il faut temarque^eheore que ces deux dissonances,
favoir la fixte-fîiajeure & la feptième mineure, ne
diffèrent que d’u.i femi-ton, & diflereroient encore
moins fi les intervalles étoient bien jufies. A laide ds
cette obfervation, l’on peut tirer du principe de la
réfonnance une origine très-approchée de l’une & de
l’autre, comme je vais le montrer.
Les harmoniques qui accompagnent un fon quelconque
ne fe bornent pas à ceux qui compofent 1 accord
parfait. Il y en a une infinité d’autres moins fen-
fibles à mefure qu’ils deviennent plus aigus & leurs
rapports plus compofés, & ces rapports font exprimés
par la férié naturelle des aliquotes | f 7 j ;|;ÿ?
Les fix premiers termes de cette férié donnent les fons
qui compofent l’accord parfait & fes répliques, le
feptième en eft exclus ; cependant ce feptième terme
entre comme eux dans la réfonnance totale du fon
générateur , quoique moins fenfiblement ; mais il n’y
entre point comme confonnance ; il y entre donc comme
dissonance, & cette dissonance eft donnée parla nature.
Refte à voir fon rapport avec celles dont je viens de
parler.
Or ce rapport eft intermédiaire entre l’un & l’autre
& fort rapproché de tous deux; car le rapport de la
fixte majeure eft \ , & celui de la feptième mineure T\ .
Ces deux rapports réduits aux mêmes termes font
& |£ .
Le rapport de l’aliquote f rapproché au fimple par
fes oêlaves eft | , & ce rapport réduit au même terme
avec les précédens fe trouve intermédiaire entre les
deux, de cette manière ; où l’on voit que
ce rapport moyen ne diffère de la fixte majeure que
d’un yy, ou à-peu-près deux comma, & de la feptième
mineure que d’un 777 qui eft beaucoup moins qu'un
comma (1). Pour employer les mêmes fons dans le
genre diatonique & dans divers modes, il a fallu les
altérer ; mais cette altération n’eft pas affez grande pour
nous faire perdre la trace de leur origine.
( ( 1 ) Tout cela eft absolument faux. Il s’agit de
rapports géométriques, & l’auteur les traire comme
des rapports arithm étiques, Il fouftraitau lieu de divifsr.
Auffi trouve-t-il des abfurdités ; car de ce qu’il dit,
il faudroit conclure que le femi-ton majeur eft com-
pofé de moins de 3 comma, ce qui n’eft pas vrai. Cet
article deyroit donc être rédigé ainfi :