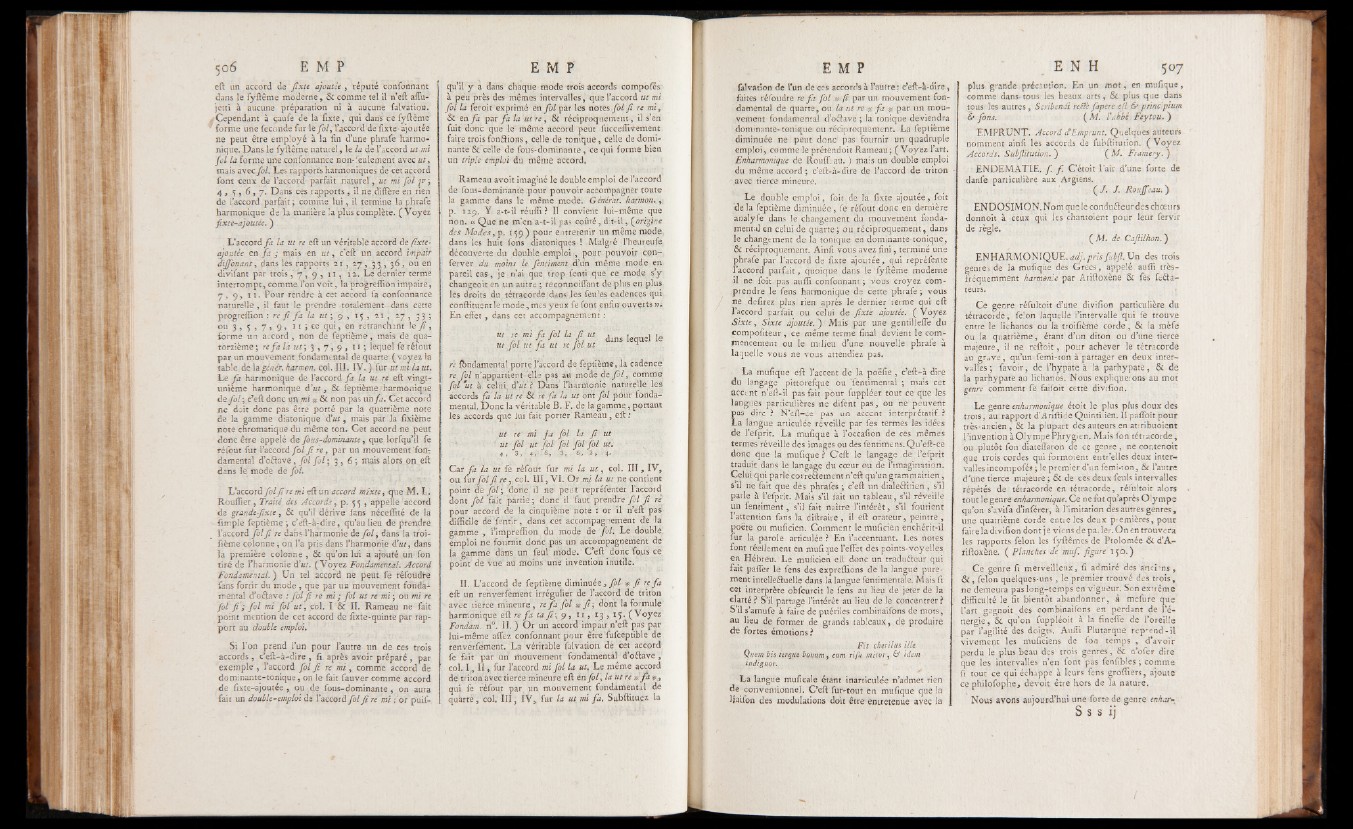
eft un accord de fixte ajoutée, réputé confonnant
dans le fyftême moderne, & comme tel il n’eft affu-
jetti à aucune préparation ni à aucune falvation.
'Cependant à çaufe de la fixte, qui dans ce fyftême
forme une fécondé fur le fol, l!a.ccord de fixte -ajoutée
ne peut être employé à la fin d’une phrafe harmonique.
Dans le fyftême naturel, le la de l’accord ut mi
fol la forme une confonnance non-feulement avec ut,
mais avec fol. Les rapports harmoniques de cet accord
font ceux de l’accord parfait naturel, ut mi fo l [v ;
4 , 5 , 6 , 7 . Dans ces rapports, il ne ^diffère en rien
de l’accord. parfait ; comme lu i , il termine la phrafe
harmonique de la manière la plus complète. (V o y e z
fixte-ajoutée. )
L ’accord fa la ut re eft un véritable accord de fixte-
ajoutée en fa ,* mais en u t, c’eft' un accord impair
dijfonant, dans les rapports 2 1 , 2 7 , 33 , 3 6 , ou en
divifant par trois , 7 , 9 , 11 , 12.. Le dernier terme
interrompt, comme l’on v o it , la pfogreffiôn impaire,
7 , 9 , 1 1 . Pour rendre à cet accord fa confonnance
natu re lle, il faut le prendre totalement dans cette
progreffion : re f i fa la ut ; 9 , 1 5 , 2.1 , 27 , 3 3 ;
ou 3 , 5 , 7 , 9, 11 ; ce q u i, en retranchant le f i ,
forme un accord , non de feptième, mais de quatorzième
; re fa la u t ’, 3 , 7 , 9 , 11 ; lequel fe réfout
par un mouvement fondamental de quarte- ( v o y e z la
table de la génér. harmon. col. III. IV . ) fur ut mi la ut.
L e fa harmonique de Paccord fa la ut re eft vingt-
unième harmonique d'ut, & feptième/harmonique
de fo l ; c’eft donc un mi » & non pas un fa. Cet accord
ne doit donc pas être porté par la quatrième note
de la gamme diatonique d’ut 9 mais par la fiixième
note chromatique dù même ton. C e t accord ne peut
donc être appelé de fous-dominante, que lorfqu’il fe
réfout fut l’accord fo l f i re, par un mouvement fondamental
d’o â a v e , fol fol 5 3 , 6 ; mais alors on eft
dans lé mode de fol.
L ’accord fo lfi re mi eft un accord mixte, que M . L.
Rou flïer, Traité des Accords, p. 5 5 , appélle accord
de grande fix te , & qu’il dérive fans néceflïté de la
fimple feptième ; c’eft-à-dire, qu’au lieu dé prendre
l ’accord fol f i re dans l’harmonie de fo l, dans la troi-
fième colonne, on l’a pris dans l’harmonie à’ut, dans
la première colonne , & qü’on lui a ajouté un fon
tiré de l’harmoriie d'ut. (V o y e z Fondamental. Accord
Fondamental. ) Un tel accord ne peu t fé réfoüdte
fans forrir du m od e , que par un mouvement fondamental
d’o â a v e ; fo l f i re mi ; fol ut re mi ; oii mi re
fol f i ; fol mi fo l ut, col. I & II. Rameau ne fait
point mention de cet accord de fixte-quinte par rapport
au double emploi
Si l ’on prend l’un pour l’autre un de ces trois
accords , c’ eft-à-dire , fi après avoir préparé , par
exemple , l’accord fol f i re mi, comme accord de
dominante-tonique, on le fait fauver comme accord
de fixte-ajoutée , ou de fous- dominante, on aura
fait un double-emploi de l’accord fol f i re mi f o r puifqu’il
y a dans chaque mode trois accords compofés
à peu près des mêmes intervalles, que l’accord ut mi
fol la feroit exprimé en fo l par les notes fol f i re mi,
& en fa par fa la üt re , & réciproquement, il s’en
fuit donc que le’ même accord peut fucceflivement
faire trois fon âions, celle de tonique, celle de dominante'
celle de fous-dominante, ce qui forme bien
un triple emploi du même accord.
Rameau avoit imaginé le double emploi de l’accord
de fous-dominante pour pouvoir accompagner toute
la gamme dans le même mode. Générât, harmon,
p. 129. Y a-t-il réuffi ? Il convient lui-même que
non. « Q u e ne m’en a-t-il pas coûté, d it-il, ( origine
des Modes, p. 15 9 ) pour entretenir un même mode
dans les huit fons diatoniques ! Malgré l’heureufe
découverte du double emploi , pour pouvoir con-
ferver du moins le fentiment d’un même mode en
pareil c a s , je n’ai que, trop fenti que ce mode s’y
changeoit en un autre ; reeonnoiffant de plus en plus
lés droits du tétraeorde;dans, les feu’es cadences qui
conftituent le mode, mes yeux fe font enfin ouverts »*
En e f fe t , dans cet accompagnement :
ut re mi fa fo l la f i ut
ut fo l ut fa ut re fo l ut
dans lequel le
re fondamental porte l’accord de feptième, là cadence
re fol n’appartient-elle pas au mode de j^/,, comme
fol *ut à celui d’ «V? Dans l’harmonie naturelle les
accords fa la üt re & re fa la ut ont fo l pour fondamental.
Donc la véritable B. F. de la gamme , portant
lés accords que lui fait porter Rameau, eft :
ut re mi fa fol la f i ut
1 ut fo l ut fo l fol fol fo l ut.
4 , 3 , 4 ,' 6 , 3 , , 6 , 3 , 4*
Car fa la ut fe réfout fur mi la u t, col. I I I , IV ,
ou furfo l f i re,. col. I I I , V I . Ovnù la ut ne contient
point de fo l ’, ‘donc il ne peut repréfentèr Iaccord
dont fo l fait partie' ; donc il faut prendre fol f i re
pour accord de la cinquième note : or il n’eft pas
difficile de fentir, dans cet accompagnement de la
gamme , l’impreflion du mode de foli L e double,
emploi ne fournit donc pas un accompagnement de
la gamme dans un feu! mode. C ’eft donc fo,us ce
poirît de vue au moins une invention inutile.
II. L ’accord de feptième diminuée , fol » f i re fa
eft un renverfement irrégulier de l’accord de triton
avec tierce mineure, re fa fo l » f i ’, dont la formule
harmonique eft re fa ta f i ; 9 , 1 1 , 1 ^ , 15. (V o y e z
Fondàtn. ri0. I I . ) O r un accord impair n’eft pas par
lui-même affez confonnant pour être fufceptible de
renverfement. La véritable falvation dé cet accord
fe fait par un mouvement fondamentàl d’o â a v e ,
col. I (, I I f u r l’accord mi fol la ut. Le même accord
de triton avec tierce mineure eft en fol, la ut re »fà ».,
qui fe réfout par un mouvement fondamental de
quarté, col. I I I , IV , fur la ut mi fa, Subftituez la
falvation de l’un de ces accords à l’autre; c’eft-à-dire,
faites réfoudre re fa fo l » f i par un mouvement fondamental
de quarte, ou la ut re » fa » par un mouvement
fondamental d’o â a vé ; la tonique deviendra
dominante-tonique, ou réciproquement. La feptième
diminuée ne peut donc pas fournir un quadruple
emploi, comme le prétendoit Rameau; (V o y e z l’art.
Enharmonique de RouflVau. ) mais un double emploi
du même accord ; c’eft-à- dire de l’accord de triton
avec tierce mineure. <
Le double emp loi, foit de la fixte ajoutée, foit
d e là feptième diminuée, fe réfout donc en dernière
analyfe dans le changement du mouvement fondamental
en celui de quarte; ou réciproquement, dans
le changement de la tonique en dominante-tonique,
& réciproquement. Ainfi vous avez fin i, terminé une
phrafe par l ’accord de fixte ajoutée, qui repréfente
l’accord parfait, quoique dans le fyftêirie moderne
il ne foit pas auflï confonnant ; vous croyez comprendre
le fens harmonique de cette phrafe; vous
ne defirez plus rien jiprès le dernier terme qui eft
l’accord parfait ou celui de fixte ajoutée. (V o y e z
Sixte, Sixte ajoutée. ) Mais par une gentilleffe du
compofiteur, ce même terme final devient le commencement
ou le milieu d’une nouvelle phrafe à
laquelle vous ne vous attendiez pas.
La mufique eft l’accent de la p o ë fie , c’eft-à dire
du langage pittorefque ou Yentimental ; mais cet
acctnt n’eft-il pas fait pour fuppléer tout ce que les
langues particulières ne difent pas, ou ne peuvent
pas dire ? N ’eft-ce pas un accent interprétatif.?
La langue articulée réveille par fes termes les idées
de l’elprit. La mufique à l’occafion de ces mêmes
termes réveille des images ou des fentimens.Qu’eft-ce .
donc que la mufique ? C ’eft le langage .de l’ëfprit
traduit dans le langage du coeur ou de l’imagination.
Celui qui parle correctement n’eft qu’un grammairien,
s il ne fait que des phrafes ; c’eft un dialeâirien , s’il
parle à l’efprit. Mais s’il fait un tableau, s’il réveille ;
un fentiment, s’il fait naître l’intérêt, s’il foutient j
l’ attention fans la diftraire , il eft orateur, peintre ,
poète ou muficien. Comment le muficien enchérit-il
fur la parole articulée ? En l’accentuant. Les notes
font réellement en mufique l’effet des points-voyelles,
en Hébreu. Le muficien eft donc un traduâeur qui
fait palier le fens des exprefiïons de la langue purement
intelleâuelle dans la langue fentimentale. Mais fi
cet interprète obfcurcit le fens au lieu de jeter de la
clarté? S’il partage l’intérêt au lieu de le concentrer?
S’il s’amufe à faire de puériles combinaifons de mots,
au lieu de former de grands tableaux, de produire
de fortes émotions?
Fit cherilus ille
Quem bis terque bonam, cuni rifu mitor, & idem
. ..,indigner. .
L a langue mufieale étant inarticulée n’admet rien
de conventionnel. C ’eft fur-tout en mufique que la
liaifon des modulations doit être entretenue avec la
plus grande précaution. En un m o t , en mufique,
-comme dans- tous les beaux arts, & plus que dans
tous les autres, Scribendi relie fapere efl & principium
&.fions. (M. l’abbé. Feytou. )
EM PR U N T . Accord dé Emprunt. Quelques auteurs
nomment ainfi les accords de fubftitution. (V o y e z
Accords. Subjlitution. ) ( M. Framery. ) *
EN D EM Â T IE . fi f . C ’étoit l ’air d’une forte de
danfe particulière aux Argiens.
( / . /. Rouffeau. j
EN D O S IM O N . Nom que le conduâeur des choeurs
donnoit à ceux qui les chantoient pour leur fervir
de règle.
( M. de Caflilhon. )
E N H A RM O N IQ U E , adj.pris fubfl. Un des trois
genres de la mufique des G re c s , appelé auflï très-
fréquemment harmonie par Ariftoxène & fes f c â a -
teulrs.
C e genre réfultoit d’une divifion particulière du
tétracorde, félon laquelle l’intervalle qui fe trouve
entre le lichanos ou la troifième co rd e, & la mèfe
Ou la quatrième, étant d’un diton ou d’une tierce
majeure, il ne reftoit, pour achever le tétracorde
au g r a v e , qu’un femi-ton à partager en deux interv
alle s; favoir, de l’hypate à la parhypate, & de
la parhypate au lichanos. Nous expliquerons au mot
genre commenr fe faifoit cette divifion.
Le genre enharmonique étoit le plus plus doux des
trois, au rapport d’Ariftide Quintiiien. Il paffoit pour
très-ancien, & la plupart des auteurs en atrribuoient
l ’invention à O lym p e Phrygien. Mais fon tétracorde,
ou plutôt fon diateffaron de ce genre, ne contenoit
que trois cordes qui formoient entr’elles deux intervalles
incompofés ; le premier d’ un femi-ton, & l’autre
d ’une tierce majeure ; & de ces deux feuls intervalles
répétés de tétracorde en tétracorde, réfultoit alors
tout le genre enharmonique. C e ne fut qu’après O lym p e
qu’on s’avifa d’inférer, à l'imitation des autres genres,
une quatrième corde entre les deux ptemières, pour
faire la divifion dont j e viens de pa. 1er. On en trouvera
les rapports félon les fyftêmes de Ptolomée & d’A -
riftoxène. ( Planches de muf. figure 150 .)
C e genre fi merveilleux, fi admiré des anciens,
& , félon quelques-uns, le premier trouvé des trois,
ne demeura pas long-temps en vigueur. Son extrême
difficulté le fit bientôt abandonner, à mefure que
l’art gagnoit des combinaifons en perdant de l’énergie,
& qu’on fuppléoit à la fineffe de l’oreille
par l’agilité des doigts. Auffi Plutarque repren d -il
vivement les muficiens de fon temps , d’avoir
perdu le plus beau des trois genres, & d’ofer dire
que les intervalles n’en font pas fenfibles ; comme
fi tout ce qui échappe à leurs fens groffiers, ajoute
ce philofophe, devoit être hors de la nature.
N o u s avons au jou rd’h u i une fo r te de g en re enhar*
S s s ij