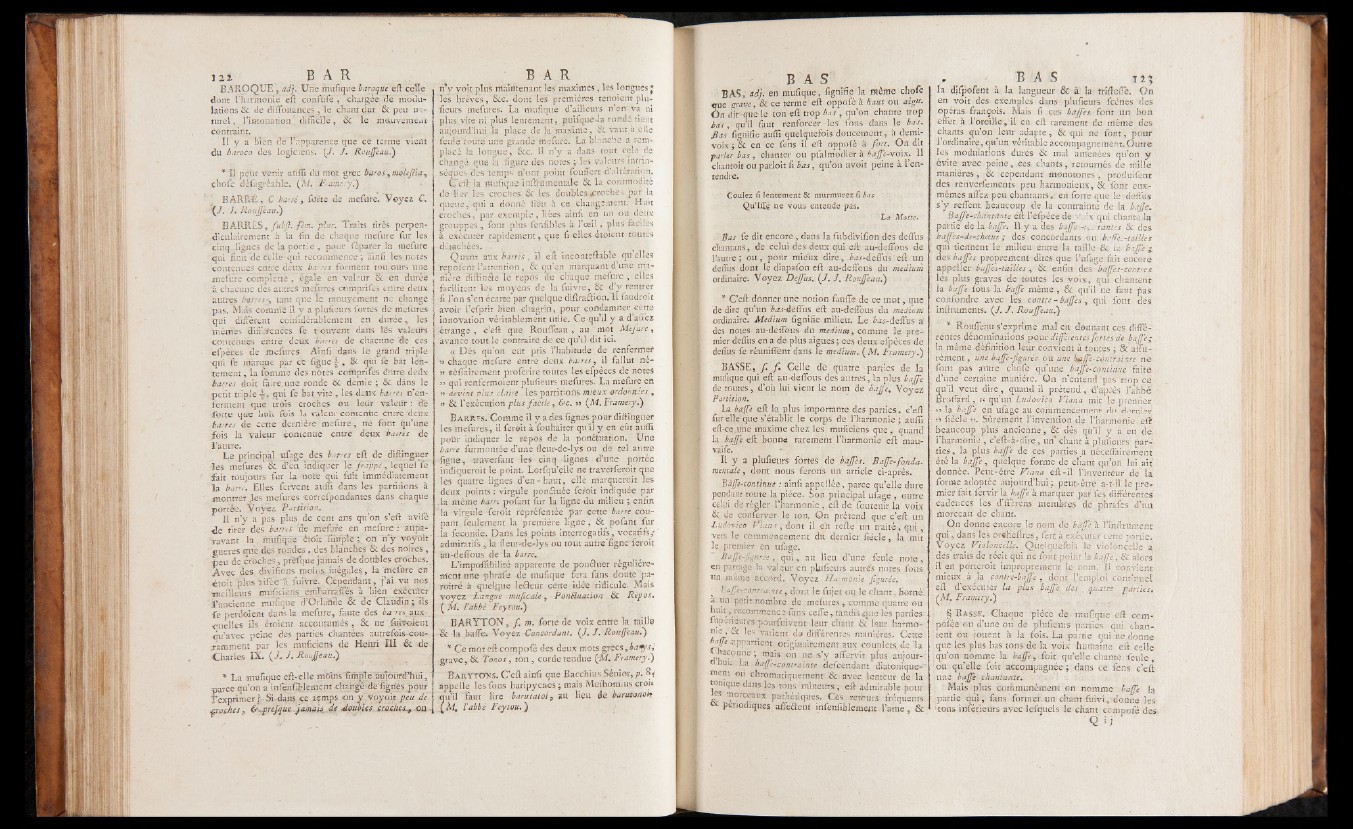
1 2 i B A R
BAROQUE , adj. Unetnufique baroque efl ceTIe
dont l'harmonie efl confüfe , chargée dé modulations
& de dïffonances, le chant dur & peu naturel
, l'intonation difficile, 8c le mouvement
contraint.
Il y a bien de l ’apparence que ce terme vient
du baroco des logiciens. (/. J. Rouffeau.)
* Il peut venir atifli du mot grec baros,molefiia,
chofé défagréable. (M. F raina y.')
; B A R R É , C barré, forte de mefure. Vo yez C
'(/. J. Roufféav.)
BAE.RES, fubjl. férn. plur. Traits tires perpendiculairement
à la fin de chaque mefure fur les
cinq lignes de la portie , pour féparer la mefure
qui finit de celle qui recommence; ainfi les notes
contenues entre deux ba ies forment toujours une
mefure compfettê , égale en valeur 8c en durée
à chacune des autres mefures comprifes entre deux
autres barres-, tant que le mouvement ne change
pas. Mais comme il y a plufieurs fortes de mefures
qui diffèrent confidérablement en durée, les
mèmès différences fe trouvent dans les valeurs
contenues entré deux barres de chacune 'de ces
efpèces de mefures. Ainfi dans le grènd triple
-qui fe marque par ce figue \ , & qui fe bat lentement
, la femme des nôtes coffiprifes ëntre deiîx
barres doit faire,une ronde 6c demie ; 8c dans le
petit triple -|?, qui fe bat vite , les deux barres n’enferment
que trois croches ou leur valeür : de
forte que huit fois la valeur contenue entre deux
bai res de cette dernière mefure, ne font qu’une
fois la valeur .contenue entre deux battes de
l ’autre.
Le principal ufage des barres efl de diflinguer
le s mefures & d’en indiquer le frappé, 'lequel fe
fait toujours fur la note qui füit immédiatement
la barre. Elles fervent airlîi dans les partitions à
montrer „les mefures correfpondantes dans chaque
portée. Vo ÿez Partition. -
Il n’y a pas plus de cent ans qu’on s’e'ff avifé
«le tirer des barres de mefure en mefure raüpa-
-favant la mufique êtOit fihfplë oïï n y voyait
cueres que des rondes , des blanches 8c des'noires ,
peu de croches , prêfqüe jamais de doubles Croches.
Ave c des diyïfions moins, inégale^, la mèfore en
ctoit plus t ifé e 'a fuivre. Cépen'dânt, j’ai vu nos
meilleurs mujîcîëns em t e r a fe a bîén 'exécuter
l ’ancienne mufique d’Orlaftcle 8c de Claudin ; ils ■
fe perdoient dans la mefure, faute des ba-res aux-,
«nielles ils étoient .accoutumés, 8c ne foi Voient
qu’avec peine des parties chantées autrefois-couramment
par les mufickns de Henri III 8c de
Charles 12. ( Z Z Rouftzu.')
* L a tnullque eil-elle m Oïn m pîe"iu]o irfdTi ni,
™rce qu’on a inféntïblenient'dMn'g’é ‘ÏÏè'fignës jioür
T’exprimer ?:-Si-danspçe temps <on j 'v o y o i t peu dé,
çzochcs , S/^refyuc-jamaii.df doubles, crouhes., on-
B A R
n’y voit plus maintenant les maximes, les longues JJ
; les brèves, 8cc. dont lès premières tenoient plufieurs
mefures. La mufique d’ailleurs n’en va ni
plus vite ni plus lentement, puifqueJa rondé tient
aujourd’hui la place dè lajnaxime, 8c vaut,à elle
feule toute une grande tnefuré. La blanche a remplacé
la longue, 8cc. 11 n’y a dans tout cela de
changé: que la figure des notes ; les valeurs intrin-*
. sèques des temps n’ont point fouffert d’alteration.
C ’efl: la mufique infinimentale 8c la commodité
de -lier les croches, 6c les doubles «proches par la
queue, qui a donné liëu à ce changement. Huit
croches, par exemple, liées ainfi en un ou deux
grouppes, font plus fe.nfibles à l’oe il, plus faciles
à exécuter rapidement, que fi elles étoient-toutes
détachées. . . . • ■ • ••. .
Quant aux barres, il efl incOnteftable qu’elles
repofent l’attention , 6c eru’en marquant d’une manière
difiin&e le repos de chaque mefure, elles
I facilitent les moyens de la fuivre, 6c d’y rentrer
I fi l’on s’en écarte par quelque diflractipnTl faudroit
avoir l’ efprit bien chagrin, pour condamner cette
innovation véritablement utile. Ce = qu’il y a d’afiez
étrange , c ’efl: que RoufTeau , au mot Mefure,
avance tout le contraire de ce qu’il dit ici.
u Dès qu’on eut pris l’habitude de renferme^
« chaque mefure entre deux barres, il fallut né-
» eèffairement proferire toutes les efpèces de notes
>j qui renfermoient plufieurs mefures. La mefure en
n devint plus claire les partitions mieux ordonnées ,
» & l’exécurion plus facile, &c. »s (A/. Frameryé)
Barras. Comme il y a des lignes pour diflinguer
les mefiirés, il feroit à fouhaiter qu’il y en eût aufli
polir indiquer le repos de la ponctuation. Uiie
barre furmontée d’une fleur-de-lys ou de tel autre
ligne, tr-averfànt les cinq lignes d’une- portée
indiqueroit le point. Lorfqu’elle ne travérferoit que
les quatre lignes d’en - haut, elle marqueroit les
deux points : virgule pon&uée fefoit indiquée par
. ,1a même barre pofant fur la ligne du milieu ; enfin
'la -virgule feroit répréfentèe par cette barre coupant
feulement la première ligne, & pofant fur
. la fécondé. Dans les points interrogatifs, vocatifs,'
admiratifs, la fleur-de-lys ou tout autre'figne feroit
âu-deffous de la barre.
L’impoffibilité apparente de ponduer régir’iere-
nfent une -phrafe de mufique fera fans-doute’pa-
roîtrë à quelque leéleur cette idée ridicule. Mais
voyez Langue muficale, PonUuation 6c Repos,
( M. l'abbé Feytou.)
B A R Y T O N , f m. forte de voix entre la taille
■ 6c 4a baffe. Voyez Concordant. (J. J. Rouffèau.)
* Ce mot efl: compote des deux mots grecs,batys,
grave, 8c Tonos, ton , corde tendue (-M. Framery.')
Ba r y t CTNs. C ’efl: ainfi que Bacchius Sénior, p.%i
appelle les fons baripyenes ; mais Meïbomius croit
qu’il faut lire barutatoi 9 au lieu de barutonoh
. l'abbé Feytou. )
B A S
BAS, adj. en mufique, fignifie la même chofe
que grave, & ce terme eft oppofé à haut où aigu.
On disque le ton efl trop bas , qu’on chante trop
bas, qu’il faut renforcer les tons dans le basv
Ras fignifie auflî quelquefois doucement, à demi-
voix ',6c en ce fens il efl: oppofé à fort. On dit
parler bas, chanter ou pfalmodier abnfe-voix. 11
cbantoit ou parloit fi bas, qu’on avoit peine à l’entendre.
Coulez li lentement & murmurez fi bas
Qu’IfCg ne vous entende pas.
La Motte.
Ras fe dit encore , dans la fubdivifion des defliis
chantans, de celui des: deux qui efi au-deflqus de
l ’autre ; o u , pour mieux dire, ^^î-defliis efi un
defliis dont le diapafon efi au-defîbus du medium.
ordinaire. Voyez Dejfus. (J. J. Roujfeau.j
* C’eft donner une notion fauffe de ce mot, que
de dire qifun ^^-defliis efl: au-deflous du medium
ordinaire. Medium fignifie milieu. Le bas-defliis â
des notes au-deflous du medium, comme le premier
defliis en a de plus aigues ; ces deux efpèces de
deffus fe réunifient dans le medium. ( M. bramery.)
BASSE, f f . Celle de quatre part les de la
mufique qui efl: au-deflous des autres, La plus baffe
de toutes, d’où lui vient le nom de bajjé. Voyez
Partition.
La baffe efl >la plus importante des parties, c’efl:
f«rellëqùe s’établit le corps de l’harmonie; aufli
eft-ce,une maxime chez les muficiens que , quand
la bfffé efl: bonne rarement l’harmonie efl mau-
vaife. “ " '
Il y a plufieurs fortes de baffes. Baffe-fondamentale
, dont nous ferons un article ci-après.
Bâffe-continue : ainfi appellée , parce qu’elle dure
pendant toute la pièce. Son principal ufage , outre
celui dé régler l’harmonie , efl'de foutenir la voix
& de cônterver le ton. On prétend que c’efl: un
Ludoviço Vïant, dont il eh relie un traité y q u i,
vers le commencement du dernier fiècle, la mit
le premier en ufage;
Rnffe-fgtirée , q u i, au lieu d’une feule note ,
en partage la valeur en pUifieurs autres notes fous
un même;accord. Voyez Harmonie figurée. ■
B*ffe*co;ntrainte, dont lé fujet ou le chant, borné-
a un petit nombre de mefures, comme quatre ou
huit ^recommence fans cefle, tandis que les parties
fuperieures pourfuivent leur chant Sc ieur harmo-
^ ^'es d® différentes manières. Cette
baffe .appartient originairement,aux couplets de la
Cnaconne; mais >on ne s’y affervit plus aujour-
« nui. La baffe-contrainte defeendant diatonique-"
mept ou chromatiquement 8c avec lenteur de la
tonique dans les tons mineurs-, efl- admirable pour'
tes morceaux pathétiques. Cès retours fréquents
périodiques affeélenf infenfiblement l’ame, 6c
» ^ B A S t
la dilpofent à , la langueur & à la* triflefle. On
en voit des exemples dans plufieurs fcènes des
opéras : franco is. Mais fi ces baffes- (ont un bon
effet à l ’oreille, il en efl rarement de même des
chants qu’on leur adapte, & qui ne font, pour
l ’ordinaire, qu’un véritable accompagnement. Outre
les modulations dures 6c mal amenées qu’on y
évite avec peine, ,ces; chants, retournés de mille
manières, 6c cependant monotones , produifent
des reriverfements peu harmonieux, 8c font eux-
mêmes affez peu chantants, en forte que le deflus
s’y reffent beaucoup de la contrainte de la bajffe«
Baffe-chantante ëft l’efpèce de voix qui chante la
partie de la baffe. Il y a des baffei-réj:tantes 8c des
baffes-de-chceur ; des concordants où baffes-tailles
qui tiennent, le milieu entre la. taille 8c la baffe i
des baffes proprement dites que l’ufage fait encore
appeller baffes-tailles , 8c enfin des baffes-contres
les plus graves de toutes les voix , qui chantent
la baffe, fous la baffe même, 6c qu’il ne faut pas
confondre avec lès contre - baffes, qui font des
iiiflruments. (7. / . Rouffeaué)
| Rouffeau s’exprime mal en donnant ces différentes
dénommations poiir diff’érentes fortes de baffe;
la même définition leur convient à toutes ; & affu-
rément, une baffe-figurée o\\ une b^ffe-contrainte ne
font pas autre chofe: qii’une baffe-continue faite
d’une certaine manière. On n’entend pas trop ce
qu’il veut dire, quand il prétend , d’après l’abbé
Broffard, ce qu’un Ludoviço Viana mit le oremier
»? la baffe en ufage au commencement du ■ dernier
ri fiècle n. Sûrement l’invention de rharmonie efl
beaucoup plus ancienne, & dès qu’il y a eu çtel
rharmonie , c’eft-a-dire, un* chant à plufieurs parties,
la plus baffe de ces parties a nêceflairement
été la baffe, quelque forme de chant qu’on lui ait
donnée. Peut-être Viana e fl- il l’inventeur de la
forme adoptée aujourd’hui : peut-être a-t-il le premier
fait fervir la baffe à marquer par fes différentes
cadences les d'fférens membres de phrafes d’un
morceau de chant.
On donne encore le nom do baffe à rinflrùment
qui, dans les or#heflres, fert à exécuter cette partie.
Vo y e z Violoncelle; Quelquefois le violoncelle a
dés traits de récit qui ne font point la baffe, 6c alors
il en po'rteroit improprement le* nom. Il convient
mieux à la contre-baffe , dont remploi continuel
efl d exeçutér la ■ plus baffe des a autre - parties•
(M. Framery.')
§ Basse. Chaque pièce dè mufique efl com-
pôfçe ou d’une ou de plufieurs parties qui chantent
ou jouent à la fois. La partie qui ne donne
que les plus bas tons de la voix humaine efl celle
qu’on nomme la baffe, (oit qu’elle chanté feule
ou qu’elle foit accompagnée ; dans ce fens c’eût
une baffe chantante.
Mais plus communément on nomme baffe la
partie q ui, fans former, un chant fuivi, donne les
‘tons intérieurs avec lefquels le chant ccmpofé des>
Q 1 i