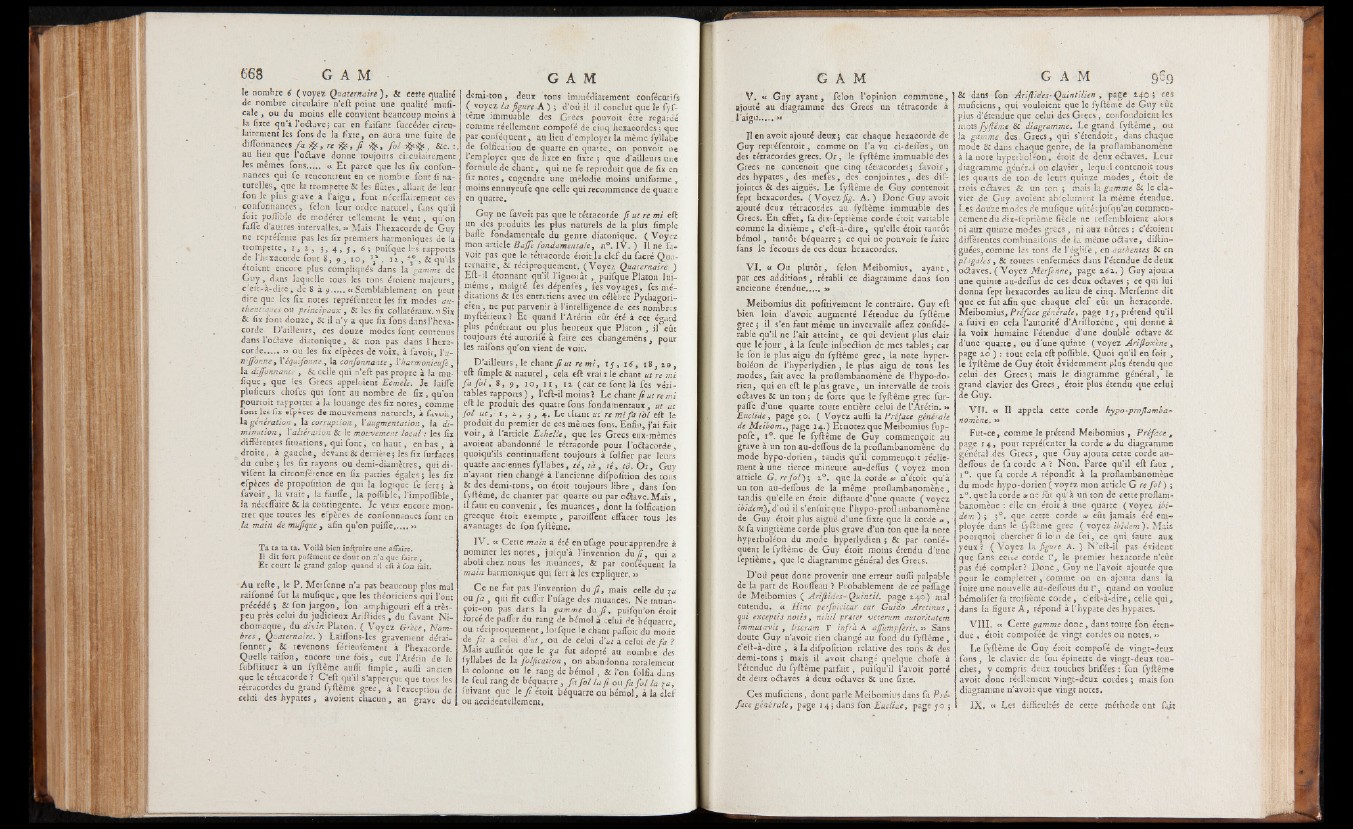
le nombre 6 ( voyez Quaternaire ) , & cette qualité
de nombre circulaire n’eft point une qualité mufi-
cale , ou du moins elle convient beaucoup moins à
la fixte qu’à l’o&ave; car en faifant fuccéder circu-
lairement les fons de la fixte, on aura une fuite de
diffonnanccs fa , re #c , f i fo l fy ifc , &c.
au lieu que l’o&ave donne toujours ci; affairement
les mêmes fons..... « Et parce que les lïx confon-
nances qui fe rencontrent en ce nombre font fi naturelles,
que la trompette & les flûtes, allant de leur
fon le plus grave à l'aigu, font néedfairement ces
confonnances', félon leur ordre naturel, fans qu'il
foit poflîble de modérer tellement le vent, qu’on
fafie d’autres intervalles. » Mais l’hexacorde de Guy
ne repréfente pas les fix premiers harmoniques de la
trompette, i , i , 3, 4 , 5 , 6; puifque 1rs rapports
de l ’hexacorde font 8 , 9 , 1 0 , 12, *° , & qu’ffs
étoient encore plus compliqués dans la gamme de
G u y , dans laquelle tous les tons étoient majeurs,
c efi-à-dire, de 8 à 9..... «Semblablement on peut
dire que les fix notes repréfentent les fix modes au-,
t fient: ques ou principaux , & les fix collatéraux. » Six
& fix font douze, & il n’y a que fix fons dansl’hexa-
corde D’ailleurs, _ces douze modes font contenus
dans l’octave diatonique, & non pas dans l ’hexa-
corde...., » ou les fix efpèces de voix, à favoir, Yu-
n 'Jfonne, Yéquifonrie., la confonnante , l’harmonieufe ,
la dijfonnante , Sc celle qui n’eft pas propre à la mu-
fique, que les Grecs appeloient Ecmele. Je laiffe
plufieurs chofes qui font aü nombre de fix , quon
jjourroit rapporter à la louange des fix notes, comme
font les fix efpèces de mouvemens naturels, à favoir,
la génération , la corruption, Y augmentation, la diminution
y Y altération & le mouvement local : les fix
différ entes fituations, qui font en haut, en bas , à I
droite, à gauche, devant & derrières les fix furfaces
du cube ; les fix rayons ou demi-diamètres, qui di-
vifent la circonférence en fix parties égales ; les fix
efpèces de propofition de qui la logique fe fert 5 à
favoir, la vraie, lafauffe, Ja poffible, î’impoflible
la néceffaire & la contingente. Je veux encore montrer
que toutes les efpèces de confonnances font en
la main de mufique, afin qu’on puiffe.,... sa
T a ta ta ta. V o ilà bien inftruire une affaire.
Il dit fort pofément ce dont on n’a que faire ,
E t court le grand galop quand il eft à fon fait.
Au refte, le P. Merfenne n’a pas beaucoup plus mal
raifonné fur la mufique, que les théoriciens qui l’ont
précédé ; & fon jargon, fon amphigouri eft à très-
peu près celui du judicieux Ariftides , du favant Ni-
chomaque, du divin Platon. ( Voyez Grèce, Nombres
t Quaternaire. ) Làiflons-les gravement dérai-
fonner, & revenons férienfement à l’hexacorde.
Quelle raifon, encore une fois, eut l’Arérin de le
fubftituer à un fyftême aufli fimple, suffi ancien
que le tétracorde ? C ’eft qu’il s’apperçue que tous les
tétracordes du grand fyftême grec, à l’exception de
celui des hypates, ayoient chacun, au graye du
dcmi*ton, deux tons immédiatement confécutîfs
( voyez la figure A ) 5 d’o iijl il conclut que le fyf-
teme immuable des Grecs pouvoit être regardé
comme réellement compofé de cinq hexacordes; que
par çonféquent, au lieu d’employer la même fÿilabe
de folfîcat ion de quarte en quarte, on pouvoir ne
l’employer que de fixte en fixte 5 que d’ailleurs une
formule de chant, qui ne fe reproduit que de fix en
fix notes, engendre une mélodie moins uniforme ,
moins ennuyeufe que celle qui recommence de quatre
en quatre,
Guy ne favoit pas que le tétracorde f i ut re mi eft
un des produits les plus naturels de la plus fimple
bafle fondamentale du genre diatonique. ( Voyez
mon article Bajfe fqndamentale, n°. IV. ) Il ne favoit
pas que le tétracorde étoit.la clef du facré Quaternaire,
& réciproquement. (Voyez Quaternaire )
Eft-il étonnant qu’il l'ignorât , puifque Platon lui-
même , malj> ré les dépenfes , fes voyages, fes méditations
& les entretiens avec un célèbre Pythagoricien,
ne put parvenir à l’intelligence de ces nombres
myftérieux? Et quand l’Arérin eûc été à cet égard
plus pénétrant ou plus heureux que Platon , il eût
toujours été autorifé à faire ces changemëns , pour
les raifons qu’on vient de voir.
D’ailleurs, le chant f i ut re mi, 1 $ , 1 6 , 1 8 ,2 0 ,
eft fimple.& naturel, cela eft vrai : le chant ut re mi
fa fo l , t , 9 , 10, I I , IX (car ce font là fes véritables
rapports ) , l’eft-il moins ? Le chant fi ut remi
eft le produit des quatre fons fondamentaux, ut ut
fo l ut y- 1 , 2 , 3 , 4. Le chant ut re mi fa fol eft le
produit du premier de ces mêmes fons. Enfin, j’ai fait
voir, à l’article Echelle, que les Grecs eux-mêmes
avoient abandonné le tétracorde pour l ’o&acorde,
quoiqu’ils continuaffent toujours à folfier par leurs
quade anciennes fyllabes, té, ta , tê, tô. O r , Guy
n’ayant rien changé à l’ancienne difpofition des tons
& des demi-tons, on étoit toujours libre , dans fon
fyftême, de chanter par quarte ou par o&ave.Maîs ,
il faut en convenir, fes muances, dont la folfîcation
grecque étoit exempte , paroiffent effacer tous les
avantages de fon fyftême.
IV . « Cette main a été en ufage pour apprendre à
nommer les notes, jufqu’à l’invention du fit, qui a
aboli chez nous les muances, & par çonféquent la
main harmonique qui fert à les expliquer, s»
Ce ne fut pas l’invention du f i , mais celle du Sr
ou f a , qui fit ceffer l’ufage des muances. Ne rnuan-
çoit-on pas da^rs la gamme du f i t puifqu’on étoit
forcé de palier du rang de bémol à celui de béquarre,
ou réciproquement, lorfque le chant paffoit du mode
de f a a celui d’ut y ou de celui d'ut à celui de fa ?
Mais auffitôt que le ça fut adopté au nombre des
fyllabes de la folfication, on abandonna totalement
la colonne ou le rang de bémol, & l’on folfia dans
le feul rang de béquarre , f a fo l la fi ou f a fo l la 7 a ,
luivant que le f i étoit béquarre ou bémol, à la clef
ou accidentellement.
V . « Guy ayant, félon l’opinion commune,
ajouté au diagramme des Grecs un tétracorde à
l ’aigu....,
Il en avoit ajouté deux 5 car chaque hexacorde de
Guy repréfentoit, comme on l ’a vu ci-deffus, un
des tétracordes grecs. O r , le fyftême immuable des
Grecs ne contenoit que cinq tétracordes 5 favoir,
des hypates, des mefes, des conjointes, des dif-
jointes & des aiguës. Le fyftême de Guy contenoit
fept hexacordcs. (V o y e z fig. A .) Donc Guy avoit
ajouté deux tétracordes au fyftême immuable des
Grecs. En.effet, fa dix-feptième corde ttoit variable
comme la dixième , c’eft-a-dire, qu’elle étoit tantôt
bémol, tantôt béquarre 5 ce qui ne pouvoir fe faire
fans le fecours de ces deux hexacordes.
V I . « Ou plutôt » félon Meibomius, ayant,
par ces additions, rétabli ce diagramme dans fon
ancienne étendue..... »
Meibomius dit pofîtivement le contraire. Guy eft
bien loin d’avoir augmenté l’étendue du fyftême
grec j il s’en faut même un invervaile affez confidé-
rable qu’il ne l’ait atteint, ce qui devient plus clair
que le jour , à la feule infoeétion de mes tables 3 car
le fon le plus aigu du fyftême grec, la note hyper-
boléon de l’hyperlydicn , le plus aigu de tous les
modes, fait avec la proflambanomène de l’hypo-do-
rien, qui en eft le plus grave, un intervalle de trois
oéfcaves & un ton 5 de forte que le fyftême grec fur-
pàffe d’une quarte toute entière celui de l’Arétin. *•
Euclide y page 50. ( Voyez auffi la Préface générale
de Meibom., page 14.) Etnotez que Meibomius fupr
pofe, i° . que le fyftême de Guy commençoit au
grave à un ton au-deffous de la proflambanomène du
mode hypo-dorien, tandis qu’il commençoit réellement
à une tierce mineure au-deffus ( voyez mon
article G. re fol'), 2°. que la corde a n’étoit qu’à
un ton au-deffous de la même proflambanomène,
tandis qu’elle en éroit diftante d’une quarte ( voyez
ibidem), d’où il s’enfuit que i’hypo-proflambanomène
de Guy étoit plus aiguë d’une fixte que la corde a ,
& fa vingtième corde plus grave d’un ton que la note
hyperboléon du mode hyperlydien j & par confié-
quent le fyftême- de Guy étoit moins étendu d’une
leptième, que le diagramme général des Grecs.
D’oü peut donc provenir une erreur auffi palpable
de la part de Roufléau ? Probablement de ce paffage
de Meibomius ( Ariftides-Qui ntil. page 240) mal
entendu. « H inc perfpicitur cur Guido Aretïnus,
qui exceptis notis, nihil prêter veterum autoritatem
immutavit , literam r infra A ajfumpferit. n Sans
doute Guy n’avoit rien changé au fond du fyftême,
c’eft-à-dire , à la difpofition relative des tons & des
demi-tons 5 mais il avoit changé quelque chofe à
l’étendue du fyftême parfait, puifqu’il l’avoit porté
de deux o&aves à deux oélaves & une fixte.
Ces muficiens, dont parle Meibomius dans fa Préface
générale, page 145 dans fon Euclide, page 50 $
& dans fon Ariftides- Quindlien , page 140 j ces
muficiens , qui vouloient que le fyftême de Guy eût
plus d’étendue que celui des Grecs, confondoient les
mots fyftême & diagramme. Le grand fyftême, ou
la gamme des. Grecs, qui s’étendoit, dans chaque
mode & dans chaque genre, de la proflambanomène
à la note hyperboléon, étoit de deux oébaves. Leur
diagramme général ou clavier, lequel contenoit tous
les quarts de ton de leurs quinze modes , étoit de
trois octaves & un ton 3 mais la gamme & le clavier
de Guy avoient abfolument la même étendue.
Les douze modes de mufique ufités jufqu’au commencement
du dix-feptième fiècle ne reffembloient alors
ni aux quinze modes grecs, ni aux nôtres : c’étoient
différentes combinaifons de la même oâave, diftin-
guées, comme les tons de l ’égiife , en authentes & en
phgales, & toutes renfermées dans l’étendue de deux
oétaves. ( Voyez Merfenne, page 262. ) Guy ajoura
une quinte au-deffus de ces deux oâraves ; ce qui lui
donna fept hexacordes au lieu de cinq. Merfenne die
1 que ce fut afin que chaque clef eût un hexacorde.
Meibomius, Préface générale, page i j , prétend qu’il
a fuivi en cela l’autorité d’Ariftoxcne, qui donne à
Ja voix humaine l’étendue d’une double otftave &
d’une quarte, ou d’une quinte (voyez Ariftoxène3
page 20 ) : tout cela eft poffible. Quoi qu’il en foit ,
le fyftême de Guy étoit évidemment plus étendu que
celui des Grecs; mais le diagramme général, le
grand clavier des Grecs, étoit plus étendu que celui
de Guy.
VII. et II appela cette corde kypo-profiamba-
ndm'ene. »»
Fut-ce, comme le prétend Meibomius , Préface ,
page 14 , pour repréfenter la corde a du diagramme
général,des Grecs, que Guy ajouta cette corde au-
deflous de fa corde A l Non. Parce qu’il eft faux ,
i ° . que fa corde A répondît à la proflambanomène
du mode hypo-dorien (voyez mon article G re fo l ) ;
2°. que la corde a ne fût qu'à un ton de cette proflambanomène
: elle en étoit à une quarte (voyez ibidem
) ; 3 °. que cette corde a eût jamais été employée
dans le fyftême grec ( voyez ibidem ). Mais
pourquoi chercher fi loin de foi, ce qui faute aux
yeux ? ( Voyez la figure A. ) N ’cft-il pas évident
que fans ceue corde r , le premier hexacorde n’eût
pas été complet? Donc, Guy ne l’avoit ajoutée que
pour le completter, comme on en ajouta dans la
fuite une nouvelle au-deffous du r , quand on voulue
béraolifer fa troifième corde , c’eft-à-dire, celle qui,
dans la figure A , répond à l'hypate des hypates.
VIII. « Cette gamme donc, dans toute fon étendue
, étoit compofée de vingt cordes ou notes. »
Le fyftême de Guy étoit compofé de vingt-deux
fons, le clavier de fon épinette de vingt-deux tou-
| ches, y compris deux touches brifées : fon fyftême
avoit donc réellement vingt-deux cordes ; mais fon
diagramme n’avoit que vingt notes.
IX. « Les difficultés de cette méthode ont f4 c