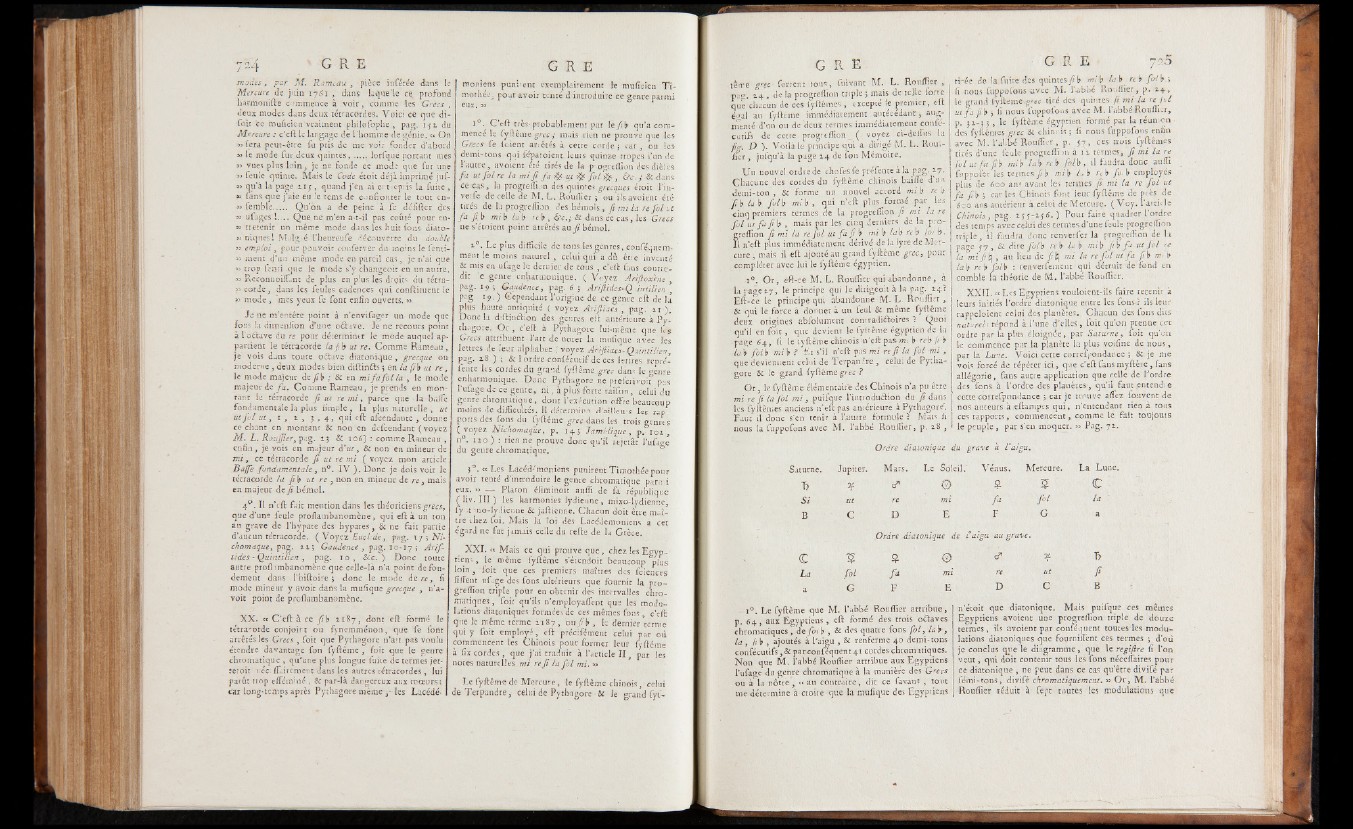
m o d e s , p a r M . R a m e a u | pièce inférée dans le
M e r c u r e de juin 1761 J dans laquelle ce profond
harmonifte commence à v o i r , comme les G r é e s ,
deux modes dans deux tétracordes. V o ic i ce que di-
foic ce rnuficicn vraiment philofophe , pag. 152 du
M e r c u r e : c ’eft le langage de l'homme de g é n i e . O n
m fera peut-être fu pris de me voir fonder d’abord
» le mode fur deux quintes, ..... lorfquê portant mes
vues plus lo in , je ne fonde ce mode que fur une
33 feule quinte. Mais le Code étoit déjà imprimé juf-
03 qu’à la page 215, quand j’en ai ert; épris la fu ite ,
.*>. fans que j’aie eu le tems de confronter le tout en-
33 femble...... Qu ’ôn a de peine à fe défifter des
33 ufages 1.... Que ne m’en a-t-il pas coûté pour en-
»3 tretenir un même mode dans les huit fons diato-
»3 niques 1 Malgré l’heureufe découverte du double
33 em p lo i | pour pouvoir conferver du moins le fenti-
33 ment d’un même mode en pareil cas, je n’ai que
33 trop fenti que le mode s’y changeoit en un autre.
33 ReconnoifLnt de plus en plus les droits du tétra-
?3 corde, dans les feules cadences qui conftituent le
33 mode , mes yeux fe font enfin ouverts. 33
Je ne m’entête point à n’envifager un mode que
fous la dimenlion d’une cétave. Je ne recours point
à l’octave du re pour déterminer Je mode auquel appartient
le tétracorde la f, b ut re. Comme Rameau,
je vois dans toute oéfcave diatonique, grecque ou
moderne , deux modes bien diftin&s 5 en la f i b ut re 3
le mode majeur de ƒ b ; & en mi f a fo l la , le mode
majeur de f a . Comme Rameau, je prends en montant
le tétracorde f i ut re mi, parce que la baffe
fondamentale la plus fimple, la plus naturelle , ut
ut f o l ut, 1 , 2 , 3 , 4 , qui eft afeendante , donne
ce ch ant en montant & non en defeendant ( voyez I
M . L. Ro.ujfier3 pag. 13 & 106) : comme Rameau ,
enfin, je vois en majeur d'ut y & non en mineur de
mi , ce tétracorde f i ut re mi ( voyez mon article
Baffe fondamentale3 n° . IV ) . Donc je dois voir le
tétracorde la f i b ut re , non en mineur de re , mais
en majeur de f i bémol.
4 ° . Il n’tft fait mention dans les théoriciens grecs,
que d’une feule proflambanomène, qui eft à un ton
au grave de l’hypate des hypares, & ne fait partie
d’aucun tétracorde. (V o y e z Eucl-.de _y pag. 17 ^ Ni-
chomaquey pag. 22 ; Gaudence , pag. 10-17 > -Arif-
tides - Quintilien , pag. 1 0 , &e. ) Donc toute
autre profitmbanomène que celle-là n’a point de fondement
dans l’hiftoire ; donc le mode de re, fi
mode mineur y avoit dans la mufique grecque , n’a-
voit point de proflambanomène.
X X . «« C ’eft à ce fi b 2.187, dont eft formé le
tétracorde eonjoirt ou fynemménon, que fe font
arrêtés les G r e c s , foit que Pythagore n’ait, pas voulu
étendre davantage fon fy ftêm e , foit que le genre
chromatique , qu’une plus longue fuite de termes jet-
reroit née-: flaire ment dans les autrestétracordes , lui
parut trop efféminé , & par-là dangereux aux moeurs;
car long-temps après Pythagore même les Lacédémoniens
punfient exemplairement le mufïcien T i mothée.
pour avoir tenté d introduire ce genre parmi
eus. 33
i ° . C ’eft très-probablement par le fi b qu’a commence
le fyflêm e grec ; mais rien ne prouve que les
Grecs fe foient anêcés à cette corde; c a r , ou les
demi-tons qui féparoient.leurs quinze tropes l’un de
l'autre , avoient été tirés de la pogreffion des diètes
fa ut fo l re la mi f i fa ifc utite f>l ite y &<-'■ S & dans
ce c a s , la progreflion des quintes grecques étoit l’in—
verfe de celle de M . L . Rouflier ; ou ils avoient été
tirés de la progreffion des bémols , f i mi la re fo l ut
f a fi. b mib la b rc b , ô’c.y & dans ce ca s , les Grecs
11e s’étoient point arrêtés au f i bémol.
l ° . Le plus difficile de tous les genres, conféquem-
ment le moins naturel , celui qui a dû être inventé
& mis en ufage le dernier de tous , c’eft fans contredit
'e genre enharmonique. ( V o y e z Ariftoxene
pag. 19 ; Gaudence, pag. 6 5 A n fl ides- Q -in ri lien J
pag 19. ) Cependant l’origine de ce genre eft de la
plus haute antiquité ( voyez Ariftiues 1 pa<*. 11 •).
Donc la diftinélion des genres eft antérieure à P y thagore.
O r , c ’eft à Pythagore lui-même que les
Grecs attribuent l’art de noter la mufique avec Jes
lettres de leur alphabet ( voyez Arifiides- Quintilien,
pag. 28 ) ; & 1 ordre confécutif de ces lettres repréfente
les cordes du grand fyftême. grec dans le genre
enharmonique. Donc Pythagore ne preferivoit pas
l’ufage de ce genre, ni , à plus forte raïfon, celui du
genre chromatique, dont l’exécution offre beaucoup
moins de difficultés. 11 détermina d’ailleurs les rapports
des fons du fyftême grec dans les trois genre s
( v o y e z Nichomaque, p. 1 4 ; Jambliquc , p. 10 2 ,
n°. 120) : rien ne prouve donc qu’il itjetâc l’ufage
du genre chromatique.
3°. « Les Lacédémoniens punirent Timothée pour
avoir tenté d’introduire le genre chromatique paru i
eux. 33 — Plaron éliminoit auffi dé fa république
( liv. III ) les harmonies lydienne, mixo-lydienne,
fy:;t mo-lydier.ne & jaftienne. Chacun doit être maître
chez foi. Mais la loi dés Lacédémoniens à cet
égard ne fut jamais celle du refte de la Grèce.
X X I . ce Mais ce qui prouve q u e , chez les Egyptiens
, le même fyftême s’étendoit beaucoup plus
lo in , foit que ces premiers maîtres des fciences
fifient u fig e des fons ultérieurs que fournit Ja progreffion
triple poùr en obtenir des intervalles chromatiques:,
foit qu’ils n’employaient que les modulations'
diatoniques formées de ces mêmes fon s , c’eft
que le même terme 2187, ou / b , le dernier terme
qui y fort employé, eft précifément celui par où
commencent les Chinois pour former leur fyftême
à fix cordes, que j’ai traduit à l’article I I , par les
notes naturelles mi, re fit la fo l mi. y»
Le fyftême de Mercure, le fyftême chinois, celui
de Tetpandre, celui de Pythagore & le grand fy fterré
grec fortent tou s, fuivant M . L. Rouflier ,
pag. 24 , de la progreffion triple ; mais de telle forcé
que chacun de ces fyftêmcs, excepté le premier, eft
égal au fyfteme immédiatement antécedant, aug-
menté d’un ou de deux termes immédiatement confé-
cutifs de cette progreffion _ ( voyez ci-de il us la
fia. D ). V oilà le principe qui a dirigé M. L . Roul-
fie r , jufqu'à la page 24 de fon Mémoire.
U n nouvel ordre de chofesfe préfente à la pag. 27.
Chacune des cordes du fyftême chinois b ai fie d un
demi-ton , & forme un nouvel accord mi b re b
ƒ b /a b fo l b mi b , qui n’eft plus formé par les
cinq premiers termes de la progreffion fi mi la re
fo l ut fa fi b , mais par les cinq derniers de la progreffion
f i mi la re fo l ut fa fi b mi b lab fe b fol b-
I l n’eft plus immédiatement dérivé delà lyre de M ercu
re, mais il eft ajouté au grand fyftême grec y pour
compléter avec lui le lyftême égyptien.
iQ. O r , eft-ce M. L. Rouiller qui abandonne ra
la page 2 7 , le principe qui le dirigeo'.t à la pag. 24?
E ft-ce le principe qui abandonne M. L . Rouflkr ,
& qui le force à donner à un feul & même fyftême
deux origines abfolument contradictoires ? Quoi
qu’il en foit , que devient le fyitême égyptien de la
page 64 , fi le tyftéme chinois n’eft pas- rm b reb Jib
la b folb mi b ? Et s’il n’eft pas mi re f i la fo l mi ,
que deviennent celui de Terpan.lre , celui de Pythagore
& le grand fyftême grec ?
O r , le fyftême élémentaire des Chinois n’a pu être
mi re f i la fol mi y puifque l'intiodudion du fi dans
les lyftêmes anciens n’ eft pas antérieure à Pythagore'.
Faut il donc s’en tenir à l’autre formule ? Mais fi
nous la fuppofons avec M . l’abbé Rouffier, p. 2 8 ,
t i ’ée de la fuiré des quintes fi b mib b ï<e b fo l b,;
fi nous fuppofons avec M . l’abbe Ptonflier, p. 2 4 ,
le grand f y f t ê m e t i r é des quintes // mi la reJtl
ut fa / b ; ii nous fuppofons avec M. l’abbé Rouflier,
p. 31-33 , le fyftême égyptien formé par la réunion
des fyflêmes grec & chinois ; fi nous fuppofons enfin
avec M. l’abbé Rouffier , p. 5 7 , ces trois fyftêmes
tirés d’une feule progrefli m à 1 2 termes, f i mi la re
fol ut fa f i b m,ï b lab a b /o/b, il faudra donc auffi
fuppofer les termes ƒ b mib i- b n b fo> b employés
plus de 600 ans avant les termes f i mi la re fo l ut
fa f b j car les Chinois font leur fyftême de près de
600 ans antérieur à celui de Mercure. ( V o y . l’article
Chinois, pag. -255-156. ) Pour faire quadrer l’ordre
des temps avec celui des termes d’une feule progreffion
triple, il faudra donc renverfer la progreffion de la
page 5 7 , & dire fol b re b la b mi b f b fa ut fo l re
la mi fitj , au lieu de fitj mi La re fo l ut fa f b m: b
la b re b folb : renverfement qui détruit de fond en
comble la théorie de M. l’abbé Rouffier.
X X II. «LesEgyptiens vouloient-ils faire retenir à
1 leurs initiés l’ordre diatonique entre les fons ? ils leur
rappeloient celui des planètes. Chacun des fons dits
naturel* répond à i ’une d’elles, foit qu’on prenne cec
j ordre par la plus éloignée, par Saturne, foit qu’on
i le commence par la planète la plus voifine de nous,
par la Lu-’.e. V o ic i cette correfpondance ; & je me
vois forcé de répéter i c i , que c’eft fans m yftère, fans
allégorie, fans autre application que celle de l’ ordre
des fons à l’ordre des planètes , qu’il faut .entend; e
cette correfpondance ; car je trouve a fiez fouvent de
nos auteurs à.eftampes q u i, n’entendant rien à tous
ces rapports, commencent, comme le fait toujours
le peuple, par s’en moquer. 33 Pag. 72.
Ordre diatonique du grave a Vaigu.
Saturne. Jupiter. Mars. Le Soleil." Vénus. Mercure. La Lune.
T? > o’ © £ ? € '
Si ut re mi f u f ° ‘ la
B c D E F G a
Ordre diatonique de i* aigu au grave.
(C 5 0 © <e Tf. r?
La fo l ƒ “ mi re ut f '
a G F E D C B
1° . Le fyftême que M. l’abbé Rouffier attribue,
p . 6 4 , aux Egyptiens, eft formé des trois oélaves
chromatiques, de foi b , & des quatre fons fo l, la b ,
la , h b , ajoutés à l ’aigu , & renferme 40 demi-tons
confécutifs , & par conféquent 41 cordes chromatiques.
Non que M. l’abbé Rouffier attribue aux Egyptiens
l’ufage du genre chromatique à la manière des G recs
011 à la nô tre , « au contraire, dit ce favant | tout
me détermine à croire que la mufique des Egyptiens
n’étoit que diatonique. Mais puifque ces mêmes
Egyptiens avoient une progreffion triple de douze
termes, ils avoient par confécjuent toutes les modulations
diatoniques que fourniflent ces termes ; d’où
je conclus qye le diagramme, que le regiflre fi l’on
v eu t, qui doit contenir tous les fons nécefiaires pour
ce diatonique , ne peut dans ce cas qu’être divifé pair
fémi-tons, divifé chromatiquemcnt. >3 O r , M. l’abbé
Rouffier réduit à fept toutes les modulations que