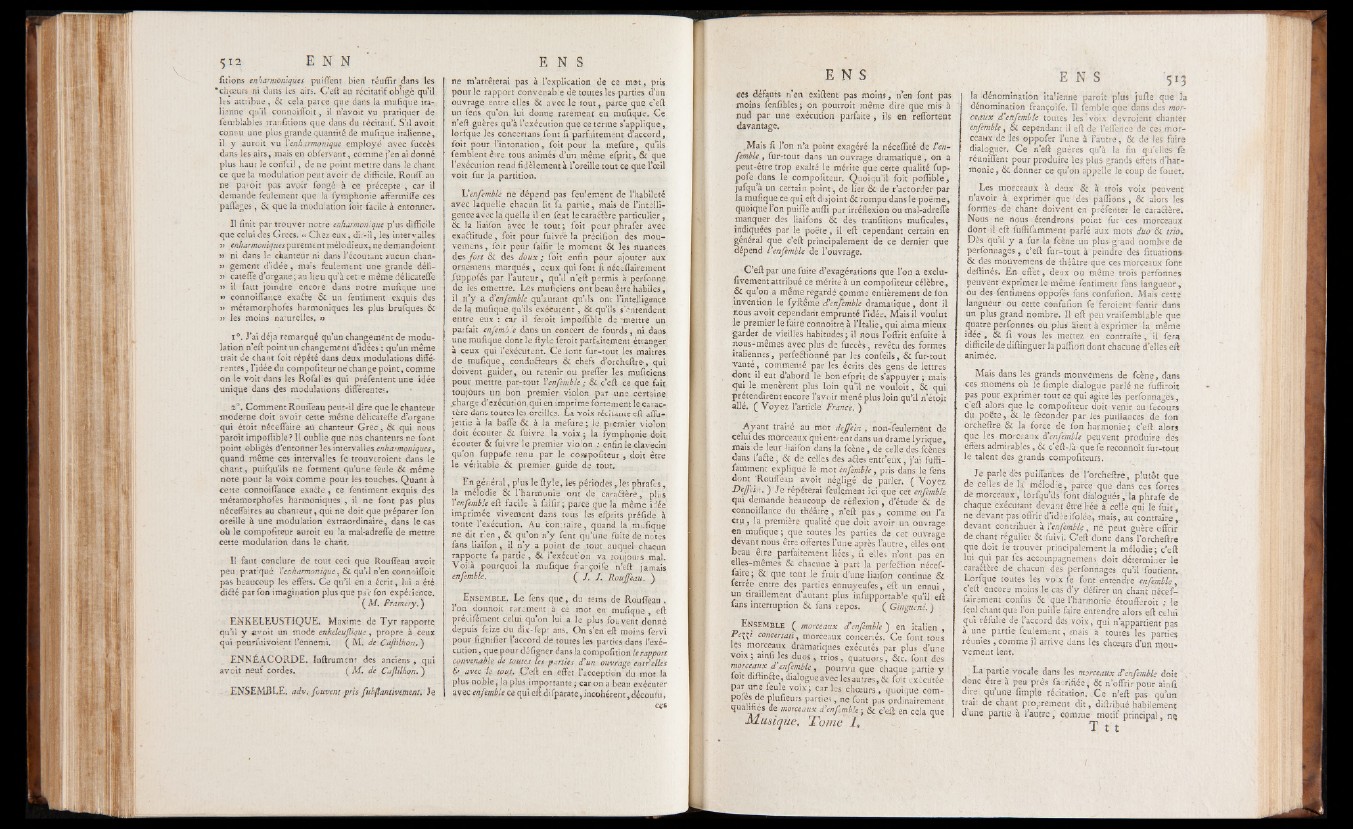
fitions enharmoniques puiffent bien réuffir dans les
‘choeurs ni dans les airs. C’eft au récitatif obligé qu’il
les attribue, 8c cela parce que dans la mufique italienne
qu’il connoiffoit, il n’avoit vu pratiquer de
l'en.'blabîes tranlitions que dans du récitatif. S’il avoit
connu une plus grande quantité de mufique italienne,
il y auroit vu Y enharmonique employé avec fuccès
dans- les airs, mais en obfervant, comme j’en ai donné
plus haut le confeil, de ne point mettre dans le chant
ce que la modulation peut avoir de difficile. Rouffiau
ne paroît pas avoir fongé à ce précepte , car il
demande feulement que la fymphonie affermiffe ces
paflages , 8c que la modulation foie facile à entonner.
Il finit par trouver notre enharmonique p’us difficile
que celui des Grecs. « Chez eux, di:-il, les intervalles
n enharmoniques purement mélodieux, nedemandoient
a ni dans le chanteur ni dans l’écoutant aucun chan-
»> gement d’idée, ma:s feulement une grande déli-
n catefTe d’organe ; au lieu qu’à cet: e même délicateffe
» il faut joindre encore dans notre mufique une
« connoiffan.ee exaébe 8c un fentiment exquis des
i» métamorphofes harmoniques les plus brufques 8c
jj les moins naturelles. »
i°. J’ai déjà remarqué qu’un changement de modulation
n’eft point un changement d’idées : qu’un même
trait ce chant foit répété dans deux modulations différentes,
l’idée du compofiteur ne'change point, comme
on le voit dans les Rofabës qui préfentent une idée
unique dans des modulations différentes.
2°. Comment RouiTeau peut-il dire que le chanteur
moderne doit avoir cette même délicatefle d’organe
qui étoit néceffaire au chanteur Grec, 8c qui nous
paroît impoffible? Il oublie que nos chanteurs ne font
point obligés d’entonner les intervalles en ha rm o n iq ue s ,
quand même ces intervalles fe trouveroient dans le
chant., puifqu’-ils ne forment qu’une feule 8c même
note pour la voix comme pour les touches. Quant à
cette connoiffance exaéle , ce fentiment exquis des
métamorphofes harmoniques , il ne font pas plus
néceffaires au chanreur, qui ne doit que préparer fon
oreille à une modulation extraordinaire, dans le cas
où le compofiteur auroit eu la mal-adreffe de mettre
cette modulation dans le chant.
Il faut conclure de tout ceci que Rouffeau avoit
peu pratiqué Y en h a rm o n iq u e , 8c qu’il n’en connoiffoit
pas beaucoup les effets. Ce qu’il en a écrit, lui a été
diéfé par fon imagination plus que par fon expérience.
(Af. F ram e ry .')
ENKELEUSTIQUE. Maxime de Tyr rapporte
qu’il y ayoit un mode en k e le u f tiq u e , propre à ceux
qui pourfuivoient l’ennemi. ( M. de C a f t ilh o n .')
ENNÉACORDE. Inftrumént des anciens , qui
avoit neuf cordes. ( M . de C a f tilh o n . )
ENSEMBLE, a d v . fo u v e n t p r is fu b fta n ù v em en t. Je
ne m’arrêterai pas à l’explication de ce mot, pris
pour le rapport convenable de toutes les parties d’un
ouvrage entre elles 8c avec le tout, parce que c’eft
un fens qu’on lui donne rarement en mufique. Ce
n’eft guères qu’à l’exécution que ce terme s’applique,
lorfque les concertans font fi parfaitement d’accord,
foit pour l’intonation, foit pour la mefure, qu’ils
femblent être tous animés d’un même efprit, 8c que
l’exécution rend fidèlement à l’oreille tout ce que l’oeil
voit fur la partition.
\ J en femble ne dépend pas feulement de l’habileté
avec laquelle chacun lit fa partie, mais de l’intelligence
avec la quelle il en feat le caractère particulier ,
8c la liaifon avec le tout ; foit pour phrafer avec
exaéfitude, foit pour fuivr’é la précifion des mou-
vemens, foit pour faifir le moment 8c les nuances
des f o r t 8c des d o u x ; foit enfin pour ajouter aux
ornemens marqués , ceux qui font fi néctflairement
/uppofés par l’auteur, qu’il n’eft permis à perfonne
de les omettre. Les muficiens ont beau être habiles,
il n’y a à 'enfem ble qu’autant qu’ils ont l’intelligence
de la mufique,qu’ils exécutent, 8c qu’ils s'entendent
entre eux : car il feroit impoffible de mettre un
parfait en fem b le dans un concert de fourds ni dans
une mufique dont le ftyle feroit parfaitement étranger
à ceux qui l’exécutent. Ce font fur-tout les maîtres
de mufique, conduéleurs 8c chefs d’orcheftre, qui
doivent guider, ou retenir ou preffer les muficiens
pour mettre par-tout Yenfemble ; 8c c’eft ce que fait
toujours un bon premier violon par une certaine
„charge d’exécution,qui en imprime fortement le caractère
dans toutes les oreilles. La Voix récitante eft affu-
jettie à la baffe 8c à la mefure; le premier violon
doit écouter 8c fuivre la voix ; la fymphonie doit
écouter 8c fuivre le premier violon : enfin le clavecin
qu’on fuppofe tenu par le côrspofiteur , doit être
le véritable & premier guide de tout.
En général, plus le ftyle, les périodes, les phralcs,
la mélodie 8c l’harmonie ont de caraélère, pîjis
Yenfemble eft facile- à fài'fir ; parce que la même idée
imprimée vivement dans tous les efprits préfide à
toute l’exécution. Au contraire, quand la mufique
ne dit rien , 8c qu’on n’y fent qu’une fuite de notes
fans liaifon, il n’y a point de tout auquel chacun
rapporte fa partie, 8c i’exéeufon va toujours mal.
Voilà pourquoi la mufique frarçoife n’eft' .jamais
enfemble. ( J . J . R o u f fe a u . )
Ensemble, j,Le fens que, du tems de Rouffeau,
l’on donnoit rarement à ce mot en mufique, eft
précisément celui qu’on lui a le plus fouvent donné
depuis feize du dix-fepr ans. On s’en eft moins fervi
pour fignifier l’accord de toutes les parties dans l’exécution
, que pour défigner dans la compofition le rapport
convenable, de to utes le s p a r tie s d 'u n ou v ra ge en t r e l ie s
& a v e c le tp u t. C’eft en effet l’acception du mot la
plus noble, la plus importante; car on a beau exécuter
avec en fem b le ce qui eft difparate, incohérent, découfii,
ces
ces défauts n’en exiftent pas moins, n’en font pas
moins fenfibles; on pourroit même dire que mis à
nud par une exécution parfaite, ils en reffortent
davantage.
,Mais fi l'on n’a point exagéré la néceffité de F enfem
b le , fur-tout dans un ouvrage dramatique, on a
peut-être trop exalté le mérite que cette qualité fuppofe
dans le compofiteur. Quoiqu’il foit poffible,
jufqu’à un certain point-, de lier 8c de r’accorder par
la mufique ce qui eft disjoint 8c rompu dans le poëme,
quoique l’on puiffe auffi par irréflexion ou mal-adreffe
manquer des liaifons 8c des tranfitions muficales,
indiquées par le poëte, il eft cependant certain en
general que c’eft principalement de ce dernier que
dépend l ' en femble de l’ouvrage.
C ’eft par une fuite d’exagérations que l’on a exclu-
fivement attribué ce mérite à un compofiteur célèbre,
&C qu’on a meme regardé comme entièrement de fon
invention le fyftême d ’en femble dramatique, dont il
nous avoit cependant emprunté l’idée., Mais il voulut
le premier le faire connoître à l’Italie, qui aima mieux
garder de vieilles habitudes ; il nous l’offrit enfuite à
nous-mêmes avec plus dé fuccès, revêtu des formes
italiennes, perfectionné par les confeils, 8c fur-tout
vante, commenté par les écrits des gens de lettres
dont il eut d’abord le bon efprit de s’appuyer ; mais-
qui le menèrent plus loin qu’il ne vouloit, & qui
prétendirent encore l’avoir mené plus loin qu’il n’éto;t
allé. ( Voyez l’article F ra n c e . )
Ayant traité au mot d e f fe in , non-feulement de
celui des morceaux qui entrent dans un drame lyrique,
mais de leur liaifon dans la fcène, de celle des fcènes
dans laéle, 8c de celles des aéles entr’eux, j’ai fuffi-
famment expliqué le mot è n fem b le , pris dans le fens
dont Rouffeau avoit négligé de" parler. ( Voyez
D e f f e in . ) Je répéterai feuj&meat ici que cet enfemble
qui demande beaucoup de réflexion, d’étude 8c de
connoiflance du théâtre, n’eft pas, comme on l’a
cru, la première qualité que doit avoir un ouvrage :
en mufique ; que toutes les parties de cet ouvrage
devant nous être offertes l’une après l’autre, elles ont
beau être parfaitement liées, fi elles n’ont pas en
elles-memes 8c chacune à part la perfection néceffaire;
8c que tout le fruit d’une liaifon continue 8c
ferrée entre des parties ennuyeufes, eft un ennui,
un tiraillement d’autant plus infupportable qu’il: eft
fans interruption 8c fans repos. ( G in g u cn é . )
Ensemble ( m o r c ea u x d'enfemble ) en italien ,
P e f t i c o n c e r ta ti, morceaux concertés. Ce font tous
-s. morceaux dramatiques exécutés par plus d’une
voix ; ainfi les duos , trios , quatuors, 8cc. font des
m o r c ea u x d en femble i pourvu que chaque partie y
loit diftinéle, dialogue avec lesautrès, 8c fait exécutée
par une feule voix; car les choeurs , quoique com-
, plufieurs parties, ne font pas ordinairement
qualifies de m o r c ea u x d’enfemble ; & c’eft en cela que
-Musique, Tome I,
la dénomination italienne paroît plus jufte que la
dénomination françoife. Il femble que dans des morc
e a u x d?enfem ble toutes les*voix devroient chanter
en fem b le , & cependant il eft de l’effence de ces morceaux
de les oppofer l’une à Tauti e , 8c de les faire
dialoguer. Ce n’eft guères qu’à la fin qu’elles le
réunifient pour produire les plus grands effets d’harmonie
, 8c donner ce qu’on appelle le coup de fouet.
Les morceaux à deux 8c à trois voix peuvent
; n’avoir à. exprimer que des pallions , & alors les
, formes de chant doivent en préfenter le caraélère.
: Nous - ne nous étendrons point fur ces morceaux
dont il eft fuffifamment parlé aux mots d u o Fri tr io .
Dès qu’il y a fur la fcène un plus- g!and nombre de
perfonnages, c’eft fur-tout à peindre des fituations
8c des mouvemens de théâtre que ces morceaux font
deftinés. En effet, deux ou même trois perfonnes
peuvent exprimer le même fentiment fans langueur ,
ou des fentimens oppofés fans confufion. Mais cette
langueur ou cette confufion fe feroient fentir dans
un plus grand nombre. Il eft peu yraifemblable que
quatre perfonnes ou plus ‘aient à exprimer la^ même
idée, 8c fi vous les mettez en contrafte, il fera
difficile de diftinguer la paflion dont chacune d’elles eft
animée.
Mais dans les grands mouvemens de fcène, dans
ces momens où lè fimple dialogue parlé ne fuffiroit
pas pour exprimer tout ce qui agite les perfonna "ès,
c eft alors que le compofiteur doit venir au fecours
du, poëte,-8c le féconder par les puiffances de fon
orcheftre 8c la force de fon harmonie; c’eft alors
que les morceaux d'enfem b le peuvent produire des
effets admirables, 8c c’eft-là' que fe reconnoît fur-tout
le talent des grands compofiteurs.
Je parle des puiffances de l’orcheftre, plutôt que
de celles de la mélodie^ parce que dans ces fortes
de morceaux , lorfqü’ils font dialogues ,1a phrafe de
chaque exécutant devant être liée à celle qui le fuit,
ne devant pas offrir d’idéeifoïée/, mais, au contraire,,
devant contribuer à Y en fem b le , ne peut guère offrir
de chant régulier 8c fuivi. C’eft donc dans l’orcheftre
que doit fe trouver principalement la mélodie; c’eft
lui qui par fes açcompagnemens doit déterminer le
.caraélère de chacun des perfonnages qu’il foutient.
Lorfque toutes les voix fe font entendre en fem b le ,
c’eft encore moins le cas d’y délirer un chant nécef-
fairement confus 8c que l’harmonie étoufferoit : le
fçul chant que l’on puiffe faire entendre alors eft celui
cjuî réfulte de l’accord dés voix, qui n’appartient pas
à une partie feulement, mais à toutes les parties
réunies, comme il arrive dans les choeurs d’un mouvement
lent.
La partie vocale dans les m o r c ea u x d ’en fem b le doit
donc être à peu près fatrifiée; 8c n’offrir pour ainfi
dire qu’une fimple récitation. Ce n’eft pas qu’un
trajt de chant proprement dit, diftribué habilement
d une partie à 1autre, comme motif principal, n$
T 11