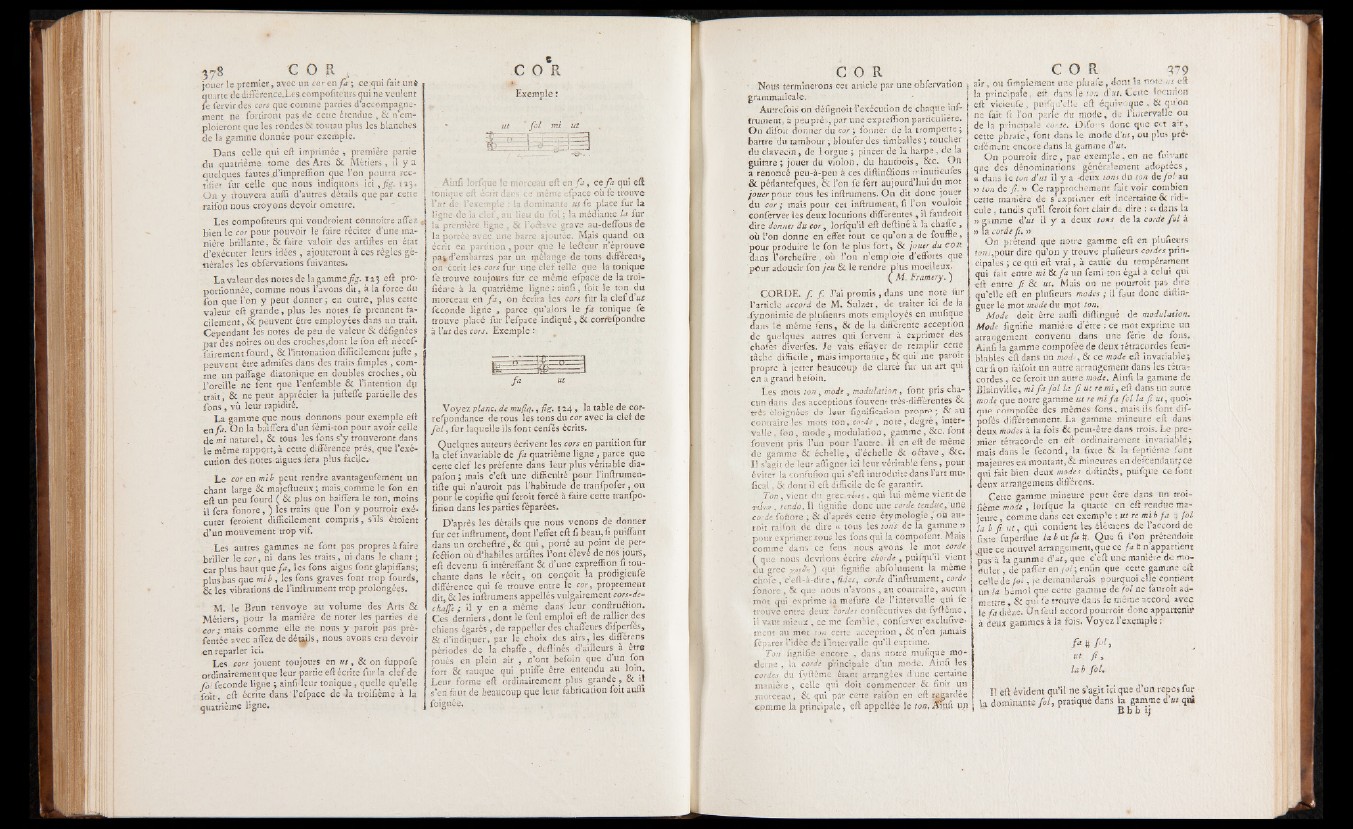
37S G O R , ,
jouer le premier, avec un cor en ƒ* ; ce .qui fait uni
quarte de différenceXes compofiteurs qui ne veulent
fe fervir des cors que comme parties d’accompagnement
ne fortiront pas de cette étendue > & n’emploieront
que les rondes & toutau plus les blanches
de la gamme donnée pour exemple.
Dans celle qui eft imprimée j, première partie
du quatrième tome des Arts & Métiers » il y a
quelques fautes .d’impreffi on que l’on pourra rec-
tilier fur celle que nous indiquons ici ,fig. 123.
On y trouvera aufli d’autres détails que par cette
raifon nous croyons devoir omettre.
Les compofiteurs qui vpudroient connoître a fiez
bien le cor pour pouvoir le faire réciter d’une manière
brillante, & faire valoir des artiftes en état
d’exécuter leurs idées , ajouteront à ces règles générales
les obfervations fuivantes.
La valeur des notes de la gamme fig. 123 eft proportionnée,
comme nous l’avons dit, à la force du
fon que l’on y peut donner; en outre, plus cette
valeur eft grande, plus les notes fe prennent facilement,
& peuvent être employées dans un trait.
Cependant les notes de peu de valeur & désignées
par des noires ou des croches,dont le fon eft nécef-
fairement fourd, & l’intonation difficilement jujfte ,
peuvent être admifes dans des traits fimples, comme
un palîage diatonique en doubles croches, où
l ’oreille ne lent que l’enfembîe & l’intention dp
trait, & ne peut apprécier la jufteffe partielle des
fons , vu leur rapidité.
La gamme que nous donnons pour exemple eft
en A On la baillera d’un fémi-ton pour avoir celle
de mi naturel, & tous les fons s’y trouveront dans
le même rapport, à cette différence près, que l’exécution
des notes aigues fera plus facile.
L e cor en mi b peut rendre avantageufement un
chant large & majeftueux; mais,comme le fon en
eft un peu fourd ( & plus on baiffera le ton, moins
il fera fonore, ) les traits que l’on y pourroit exécuter
feroient difficilement compris, s’ils étoient
d’ un mouvement trop vif.
Les autres gammes ne font pas propres à faire
briller le cor, ni dans les traits, ni dans le chant ;
car plus haut que fa , les fons aigus font glapiffans;
plus bas que mi b , les fons graves font trop fourds,
& les vibrations de l ’inffrument trop prolongées.
M. le Brun renvoyé au volume des Arts &
Métiers, pour la manière de noter les parties de
cor; mais comme elle ne nous y paroit pas pré-
fentée avec affez de détails, nous avons cru devoir
.en reparler ici.
Les cors jouent toujours en u t , & on fuppofe
ordinairement que leur partie eft écrite fur la cle f de
fo i fécondé ligne ; ainfi: leur tonique , quelle qu’elle
foit , eft écrite dans l’efpace de la troifième à la
quatrième ligne.
c 0 #R
il' n
Exemple :
ut • fo l
Ainfi lorfque le morceau eft en f a , ce fa qui eft
tonique eft écrit dans ce même efpaçe où fe trouve
Y ut de l ’exemple : la dominante ut fe place fur la
ligne de la c le f, au lieu du fol ; la médiante la fur
la première ligne, & l’oâave grave au-deffous de
la portée avec une barre ajoutée. Mais quand on
écrit en partition, pour que le leéleur n’éprouve
pas,.d’embarras par un mélange de tons différens,
on écrit les cors fur une clef telle que la tonique
fe trouve toujours fur ce même efpace de la troù-
fième à la quatrième ligne : ainft, foit le ton du
morceau en f a , on écrira les cors fur la clef d'ut
fécondé ligne , parce qu’alors le fa tonique fe
trouve placé fur l’efpace indiqué, & correfpondre
à Y ut des cors. Exemple: a
fa ut
V oyez plane. de mufiq., f i g. 1 24 > la table de cor*
refpondance de tous les tons du cor avec la clef de
fo l , fur laquelle ils font cenfés écrits.
Quelques auteurs écrivent les cors en partition fur
la clef invariable de fa quatrième ligne , parce que
cette clef les préfente dans leur plus véritable dia-
pafon ; mais c’eft une difficulté pour l’inftrumen-
tifte qui n’auroit pàs l’habitude de tranfpofer, ou
pour le copifte qui feroit forcé à faire cette tranlpo-
fition dans les parties féparées.
D ’après les détails que nous venons de donner
fur cet infiniment, dont l’effet eft fi beau, fi puiffant
dans un orcheftré , & q u i, porte au point de per-
feélion où d’habiles artiftes l ’ont élevé de nos jours,
eft devenu fi intéreffant Sc d’une expreffion fi touchante
dans le récit, on conçoit la prodigieufe
différence qui fe trouve entre le cor, proprement
dit, & les inftrumens appellés vulgairement cors-de-
chajfe ; il y en a même dans leur conftru&ion.
Ces derniers , dont le feul emploi eft de rallier des
chiens égarés , de rappeller des chaffeurs difperfés,
& d’indiquer, par le choix des airs? les différens
périodes de la chaffe, deftinés d’ailleurs à être
joués en plein air , n’ont befoin que d un fon
fort & rauque qui puiffe être entendu au loin.
Leur forme eft ordinairement plus grande , & il
s’en faut de beaucoup que leur fabrication foit aufïi
foignée.
C O R
Nous terminerons cet article par une obfervation j
grammaticale. ' l
Autrefois on défignoitd’exécution de chaque inf-
frument, à peu pré:,, par une expreffion particulière.
On difoit donner du cor ; fonner de la trompette ; |
battre du tambour ; bioufer des timballes ; toucher
du clavecin, de 1 orgue ; pincer de la harpe, de la
guitare; jouer du violon, du hautbois, &c. On
a renoncé peu-à-peu à ces diftinétions rmnutieufes
& pédantelques, 6c l’on fe fert aujourd’hui du mot
jo u e r pour tous les inftrumens. On dit donc jouer
du cor ; mais pour cet infiniment, fi l’on vouloit
conferver les deux locutions différentes , il faudroit
dire donner du cor, lorfqu’il eft deftiné à la chaffe ,
où l’on donne en effet tout ce qu’on a de fouffle,
pour produire le fon le plus fort, & jouer du c o r
dans l’orchéftre , où l’on n’empioie d’efforts que
pour adoucir fon je u 6c le rendre plus moelleux.
( M. Framcry. )
CORDE, f . f . J’ai promis , dans une note fur
l’article accord de M. Sulzer, de traiter ici de la
-fynonimie de plufienrs mots employés en mufique
dans le même fens, & de la différente acception
de quelques autres qui fervent à exprimer des
chofes diverfes. Je vais effayer de remplir cette
tâche difficile , mais importante, 6c qui' me paroît
propre à jetter beaucoup de clarté fur un art qui
en a grand befoin.
Les mois to n , mode , m od u la tio n , font pris chacun
dans des acceptions fouvent très-différentes 6c
très éloignées de leur fignification propre ; & au
contraire les mots ton,,corde , note, degré, intervalle
, fon, mode , modulation, gamme, &c. font
fouverit pris l’un pour l’autre. 11 en eft de même
de gamme & échelle ; d’échelle & oélave, &c.
I l s’agit de leur affigner ici leur véritable fens, pour
éviter la confufion qui s’eft introduite dans l’art mu-
f i c a l& dont il eft difficile de fe garantir.
Ton, vient du grec.roW, qui lui même vient de
ruva»1, tendo. Il lignifie donc une corde tend ue, une
corde fonore ; & d’après cette étymologie ,' on au-
roit raifon de dire « tous les tons de la gamme »
pour exprimer .tous les fons qui la compofent. Mais
comme dans ce fens nous avons le mot corde
( que nous devrions écrire chorde , puifqu’il vient
du grec |$|ff ) qui fignifie abfolument la même j
chofe , c’eft-à-dire, fides, corde d’inftrument, corde j
fonore que nous n’avons , au contraire, aucun
mot qui exprime la mefure de l’ intervalle qui fe j
trouve entre deux cordes confécutives du fyftême, j
il vaut mieux , ce me femble, conferver exclufive-
ment au mot ton cette acception, & n’en jamais
féparer l’idée de l’intervalle qu’il exprime.
Ton. fignifie encore , dans notre mufique moderne
, la corde principale d’un mode. Ain fi les
cordes du fyftême étant arrangées d une certaine
manière, celle qui doit commencer & finir un
morceau, & qui par cette raifon en eft regardée
çpmme la principale, eft appellée le ton, Annfi un
C O R 3 7 9
air, ou Amplement une phrafe, dont la note ut eft
la principale, eft dans le ton d'ut. Cette locution
eft vicieufe , puifqu’elîc eft équivoque , & qu on
ne fait fi l’on parle du mode, de ^intervalle ou
de la principale corde. Difo-s donc que cet a 'r ,
cette phrafe, font dans le mode d'ut, ou plus pré-
cifément encore dans la gamme d’i/f.
On pourroit dire, par exemple, en ne fuyant
que des dénominations généralement adoptées,
u dans le ton d'ut il y a deux ions du ton de fo l au
sa ton de fi. » Ce rapprochement fait voir combien
cette manière de s’exprimer eft incertaine & ridicule
, tandis qu’il feroit fort clair de dire : « dans la
» gamme d'ut il y a deux tons de la corde fo l à
j> la corde fi. »
On prétend que notre gamme eft en plufieurs
tcmj,pour dire qu’on y trouve plufieurs cordes principales
; ce qui eft vrai, à caufe du tempérament
qui fait entre mi 6c fa un femi-ton égal à celui qui
•eft entre fe & ut. Mais on ne pourroit pas dire
qu’elle eft en plufieurs modes ; il faut donc diflin-
guer le mot mode du mot ton.
Mode doit être aufli diftingué de modulation.
Mode fignifie manière d’être : ce mot exprime un
arrangement convenu dans une férié de fons.
Ainfi la gamme compofée de deux tétracordes fem-
blabies eft dans un mode, & ce mode eft invariable;
car fi on faifoit un autre arrangement dans les tétra-r
cordes , ce feroit un autre mode. Ainfi la gamme de
Blainville, mi fa fol la f i ut re mi, eft dans un autre
mode que notre gamme ut re mi fa fol la f i ut, quoique
compofée des mêmes fons, mais ils font dif-
pofés différemment. La gamme mineure eft dans
deux modes à la fors & peut-être dans trois. Le premier
tétracorde en eft ordinairement invariable’ ;
mais dans le fécond, la fixte 6c la feptième font
majeures en montant, & mineures en defeendant; ce
qui fait bien deux modes diftin&s, puifque ce font
deux arrangemens différens.
Cette gamme mineure peut être dans un troifième
mode , lorfque la quarte en eft rendue majeure
, comme dans cet exemple : ut re mi b fa fol
la b f i u t , qui contient les élémens de l’accord de
fixte fuperflue la b ut fa fc. Que fi l’on prétendoit
que ce nouvel arrangement, que ce fa # n’appartient
pas'à la gamme d'ut, que c’eft une manière de moduler
, de paffer en fo l; enfin que cette gamme eft:
celle de f e l , je demanderois pourquoi elle contient
un la bémol que cette gamme de fol ne fauroit admettre
, & qui fe trouve dans le même accord avec
le fa dièze. Un feul accord pourroit donc appartenir
à deux gammes à la fois. Voyez l’exemple :
fa $ fo l , ^
ut f i*
la b fol.
Il eft évident qu’il ne s’agit ici que d’un repos fur
la dominante fo l, pratiqué dans la gamme d'ut tpi
B b b 1;