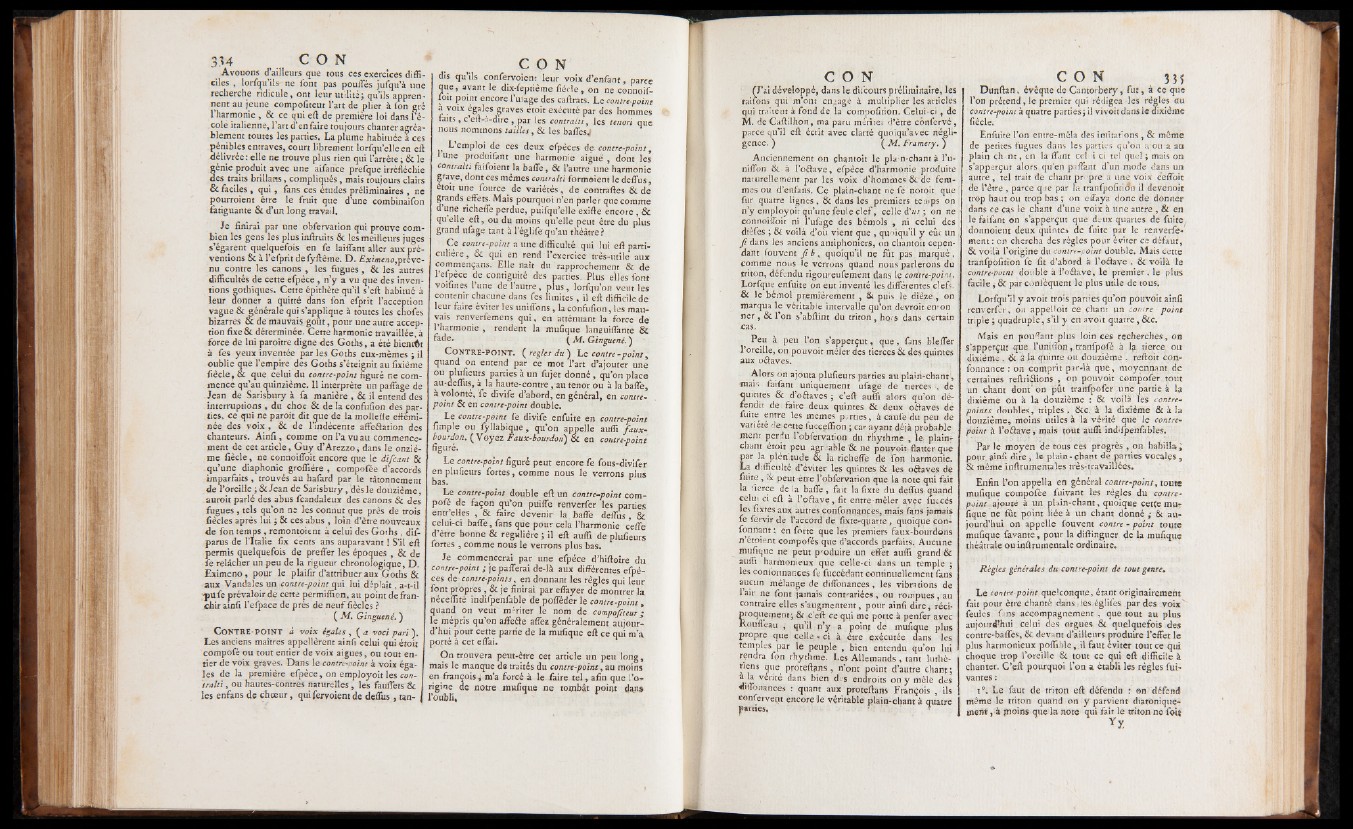
334 C O N
A v o u o n s d’a illeu r s q u e to u s c e s e x e r c ic e s d iffic
i le s , lo rsq u ’ ils n e fo n t pa s p o u lie s ju fq u ’ à u n e
r e c h e r c h e r id ic u le , o n t le u r u t i l i t é ; q u ’ils a p p r e n n
e n t au je u n e c om p o f it e u r l ’art d e p lie r à (on g ré
l ’h a rm o n ie , & c e q u i e f t d e p r em iè r e lo i dans F é -
c o le ita lie n n e , l ’art d’ en fa ire tou jo u r s ch an te r a g ré a b
lem e n t tou te s le s p a rtie s. L a p lum e h a b itu é e à c e s
p é n ib le s e n t ra v e s , c o u r t lib r em e n t lo r fq u ’e l le en e f t
d é liv r é e : e l le n e t ro u v e p lu s rien q u i l’a r r ê te ; & le
g é n ie p ro d u it a v e c u n e a i fa n c e p r e fq u e ir ré flé ch ie
d e s tra its b r i l la n s , c om p liq u é s , mais tou jo u r s c la ir s
& fa c ile s , q u i , fan s c e s é tu d e s prélim in a ire s , n e
p o u r ro ien t ê t r e l e f ru it q u e d ’u n e com b in a ifo n
fa tig u a n te 8c d’ un lo n g tra v a il.
J e f in ira i pa r u n e o b fe r v a tio n q u i p ro u v e c om b
ie n le s g e n s le s p lu s inftru its & le s m e ille u r s ju g e s
s ’é g a r en t q u e lq u e fo is e n f e la if fa n t a lle r a u x p r é v
e n t io n s & à l ’ e fp r it d e fy f fêm e . D . Eximeno,p r é v e n
u c o n t r e le s c a n o n s , le s f u g u e s , 8c le s autres
d iff icu lté s d e c e tte e fp è c e , n ’y a v u q u e de s in v e n t
io n s g o th iq u e s . C e t t e ép ith è te qu ’ i l s’e f t h a b itu é à
le u r d o n n e r a q u itté dans fo n e fp r it l’a c c ep tio n
v a g u e & g é n é r a le qui s’ap p liq u e à tou te s le s ch o fe s
b iz a r r e s & d e m au v a is g o û t , p o u r u n e au tre a c c e p tio
n f ix e & d é te rm in é e . C e t t e h a rm o n ie t ra v a illé e , à
f o r c e d e lu i p a ra ître d ign e d e s G o t h s , a é té b ie n té t
à fe s y e u x in v e n t é e pa r le s G o th s e u x -m êm e s ; i l
o u b l ie q u e l’ em p ire d e s G o th s s ’é te ign it au f ix ièm e
f iè c le f & q u e c e lu i d u contre-point fig u ré n e c om m
e n c e q u ’ au q u in z ièm e . 11 in te rp r ê te un p a ffa g e de
J e a n d e S a r isb u r y à fa m an iè re , & i l en ten d des
in te r ru p tio n s , du c h o c & d e la c o n fu f io n de s p a r t
ie s , c e q u i n e p a ro ît d it q u e d e la m o lle f fe e f fém in
é e d e s v o ix , & d e l ’in d é c en te a f fe â a t io n des
ch an teu r s . A i n f i , c om m e o n l’ a v u au c om m e n c e m
e n t d e c e t a r t ic le , G u y d’ A r e z z o ; dans l e o n z iè m
e f i è c l e , n e c o n n o iffo it e n c o r e q u e le difcant 8c
q u ’ un e d iap h o n ie g ro ff iè r e , c om p o fé e d’ ac co rd s
im p a r fa its , t ro u v é s au h a fa rd p a r le tâ ton n em en t
d e l ’ o r e i lle ; & J ean d e S a r i s b u r y , dè s l e d o u z ièm e ,
a u ro it p a r lé d e s ab u s fc a n d a le u x de s ca n o n s & d e s
fu g u e s , te ls q u ’o n n e le s c o n n u t q u e p r è s d e trois
f iè c le s ap rè s lu i ; & c e s ab u s , lo in d’ê tre n o u v e a u x
d e fo n tem p s , r em o n to ien t à c e lu i de s G o th s , d is p
a ru s d e l ’I ta lie f ix c e n t s ans au p a ra v a n t ! S ’i l eft
p e rm is q u e lq u e fo is d e p r e f fe r le s é p o q u e s , 8c d e
l e r e lâ c h e r un p eu d e la r igu eu r c h r o n o lo g iq u e , D .
E x im e n o , p o u r l e pla ifir d ’a ttr ib u e r au x G o th s &
a u x V a n d a le s un contre-point q u i lu i d é p la î t , a-t-il
" p t lfe p r é v a lo ir d e c e tte p e rm iffio n , au p o in t d e franc
h i r ainfi l ’e fp a c e de près de n e u f f iè c le s ?
( M. Ginguené. )
CONTRE-POINT à voix égaies , ( a voci pari Y
L e s an c ien s maître s a p p e lè r e n t a in fi c e lu i qu i é to it
c om p o fé o u to u t en tie r d e v o ix a i g u e s , o u to u t en -
f ie r d e v o ix g ra v e s . D a n s l e contre-point à v o ix é g a l
e s d e la prem ière e f p è c e , o n em p lo y o i t le s con-
trahi y o u h au te s - co n tre s n a tu r e lle s , le s fauffe ts &
le s en fa n s d e c h oe u r , q u i fe r v o ie n td e d e ffu s , tan-
C O N
dis qu ils confervoient leur voix d’enfant, parce
que, avant le dix-feptième fiècle , on ne connoif-
loir point encore i’uiage des caffrats. Le contre point
a voix égales graves étoit exécuté par des hommes
faits, c eft-à-dire , par les contraiti, les tenori que
nous nommons taille s , 8c les baffes^
L’emploi de ces deux efpèces de. contre-point,
1 une produisant une harmonie aiguë , dont les
contralti faifoient la baffe, 8c l’autre une harmonie
grave, dont ces memes contralti formoient le deffus,
étoit une fource de variétés, de centrales & de
grands effets. Mais pourquoi n’en parler que comme
d’une richeffe perdue, puifqu’elle exifte encore , &
qu elle eft, ou du moins qu’elle peut être du plus
grand ufage tant à l’églife qu’au théâtre?
Ce contre-point a une difficulté qui lui efi particulière
, 8c qui en rend l ’exercice très-utile aux
commençans. Elle naît du rapprochement & de
l’efpèce de contiguïté des parties. Plus elles font
voifines l’une de l’autre, plus, lorfqu’on veut les
contenir chacune dans fes limites , il eft difficile de
leur faire éviter les unifions, la confufion, les mauvais
renverfemens qui, en atténuant la force de
l’harmonie , rendent la mufique laneuiffante &
^at^ . ( M, Ginguené. )
C o n t r e -p o in t . ( réglés du') Le contre -point,
quand on entend par ce mot l’art d’ajouter une
ou plufieurs parties à un fujet donné, qu’on place
au:deffus, à la haute-contre, au ténor ou à la baffe,
à volonté, fe divife d’abord, en général, en contrepoint
& en contre-point double.
Le contre-point fe divife enfuite en contre-point
fimple ou fyllabique, qu’on appelle auffi faux-
bourdon, (V o y e z Faux-bourdon) & en contre-point
figuré.
Le contre-point figuré peut encore fe fous-divifer
en plufieurs fortes, comme nous le verrons plus
bas.
Le contre-point double eft un contre-point compofé
de façon qu’ on puiffe renverfer les parties
entr’elles , & faire devenir la baffe deffus , &
celui-ci baffe, fans que pour cela l’harmonie ceffe
d’être bonne & régulière ; il eft auffi de plufieurs
fortes , comme nous le verrons plus bas.
Je commencerai par une efpèce d’hiftoire du
contre-point ; je pafferai de-là aux différentes efpèces
de- contre-points, en donnant les règles qui leur
font propres, & je finirai par effayer de montrer la
néceffité indifpenfable de pofféder le contre-point,
quand on veut mériter le nom de compofiteur ;
le mépris qu’on affefte affez généralement aujourd’hui
pour cette partie de la mufique eft ce qui m’a
porté à cet effai.
On trouvera peut-être cet article un peu long,
mais le manque de traités du contre-point, au moins
en français ; m’a forcé à le faire te l, afin que l’o-
rigide de notre jnufique ne tombât point dan»
l’oubli«
C O N
(J’ai développé, dans le diieours préliminaire, les
railons qui m’ont engagé à multiplier les articles
qui traitent à fond de la compofition. Celui-ci, de
M. de Caftilhon, ma paru mériter d’être cônfervè,
parce qu’il eft écrit avec clarté quoiqu’avec négligence.
) ( M. Framery. )
Anciennement on çhantoit le pla-n-chant à l’u-
niffon 8c à l ’o&ave, efpèce d’harmonie produite
naturellement par les voix d’hommes 8cde femmes
ou d’enfans. Ce plain-chant ne fe notoit que
fur quatre lignes, & dans les premiers temps on
n’y employoit qu’une feule c le f, celle d’r/r.; on ne
connoifibir ni l’ufage des bémols , ni celui des
dièfes ; 8c voilà d’où vient q u e , quoiqu’il y eue un
f i dans les anciens antiphoniers, on çhantoit cependant
fouvent fi. b , quoiqu’il ne fût pas marqué ,
comme nous le verrons quand nous parlerons du
triton, défendu rigoureufement dans le coriirerpoint, >
Lorfque enfuite on eut inventé les différentes clefs. ?
& le bémol premièrement , & puis le dièze, on
marqua le véritable intervalle qu’on devroit en-on
n e r , 8c l’on s’abftint du triton, hors dans certain
cas.
P e u à p eu l’o n s’a p p e r ç u t , q u e , fan s b l e f f e r ,
l ’o r e i lle , o n p o u v o it m ê le r de s t ie rc e s 8c de s quinte s
a u x o& a v e s .
Alors on ajouta plufieurs parties au plain-chant', !
'JTiai'î faifant uniquement ufage de tierces , de :
uuintes & d’oétaves ; c’eft auffi alors qu’on dé- !
fendit de faire deux quintes & deux o&aves de
fuite entre les mêmes parties, à caufe du peu de
variété de cette fucceffion ; car ayant déjà probable
mem perdu 1 obfervation du rhythme , le: plains
chant etoit peu agr-able & ne pouvoit flatter que
par la plén.tude oc la richefle de fon harmonie.
La difficulté d’éviter les quintes & les o&aves de
fuite, & peut être l’obfervation que la note qui fait
la tierce de la baffe, fait la fixte du deffus quand
celui ci eft à l’o&ave, fit entre mêler avec uiccès
les fixres aux autres confonngnçes, mais fans jamais
fe fervir de l’accord de fixte-qyarte , quoique çon-
fonnarit ; en forte que les premiers faux-bourdons
n’étoient compofés que d’accords parfaits. Aucune
mufique ne peut produire un effet auffi grand &
auffi harmonieux que celle-ci dans un temple ;
les conlonnances fe fuccédant continuellement fans
aucun mélange de diffonances, les vibrations de
lair ne font jamais contrariées , ou rompues, au
contraire elles s’augmentent, pour ainfi dire, réciproquement;
& c’eft ce qqi me porte à penfer avec
Roufleau , qu’il p’y a point de mufique plus
propre que celle | ci à être exécutée dans les
temples par le peuple , bien entendu qu’on lui
rendra fon rhythme. Les Allemands , tant luthériens
cjue^ proteftans , n’ont point d’autre chant ;
v e r ‘ te dans b ie n d e s en d ro its o n y m ê lé des
«hffonances : quant a u x p ro te ftan s F r a n ç o is , ils |
conferv erçt e n c o r e l e v é r ita b le p la in - ch a n t à qua tre
p a rtie s, ' ' 1 I
C O N 3 3 s
Dunftan, évêque de Cantorbery, fu t, à ce que
l’on prétend, le premier qui rédigea les règles du
contre-point à quatre parties; il vi voit dans le dixième
1 fiècle.
Enfuite l’on entre-mêla des imitations , & même
de petites fugues dans les parties qu’on a;ou a au
plain ch n t , en la ffant ceh i ci tel quel ; mais on
s’apperçut alors qu’en paffant d'un mode dans un
autre, tel trait de chant pr- pre à une voix ceffoit
de l’être , parce que par la tranfpofitidn il devénoit
trop haut ou trop bas ; on effaya donc de donner
dans ce cas le chant d’une voix à une autre , & en
le faifant on s’apperçut que deux quartes de fuite
donnoient deux quintes de fuite par le renverfe-
ment : on chercha des règles pour éviter ce defaut,
8c voilà l’origine du contre-point double. Mais Cette
tranfpofition fe fit d’abord à l’oâave , & voilà le
contre-point double à Foélave, le premier, le plus
facile, 8c par conféquent le plus utile de tous.
Lorfqu’il y avoit trois parties qu’on pouvoit ainfi
renverfer, on appelait ce chant un contre point
triple ; quadruple, s’il y en avoit quarre, &c.
Mais en pouvant plus loin ces recherches, on
s’apperçut que l’uniffon,.tranfpofé à la tierce ou
dixiéme , & 3 la quinte ou douzième , reftoit con-
fonnance : on comprit par-là que, moyennant de
certaines reftri&ions , on pouvoit compofer tout
un chant dont'on put tranfpofer une partie à la
dixième ou à la douzième : & voilà les contrepoints
doubles, triples, &c. à la dixième & à la
douzième, moins miles à la vérité que le contrepoint
à l’oélave, mais tout auffi indifpenfables.
Par le moyen de tous ces progrès , on habilla \
pour, ainfi dire , le plain - chant de parties vocales ,
& même inftrumentales très-travaillées.
Enfin l’on appella en général contre-point, toute
mufique compofée fuivant les règles du contrepoint
ajouté à un plain-chant, quoique cetçe mur
fique ne fut point liée à un chant donné ,* & aujourd’hui
on appelle fouvent contre - point toute
mufique favante, pour la diftinguer tfe la mufique
théâtrale ou iiffirumentale ordinaire.
Réglés générales du contre-point de tout genre.
Le contre-pointquelconque, étant originairement
fait pour être chanté dans .les,églifes par des v o ix '
feules fins accompagnement , que tout au plus
aujourd'hui celui des orgues 6c quelquefois des
contre-baffes, 8c devant d’ailleurs produire l’effet le
plus harmonieux poffible, il faut éviter tout ce qui
choque trop l’oreille 8c tout ce qui eft difficile à
chanter. C ’eft pourquoi l’on a établi les règles fui-
vantes :
i°. Le faut de triton eft défendu : ©n' défend
même le triton quand on y parvient diatoniquement
, à moins que la note qui fait le triton ne foit
Y y .