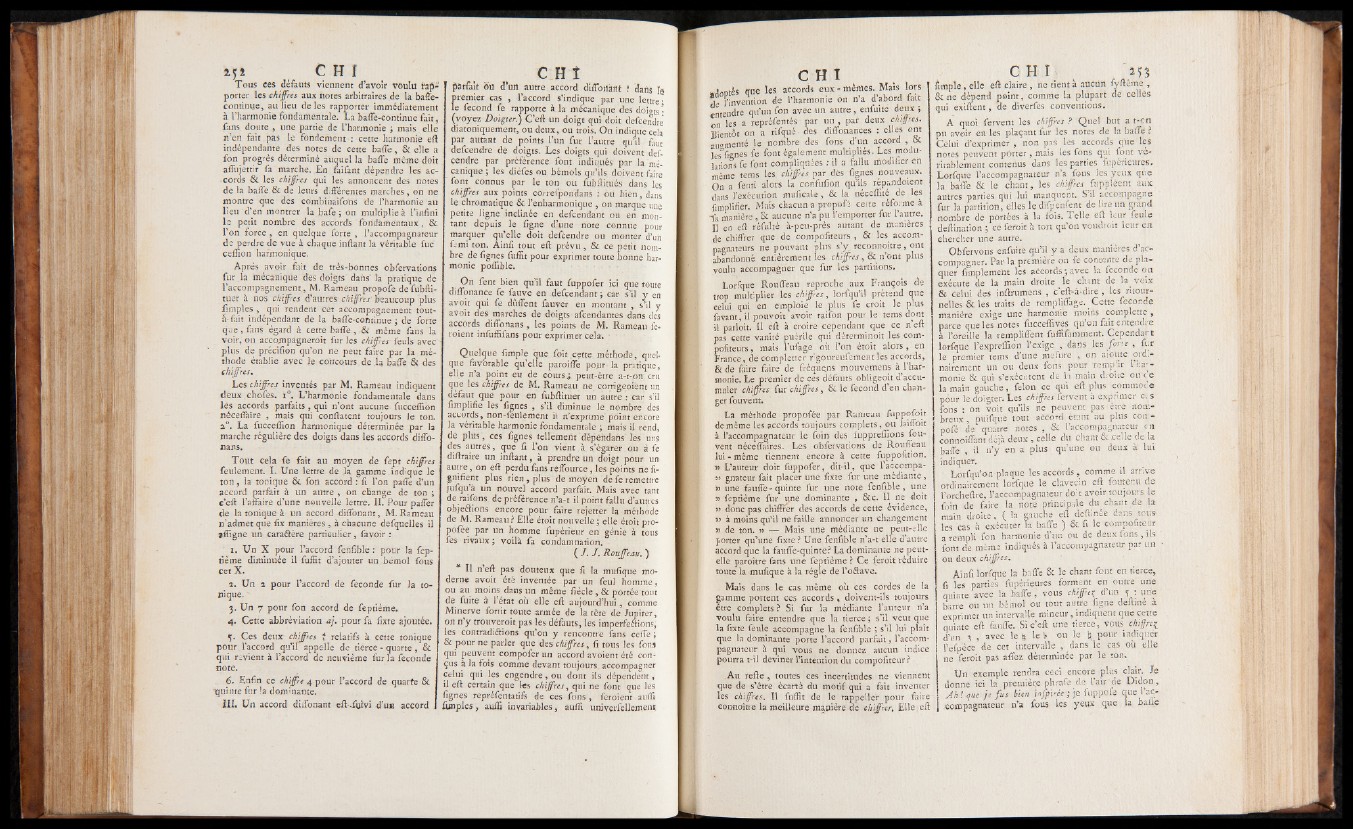
2jî C H I
Tous ces défauts viennent d’avoïr voulu l'apporter
les chiffres aux notes arbitraires de là baffe-
continue, au lieu de les rapporter immédiatement
à l’harmonie fondamentale. La baffe-continue fait,
fans doute , une partie de l’harmonie ; mais elle
n’en fait „pas le fondement : cette harmonie eft
indépendante des notes de cette baffe, & elle a
fon progrès déterminé auquel la baffe même doit
affujettir fa marche. En faifant .dépendre les accords
& les chiffres qui les annoncent des notes
de la baüîe & de leurs différentes marches, on ne
montre que des combinaifons de l’harmonie au
lieu d’en montrer la bafe; on multiplie à l’infini
le petit nombre des accords fondamentaux , &
l’on force , en quelque forte , l’accompagnateur
de perdre de vue à chaque inftant la véritable fuc
ceflion harmonique.
Après avoir fait de très-bonnes ôbfervations
fur la mécanique des doigts dans la pratique de
l’accompagnement, M. Rameau propofe de fubfti-
tuer à nos chiffres d’autres chiffres' beaucoup plus
limples , qui rendent cet accompagnement tout-
â-fait indépendant de la baffe-continue ; de forte
que, fans égard à cette baffe, & même fans la
voir, on accompagneroit fur les chiff es feuls avec -
plus de précifion qu’on ne peut faire par la méthode
établie avec le corfcours de ,1a baffe & des
chiffres.
Les chiffres inventés par M. Rameau indiquent
deux .chofes. i° . L ’harmonie fondamentale dans
les accords parfaits , qui n’ont aucune fucceffiôn
néceffaire , mais qui conffatent toujours le ton.
i ° . La fucceffiôn harmonique déterminée par la
marche régulière des doigts dans les accords diffo-
nans. .
Tout cela fe fait au moyen de fept chiffres
feulement. I. Une lettre de la gamme indique le
to n , la tonique & fon accord : fi l’on paffe d’un
accord parfait à un autre , on change de ton ;
c’eft l’affaire d’une nouvelle lettre. IL Pour paffer
de la tonique à un accord diffonant, M. Rameau
n’admet que fix manières , à chacune defquelles il
affigne un cara&ère particulier, favoir :
1. Un X pour l’accord fenfible : pour la fep-
tième diminuée il fuffit d’ajouter un bémol fous
cet X.
2. Un 2 pour l’accord de fécondé fur la tonique.
I
3. Un 7 peur fon accord de fepdème.
4. Cette abbréviation a), pour fa fixte ajoutée.
ç. Ces deux chiffres f relatifs à cette tonique
pour l’accord qu’il appelle de tierce - quarte, &
qui revient à l’accord de neuvième fur la fécondé
note.
_ 6. Enfin ce chiffre 4 pour l’accord de quarte &
■ quinte fur !a dominante.
III. Un accord diifonant eft-fuivi d’un accord
CH î
parfait ou d’un autre .accord diffotlànt ! dafts }*
premier cas , l’accord s’indique par une lettre-
le fécond fe rapporte à.la mécanique des doigts •
(voyez Doigter?) C ’eft un doigt qui doit defeendre
diatoniquement, ou deux, ou trois. On indique cela
par autant de points l’un fur l’autre qu’il fa„ t
defeendre de doigts. Les doigts qui doivent defeendre
par préférence font indiqués par laimé-
canique ; les diéfes ou bémols qu’ils doivent faire
font connus par le ton ou fubflimés dans les
chiffres aux points correfpondans : ou bien, dans
le chromatique & l’enharmonique , on marque, une
petite ligne inclinée en defeendant ou en montant
depuis le ligne d’une note connue pour
marquer qu’elle doit defeendre ou monter d’un
f-mi ton. Ainfi tout eft prévu, & ce petit nombre
de lignes fuffit pour exprimer toute bonne harmonie
pollible.
On fent bien qu’il faut fuppofer ici que toute
dilïonance fe fauve en defeendant car s’il y en
avoir qui fe dûffent fauver en montant , s’il y
aVoit des marches de doigts amendantes dans des
accords diffonans , lés points de M. Rameau fe-
roient infuffifans pour exprimer cela. -
Quelque fimple que fpit .cette, méthode, quel-
que favorable qu’elle paroifle pour la pratique,
elle n’a point eu de course peut-être a-t-on cru
que les chiffres de M. Rameau ne corrigeoiènt un
defaut que pour en fubftituer un autre : car s’il
Amplifie les fignes , s’il diminue le nombre des
accords, non-feulement ii n’exprime point encore
la véritable harmonie fondamentale ; mais il rend,
de plus, ces fignes tellement dependans les uns
des autres, que fi l’on vient.à. s’égarer ou à fe
difiraire un inftant, à prendre un doigt pour un
autre, on eft perdu fans reffource, les points ne fi-
gnifient plus rien , plus de moyen de fe remettre
jufqu’à un nouvel accord parfait. Mais avec tant
; de raifons de préférence n’a-t il point fallu d’autres
obje&iofls encore pour faire rejetter la méthode
de M. Rameau? Elle étoit nouvelle; elle étoitproposée
par un homme fupérîeur en génie à tous
fes rivaux ; voilà fa condamnation.
( /. J. Rouffedu. )
* Il n’eft pas douteux que fi la mufique moderne
avoit été inventée par un feul homme,
ou au moins dans un même fiècle ,& portée tout
de fuite a 1 état ou elle eft aujourd’h ui, comme
Minerve fonit toute armée de la tête de Jupiter,
on n’y trouveroit pas les défauts, les imperfections,
les contradi&ions qu’on y rencontre fans ceffe ;
& pour ne parler que des chiffres, fi tous les fons
qui peuvent compofer un accord avoient été conçus
à la fois comme devant toujours accompagner
celui qui les engendre, ou dont ils dépendent,
il eft certain que les chiffres, qui ne font que les
fignes repréfentatifs de ces fons , feroient. aufli
fimples, aufti invariables * aufii univerfellement
c H 1
«doDtès mie les accords eux - mêmes. Mais lors
, {’invention de l’harmonie On n’a d abord fait
entendre qu’un fon avec un autre , enfuite deux ;
on les a repréfentés par un , par deux chipes.
Bientôt on a rifqué - des diffonances : elles ont
augmenté le nombre des fons d’un accord , &
les^fignes fe font également multipliés. Les modulations
fe font compliquées : il a fallu modifier en
même tems les chiffres par dès fignes nouveaux.
On a fenti alors la confufion qu’ils répandolent
dans l’exécution muficale, & la néceflité de les
Amplifier. Mais chacun a propofé ceite réforme à
Ta manière, & aucune n’a pu l’emporter fur l’autre.
Il en eft réfulté à-peu-près autant de manières
de chiffrer que de compofiteurs , & ' les^ accompagnateurs
ne pouvant plus s’y. reconnaître, ont
abandonné entière nient les chiffres, & n’ont plus
voulu accompagner que fur les partitions.
Lorfque Rouffeau reproche aux François de
trop multiplier les chiffres, lorfqu’il prétend que
celui qui en emploie le plus fe croit le plus
favant, il pouvoit avoir raifon pour le tems dont
il parloit. U eft à croire cependant que ce n’eft
pas cette vanité puérile qui déterminoit les compofiteurs
, mais l’ufage où l’on étoit alors , en
France, de completter rlgoureufement les accords,
& de faire faire de fréquçns mouvemens à l’har-
monie. Le premier de ces défauts obligeoit d accumuler
chipes fur chiffres, &. le fécond den changer
fouvent.
La méthode propofée par Rameau fuppofoit
de même les accords toujours complets, ou laiffoit
à l’accompagnateur le foin des fupprellions fou-
vent néceffaires. Les obfervations de Rouffeau
lui-même tiennent encore à cette fuppofition.
» L’auteur doit fuppofer, dit-il, que l’acccmpa-
» gnateur fait placer une fixte fur une mediante,
» une fauffe - quinte fur une note fenfible, une
v feptîème fur une dominante , &c. 11 ne doit
»s donc pas chiffrer des accords de cette évidence,
m à moins qu’il ne faille annoncer un changement
» de ton. « — Mais une médiante ne peut-elle
porter qu’une fixte ? Une fenfible n’a-t elle d’autre
accord que la fauffe-quinte? La dominante ne peut-
elle paroître fans une feptîème ? Ce feroif réduire
toute la mufique à la règle de l’oétave.
Mais dans le cas même où ces cordes de la
gamme portent ces accords, doivent-ils toujours
être complets ? Si fur la médiante l’auteur n’a
voulu faire entendre que la tierce ; s’il veut que
la fixte feule accompagne la fenfible ; s’il lui plaît
que la dominante porte l’accord parfait, l’accompagnateur
à qui vous ne donnez aucun indice
pourra t-il deviner l’intention du compofiteur ?
Au refte , toutes ces incertitudes ne viennent
que de s’ être écarté du motif qui a fait inventer
les chiffres. Il fuffit de le rappeller pour faire- 1
connoître la meilleure manière de chiffrer. Elle eft |
C H I
fimple, elle eft claire , ne tient à aucun fyftéme ,
& ne dépend peint, comme la plupart de celles
qui exïftent, de diverfes conventions.
A quoi fervent les chiffes ? Quel but a t-cn
pu avoir en les plaçant fur les notes de la baffe ?
Celui d’exprimer , non pas les accords qtie les
notes peuvent porter, mais les fons qui font véritablement
contenus dans les parties Supérieures.
Lorfque l’accompagnateur n’a fous les yeux que
la baffe & le chant, les chiffres^ Suppléent aux
autres parties qili lui manquent. S il accompagne
fur la partition, elles le difpehfent de lire un grand
nombre de portées à la fois. Telle eft leur feule
destination ; ce ferait à tort qu’on voudrait leur en
chercher une autre,
ObferVons enfuite qu’il y a deux manières d accompagner.
Par la première on fe contente de plaquer
fimplemeht les accords ; avec la fécondé on
exécute de la main droite le chant de la voix
& celui des inftrumens , c’eft-à-dire , les ritournelles
& les traits de rempliffage. Cette fécondé
manière exige une harmonie moins complette,
parce que les notes fucceSîives qtt on fait etitendte
à l’oreille la rempliffent fuffifamment. Cependant
lorfque l’exprefiion l’exige , dans les fore , fur
le premier tems d’une mefiire , on ajoute ord.-
nairement un ou deux fons pour remplir lh a ’ -
monie & qui s’exécutent de la main droite oii c’ e
la main gauche, félon ce qui eft plus commet e
pour le doigter. Les chiffres fervent à exprimer et s
fons i on voit qu’ils ne peuvent pas être nombreux,
puifque tout accord étant au plus Coii-
pofé de quatre notes , & l’accompagnateur en
connoiffant déjà deux , celle du chant & celle de la
baffe , il n’y en a plus qu’une ou deux à lui
indiquer.
Lorfqu’on plaque les accords , comme il arrive
ordinairement lorfque le clavecin eft foutenu de
l’orcheftre, l’accompagnateur do t avoir toujours le
foin de faire la note principale du chant de la
main droite, ( l a gauche eft deftinèe dans tous
les cas à exécuter la baffe ) & fi le compofiteur
a rempli fon harmonie d'un ou de deux fons , ils
font de même indiqués à l ’accompagnateur- par un
ou deux chiffres.
Ainfi lorfque la baffe & le chant font en tierce,
fi les parties fupérieures forment en outre une
quinte avec la baffe , vous chiffre{ d’un 5 : une
barre où un bémol ou tout autre figue deftine a
exprimer un intervalle mineur, indiquent que cette
quinte eft fauffe. Si c’eft une tierce, vous chiffet
d’un S , avec le | le b ou le t) pour indiquer
1-efpèce de cet intervalle , dans le cas où elle
ne feroit pas affez déterminée par le ton.
Un exemple rendra ceci encore plus clair. Je
donne ici la première phrafe de l’air de Didon.,
A h ! que je fus bien ïnfpirée; je fuppofe que l’accompagnateur
n’a fous les yeux que la balie