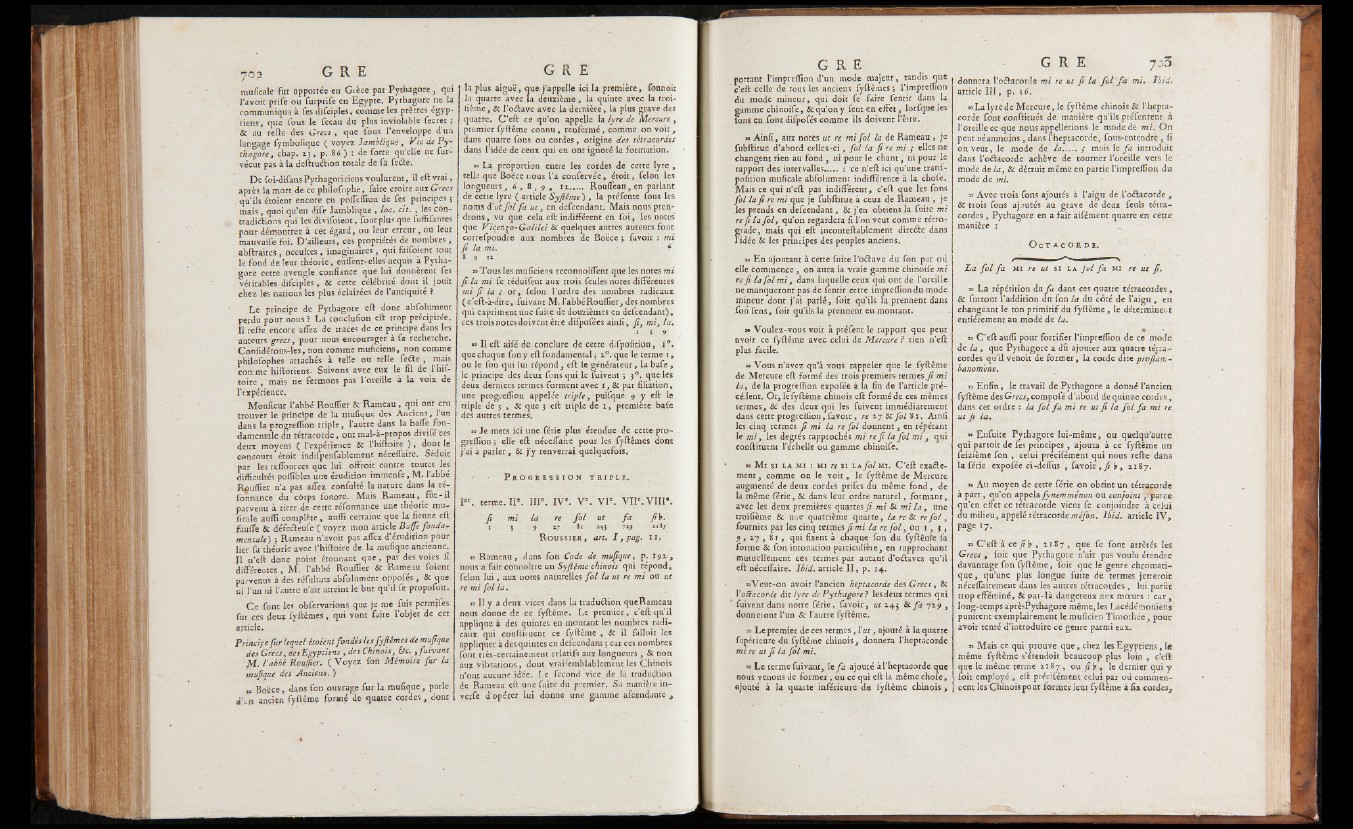
muficale fut apportée en Grèce par Pythagore , qui
l ’avoit prife ou furprife en Egypte. Pythagore ne la
communiqua à fes difciples, comme les prêtres égyptiens,
que fous le fceau du plus inviolable fecret J
& au refte des Grecs , que fous l’enveloppe d un
langage fymboiique ( voyez Jamblique , Vie de Pythagore
, chap. X3, p. 8<>.) : de forte que lle ne fur-
vécut pas à la deftruétion total? de fa feôte.
D e foi-difansPythagoriciens voulurent, il eft v ra i,
après la mort de ce philofophe, faire croire aux Grecs
qu’ils étoient encore en pofleffion de fes principes ,
m a is, quoi qu’en dife Jamblique , loc. cit. , les contradictions
qui les divifoient, font plus que fuffifantes
. pour démontrer à cet égard, ou leur erreur, ou leur
raauvaife foi. D'ailleurs, ces propriétés de nombres,
abftraites, occultes , imaginaires , qui faifoient tout
le fond de leur théorie, euffent-elles acquis à Pytha-
<rore cette aveugle confiance que lui donnèrent fes
véritables difciples, & cette célébrité dont il jouit
chez les nations les plus éclairées de l’antiquité î
L e principe de Pythagore eft donc abfolument
perdu pour nous ? La conclufion eft trop précipitée.
Il refte encore affez de traces de ce principe dans les
auteurs grecs, pour nous encourager à fa recherche.
Confidérons-les, non comme muficiens, non comme
philofophes attachés à telle ou telle fefte , mais
comme hiftoriens. Suivons avec eux le fil de l’hif-
toire , mais ne fermons pas l ’oreille à la voix de j
l’expérience.
Monfieur l’abbé Rouflier & Rameau, qui ont cru
trouver le principe de la mufique des Anciens, 1 Un
dans la progreflion triple, l’autre dans la balle fondamentale
Ju titracorde, ont mal-à-propos divifé "Ces
deux moyens ( l’expérience & l’hiftoire ) , dont le
concours étoit indifpenfablement néceflaire. Séduit
par les relfources que lui offroit contre toutes les
difficultés pollibles une érudition immenfe, M. l’abbé
Rguffier n’a pas alTez confulté la nature dans la ré-
fonnance du côrps fonore. Mais Rameau, fu t - i l
parvenu à tirer de cette réfonnance une théorie muficale
aüffi complète, auffi certaine que la fienne eft
faufle & défeéteufe (vo y e z monarticle Baffe fondamentale)
j Rameau n’avoit pas allez d’érudition pour
lier fa théorie avec l’hiftoire de la mufique ancienne.
J1 n’eft donc point étonnant q u e , par des voies fi
différentes , 'M . l’abbé Rouflier & Rameau foient
parvenus à des réfultats abfolument oppofés, & que
pi l’un ni l’autre n’ait atteint le but qu’il fe propofoit.
C e font les obfervations que je me fuis permifes
fur ces deux fyftêmes, qui vont faire l’objet de cet
article.
Principe fur lequel étoient fondés lesfyftêmes de mufique
des Grecs, des Egyptiens, des Chinois, &c. 3 fuivant
M. l ’abbé Roufter. ( V o y e z fon Mémoire fur la
mufique des Anciens. )
éc Bo$ce, dans fon ouvrage fur la mufique, parle
d’ tiîi ancien fyftême formé de quatre cordes, donc
la plus aiguë, que Rappelle ici la première, fonnoit
la quarte avec la deuxième , la quinte avec la troi-
lième, & l’o â a v e avec la dernière, la plus grave des
quatre. C ’eft ce qu’on appelle la lyre de Mercure ,•
premier fyftême connu, renfermé, comme on v o it ,
dans quatre fons ou cordes, origine des tétracordes
dans l’idée de ceux qui en ont ignoré la formation.
» La proportion entre les cordes de cette lyre ,
telle que Boëce nous l’a confervée, é to it, félon les
longueurs, 6 > 8 , 9 , i l ...... Rouffeau, en parlant
de cette lyre ( article Syfilme ) , la ptéfente fous les
noms à’u t fo l fa ut, en defeendant. Mais nous prendrons
, vu que cela eft indifférent en f o i . les notes’
que Vicenjro-Galilei & quelques autres auteurs font
correfpondre aux nombres de Boëce j favoir : mi
f i la mi. 6
8 9 i r
» T o u s les muficiens reconnoiffent que les notes mi
f i la mi fe réduifent aux trois feules notes différentes
mi f i la j, o r , félon l'ordre des nombres radicaux
( c ’eft-à-dire, fuivant M. l’abbé Rouflier, des nombres
qui expriment une fuite de douzièmes en defeendant),
ces trois notes doivent être difpofées ainfi, fi3 mi3 la,
1 3- 9
» Il eft aifé de conclure de cette difpofition, i®.
que chaque fon y .eft fondamental j x°. que le terme 1 ,
ou le fon qui lui répond , eft le générateur, la bafe ,
le principe des deux fons qui le fuivent.j 30. queltfs
deux derniers termes forment avec 1 , & par filiation,
une progreflion appelée triple, puifque 9 y eft le
triple de 3 , & que 3 eft triple de 1 , première bafe
des autres termes.
» Je mets ici une férié plus étendue de cette progreflion
, elle eft néceflaire pour les fyftêmes dont
j ’ai à parler, & j’y renverrai quelquefois.
P r o g r e s s i o n t r i p l e .
Ier. terme. I Ie. I IIe. I V e. V e. V I e. V I I e. V I I I * .
f i mi la re fo l ut fa fi\>.
1 3 9 *7 81 14.3 7x9 118/
R oussier, a r t. I , pag. 1 1 .
» Rameau, dans fon Code de mufique, p. I9X ,
nous a fait connoître un Syfilme chinois qui répond,
félon lu i , aux notes naturelles fo l la ut re mi ou ut
re mi fo l la.
m II y a deux vices dans la tradu&ion queRameau
nous donne de ce fyftême. Le premier, c’eft qu’il
applique à des quintes en montant les nombres radicaux
qui conflit uent ce fyftême , & il falloir les
appliquer à des quintes en delcendant 3 car ces nombres
font très-certainement relatifs aux longueurs , & non
aux vibrations, dont vraifemblablement les Chinois
n’ont aucune idée. Le fécond vice de la traduction
de Rameau eft une fuite du premier. Sa manière in-
verfe d’opérer lui donne une gamme amendante a
G R E
portant l’impreflion d’un mode majeur, tandis que
c’eft celle de tous les anciens fyftêmes, l’impreflion
du mode mineur, qui doit fe faire fentir dans la
gamme chinoife, & qu’on y fent en e f fe t, lorfque les
Ions en font difpofés comme ils doivent l’être.
» A in fi, aux notes ut re mi fo l la de Rameau , je
fubftitue d’abord ce lles -ci, fo l la f i re mi y elles ne
changent rien au fon d , ni pour le ch ant, ni pour le
rapport des intervalles...... : ce n’eft ici qu’une tranlpofition
muficale abfolument indifférente à la choie.
Mais ce qui n’eft pas indifférent, c’eft que les fons
fo l la f i re mi que je fubftitue à ceux de Rameau , je
les prends en defeendant, & j’en obtiens la fuite mi
re f i la fo l, qu’on regardera fi l’on veut comme rétrograde,
mais qui eft inconteftablement dire&e dans
l’idée & les principes des peuples anciens.
» En ajoutant à cette fuite l ’oétave du fon par où
elle commence , on aura la vraie gamme chinoife mi
re f i la fo l mi9 dans laquelle ceux qui ont de l’oreille
ne manqueront pas de lentir cette impreflïondu mode
mineur dont j’ai parlé, foit qu’ils la prennent dans
fon féns, foit qu’ils la prennent en montant.
>• Voulez-vous voir à préfent le rapport que peut
avoir ce fyftême avec celui de Mercure ? rien n’eft
plus facile.
» Vous n’avez qü’à vous rappeler que le fyftême
de Mercure eft formé des trois premiers termes.y? mi
la , de la progreflion expofée à la fin de l’article précédent.
Or, le fyftême chinois eft formé de ces mêmes
termes, & des deux qui les fuivent immédiatement
dans cette progreflion, favoir, re X7 & fo l 81. Ainfi
les cinq termes f i mi la re fo l donnent, en répétant
le mi y les degrés rapprochés mi re f i la fo l mi, qui
conftituent l’echelle ou gamme chinoife.
» Mi si la m i : m i re si la fo l m i . C ’eft exade-
ment, comme on le v o it, le fyftême de Mercure
augmenté de deux cordes prifes du même fond, de
la même fêrie, & dans leur ordre naturel, formant,
avec les deux premières quartes f i mi & mi la , une
troifième & une quatrième quarte, la re & re f o l ,
fournies par les cinq termes f i mi la re f o l , ou 1 , 3 ,
9 , X7, 8 1 , qui fixent à chaque fon du fyftênîe fa
forme & fon intonation particulière, en rapprochant
mutuellement ces termes par autant d’o&aves qu’il
eft néceflaire. Ibid, article I I , p. 14.
»Veut-on avoir l’ancien heptacorde des Grecs, &
1 ' oStacorde dit lyre de Pythagore? les deux termes qui
fuivent dans notre fé r ié , favoir , ut X43 8c fa 7x9 ,
donneront l’un & l’autre fyftême.
» L e premier de ces termes, Y ut, ajouté à la quarte
fupérieure du fyftême chinois , donnera l’heptacorde
mi re ut f i la fo l mi.
» Le terme fuivant, Je fa ajouté à l ’heptacorde que
nous venons de forme r, ou ce qui eft la même chofe,
ajouté à la quarte inférieure du fyftême ch in o is,
donnera l’o&acorde mi re ut f i la fo l fa mi. Ibid,
article I I I , p. 16.
» L a lyre de Mercure, le fyftême chinois & l’heptacorde
font conftitués de manière qu’ils préfentent à
l’oreille ce que nous appellerions le mode de mi. On
peut néanmoins , dans l’heptacorde, fous-entendre, fi
on veut, le mode de la.......y mais le fa introduit
dans l’oétacorde achève de tourner l’oreille vers le
mode de lat 8c détruit même en partie l’imprelfion du
mode de mi.
» Avec trois fons ajoutés à l ’aigu de l’o&acorde ,
& trois fons ajoutés au grave de deux feuls tétracordes
, Pythagore en a fait aifément quatre en cette
manière :
O c T A C O R D E .
La fo l fa mi re ut s i la Jol fa mi re ut fi.
» La répétition du fa dans ces quatre tétracordes ,
& furtout l’addition du fon la du côté de l’aigu , en
changeant le ton primitif du fyftême, le déterminent
entièrement au mode de la.
» C ’eft auffi pour fortifier l’impreffion de ce mode
de la y que Pythagore a dû ajouter aux quatre tétracordes
qu’il venoit de former, la corde dite profiam-
banoméne.
» E nfin, le travail de Pythagore a donné l’ancien
fyftême des Grecs, compofé d ’abord de quinze cordes,
dans cet ordre : la fo l fa mi re ut f i la fo l fa mi re
ut f i la.
» Enfuite Pythagore lui-même, ou quelqu’autre
qui partoit de fes principes , ajouta à ce fyftême un
leizième fon , celui précifément qui nous refte dans
la férié expofée ci-deflus , favoir f f i b , X187.
» Au moyen de cette férié on obtint un tétracorde
a p a rt , qu’on appela fynemménon ou conjoint / ’parce
qu’en effet ce tétracorde vient fe conjoindre à celui
du milieu, appelé tétracorde méfon. Ibid, article IV ,
page 17.
» C ’eft à ce fi b , x i 87 , que fe font arrêtés les
Grecs , foit que Pythagore n’ait pas Voulu écendre
davantage fon fyftême, foit que le genre chromatique
, qu’une plus longue fuite de termes jetteroit
néceflairement dans les autres tétracordes , lui parût
trop efféminé, & par-là dangereux aux moeurs : c a r ,
long-temps aprèsPythagore même, les Lacédémoniens
punirent exemplairement le muficien T imothée , pour
avoir tenté d’introduire ce genre parmi eux.
» Mais ce qui prouve qu e , chez les E gyptiens, le
même fyftême s’étendoit beaucoup plus lo in , c’eft
que le même ternie X187 , ou fi l>, le dernier qui y
loit employé , eft précifément celui par où commencent
les Chinois pour former leur fyftême à fix cordes,