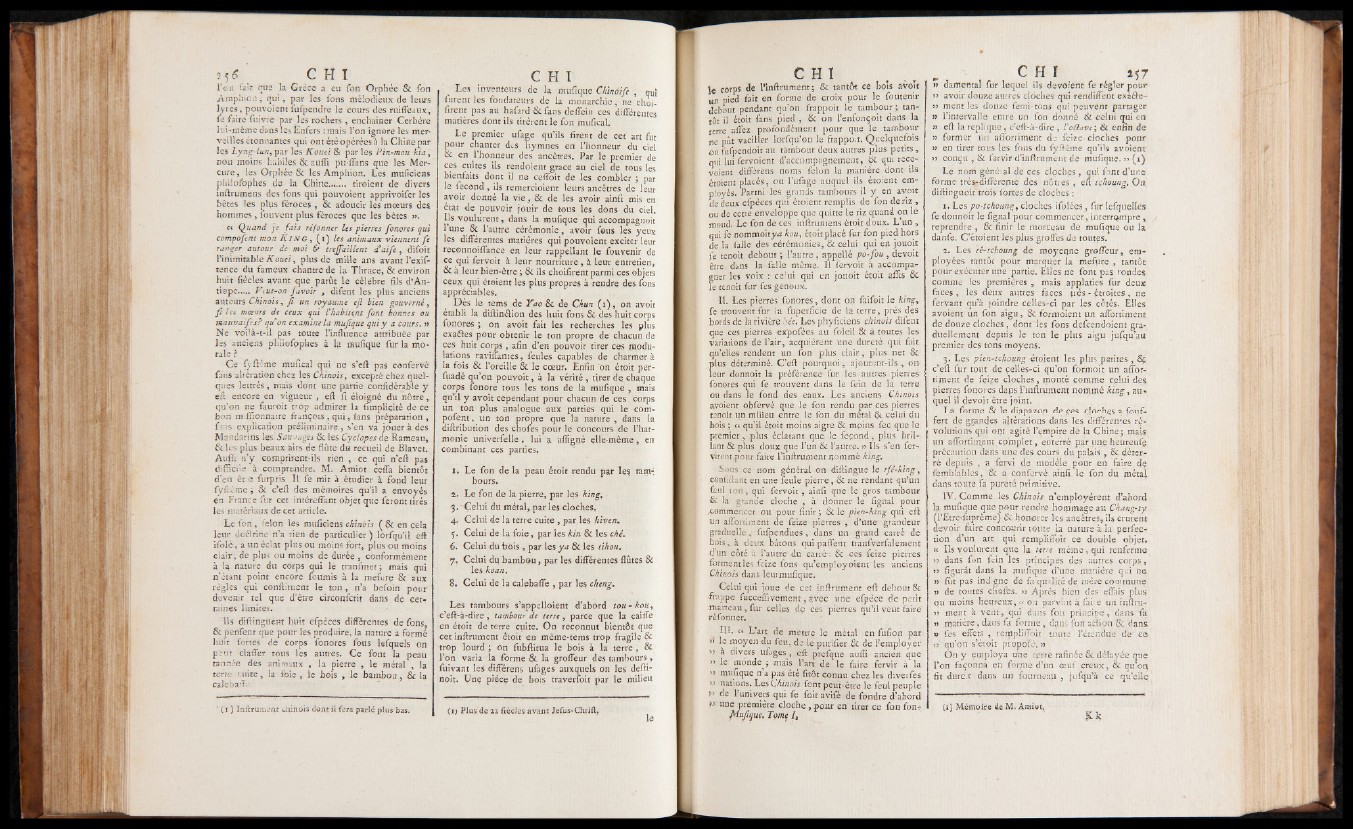
l’en Tait que la Grèce a eu Ton Orphée & fon
Amphion, q ui, par les fons mélodieux de leurs
ly res, pouvoient fufpendre le cours des ruifleaux,
fe faire fuivre par les rochers , enchaîner Cerbère
lui-même dans les Enfers :mais l’on ignore les merveilles
étonnantes qui ont été opérées à la Chine par
les Lyng-lun, par les Kouei & par les Pin^mou kia,
non moins habiles {k aufli puiffans que les Mercure,
les Orphée & les Amphion. Les muficiens
philofophes de la Chine....... tiroient de divers
inftrumens des fons qui pouvoient apprivoifer les
bêtes les plus féroces , Bc adoucir les moeurs des
fiommes, iouvent plus féroces que les bêtes ».
a Quand je fais réfonner les pierres fonores qui
composent mon K i n g , ( i ) les animaux viennent fe
ranger autour de moi 6» treffaillent d'aife, difoit
l’inimitable Kouei, plus de mille ans ayant l ’exif-
tence du fameux chantre de la Thrace, & environ
huit fiècles avant que parût le célèbre fils d’Antiope
Veutron Javoir , difent les plus anciens
auteurs Chinois, f i un royaume efl bien gouverne,
f i les moeurs de ceux qui L’habitent font bonnes ou
mauvaifes? quon examine la mufique qui y a cours. »
Ne voilà-t-il pas toute l’influence attribuée par
les anciens phiiofpphes à la mufique fur la morale
?
Ce fyfléme mufical qui ne s’efl pas confervé
fans altération chez les Chinois, excepté chez quelques
lettrés, mais dont une partie confidérable y
efl encore en vigueur , efl fi éloigné du nôtre
qu’on ne fauroit trop admirer la fimpliçité de ce
bon millionnaire françois , qui, fans préparation ,
fans explication préliminaire , s’en va jouer à des
Mandarins les Sauvages & les Cyclopes de Rameau,
& lc s plus beaux airs de flûte du recueil de Blavet.
Aufli n’y comprirent-ils rien , ce qui n’efl pas
difficile à comprendre. M. Amiot cefla bientôt
d’en être furpris II fe mit à étudier à fond leur
fyflème ; & c’efl des mémoires qu’il a envoyés
en France fur cet intéreflant objet que feront tirés
les matériaux de cet article.
Le fon, félon les muficiens chinois f & en cela
leur doélrine n’a rien de particulier) lorfqu’il efl
ifolé, a un éclat plus ou moins fort, plus ou moins
clair, de plus ou moins de durée , conformément
à la nature du corps qui le tranfmet; mais qui
n’étant point encore fournis à la mefure & aux
règles qui conflituent le ton , n’a befoin pour
devenir tel que d’être circonfcrit dans de certaines
limites.
Ils diflinguent huit efpèces différentes de fons.
& penfent que pour les produire, la nature a forme
huit fortes de corps fonores fous lefquels on
peut claffer tous les autres. Ce font la peau
tannée des animaux , la pierre , le métal , la
terre cuite, la foie , le bois , le bambou, & la
cale baffe.
C H I
Les inventeurs de la mufique Chinoife , qui
furent les fondateurs de la monarchie, ne choi-
firent pas au hafard & fans deflein ces différentes
matières dont ils tirèrent le fon mufical.
Le premier ufaee qu’ils firent de cet art fut
pour chanter des hymnes en l’honneur du ciel
& en l’honneur des ancêtres. Par le premier de
ces cultes ils rendoient grâce au ciel de tous les
bienfaits dont il ne cefloit de les combler ; par
le fécond, ils remercioient leurs ancêtres de leur
avoir donné la v ie , & de les avoir ainfi mis en
état de pouvoir jouir de tous les dons du ciel.
Ils voulurent, dans la mufique qui accompagnoit
l’une & l’autre cérémonie, avoir fous les yeux
les différentes matières qui pouvoient exciter leur
reconnoiffance en leur rappellant le fouvenir de
ce qui fervoit à leur nourriture, à leur entretien,
& à leur bien-être ; & ils choifirent parmi ces objets
ceux qui étoient les plus propres à rendre des fons
appréciables.
Dès le tems de Yao & de Chun ( i ) , on avoit
établi la diflinélion des huit fons 8c des huit corps
fonores ; on avoit fait les recherches les plus
exaéles pour obtenir le ton propre de chacun de
ces huit corps, afin d’en pouvoir tirer ces modulations
ravinantes, feules capables de charmer à
la fois & l’oreille & le coeur. Enfin on étoit per-
fuadé qu’on pouvoit, à la vérité , tirer de chaque
corps honore tous les tons de la mufique , mais
qn’il y avoit cependant pour chacun de ces corps
un ton plus analogue aux parties qui le eom-
pofent, un ton propre que la nature , dans la
diftribution des chofes pour le concours de l’harmonie
univerfelle, lui a afligné çlle-même, en
combinant ces parties,
1. Le fon de la peau étolt rendu par lç$ tanv*
bours.
2. Le fon de la pierre, par lqs king,
3. -Çelui du métal, par les cloches,
4. Celui de la terre cuite , par. les hiyen.
5. Celui de la fo ie , par les kin & les ché.
6. Celui du bois , par les y a & les tihou.
7. Celui du bambou, par les différentes flûtes &
les koan.
8. Celui de la calebafle , par lç$ cheng.
Les tambours s’appelloient d’abord tou-kou,
c’efl-à-dire, tambour de terre, parce que la caiffe
en étoit de terre cuite. On reconnut bientôt que
cet infiniment étoit en même-tems trop fragile fk
trop lourd ; on fubflitua le bois à la terre, &
l’on varia la forme &. la grofleur des tambours,
fuivant les différens ufages auxquels on les deffi-
noit. Une pièce de bois traverloit par le milieu
(ï ) Infiniment chinois dont il fera parlé plus bas. (i) Plus de 22 fiècles avant Jefus-Chrift,
le
le corps de l’inftrument; & tantôt ce bols avoït
un pied fait en forme de croix pour le foutenir
debout pendant qu’on frappoit le tambour ; tantôt
il étoit fans pied , & on l’enfonçoit dans la
terre affez profondément pour que le tambour
ne pût vaciller lorfqu’on le frappoit. Quelquefois
on fufpendoit au tambour deux autres plus petits,
qui lui fervoient d’accompagnement, & qui rece-
voient différens noms félon la manière dont ils
étoient placés, ou l ’ufage auquel ils étoient employés.
Parmi les grands tambours il y en avoit
de deux efpèces qui étoient remplis de fon de riz ,
ou de cette enveloppe que quitte le riz quand on le
moud. Le fon de ces inflrumens étoit doux. L’un ,
qui fe nommoitytf kou, étoit placé fur fon pied hors
de la falle des cérémonies, & celui qui en jouoit
fe tenoit debout ; l’autre , appellé po-fou , devoit
être dans la falle même. Il fervoit à accompar
grier les voix : celui qui en jouoit étoit aflis &
le tenoit fur fes genoux.
II. Les pierres fonores, dont on faifoit le king,
fe trouvent fur la fuperficie de la terre, près des
bords de la rivière Les phyficiens chinois difent
que ces pierres expofées au foleil & à toutes les
variations de l ’air, acquièrent une dureté qui fait
qu’elles rendent un fon plus clair., plus net &
plus déterminé. C ’efl pourquoi, ajoutent-ils , on
leur donnoit la préférence fur les autres pierres :
fonores qui fe trouvent dans le fein de la ferre
ou dans le fond des eaux. Les anciens Chinois
^voient obfervé que le fon rendu par ces pierres
tenoit un milieu entre le fon du métal celui' du
bois ; « qu’il étoit moins aigre & moins fec que le
premier, .plus éclatant que le feçond, plus brillant
& plus doux que l’un & l’autre. » Ils s’en fer-
yirent,pour faire l’inflrunient nommé king.
Sous ce-nom général on diftirïgue le tfé-king,
confiflant en une feule pierre, & ne rendant qu?un
feul ton, qui fervoit, ainfi que le gros tambour
& la grande cloche , à donner le fignal pour
^commencer ou pour finir ; 8c le pien-king qui efl
Bp affortiment de feize pierres , d’une grandeur
graduelle, fufpendues, dans un grand carré de
bois, à deux bâtons qui paffent tranfverfalement
d’un côté à l’autre' du carré-; & ces feize pierres
forment les feize fons qu’employoient les anciens
Chinois dans leurmufique.
Celui qui joue de cet infiniment efl debout &
•frappe fuccefiivement, avec une efpèce de petit
marteau, fur celles dp ces pierres qu’il veut faire
réfonner.
III. c< L’art de mettre le métal en fufion par
» le moyen du feu, de le purifier & de Remployer
” a divers ufages , efl prefque aufli ancien que
»J le inonde^ ; mais l’art de le faire fervir à la
s* mufique nja pas été fitôt connu chez les diverfes
93 nations, hes Chinois font peut-être le feul peuple
»3 de 1 univers qui fe foit avifé de fondre d’abord
P une première cloche , pour en tirer ce fon fon-?
fiufique. Tome
C H I î 57
» damental fur lequel ils dévoient fe régler pour
35 avoir douze autres cloches qui rendiffent exaéle-
33 ment les douze femi-tons qui peuvent partager
» l’intervalle entre un fon donné & celui qui en
» efl la répliqué, c’efl-à-dire, l'oHave ; & enfin de
» former un affortiment ds feize cloches pour
» en tirer tous les fons du fyflême qu’ils avoienc
33 conçu , & fervif d’inflrument de mufique. >> ( t )
Le nom général de ces cloches, qui font d’une
forme très/rdifférente des nôtres , efl tçhoung. On
diftinguoit trois fortes de cloches :
1. Les po-tchoung, cloches ifolées, fur lefquelles
fe donnoit le fignal pour commencer, interrompre,
reprendre , & finir le morceau de mufique ou la
danfe. C ’étoient les plus groffes de toutes.
2. Les eé-tchoung de moyenne grofleur, employées
tantôt pour marquer la mefure , tantôt
pour exécuter une partie. Elles ne font pas rondes
comme les premières , mais applaties fur deux
faces , les deux autres faces très - étroites , ne
fervant qu’à joindre celles-ci par les côtés. Elles
avoient un fon aigu, & fbrmoient un affortiment
de douze cloches, dont des fons defeendoient graduellement
depuis le ton le plus aigu jufqu’au
premier des tons moyens.
3. Les pien-tchottng étoient les plus petites, Sç
c’efl fpr tout de celles-ci qu’on formoit un affortiment
de feize cloches, monté comme c.elui des
pierres fonores daps l ’inffrument nommé king, auquel
il deyoit être joint.
La forme & le digpazop de ,çes cloches a fouff
fert de grandes altérations dans les différences révolutions
qui ont agité l’empire de la Chine; mais
un affortiment complet, enterré par unç heureufç
précaution dans une des cours du palais , & déterré
depuis , a fervi de modèle pour en faire dç
femblables, & a confervé ainfi le fon du métal
dans toute fa pureté primitive.
IV. Comme les Chinois n’employèrent d’abord
la mufique que pour rendre hommage au Çhang-ty
(l’Etre-fiiprême) & honorer les ancêtres, ils crurent
devoir faire concourir toute la nature à la perfec?
tion d’un art qui rempliffoir ce double objet.
« Ils voulurent que la terre même, qui renferme
3? dans fon fein les principes des autres corps,
33 figurât dans la mufique d’une manière qui ne
» fut pas incTgne de fa qualité de mère commune
» de toutes choffes. 33 Après bien des effais plus
ou moins heureux, et o.n parvint à fane un inflru-
33 ment à vent, qui dans fon principe, dans la
33 matière, dans fa form ed gn s fon aéiipn dans
» fes effets , rempliffoit toute l’étendue de' ce
3s' qu’on s’étoit propofé. »
On y employa une terre rafinée & délayée que
l’on façonna eh forme d’un oeuf creux, & qu’on
fit durcir dans un fourneau , jufqu’à ce qu’elle 1
(1) Mémoire de M. Amioq